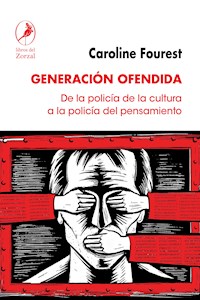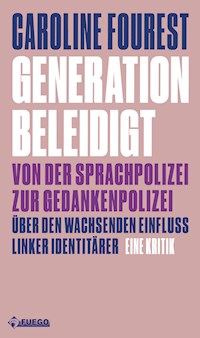Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luc Pire
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Lorsque la première édition de Fichu voile est parue en 2011, la question du voile se posait déjà sur le terrain scolaire, mais également dans la fonction publique et au parlement. La loi d’interdiction du voile intégral était alors en gestation. Dix ans plus tard, les mêmes questions restent en suspens, mais d’autres s’y sont ajoutées : le voilement des fillettes se répand, les tenues de sport à connotation religieuse se multiplient, et l’idée selon laquelle interdire le voile serait une discrimination se banalise, comme en témoigne l’autorisation récente du port du voile dans les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parallèlement, tout critique du voile semble devenir de plus en plus difficile, voire dangereuse à formuler. La banalisation de celui-ci est à l’œuvre, alors même que se radicalisent les discours et les actes de ceux qui le défendent. La banalisation du voile est à l’œuvre, alors même que se radicalisent les discours et les actes de ceux qui le défendent. Et cette banalisation se fait au prix des principes universalistes, à la fois antiracistes, féministes et laïques, qui sont chaque jour un peu plus sacrifiés sur l’autel d’idéologies alliées, conscientes ou non, d’un islam totalitaire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IV Le voile dans la fonction publique
Quittons à présent le monde de l’école pour entrer dans celui de la fonction publique. Ces dernières années, en effet, les mises en cause de l’obligation de neutralité des fonctionnaires publics se sont multipliées ; plus exactement, l’idée selon laquelle la neutralité de ceux-ci impliquait nécessairement qu’ils ne portent pas de signes convictionnels a été battue en brèche par les défenseurs d’une neutralité exclusivement « de service65 ».
Pourtant, comme le rappelle le service public indépendant de lutte contre la discrimination Unia, le Conseil d’État reconnaît que « la neutralité des pouvoirs publics est un principe constitutionnel qui, s’il n’est pas inscrit comme tel dans la Constitution, est cependant intimement lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe d’égalité des usagers du service public en particulier. Dans un État de droit démocratique, l’autorité se doit d’être neutre, parce qu’elle est l’autorité de et pour tous les citoyens et qu’elle doit, en principe, les traiter de manière égale sans discrimination basée sur leur religion, leur conviction ou leur préférence pour une communauté ou un parti. Pour ce motif, on peut dès lors attendre des agents des pouvoirs publics que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils observent strictement eux aussi, à l’égard des citoyens, les principes de neutralité et d’égalité des usagers. »
L’impératif de neutralité du service public « constitue donc un motif légitime de restriction de la liberté religieuse66 ».
Neutralité inclusive ou exclusive
Pourtant, bien que peu de gens contestent qu’un fonctionnaire doive observer un devoir de neutralité dans l’exercice de ses fonctions, sitôt que l’on tente de donner corps à cette nécessaire neutralité, deux conceptions de celle-ci s’affrontent.
Selon certains, en effet, seule compte la neutralité du service rendu, et l’apparence des fonctionnaires ne devrait donc pas entrer en ligne de compte. En conséquence, l’État témoignerait à suffisance de son impartialité s’il considérait avec la même bienveillance les convictions philosophiques et religieuses des uns et des autres, ces dernières ne pouvant constituer ni un avantage ni un handicap pour celui qui s’en revendique. Ainsi, la neutralité serait atteinte dès lors qu’on aurait rassemblé, à l’école par exemple, un professeur de chacune des religions reconnues. Sur le même modèle, dans les administrations publiques, la coexistence d’employé(e)s portant les uns une kippa, les autres un crucifix apparent, les troisièmes un voile et les derniers, pourquoi pas, un t-shirt proclamant leur athéisme, suffirait à réaliser une neutralité « en acte ». Et l’on pourrait de même imaginer qu’au lieu du seul crucifix, soient suspendus désormais côte à côte, dans les administrations communales, un crucifix, un croissant, une étoile de David, un flambeau laïque, etc.
Bien que cette « neutralité inclusive » puisse paraître une formule séduisante, elle fait l’impasse sur une donnée importante. En effet, le nombre de musulmanes voilées est sans conteste bien plus élevé, particulièrement dans certaines villes, que le nombre, même cumulé, de juifs portant une kippa hors de la synagogue, de catholiques exhibant un crucifix, de sikhs coiffés d’un turban et d’athées brandissant leur incroyance. Autrement dit, une administration communale mettant en scène, au quotidien, un panel d’employés représentatifs de chaque tendance convictionnelle est une pure vue de l’esprit. À moins évidemment que la propagation du voile islamique partout ne pousse bientôt les autres croyants ainsi que les athées à afficher eux aussi ostensiblement leurs convictions, dans une sorte de ferveur militante généralisée…
Qui plus est, cette neutralité, à mon sens, ressort plus du pluralisme que de la laïcité, laquelle implique l’existence d’une sphère étatique neutre, certes, mais non pas seulement en ce qu’elle ne privilégierait aucune conviction. La neutralité, dans sa version laïque, va un pas plus loin que cette simple posture d’abstention de l’État : elle implique une mise à distance et demande à chacun, dans la sphère institutionnelle, de se présenter non pas en tant que simple citoyen, mais en tant que détenteur d’une parcelle de l’autorité publique, et soumis en tant que tel à une stricte neutralité, y compris d’apparence. Et le fait de voir dans cette exigence une forme de racisme larvé dénote d’une singulière confusion dans l’analyse, car les signes religieux ou politiques ne peuvent sans mauvaise foi être comparés à notre sexe ou notre couleur de peau, que nous n’avons pas choisis et qui ne disent rien de ce que nous pensons. Dès lors que nous choisissons de les porter, il est inévitable qu’ils disent quelque chose de nous.
Et c’est bien pour cette raison qu’il est souhaitable que nous mettions nos convictions en veilleuse dès lors que nous agissons en tant que membres du corps médical, enseignants ou assesseurs, par exemple, car la neutralité du service doit alors primer sur l’expression de nos convictions personnelles.
Cette neutralité d’apparence doit naturellement s’accompagner d’une neutralité dans le service rendu. Cela nous ferait une belle jambe, en effet, qu’un employé communal apparaisse comme neutre s’il se départait de sa neutralité pour tenir des propos malveillants vis-à-vis d’un couple homosexuel qui viendrait accomplir des démarches en vue de son mariage, ou qu’une infirmière s’abstienne du port de tout signe d’appartenance religieuse sans conserver une attitude de bienveillante neutralité face à une jeune fille enceinte qui viendrait s’informer sur les possibilités d’interruption de grossesse.
Il n’empêche que prétendre que la neutralité ne peut s’appliquer qu’au service rendu, et non à l’apparence, me paraît négliger le fait que toute relation commence par une prise de contact visuelle, laquelle risque, si le fonctionnaire n’apparaît pas comme neutre, de décourager l’usager d’aller plus loin dans la relation qu’il doit nécessairement nouer avec son vis-à-vis pour en obtenir un service. Il importe, autrement dit, non seulement que l’usager soit traité de manière neutre, mais que tout dans l’attitude de celui qui l’accueille le rassure d’emblée sur le fait qu’il sera accueilli et traité de manière neutre.
Un cas particulier : le voile de l’enseignante
Les textes définissant la neutralité des enseignants de l’enseignement officiel sont sans équivoque. Selon les décrets de 1994 et de 2003 définissant respectivement la neutralité de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné, l’enseignant « s’abstient, devant les élèves, de toute attitude et de tout propos partisan dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique. De même, il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique quel qu’il soit67. »
La jurisprudence a de ce fait confirmé, ces dernières années, que l’impératif de neutralité des enseignants impliquait qu’ils renoncent à tout affichage de signes convictionnels… à l’exception notable des professeurs de religion. C’est ainsi que les enseignantes de religion islamique sont autorisées à porter le voile, comme leurs collègues d’autres cours dits « philosophiques » peuvent arborer leur kippa, leur crucifix ou leur flambeau laïque.
Si cette exception paraît tout à fait justifiable par le fait qu’il serait absurde de demander à des enseignants de religion d’être neutres – ils ne le sont pas et n’ont pas à l’être, en tout cas en ce qui concerne les convictions religieuses68 –, elle n’en risque pas moins de mener à quelques apories, et notamment à des enseignantes dûment voilées enseignant à leurs élèves que le voile est une obligation religieuse pour elles… alors que le règlement scolaire leur en interdit le port.
Ne serait-il pas beaucoup plus cohérent, et plus conforme à la laïcité de l’État, de poursuivre dans la voie déjà amorcée ces dernières années, et de remplacer totalement les cours de religion et de morale par un cours commun à tous les élèves, où les religions seraient enseignées en tant qu’éléments de culture, par des enseignants qui seraient naturellement tous soumis aux mêmes obligations en matière de neutralité ? Une neutralité qui n’empêcherait aucun enseignant d’avoir des convictions personnelles, qu’elles soient religieuses ou autres, mais qui les obligerait tous à une certaine retenue dans l’expression de leurs convictions devant les élèves. Et donc à ne pas porter de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignants.
Il est à craindre cependant que la récente décision de WBE d’autoriser le port de signes convictionnels aux étudiants des hautes écoles pédagogiques fasse naître une nouvelle revendication en la matière. Les écoles disposeront en effet d’ici peu d’un réservoir de jeunes enseignantes diplômées, dûment formées à la neutralité, mais voilées. Et il serait étonnant qu’elles se plient sans sourciller à l’obligation d’ôter leur voile pour enseigner, dès lors qu’on les aura autorisées à le garder pendant leurs études, au nom de la liberté de culte et du fait que « l’enseignement et l’emploi sont les principaux vecteurs d’émancipation dans notre société », comme l’a rappelé à l’occasion de cette modification réglementaire Mustapha Chaïri, président du Collectif contre l’islamophobie en Belgique (CCIB) .
65 Je ne citerai ici, pour mémoire, que la modification du règlement de travail de la commune de Molenbeek-Saint-Jean à la rentrée 2020, afin de le rendre plus « inclusif » par l’autorisation du voile.
66 « Neutralité de l'état » par l’Outil en ligne pour un environnement de travail diversifié et inclusif, https://www.ediv.be/theme/unia2019/library.php?id=14.
67 Je n’ai repris ici que les parties communes aux deux décrets, dont le contenu diffère par ailleurs légèrement. On trouvera une comparaison des deux textes ici : http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000001/1186_20050218162007.pdf.
68 En matière politique, ils sont en revanche soumis à la même obligation de neutralité que leurs collègues de cours « généraux ».
III Le voile dans l’enseignement supérieur
La loi française de 2004 ne vaut que pour l’enseignement public obligatoire, pas pour les universités et écoles supérieures. Seul le prosélytisme est interdit, et le port de certaines tenues peut être prohibé lors de certaines activités, notamment sportives par exemple. Mais l’interdit reste l’exception : les étudiants sont traités comme des usagers d’un service public qui, seul, est astreint à la laïcité.
Il y est également rappelé la recommandation émise par le Haut Conseil à l’Intégration (HCI) en 2013, non suivie d’effet à ce jour : « Le rapport du Haut Conseil à l’intégration a préconisé l’interdiction de signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements publics d’enseignement supérieur, dans les espaces dédiés à l’enseignement et à la recherche (mais pas dans les lieux dédiés à la vie étudiante), afin de préserver “la liberté d’expression, l’autorité du professeur et la transmission du savoir dans un cadre serein”. »
Notons cependant qu’en ce qui concerne les futurs enseignants, ce sont les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) qui se chargent de leur formation professionnelle, ainsi que de celle des enseignants stagiaires et des enseignants en formation continue. Et que ceux qui les fréquentent « sont devenus des fonctionnaires stagiaires et, à ce titre, sont soumis à une obligation de neutralité (religieuse et politique), qu’ils soient dans la position d’enseignant ou d’étudiant56 ».
Après ce bref détour par la France, revenons en Belgique, où la situation est assez similaire, puisque les signes convictionnels sont généralement admis dans l’enseignement supérieur. Toutefois, cette autorisation ne repose sur aucune règle générale que les établissements seraient tenus d’appliquer. Et certaines hautes écoles interdisent donc à leurs étudiants le port de signes convictionnels, notamment dans les filières formant de futurs enseignants, éducateurs spécialisés, professionnels de la santé ou assistants sociaux.
C’est ce qui a amené plusieurs étudiantes de confession musulmane à porter plainte contre la Haute École pédagogique de la Ville de Bruxelles Francisco Ferrer, estimant que son règlement d’ordre intérieur était contraire à leurs droits en matière de liberté de culte et de droit à l’instruction.
Très attendu, l’arrêt rendu le 4 juin 2020 n’allait pas de soi : en effet, s’il est généralement admis qu’il peut être légitime de protéger des mineurs contre les pressions qu’ils pourraient subir, on considère tout aussi généralement que l’argument de la protection ne tient plus s’agissant de personnes majeures. Or, c’est ce motif qu’a retenu la Cour constitutionnelle, considérant qu’une limitation de la liberté de manifester ses convictions religieuses dans l’enceinte de l’école pouvait se justifier par la nécessité de protéger les convictions d’autrui, et en particulier de protéger les jeunes femmes musulmanes non voilées de la pression sociale que pourraient exercer sur elles leurs coreligionnaires portant le voile.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a certes reconnu l’obligation pour la Haute École concernée de respecter le principe constitutionnel de neutralité, qui comprend notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Cependant, cette neutralité ne saurait se limiter, selon elle, à une obligation d’abstention : au contraire, elle comporte une obligation positive d’organiser un enseignement dans lequel l’accent sur les valeurs communes ne risque pas d’être compromis. Et dès lors que la notion de neutralité n’est pas conçue de manière figée par la Constitution belge, il appartient à chaque instance compétente de déterminer si l’interdiction des signes convictionnels est ou non indiquée ou nécessaire pour garantir « la reconnaissance et l’appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes » et « l’accent sur les valeurs communes ».
La neutralité et la liberté de religion étant, qui plus est, deux libertés constitutionnelles qui ne peuvent être hiérarchisées, la Cour a insisté sur l’importance de trouver un moyen de les concilier, et donc d’admettre « que la liberté de religion ne peut avoir pour effet de porter atteinte à d’autres libertés constitutionnelles ».
Enfin, tout comme l’avait fait Marie Arena en 2005, la Cour constitutionnelle a estimé que le principe constitutionnel de liberté d’enseignement implique l’existence d’une offre variée qui permette aux parents, aux élèves et aux étudiants de choisir l’enseignement qui correspond le mieux à leurs conceptions philosophiques.
En d’autres termes, l’arrêt de la Cour constitutionnelle réaffirme l’existence et la légitimité de plusieurs conceptions de la neutralité – généralement dénommée « inclusive » et « exclusive » – pérennisant ainsi une longue tradition belge d’absence de positionnement clair sur la question.
Dans ce contexte, la décision quelques mois plus tard de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) d’autoriser les signes convictionnels dans l’ensemble des hautes écoles relevant de sa compétence, soit 50 000 étudiants environ, a suscité la surprise, mais aussi l’enthousiasme des uns et l’inquiétude des autres.
Désormais, c’est en effet l’interdiction qui sera l’exception. Le Règlement des études devra donc prévoir textuellement que « toute activité ou pratique de nature religieuse, idéologique ou politique est interdite dans les locaux de l’établissement ou dans le cadre des enseignements dispensés en dehors de ceux-ci. De même, toute forme de prosélytisme ou de militantisme affectant la tranquillité des étudiantes et des étudiants est interdite dans les mêmes conditions. » Mais aussi que « le directeur de l’établissement interdit le port de tout signe convictionnel, idéologique, politique ou religieux dans le cadre de toutes les activités qui se tiennent dans un lieu ou en une occasion où ces signes doivent être prohibés pour des raisons de sécurité, pour des raisons sanitaires ou parce que les normes de droit supérieur qui s’imposent à l’établissement d’enseignement supérieur l’exigent. Le règlement de section ou de domaine interdit le port de tout signe convictionnel, idéologique, politique ou religieux lorsque, en vertu d’exigences pédagogiques, il se justifie que les étudiants adoptent une tenue uniforme ou particulière57. »
Une décision que l’administrateur général de WBE, Julien Nicaise, justifie ainsi : « L’intérêt général doit primer. Nous ne pouvons plus refuser ces jeunes femmes sous prétexte qu’elles portent un voile, les empêcher de faire des études. Un diplôme, c’est leur passeport pour une inclusion par l’emploi. »
Le Règlement des études de toutes les hautes écoles organisées par WBE autorisera donc dès la rentrée prochaine le port de signes convictionnels, y compris dans les établissements qui forment de futurs enseignants et éducateurs spécialisés. Et il faudra donc demain préparer à ces professions des jeunes femmes qui porteront sur elles le signe de leur soumission à la loi religieuse, et ce, au nom d’un argument pour le moins spécieux : celui de l’inclusion par l’emploi58.
Car de deux choses l’une en effet : soit ces jeunes femmes comprendront, toutes voilées qu’elles sont, que le métier d’enseignant exige le respect du principe de neutralité, qui interdit aux enseignants de « témoigner de leur préférence pour un système religieux59 », et qu’elles devront donc de toute évidence ôter leur voile lorsqu’elles seront devant leurs élèves, mais aussi lors de leurs stages. Mais alors, elles témoigneront par là même qu’elles sont capables de retirer leur voile lorsque les circonstances l’imposent, et l’autorisation qui leur est faite de le garder à l’école ne sera d’aucune utilité : elles auraient tout aussi bien pu accéder aux études supérieures sans leur voile. D’autant que dans l’immense majorité des cas, elles sortent d’un enseignement obligatoire qui leur imposait déjà de retirer leur voile en entrant à l’école, et qu’il ne s’agit donc pour elles que de poursuivre dans la même voie.
Soit ces jeunes femmes estiment que porter le voile est une obligation religieuse majeure, à laquelle rien ne saurait légitimement faire obstacle et, dans ce cas, nous nous préparons des lendemains qui (dé)chantent, car il est à prévoir qu’elles demanderont bientôt à pouvoir faire leurs stages dans des écoles qui autorisent le port du voile à leurs enseignantes – et il en existe en Belgique, à commencer par les écoles confessionnelles islamiques. Pourra-t-on alors le leur refuser sans que l’on nous objecte, une fois de plus, que leur diplôme, « c’est leur passeport pour une inclusion par l’emploi » ?
Et l’étape suivante, comment ne pas la voir ? Toujours au nom de l’inclusion par l’emploi, il sera demain évident qu’on ne saurait empêcher une jeune femme diplômée – et donc « compétente » – de devenir enseignante sous le fallacieux prétexte qu’elle porte un « foulard ». Et comment justifier alors qu’après-demain les élèves ne puissent afficher les signes extérieurs de leurs convictions, si leurs enseignants le peuvent ?
Autrement dit, pendant qu’on nous bassine à longueur de journée sur l’importance de traquer les stéréotypes de genre, nous allons donc bien tranquillement – mais à grands pas – vers un enseignement officiel « inclusif » où enseigneront demain des jeunes femmes qui ont bien intégré le plus gros stéréotype de genre qui soit. Mais on ne pourra bien entendu rien dire, et on se contentera d’enseigner, main dans la main, avec nos chères collègues musulmanes voilées de pied en cap, l’écriture inclusive, le féminisme décolonial et la lutte contre le summum de l’oppression : le mâle blanc hétérosexuel.
Le rôle des organisations étudiantes
L’annonce de la décision de WBE a immédiatement été saluée de manière triomphaliste par le Conseil des Étudiants de la HE2B60, qui publiait dès le 16 janvier sur sa page Facebook :
« Il y en a eu des manifestations, il y en a eu des débats...
Depuis quelques années, le Conseil des Étudiants de la HE2B se bat pour modifier le point relatif à la neutralité et l’interdiction de signes convictionnels dans le Règlement des études.
En septembre 2020, nous avons fait bloc en conseil d’administration et face à ce blocage, le Collège de direction a envoyé nos arguments au WBE en leur demandant de trancher !
Aujourd’hui, ça y est ! NOUS AVONS RÉUSSI !
#étudiants #droit #liberté #inclusion #wbe #neutralité #He2b #cehe2b #victoire. »
Comme en écho, soulignant explicitement le rôle joué par les mobilisations étudiantes, la Fédération des étudiant(e)s francophones (FEF) a immédiatement salué cette décision qui « permet d’améliorer concrètement l’accès à l’enseignement supérieur en le rendant plus inclusif et en respectant davantage les libertés des individus61 ». Dénonçant les « stéréotypes sur le voile », la FEF a tenu à rappeler que « le port du voile est le résultat d’un choix réfléchi et conscient. En juillet dernier, des collectifs avaient organisé une mobilisation suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle justifiant l’interdiction des signes convictionnels au sein des établissements d’enseignement supérieur. Elle a rassemblé plus de 2 000 personnes. Ces collectifs avaient à ce titre pris la parole. Nous tenons à la relayer ici, afin de laisser s’exprimer les premières concernées : “Des personnes ont pris des décisions pour nous, sans connaître notre réalité, sans nous concerter, en disant que c’est pour notre bien. C’est très paternaliste. Toute femme peut et doit décider pour elle-même et personne n’est censé lui dire ce qui est bon ou non pour elle”, dénoncent-elles. »
Or, personne n’a évidemment jamais prétendu interdire les signes convictionnels dans l’enseignement supérieur pour le bien des jeunes musulmanes voilées : tout au plus la Cour constitutionnelle a-t-elle fait valoir l’intérêt des jeunes musulmanes non voilées, ainsi que l’intérêt collectif poursuivi par l’impératif de neutralité. Mais ici, rien de tout cela n’est pris en compte : le « libre choix » est l’alpha et l’oméga de l’argumentation, et toute personne qui prétendrait mettre en avant un autre principe est ipso facto taxée de « paternalisme ».
Et la FEF ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : elle a déjà demandé « à l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur), organe qui réunit l’ensemble des acteur·trice·s de l’enseignement supérieur, de prendre officiellement position afin de supprimer l’interdiction des signes convictionnels dans l’ensemble des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». Ce qui mettrait fin à toute possibilité d’interdiction des signes convictionnels dans une quelconque école supérieure francophone, quel que soit le réseau d’enseignement, et entrerait donc en contradiction avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui estimait nécessaire l’existence d’une offre variée qui permette aux parents, aux élèves et aux étudiants de choisir l’enseignement qui correspond le mieux à leurs conceptions philosophiques.
Cette propension des organisations étudiantes à prendre fait et cause pour le droit de porter le voile, au mépris de toute autre considération, me semble inquiétante à plusieurs égards.
Premièrement, parce qu’elle témoigne d’une dérive de la démocratie participative, où les étudiants, sous prétexte qu’ils seraient les « premiers concernés », peuvent jouer un rôle prépondérant dans la modification des règles qui les visent. Or, je persiste à prétendre que les enseignants sont en réalité bien plus concernés que les étudiants par le type de modifications dont il est ici question, puisqu’après tout les étudiants ne font que passer, tandis que les enseignants restent.
Deuxièmement, parce qu’elle est une des manifestations majeures de ce fameux « islamo-gauchisme » conceptualisé au début des années 2000 par Pierre-André Taguieff : « Quel est le présupposé idéologique commun des islamistes et des gauchistes ? La thèse selon laquelle l’islamophobie constitue la principale forme de racisme et celle selon laquelle l’antiracisme dit “politique” est le combat des combats. Il s’ensuit que l’ennemi commun est caractérisable soit comme “raciste”, soit comme “islamophobe”. À l’extrême gauche, cet antiracisme islamisé tend à remplacer le vieil antifascisme communiste. On peut voir dans ces attitudes et ces comportements le résultat de la stratégie des Frères musulmans qui jouent sur la culpabilisation et le victimisme pour conquérir l’opinion occidentale. Bref, l’Occident “mécréant-islamophobe” (pour les islamistes) ou “capitaliste-raciste” (pour les gauchistes) est toujours le seul coupable.
Au moment où je l’ai forgée, en 2001-2002, l’expression “islamo-gauchisme” avait donc à mes yeux une valeur descriptive, en ce qu’elle désignait une alliance militante observable entre des milieux islamistes et des milieux d’extrême gauche, au nom de la cause palestinienne, érigée en nouvelle cause révolutionnaire supposée “universelle”, comme certains marxistes, tel Étienne Balibar, le claironnaient. C’est par la suite, notamment lorsque l’islamo-gauchisme est entré dans les universités et dans certains syndicats étudiants tandis que le mouvement des Indigènes de la République (lancé début 2005) lui conférait un visage, que je me suis efforcé de donner à l’expression un contenu conceptuel62. »
On observe en effet ce même phénomène en France, où le voile de l’actuelle vice-présidente de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), Maryam Pougetoux, suscite la polémique : d’aucuns, en effet, estiment pour le moins étrange qu’un syndicat de gauche soit représenté par une musulmane voilée ; Laurent Bouvet, cofondateur du mouvement Printemps républicain et membre du conseil des sages de la laïcité, dénonce à cet égard une « dérive de l’UNEF qui, il y a encore quelques années, faisait des campagnes de communication où l’on voyait deux jeunes faire l’amour et défendait la laïcité » comme principe de « neutralité de l’espace public ».
Imaginerait-on un syndicat étudiant de gauche se choisir comme présidente une catholique bon teint arborant sur la poitrine un imposant crucifix en bois ?
Mais la dérive de l’UNEF ne se limite pas à cette malheureuse erreur de casting, et le syndicat étudiant est devenu coutumier des prises de position pour le moins contraires à la tradition laïque et progressiste dont il est issu. Ainsi, en 2019, l’UNEF s’illustrait déjà par son soutien au blocage de la pièce d’Eschyle Les Suppliantes qui devait être jouée à la Sorbonne : cette pièce du Ve siècle avant Jésus-Christ avait en effet le grand tort de recourir à des masques noirs, ce que le syndicat étudiant considérait comme un inacceptable « blackface », malgré l’absence de toute intention blessante ou dénigrante. Aux côtés du syndicat Solidaires étudiants, l’UNEF n’a pas hésité non plus à appeler en 2018 à un « rassemblement contre l’islamophobie et sa promotion à l’université » dans le but d’obtenir l’annulation de la représentation théâtrale d’un texte de Charb, l’ancien dessinateur de Charlie Hebdo tué dans l’attentat du 7 janvier 2015. Un texte qui, intitulé « Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » et publié après la mort de Charb, devrait au contraire selon le philosophe Raphaël Enthoven « être lu à l’école, au lieu d’être censuré à l’université63 ».
Et l’UNEF, comme le syndicat étudiant SUD-Solidaires, n’hésite pas organiser des réunions non mixtes réservées aux femmes, ou encore aux personnes « racisées ».
Ces quelques exemples illustrent à merveille les dérives actuelles de l’antiracisme et du féminisme à la sauce intersectionnelle, malheureusement portées par la jeune génération, syndicats étudiants en tête.
Un dernier mot encore. Le lendemain de la décapitation de Samuel Paty, je postais sur la page Facebook gérée par le Conseil Étudiant de la Haute École où j’enseigne un simple #JeSuisSamuelPaty. Cette publication me valait une salve de commentaires haineux de la part d’anciens étudiants, me traitant de raciste et d’islamophobe, et me contestant le droit d’enseigner, ce qui dans le contexte de l’immédiat « après-Paty » aurait dû être pris très au sérieux : on sait désormais à quoi peut mener le fait de coller ainsi publiquement une cible dans le dos d’un enseignant. Mais loin de me soutenir, le Conseil Étudiant réagissait en supprimant les commentaires litigieux certes, mais aussi et surtout en me bloquant en même temps que mes agresseurs, renvoyant ainsi dos à dos coupables et victime ! Il est vrai que je n’avais pas publié auparavant de #JeSuisPalestine ni #JeSuisHijab, ce qui me rendait de toute évidence suspecte d’islamophobie… Lorsque trois mois plus tard, un autre ancien étudiant m’accusa publiquement et nommément de comportements xénophobes envers mes étudiants « trop basanés », suggérant qu’on prévoie dorénavant un assesseur lors de mes examens, le même Conseil Étudiant commenta ainsi cette accusation ignoble : « Malheureusement, le pouvoir que certains professeurs exercent sur les étudiants est tel que ces derniers n’osent pas réagir. Il y a la peur de l’échec, la peur que tout se retourne contre lui, il y a également le fait qu’on peut voir les choses, les entendre, les vivre même, mais au moment de porter plainte, l’étudiant entendra “Avez-vous des preuves ?” et même lorsqu’il y a plusieurs personnes qui témoignent, cette même phrase ressort. »
Ces commentaires s’inscrivaient dans la foulée immédiate de la décision de WBE, et ajoutaient une dernière pièce à la véritable campagne de haine, de diffamation et de menaces sur les réseaux sociaux dont j’étais la cible64, qui a mené à une constitution de partie civile de la part de WBE, agissant en tant que mon employeur, mais aussi à ma décision de poursuivre ailleurs mes activités professionnelles : si la défense des principes démocratiques devrait être l’affaire de tous, l’islamo-gauchisme fait tant de dégâts que les forces sont devenues par trop inégales, ce dont j’ai fait l’amère expérience.
Si certains tiennent visiblement beaucoup au droit de porter le voile partout, ils sont parfois nettement moins regardants sur l’indispensable respect des personnes dans leur intégrité physique et psychique, et leur droit à la réputation.
56 Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité, https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000357.pdf.
57 Extrait du courrier adressé par WBE le 14 janvier 2021 à l’ensemble des directions des hautes écoles, des écoles supérieures des arts et des établissements d’enseignement de promotion sociale de Wallonie-Bruxelles Enseignement.
58 Monique Baus, « Le voile sera massivement autorisé en septembre dans l’enseignement supérieur : “L’intérêt général doit primer” », La Libre, 16 janvier 2021, https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/le-voile-sera-massivement-autorise-en-septembre-dans-l-enseignement-superieur-l-interet-general-doit-primer-6001eabb9978e227df936a0d.
59 Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté.
60 Haute École Bruxelles-Brabant, l’une des hautes écoles organisées par WBE.
61 « FWB : le port de signes convictionnels n’est plus interdit dans le Supérieur », https://www.7sur7.be/belgique/lautorisation-du-voile-dans-le-reseau-officiel-superieur-nest-pas-acceptable-pour-le-mr~a7ead8c9/.
62 « Entretien avec Pierre-André Taguieff, première partie : qu'est-ce que l'islamo-gauchisme ? », Marianne, Idées, propos recueillis par Hadrien Brachet, publié le 19 février 2021.
63 Chronique de Raphaël Enthoven sur Europe 1, le 29 janvier 2018.
64 Voir notamment la tribune de soutien cosignée par le collectif Laïcité Yallah, le Centre communautaire laïc juif et le Centre d’action laïque et publiée dans Marianne le 27 janvier 2021, https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/nous-soutenons-nadia-geerts-militante-feministe-et-laique#xtor=AL-8.
Bibliographie
Livres
ABOUDRAR Bruno Nassim, Comment le voile est devenu musulman, Flammarion, 2014.
AGAG-BOUDJAHLAT Fatiha, Combattre le voilement, Le Cerf, 2019.
BABÈS Leïla, Le voile démystifié, Bayard, 2004.
BADINTER Élisabeth, Fausse route, Odile Jacob, 2003.
BENCHEIKH Soheib, Marianne et le Prophète, Grasset, 1998.
BERGEAUD-BLACKLER Florence, Le marché halal ou l’invention d’une tradition, Seuil, 2017.
BRENNER Emmanuel (sous la direction de), Les territoires perdus de la République, Les Mille et une nuits, 2002.
DEBRAY Régis, Ce que nous voile le voile, Gallimard, 2004.
DEBRAY Régis, La République expliquée à ma fille, Seuil, 1998.
DJAVANN Chahdortt, Bas les voiles !, Gallimard, 2003.
DJITLI Leïla, Lettre à ma fille qui veut porter le voile, La Martinière, 2004.
DUCOMTE Jean-Michel, La République, Milan, 2002.
FABRE-MAGNAN Muriel, L’institution de la liberté, PUF, 2018.
FOUREST Caroline, Génération offensée, Grasset, 2020.
FOUREST Caroline, La dernière utopie, Grasset, 2009.
FOUREST Caroline, La tentation obscurantiste, Grasset, 2005.
GEERTS Nadia, La neutralité n’est pas neutre !, La Muette, 2012.
GEERTS Nadia, Dis, c’est quoi le féminisme ?, Renaissance du Livre, 2017.
GEERTS Nadia, Dis, c’est quoi une religion ?, Renaissance du Livre, 2018.
GEERTS Nadia, Tolérance ? Diversité ? Laïcité !, CEP, 2019.
JAVEAU Claude, La Bienpensance. Thèmes et variations, Labor, 2005.
KAHN Pierre, La Laïcité, coll. « Idées reçues », Le Cavalier bleu, 2005.
KEPEL Gilles, La revanche de Dieu, Seuil,1991.
KHOURI-DAGHER Nadia, L’islam moderne. Des musulmans contre l’intégrisme, Hugo & Cie, 2009.
KINTZLER Catherine, Qu’est-ce que la laïcité, Vrin, 2007.
MAALOUF Amin, Les identités meurtrières, Grasset, 1998.
PEÑA-RUIZ Henri, Qu’est-ce que la laïcité ?, Gallimard, 2003.
PEÑA-RUIZ Henri, Dictionnaire amoureux de la laïcité, Plon, 2014.
PEÑA-RUIZ Henri, Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité, PUF, 2005.
ROZA Stéphanie, La gauche contre les Lumières ?, Fayard, 2020.
TODOROV Tzvetan, L’esprit des Lumières, Biblio essais, 2006.
VIANES, Un voile sur la République, Stock, 2004.
Articles
ADONIS, « Le foulard islamique est un voile sur la vie », Courrier international, n° 663, 17-23 juillet 2003, extrait de Al-Hayat, Londres.
AÏT-HATRIT S., « Boulmerka Hassiba : “Il n’y a pas de politique sportive en Algérie” », Jeune Afrique, 11 août 2012, https://www.jeuneafrique.com/174761/politique/hassiba-boulmerka-il-n-y-a-pas-de-politique-sportive-en-alg-rie/.
BABÈS L., « Pour se protéger de la femme, objet de désirs », article paru dans La Libre Belgique, le 23 novembre 2004, https://www.lalibre.be/debats/opinions/pour-se-proteger-de-la-femme-objet-de-desirs-51b886eae4b0de6db9ab2bb2.
BAUS M., « Le voile sera massivement autorisé en septembre dans l’enseignement supérieur : “L’intérêt général doit primer” », La Libre, 16 janvier 2021, en ligne https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/le-voile-sera-massivement-autorise-en-septembre-dans-l-enseignement-superieur-l-interet-general-doit-primer-6001eabb9978e227df936a0d.
BESTANDJI N., « Voile «islamique»/voile des nonnes et croix : une fausse comparaison religieuse pour dissimuler un vrai racisme sexuel », 26 octobre 2018, http://sisyphe.org/spip.php?article5486.
BLOGIE É., « De la polémique “burkini” au fantasme de la “révolte du bikini” », Le Soir, 10 août 2017, https://plus.lesoir.be/108701/article/2017-08-10/de-la-polemique-burkini-au-fantasme-de-la-revolte-du-bikini.
BOURTON W. et MOUTON O., « Les Belges assimilent les étrangers en faisant des enfants avec eux », Le Soir, 21 septembre 2009, https://plus.lesoir.be/art/-les-belges-assimilent-les-etrangers-en-faisant-des-enf_t-20090921-00Q0P9.html.
BOURTON W., « Comment devient-on fanatique ? », Le Soir, 3 novembre 2009.
BRACHET H., « En voilant les fillettes, les islamistes cherchent à les formater suffisamment tôt », Marianne, 19 janvier 2021, article en ligne, https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/en-voilant-les-fillettes-les-islamistes-cherchent-a-les-formater-suffisamment-tot.
BRACHET H., « Entretien avec Pierre-André Taguieff, première partie : qu’est-ce que l’islamo-gauchisme ? », Marianne, 19 février 2021.
CHAMBRAUD C., « Que dit la tradition coranique sur le voile ? », Le Monde, 28 octobre 2019, https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/28/que-dit-la-tradition-coranique-sur-le-voile_6017181_3224.html.
CHEVRIER G., « Femmes payées par le Qatar pour porter le voile et islamistes qui se substituent à l’État-providence dans les cités : rumeur ou vérité ? », https://www.atlantico.fr/article/decryptage/femmes-payees-par-le-qatar-pour-porter-le-voile-et-islamistes-qui-se-substituent-a-l-etat-providence-dans-les-cites--rumeur-ou-verite--guylain-chevrier.
CONTE C., « Européens et musulmans », Librex-news, n° 17, septembre 2005.
DAOUD K., « Cologne, lieu de fantasme », Le Monde, 29 janvier 2016, https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/31/cologne-lieu-de-fantasmes_4856694_3232.html.
de BAERDEMAEKER R., « Les restrictions à l’expression de la conviction religieuse », L’Écho, 5 février 2021.
DEBRAY R., « Êtes-vous démocrate ou républicain ? », Nouvel Observateur, 30 novembre 1995, https://www.les-crises.fr/etes-vous-democrate-ou-republicain-regis-debray/.