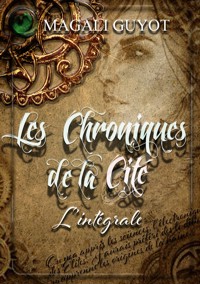Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Robert Stepson, scientifique renommé, doit passer devant une commission pour révéler le résultat de ses recherches sur la longévité de la vie. Confronté à l'arrivisme des Hommes et en proie à ses propres questions existentielles, il replonge dans ses carnets de recherches jusqu'au jour où tout a commencé. 1918, Etienne Naville, médecin obsédé par l'immortalité, plonge dans la folie et laisse derrière lui sa petite fille, Aiyanna. Celle-ci est ainsi recueillie par la famille Bretaudeau, proche de son père. Mais les années passent et le vieillissement de la jeune femme ralentit jusqu'à totalement se figer. Au sein de sa famille adoptive, Aiyanna traverse alors les époques, les guerres et se confronte à l'intolérance, la rancoeur, la perte , et aussi l'amour du seul qu'elle ne devait pas approcher. Et depuis toujours, entre le soutien des Stepson et les déchirements des Bretaudeau, une question revient à chaque fois : serions-nous vraiment gagnants à triompher contre le temps ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PROLOGUE
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CHAPITRE 4
CHAPITRE 5
CHAPITRE 6
CHAPITRE 7
CHAPITRE 8
CHAPITRE 9
CHAPITRE 10
CHAPITRE 11
CHAPITRE 12
CHAPITRE 13
CHAPITRE 14
CHAPITRE 15
CHAPITRE 16
CHAPITRE 17
CHAPITRE 18
PROLOGUE
« Avis-Est-Ignis/Centaurea/Astéracées ».
Gillian écarquilla les yeux et se pinça les lèvres. Du haut de ses quatorze ans, le latin et la science de son génie de père lui échappaient encore. Elle n’avait lu cette inscription que par curiosité pour la fleur séchée écrasée au-dessus et précieusement gardée sous cadre vitré. Les pétales de la plante étrange la narguaient de ses couleurs chatoyantes. Un dégradé délicat de rouge et jaune donnait l’impression d’un petit bouquet de flammes. Si l’adolescente plissait légèrement les paupières et se concentrait quelque peu, elle pouvait presque les voir bouger, briller. Un claquement de porte la tira brutalement de ses pensées et elle sursauta comme une voleuse prise sur le fait. Son père pouffa de rire, fier de son petit effet.
— Ça te fait rire ? s’offusqua-t-elle.
Robert Stepson, cinquième du nom, contourna son gigantesque bureau de merisier et s’affala sur son fauteuil. Tel un enfant, il se balança d’un côté à l’autre, jouant du pivot de plus en plus usé. Malgré un visage marqué par une quarantaine d’années, une brillance juvénile perçait dans les iris de couleur verte. Il dévisagea un instant sa fille, devant lui, excédée, une main figée sur la hanche et l’autre accrochée à un ballon de basket. Lui n’avait jamais été sportif. D’ailleurs, d’aussi loin que remontent ses souvenirs, personne dans la famille Stepson n’avait pu se vanter de cette qualité. La médecine et la science : deux pratiques indissociables de cette maison. Deux mots et leurs passions qui n’avaient jamais supporté quelconque concurrence ou autre activité trop accaparante.
— Elle est belle cette fleur, n’est-ce pas ? demanda-t-il alors, désireux d’éveiller un intérêt scientifique chez Gillian.
— C’est une fleur, grommela-t-elle. Mais apparemment plus intéressante à encadrer dans ton bureau que le trophée de basket de ta fille !
Un large sourire apparut sur le visage de Stepson et il tira sur la poignée de son premier tiroir pour en sortir un exemplaire de journal. Sans un mot, il l’ouvrit en grand sur ledit trophée serré dans les mains d’une Gillian posant avec son équipe.
— Le tiroir de ton bureau, marmonna-t-elle en mimant l’admiration. Ah, mais je monte en grade !
Il pencha la tête, suppliant une trêve, et elle baissa les armes, prise de pitié.
— C’est demain que tu passes devant le tribunal ? demanda-t-elle.
Le visage de Stepson se rembrunit alors, subissant un brusque retour à la réalité.
— Ce n’est pas un tribunal. C’est une commission de scientifiques, corrigea-t-il.
Il reposa ses coudes sur le bois de son plan de travail et croisa les doigts, cherchant comment expliquer les choses à l’enfant qui n’avait jusqu’alors pas abordé le sujet.
— Des histoires de grands peu intéressantes, et finalement si banales, souffla-t-il.
— Maman dit que ton collègue est un « enfoiré arriviste, sans scrupule », répéta-t-elle, persuadée de son bon droit de rapporter ses mots.
— Je suppose que c’est un très bon résumé, s’amusa-t-il.
— C’est vrai qu’il est allé dire que tu cachais des informations importantes pour la santé aux autorités ? interrogea-t-elle, un voile d’inquiétude sur le visage.
Stepson se contenta d’acquiescer de la tête, le regard dans le vide.
— Et c’est grave ? finit par bredouiller Gillian. Tu as découvert quelque chose d’important ? Ça concerne Aiyanna ?
Il fronça les sourcils devant le regard perturbé et perturbant de la seule personne insouciante de cette maison. La question était posée de façon innocente, anodine. Pas une once de malveillance n’en ressortait et aucun jugement ne serait prononcé, quelle que soit la réponse. En revanche, devant la commission, d’autres enjeux compliquaient cette simple discussion. Toute sa vie durant et depuis des générations de Stepson, une découverte scientifique miraculeuse avait été un rêve, un fantasme. Dans l’esprit profondément pur et bienveillant de la famille, ce ne pouvait être qu’une bonne chose, bénéfique pour tous. Finalement confronté pour la première fois au monde réel, en dehors de l’espace sécurisant de son laboratoire, Robert Stepson réalisait que le choix s’offrant à lui désormais n’était pas aussi simple qu’il l’avait espéré.
Le lendemain, il devrait se présenter devant ses confrères. Deux options s’offraient à lui : déposer à leurs pieds une découverte aux conséquences sans précédent et ainsi récompensée, glorifier le travail et la dévotion de toute sa famille devant des centaines d’années ou tout renier, répondant à une alarme intérieure lui criant des mots encore confus.
Les yeux de Gillian étaient toujours posés sur lui et leur propriétaire attendait une réponse qu’elle voulait rassurante. Il inspira, regagna une expression apaisante et se releva de son fauteuil pour la rejoindre. Il l’entoura de son bras, déposa un baiser sur son front avant de se tourner lui aussi vers la fleur séchée encadrée devant eux. Elle était belle. Morte depuis des années et pourtant belle.
— Ne t’en fais pas pour demain, dit-il. La seule chose qui doit te préoccuper se tient sous ton bras. Je suis certain que tu peux faire encore mieux que deux ou trois paniers dans un match !
Elle releva un sourcil et se redressa fièrement, piquée au vif par le défi. Les Stepson ne se contentaient pas de résultats satisfaisants. Il leur fallait de l’exceptionnel ! Elle quitta la pièce, renonçant à demander une nouvelle fois à son père de faire une partie avec elle. Il avait toujours été trop occupé de toute façon. Il reprit sa place derrière le bureau après avoir verrouillé sa porte. Ses doigts effleurèrent des tranches de livres de sa bibliothèque personnelle juste derrière lui. Il tira sur l’une d’elles, dévoilant un coffre. La date de naissance de Gillian lui permit de l’ouvrir et d’en sortir une vieille couverture du Daily New aux informations sans intérêt qui emballait une photo vieillie. Le visage d’une jeune femme resplendissante, au regard lointain apparaissait. « Aiyanna ». Il posa des yeux tendres dessus, habités par une sorte de respect immense puis, l’écarta pour dévoiler un tas de calepins d’un autre temps, d’un autre siècle. « Étienne Naville » apparaissait comme annotations sur leurs couvertures. Demain, il devrait choisir d’en révéler le contenu devant le monde scientifique ou les refermer à jamais. Mais, aujourd’hui, leur histoire n’appartenait qu’à lui, à sa famille et à Aiyanna. L’introspection était nécessaire à cet instant précis. C’était la dernière. Il fixa la fleur avec intensité. En plissant les paupières et en se concentrant bien, il arrivait presque à la voir bouger, briller. Il ferma alors les yeux et, répondant à une impulsion, sortit un nouveau carnet, vierge cette fois-ci. Il s’agirait du sien. Il s’agirait du début de l’histoire et de sa fin.
Juillet 2053, Dublin, Irlande
Je m’appelle Bob. En fait, le diminutif de Robert. Le nom semble ancien à notre époque, mais il est sacré dans la famille. Je suis le cinquième à porter ce nom ! Oui, le cinquième. Je sais, cela peut faire sourire. Je suis de ces familles qui tiennent à leur tradition. Chez nous, le fils aîné porte le même prénom depuis Robert Stepson, né en 1890 dans le beau pays d’Irlande. Et il y a autre chose qui est sacré chez nous : la recherche. De mes ancêtres médecins aux scientifiques d’aujourd’hui, nous avons toujours porté cette vocation comme une mission. Je ne saurais pas vraiment dire ce qui a provoqué ce besoin chez le tout premier Stepson, mais je sais ce qui l’a fait perdurer. Un prénom, une personne hors du commun, a accompagné nos vies. Sa présence, bien qu’épisodique, nous a donné l’envie de chercher, encore et encore, comment améliorer la vie, la soigner, la rallonger. Ce fut un travail de plusieurs générations, l’étude de gribouillages, résultat de la folie d’un homme, Étienne Naville, dans une série de vieux carnets datant du début des années 1900. Si j’écris aujourd’hui, ce n’est pas pour continuer ce récit, mais pour y apporter une conclusion. Une conclusion bruyante, je dirais. Ma fille, Gillian, joue au basket dehors et le ballon a une fâcheuse tendance à frapper plus souvent le mur près de ma fenêtre que le panneau qu’il est censé atteindre. J’ai passé beaucoup d’années au travail et consacré peu de temps à son éducation. Mais j’ai mis un point d’honneur à ce qu’elle profite des loisirs simples ; qu’elle ne soit jamais esclave des technologies. Chose de plus en plus difficile à l’heure actuelle. Je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de minutes qu’elle ne passe pas « connectée » dans la journée. Connectée ou déconnectée du monde ? L’avenir seul nous dira ce que nous avons provoqué à vouloir être toujours plus moderne, toujours plus rapide. Moi, je ne serai plus là… et Aiyanna dirait « tant mieux ». Aiyanna qui m’appelle « Bob 5 ». Pour elle, je suis le « Bob 5 » de la « famille Bob ». Elle me l’a toujours dit avec un air enfantin. Je me fais l’effet d’un énième robot, mais je comprends bien que c’était plus pratique pour elle. Elle a connu le premier. Elle a connu tous les suivants. Qui d’autre peut se vanter d’avoir fréquenté autant de générations de la même famille ? Personne. Et là aussi, elle me dirait « tant mieux ». Oui, elle me le dirait sur ce ton plein de sagesse et de douceur qu’utilisent ces gens qui ont compris, bien avant les autres, ce qu’était la vie. « Aiyanna » était le prénom de l’épouse du premier Robert Stepson de la famille. Il voulait dire « fleur éternelle ». Étienne Naville, ami de la famille, avait alors repris le prénom pour son enfant. L’enfant d’Étienne Naville. Sa petite fille. Aiyanna Naville : son histoire a débuté dans les cris de douleur de la femme qui lui a offert son dernier souffle. Elle est née en 1914, quelques mois après le départ d’Étienne pour la guerre. Étienne Naville, médecin renommé par son génie, pour ses névroses. Une photo de lui a trôné jusqu’à ce matin dans la bibliothèque de ma famille. Il était bras dessus, bras dessous avec ses meilleurs amis et compagnons de combat : Pascal Bretaudeau et Robert Stepson. Robert Stepson, le premier « Bob », le premier témoin de ce que nous prenions pour un miracle. Un miracle.
CHAPITRE 1
L’histoire aurait pu commencer en 1890, à la naissance d’Étienne Naville. Elle aurait pu raconter la lente descente aux enfers d’un homme prisonnier de ses démons. La naissance d’une peur incontrôlable, inextricable. La vérité est qu’il reste trop peu de choses dans ses carnets sur lui-même. Sa propre enfance est peu retranscrite. Peu d’effusion de sentiments, peu de souvenirs, pas de sentiments ordinaires. L’enfant avait disparu au profit de l’homme torturé que tout le monde a connu. Et pourtant. Il avait sûrement rêvé, espéré et aimé. Que garde-ton vraiment des gens lorsque le temps les détruit ? Quelle image reste à jamais lorsque la folie s’abat sur une existence ?
Le premier carnet avait pour seule photo celle du village où il avait grandi. Ménérelle. Petite terre de paradis, de campagne. À peine cinq cents habitants arpentaient les chemins de ce hameau placé sur un plateau du Centre. Un point de vue agrémenté d’un muret donnait tout le loisir d’apprécier les villes alentour, les champs gigantesques et les couleurs vivifiantes des prairies. À Ménérelle, tout le monde se connaissait, tout le monde se côtoyait. Il s’agissait d’une autre vie, d’un autre temps. Là-haut, l’hiver était un peu plus glacial qu’ailleurs, le froid s’installant plus longtemps sur les hauteurs. Le vent s’engouffrait de façon parfois violente, balloté par les petites collines environnantes, s’insinuant dans chaque rangée de vignes, sifflant à plusieurs kilomètres à la ronde. Des arbres gigantesques se voyaient pliés sans ménagement, leur pointe frottant le sol l’espace de quelques secondes. Étienne Naville avait aussi noté qu’il voyait là un message de la nature. Il avait compris que malgré la hauteur que l’on pouvait atteindre, la nature finissait par nous ramener à terre. Malheureusement, bien avant qu’il se soit résigné, le mal était déjà fait.
Novembre 1944, Ménérelle, commune française.
« Carnet numéro cinq,
Le temps fout le camp. J’ai espéré tellement fort que cette réalité me paraîtrait moins cruelle à mesure des années passant. J’ai voulu croire les anciens me répétant que j’apprendrais à vivre avec. Mais elles passent et sont autant de gifles douloureuses, inévitables, de plus en plus insupportables. Mes derniers tests ont échoué. Tu es là. Tu grandis. Et je me sens trahi. Ton évolution si monstrueusement banale et régulière renforce le fait que la vie m’échappe d’heure en heure. Tes progrès me renvoient les jours fuyants. Ils marquent mon visage de rides annonciatrices de quelque chose d’inacceptable. La colère m’envahit lorsque mes yeux se posent sur toi. Toi, l’ultime affront que me fait la vie. Elle me rappelle qu’elle seule commande et contrôle tout. Je me fais peur moi-même, à te haïr à ce point, toi, une enfant encore incapable de comprendre qu’à peine née, tu es déjà condamnée. Le temps et l’énergie que j’ai sacrifiés partent en fumée. La violence remplace la peur. Je pourrais te tuer pour mes espoirs de nouveau étouffés. Reprendre la vie comme si rien ne s’était passé. Sans horloge. Sans personne. Aucun compte à rebours. Décider que le cycle est brisé parce que moi, je l’ai voulu. »
— Tu ne devrais pas lire ce livre ! Il n’est pas pour les enfants, expliqua doucement Aiyanna en récupérant
l’objet des mains d’Elias.
Elle le referma plus brusquement que prévu, provoquant un petit nuage de poussière. Un air mélancolique habilla le visage de la jeune femme lorsque ses yeux se posèrent sur la couverture vieillie. L’inscription sur le carton abîmé n’était presque plus visible : « Étienne Naville, 1920 ». Vingt-cinq ans étaient passés depuis qu’il avait rempli ces pages d’encre noire. L’auteur n’était plus de ce monde. Seules restaient ses dernières pensées et sa folie retranscrites en plusieurs volumes au milieu de milliers d’autres univers plus ou moins imaginaires. Aiyanna s’était demandé à maintes reprises si elle devait conserver ces écrits ou les brûler. À défaut de trouver une réponse satisfaisante, elle les avait laissés à leur place. Pourquoi l’enfant avait jeté son dévolu sur ce chiffon alors qu’une multitude d’autres livres envahissaient la pièce ?
— On dirait un journal secret, répondit-il aussitôt à la question silencieuse.
Le garçonnet de sept ans tourna les talons pour longer les immenses étagères servant de bibliothèque. Chacune d’elles était ornée d’une date gravée au couteau. Le petit s’était persuadé qu’il s’agissait de celles d’achats quelconques.
La pièce mesurait presque trente mètres carrés et se trouvait au sous-sol de la maison. Le seul éclairage dont elle disposait était une ampoule pendouillant au bout d’un fil déjà usagé. Il était bien difficile de déterminer la couleur du papier peint, ce dernier étant entièrement caché derrière les multiples ouvrages.
Plusieurs semaines s’étaient écoulées depuis qu’Aiyanna, la jeune maîtresse du village, avait recueilli les deux enfants d’Éric Bretaudeau, son frère d’adoption. Thomas, le cadet, passait le plus clair de son temps prostré à la fenêtre de la salle à manger, espionnant d’un œil méfiant la maison leur faisant face : celle d’Eliane Brochard, une femme peu avenante à la réputation difficile. Bien que jeune et distinguée, ses regards mauvais et son style strict à excès en avaient fait la bête noire des marmots alentour. Les enfants du village aimaient dire qu’il s’agissait d’une sorcière dévorant les nouveau-nés à tour de bras et leurs parents se servaient de l’aubaine pour les terroriser afin de les tenir en place. Thomas s’était fait un devoir de veiller à ce que la « vilaine femme » reste toujours bien de son côté de la rue.
Elias, lui, se confinait quatre-vingt-dix pour cent du temps au milieu des livres, dévorant chacun d’entre eux à une vitesse impressionnante. Il se souviendrait probablement toute sa vie du premier jour où il avait mis les pieds ici.
— Il y en a des millions ! s’était-il écrié.
La réflexion avait fait sourire Aiyanna. Des millions ? Peut-être pas ! Mais ne s’était-elle jamais risquée à vraiment les compter ? Derrière sa grande porte en chêne, cette caverne d’histoires accumulait un nombre de trésors phénoménal. La reliure usée du carnet d’Étienne Naville avait tout de suite attisé la curiosité d’Elias.
— C’est de la mort qu’il a peur ? demanda-t-il alors, toujours tourné vers ses futures lectures.
Surprise par la question, Aiyanna prit le temps de remettre l’objet sur la planche la plus haute, hors de portée. Elle laissa échapper un souffle bruyant, tentant d’évacuer une douleur au fond de sa poitrine.
— Le monsieur qui a écrit le livre, c’est la mort qui lui fait peur ? insista-t-il.
Devant le silence persistant, il offrit une bouille hésitante à la femme qui le bordait chaque soir. Cette dernière s’en amusa. Ses cheveux blonds, coupés maladroitement, étaient ébouriffés et cachaient presque le bleu de ses yeux arrondis. Son pantalon était trop court de quelques centimètres ; les bretelles servaient plus d’accessoires qu’autre chose et sa chemise débordait par endroits.
— Tu es bien petit pour te préoccuper de ce genre de choses, murmura-t-elle avec tendresse.
Elle tira le fauteuil rouge se trouvant à ses côtés et se laissa tomber dans le fond de l’assise. L’enfant à l’expression boudeuse prit place avec évidence sur les genoux de son hôte.
— Jamais tu ne dois te préoccuper de cette « chose ». Jamais, souffla-t-elle.
— Mais papa… ça pourrait lui arriver. Là où il est… les autres disent qu’il est peut-être déjà mort.
La phrase mourut dans un sanglot retenu. « Les autres », pensa-t-elle. La cruauté des enfants entre eux et de certains adultes ignorant l’impact de leurs paroles sur leur entourage n’était pas une nouveauté, mais la révulsait toujours autant.
— Tu crois qu’il y a un paradis ? Et que maman y est déjà ? continua-t-il.
— Bien sûr, mentit-elle. Elle est en sécurité maintenant. Et elle te surveille.
Elias parut réfléchir quelques secondes puis fronça les sourcils en dévisageant Aiyanna. Il était jeune, mais suffisamment conscient des choses pour les juger jolies. Ses cheveux mi-longs et châtain foncé entouraient son visage pâle aux yeux bruns. Son expression était à la fois douce et assurée. Elle faisait partie de ces femmes pourvues d’une présence les dispensant de tout autre artifice. La sagesse dont elle faisait preuve parfois révélait vingt ans passés sans pour autant lui donner un âge précis. Elias la fixa un moment, cherchant à lire l’âme devant lui de la même façon que n’importe quel autre manuscrit. Elle était belle pour lui. Il appuya alors sa tête contre l’épaule féminine sans plus d’autres questions. Aiyanna fredonna l’air de la « java bleue », adoré du petit, et remercia intérieurement la fatigue fermant ses paupières, lui évitant d’aborder un sujet déplaisant.
La guerre faisait rage depuis presque cinq ans. La maladie qui avait emporté la mère des deux enfants avait fragilisé la famille très vite délestée de son patriarche parti en résistance. Ménérelle s’était vue amoindrie d’une bonne partie de sa population masculine. Tout était fait malgré tout pour que les enfants ne souffrent de rien. Aiyanna baissa à son tour les paupières, les serrant plus que de raison. Il fallait évacuer le stress. Il fallait évacuer l’angoisse.
Elle n’avait aucun souvenir de la vie avec son propre père, le fameux Étienne Naville. Le couple Bretaudeau, Inès et Pascal, l’avait recueillie dès sa troisième année. Elle avait passé une bonne partie de son enfance de la façon la plus normale qui soit, persuadée d’être la troisième enfant du couple après Éric et Ortense, la fille aînée. Bien du temps s’était écoulé avant qu’on ne lui explique qui était l’homme alimentant les conversations secrètes ; le pourquoi de ces discussions avortées en sa présence. Étienne Naville. Les lèvres frémissaient à l’usage de ce nom et de ce prénom. Les yeux se baissaient, remplis de gêne.
Un jour particulier lui revint alors en mémoire. À l’aube de ses treize ans, Pascal Bretaudeau l’avait prise par la main et lui avait annoncé qu’un homme important, pour lui et pour elle, était mort dans la journée. Il avait les larmes aux yeux et, sans comprendre vraiment pourquoi, elle le prit dans ses bras. Elle ne voulait pas savoir. Son intuition lui disait que la réponse serait déplaisante. Une vie entière semblait s’être écoulée depuis. Elle réalisa que le bambin dans ses bras aurait peut-être à entendre la même chose, avec seulement moins de mystère. Des bruits de pas précipités résonnèrent alors dans les escaliers menant à l’antre littéraire. Le jeune Thomas manqua de trébucher, essoufflé par sa course.
— Il y a des méchants, lança-t-il sur un ton saccadé. Ils viennent ici !
« Les méchants ». Sorti de la bouche d’un enfant d’à peine six ans, dans un autre contexte, il aurait presque pu s’agir de quelque chose de mignon : des monstres dans le placard, de mauvais gamins à l’école. En ce jour, il s’agissait de soldats allemands aux brassards ornés de symboles nazis qui approchaient de la demeure. Acculés de tous les côtés par les forces alliées, les derniers combattants perdaient pied et retournaient tout sur leur passage. Les balles fusaient sans aucune autre raison que celle de la vengeance. L’engagement d’Éric dans la résistance n’avait curieusement pas mis bien longtemps avant d’être connu. La visite des soldats n’avait, pour Aiyanna, rien d’une coïncidence. Il leur faudrait peu de temps pour fouiller la maison. Elle saisit Thomas sous les bras et tira Elias par la manche en direction d’une étagère amovible.
— Personne ne bouge ! Personne ne parle ! Personne ne crie ! Je reviens très vite.
Elias retint son souffle. Il se trouvait dans la fameuse pièce. Celle dont il connaissait l’existence après avoir un peu trop tendu l’oreille pendant un échange d’adultes. Celle où personne ne voulait plus mettre les pieds. Elle était interdite. Les nuits où il cauchemardait, imaginant le lieu hanté ou cachant un monstre, n’étaient pas si vieilles. Il savait qu’une étagère en servait l’accès, mais jamais il n’avait osé chercher laquelle. L’obscurité dans laquelle il se trouvait désormais ne lui permettait pas de voir ce qu’elle renfermait. La terreur la plus basique envahissait son petit être, bien plus que l’éventualité de tomber nez à nez avec un soldat ennemi. Son petit frère se collait contre lui, tremblant. Elias serra les dents. Il était l’aîné. Il devait protéger et rassurer Thomas. Il l’avait promis à son père avant son départ. Il ferma les yeux un moment avant de les rouvrir sur un léger faisceau de lumière. Quelque chose brillait dans la pièce. La trop faible source ne lui permettait pas de voir d’où cela provenait. Son imagination décadente tenta d’écarter la possibilité du regard monstrueux d’une bête quelconque. Ça ne bougeait pas. Ça ne tremblait pas. Une certaine pureté s’en dégageait. Quelque chose d’apaisant. Peut-être n’était-ce qu’un délire de môme apeuré. Il referma de nouveau les paupières, chassant toutes distractions idiotes de sa tête et serra Thomas encore plus fort contre lui.
Aussitôt la cachette refermée, Aiyanna remonta les marches, trois par trois, jusqu’au placard de l’entrée. Elle saisit le fusil accroché derrière les manteaux et eut juste le temps de courir vers l’arrière de la maison en interpellant les hommes dans sa direction. Ils firent voler la porte en éclats. Du jardin, elle appuya une première fois sur la gâchette. Les trois militaires se précipitèrent vers le bruit, en coursant la responsable. Un petit bosquet attenant au manoir séparait les deux camps. Elle le connaissait par cœur. Toutes les cachettes possibles et inimaginables avaient été trouvées lors de ses parties de cachecache enfantines avec Éric. Ils étaient trois. Ils étaient confiants. Le gibier qu’ils avaient aperçu leur avait suffisamment mis l’eau à la bouche pour qu’ils ne veuillent s’en détourner. Les branches pliaient à leur passage et le sol recouvert de feuilles mortes accusait le coup des bottes déjà bruyantes. Des mots allemands résonnaient. Un coup de feu couvrit les voix et une première masse verte s’écroula sur le sol. Les tirs retentirent alors dans tous les sens et la respiration d’Aiyanna se coupa de façon nette. Un filet de sang s’échappa de son épaule et elle plia les genoux sous le choc. Peu importait. Deux des trois intrus gisaient à terre et le troisième tentait de retrouver son souffle, gravement blessé. La jeune femme s’en approcha péniblement. Personne n’avait à mettre en danger son territoire. Personne n’avait à menacer sa famille. Aucun proche ne devait mourir si elle avait le moyen de l’éviter. Le liquide rouge continuait de s’échapper de son épaule alors qu’elle grimaçait de douleur.
— Vous… vous allez mourir, ricana-t-il dans une vaine tentative de dernière victoire.
Un sourire illumina le visage d’Aiyanna, suivi d’un rire.
— Non. Vous, vous allez mourir. Moi, je serai encore là dans une petite centaine d’années, j’en ai bien peur.
Le mourant fronça les sourcils, le souffle de plus en plus pénible. L’hémorragie était trop importante. La fin se profilait pour lui.
— Vous n’avez pas le monopole de la folie. Ici, c’est une histoire de famille, expliqua-t-elle, consciente que ses paroles n’auraient aucun sens pour un étranger de la maison.
Les yeux du soldat se fermèrent après un dernier son rauque échappé de sa gorge. La porte de la véranda à quelques centaines de mètres d’eux claqua et les deux enfants échappés de la maison coururent vers leur protectrice.
— Je vous avais dit de rester dans la maison ! gronda-telle.
— On se sépare pas ! pesta Elias. Je veux plus jamais qu’on soit seuls !
Il posa un regard perplexe sur la dépouille devant lui et cacha les yeux de son petit frère. La guerre serait bientôt finie et ils vivraient bientôt de nouveau tous ensemble et en sécurité. Il s’agissait pour lui d’une évidence. La vie reprendrait son cours.
La maîtresse regagna l’intérieur de la maison pour éloigner les enfants de la scène de mort. Elle jeta un coup d’œil furtif sur la rue et eut juste le temps d’apercevoir Eliane Brochard rabattre son rideau à la hâte. Il ne faisait aucun doute qu’elle avait vu les hommes rentrer et entendu les coups tirés. Et il ne faisait non plus aucun doute qu’elle ne se déplacerait pas pour autant.
Il y avait forcément d’autres patrouilles. Une autre troupe viendrait rapidement à la recherche de leurs trois comparses. Aiyanna tenta une réflexion rapide. Partir ? Où et comment avec les deux enfants à bout de bras ? Avant qu’elle n’ait eu le temps de se poser plus de questions, des vrombissements impressionnants retentirent à l’entrée du village. Son cœur s’arrêta. Un drapeau américain apparut et elle relâcha la pression de ses mains sur le fusil. La tête appuyée contre la fenêtre, elle ferma les yeux, soulagée.
— Tiens, entendit-elle dans son dos.
Thomas lui tendait naïvement une petite boîte de pansements, ignorant l’ampleur de la blessure à l’épaule. Elle s’en saisit avec un sourire rassurant pour le petit.
— C’est trop petit, souffla Elias.
— Allez dans votre chambre, les garçons, se contenta-telle de répondre. Le docteur Bob va venir. Je vais
l’appeler.
Si Thomas courut à l’étage sans broncher, Elias observait, inquiet, le sang retenu sous la main rougie.
— File, je te dis ! répéta-t-elle avec un faux air autoritaire.
Elle le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse dans le couloir menant aux chambres et passa l’entrée de la salle à manger pour s’assoir sur le canapé. Son cœur reprit un rythme lent, très lent. Que se passerait-il si plus de sang venait à s’échapper de la plaie ? Regagnerait-elle sa place parmi les êtres humains normaux ?
« Tu es là. Tu grandis. Et je me sens trahi. Ton évolution si monstrueusement banale et régulière… »
La phrase d’Étienne Naville lui revint à l’esprit et elle ne put contenir un rire nerveux.
— Oh, papa, si tu savais.
Elle saisit le téléphone et fit tourner les chiffres sans même les regarder.
— C’est Aiyanna Naville. Le docteur Robert Stepson est là, je vous prie ?
CHAPITRE 2
17 janvier 1945,
Ortense Janin, la sœur aînée d’Éric, dévisageait Aiyanna et les deux enfants avec un air pincé. Depuis un désaccord avec son frère datant d’avant-guerre, il n’y avait plus eu aucun contact et aucune des deux parties ne semblait s’en porter plus mal.
— J’ai déjà trois enfants ! lança-t-elle en direction de l’assistante sociale assise au bout de la table.
— Il s’agit de tes neveux, rappela aussitôt Aiyanna.
— Cela ne change rien à notre situation financière ! Éric n’en faisait qu’à sa tête ! Cette folie, cette déraison qui l’a toujours caractérisé sur bien des plans a rendu ses propres enfants orphelins ! Il ne semble pas qu’il s’en soit soucié à un moment ou à un autre.
Elias et Thomas étaient assis l’un à côté de l’autre, prostrés. L’homme qui s’était présenté à leur porte peu de temps avant pour annoncer la mort de leur père les avait laissés dans un état second. Aiyanna avait craint une réaction affreusement douloureuse et avait été finalement surprise du calme des deux frères. Thomas avait fixé son aîné, cherchant à comprendre. Elias avait regardé le sol un long moment, les yeux d’abord tristes puis une résignation bien trop mature pour son âge était apparue. Il semblait qu’il s’était préparé à cette nouvelle et qu’il avait fallu à peine quelques secondes pour chasser la dernière lueur d’espoir qui combattait dans son esprit. Il avait alors relevé le visage vers celui d’Aiyanna. Il demandait « et maintenant ? » avec inquiétude. La réponse n’avait pas tardé, livrée par les services sociaux. La seule famille qu’il leur restait vis-à-vis de la loi était Ortense et Hervé Janin.
— Pourquoi avoir pris la peine de venir jusqu’ici ? interrogea Aiyanna. Pour le plaisir de leur dire en face que tu refuses de les recueillir ?
— Nous devrions tous rester calmes ! intervint l’assistante sociale. Il était question d’un enfant.
— D’un enfant ? répéta Aiyanna, surprise.
Ortense releva le menton avec assurance.
— Nous allons prendre Thomas chez nous.
Un rire nerveux s’échappa de la bouche d’Aiyanna.
— Nous allons prendre, répéta-t-elle. Il ne s’agit pas d’un objet. Et ils sont deux ! Ce sont deux frères ! Vous…
Elle se tourna, le regard suppliant, vers l’assistante.
— Ils ne peuvent pas être séparés ! Ils viennent de perdre leur père et… c’est une plaisanterie !
Elle lança des yeux noirs en direction d’Ortense.
— Tu n’as donc aucun cœur !
— Pourquoi ne les récupères-tu pas tous les deux ? Ah oui ! J’oubliais. Tu ne le peux pas, rétorqua Ortense. Tu n’es rien pour cette famille. Rien ! Que mon père ait eu la folie de te prendre sous notre toit me dépasse encore ! Nous imposer ça, à nous tous… Dieu merci, aucun papier n’a été fait pour que tu aies un droit quelconque sur notre foyer et tous ceux qui en font partie !
La jalousie qu’avait toujours éprouvée Ortense à l’égard de la petite fille de trois ans arrivant dans leur maison et hypnotisant toute l’attention de ses parents et de son frère semblait plus vive que jamais. Les années s’étaient envolées sans pour autant effacer la rancœur de l’aînée de la famille.
— Nous savons tous très bien ici ce que tu es, persifla-t-elle sur un ton menaçant. Un monstre ! Par égard pour les gens que tu m’accuses de n’avoir jamais respectés, cette conversation s’arrêtera là de façon définitive !
Aiyanna serra les dents et les poings. La menace existait vraiment. Alors que la tension était à son comble et que plus rien d’autre que les deux femmes ne paraissait exister dans la pièce, quelque chose vola au-dessus de la table pour atterrir sur le visage déformé de haine d’Ortense.
L’assistante sociale écarquilla les yeux, choquée, en direction d’Elias. Il avait vu l’arme parfaite dans la part de gâteau devant lui.
— C’est toi le monstre ! cria-t-il.
— Cet enfant a toujours été ingérable ! grogna la victime de l’attaque en s’essuyant la figure. Il est comme son père et je vois difficilement comment nous pourrions le changer maintenant ! Nous n’avons pas besoin de ça dans cette maison, au milieu de nos propres enfants ! Le sujet est clos pour nous ! Thomas viendra chez nous ! L’autre, faites-en ce que vous voulez.
Elle secoua ses mains pâteuses au-dessus de l’évier vers lequel elle s’était précipitée pour se nettoyer.
— Dès que mon mari sera rentré, nous signerons les papiers.
Elle souffla, semblant chercher à reprendre son calme.
— Nous n’interdirons pas aux enfants de communiquer entre eux, bien entendu. Madame, expliqua-t-elle en direction de l’assistante, veuillez croire que je ne fais pas ça par gaieté de cœur. Je suis profondément désolée de m’être emportée, mais… il s’agissait de mon frère et malgré nos désaccords, sa mort m’attriste profondément. Le fait de ne pas être en situation de l’aider davantage me meurtrit, évidemment.
Son visage s’habilla d’une expression chagrinée. Une partie d’Aiyanna souhaitait y voir enfin un signe de sincérité, mais l’autre, désabusée, s’offusquait de la comédie se jouant devant elle.
Thomas observait autour de lui, perdu. Cette personne, censée être de sa famille, mais qu’il n’avait jamais vue, lui tendait désormais la main en direction de sa chambre pour qu’il y regroupe ses affaires. Elias fit claquer la porte d’entrée, rapidement rejoint par Aiyanna. Ils s’assirent sur les marches du perron et, l’espace d’un moment, s’imprégnèrent ensemble du silence revenu. Leurs souffles se mêlaient.
— Regarde, finit-elle par dire en tendant le doigt vers la maison d’en face.
Eliane Brochard tira son rideau aussi maladroitement que d’habitude.
— Elle doit en avoir des choses à raconter depuis le temps, tu ne crois pas ? demanda Aiyanna sur un ton amusé dans une vaine tentative de distraire le petit.
Un sourire presque forcé lui répondit. Elle voulait le consoler et il l’avait bien compris.
— Je veux rester avec toi, dit-il.
— Je ne peux pas, répondit-elle, la gorge serrée. Je n’ai aucun droit.
— Je sais que c’est pas à cause de ça, coupa-t-il.
La maturité de l’enfant n’avait jamais cessé de la surprendre. Il écoutait tout, comprenait tout. Ce fait l’inquiétait même plus que de raison. Elle le considérait à un âge qui se devait d’être fait d’insouciance et de naïveté. Les répercussions de la guerre lui avaient volé ces choses et la situation familiale avait achevé le travail.
— Je… commença-t-elle, la respiration pénible. Je ne peux pas rester ici. Je vais devoir partir. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas t’expliquer.
— On ira partout où tu veux. Et plus tard, on viendra récupérer Thomas.
— Elias, ce n’est pas une vie pour toi.
Les yeux du marmot se voilèrent de larmes contenues.
— Je m’enfuirai de tous les endroits où on me mettra ! Tu paries combien ? Je m’enfuirai, tu sais. Je veux venir avec toi. Je dirai jamais rien aux autres pour toi !
Elle le fixait, interloquée.
— Je sais que t’es pas comme tout le monde, mais moi, je m’en fiche.
Qu’avait-il pu bien comprendre de son état ? Qu’avait-il pu bien entendre ou lire ? À quel moment la petite cervelle normalement remplie de mondes imaginaires avait-elle bien pu relier des faits inacceptables même pour des adultes ? Elle baissa alors les yeux vers le sol, perdue dans ses réflexions. Imposer sa vie à un enfant ne lui paraissait pas raisonnable, mais l’idée qu’il puisse atterrir chez des étrangers ou, pire encore, être baladé de foyer en foyer la révulsait autant. Le visage décidé d’Elias au moment de menacer de fuir n’avait rien de rassurant. En le prenant avec elle, elle le séparait aussi de son frère. Tous les chemins menaient vers des impasses.
Le vent se leva. Plus un mot ne fut prononcé. Les yeux d’Elias ne quittaient pas Aiyanna, exerçant une pression invisible sur ses réflexions. Elle ferma les siens, tenta de calmer la colère qu’elle éprouvait alors envers Ortense, pour sa bêtise ; envers Éric, pour son abandon involontaire ; et envers Étienne Naville, lui ayant laissé une vie tortueuse avec ses choix assortis.
La porte s’ouvrit alors derrière eux et ils se relevèrent au passage d’Ortense tirant Thomas par la main. Au moment de monter dans la voiture, le cadet sembla enfin comprendre la situation. Son frère ne bougeait pas du palier et n’en bougerait jamais. Il s’agissait d’un départ, d’une séparation. Une douleur aiguë saisit alors la petite poitrine. La peur se fraya un chemin jusqu’à sa gorge qui libéra alors un cri larmoyant. Ortense se saisit du corps tendu vers Elias, le souleva du sol et verrouilla la portière. Elle se tourna une dernière fois vers Aiyanna et, pour la première fois, une réelle douleur transparut.
— J’aimerais pouvoir pardonner à Éric le choix imprudent de combattre de cette façon. Et peut-être qu’un jour… mais toi… toi, si tu m’avais soutenue. Il t’aurait écoutée. Il n’écoutait toujours que toi. Tu es arrivée dans ma famille et il n’y a plus eu que toi à ses yeux. Ce n’était pas de ta faute à l’époque. Je le sais. Je ne suis plus une enfant, Aiyanna. J’ai passé ce stade de rivalité idiote. Mais comment as-tu pu oublier qu’il n’était pas comme toi ? Aucun d’entre nous ne l’est ! Tous les problèmes que tu nous as apportés. Je te regarde et je vois juste quelqu’un qui s’en fiche royalement ! Tout ça, c’est fini pour nous. Si tu as un peu de bon sens, tu nous laisseras vivre tranquillement.
Elle jeta un dernier regard vers Elias, sans aucune tendresse, puis pénétra dans la voiture avant de disparaître au premier virage de la rue.
— Vous avez été recueillie par les Bretaudeau, c’est bien cela ? interpella une voix depuis le pas de la porte.
L’assistante sociale, la pochette sous le bras, n’avait cessé d’être déconcertée. Aiyanna fit signe à Elias de rejoindre sa chambre un moment puis s’approcha de sa visiteuse.
— Vous n’êtes pas du coin apparemment, constata-t-elle, blasée.
— Je viens effectivement d’arriver.
Aiyanna s’appuya sur l’encadrement de l’entrée.
— Mon père était un médecin réputé de la région et était le meilleur ami de Pascal Bretaudeau. Il souffrait de problèmes psychologiques et après la mort de ma mère en couche alors qu’il était à la guerre, son état s’est empiré. Il a été interné, et Inès et Pascal m’ont récupérée.
— Votre père vit toujours ?
— Non. Il est mort lorsque j’avais treize ans. Je ne l’ai jamais connu.
— Les Bretaudeau n’ont jamais fait les démarches d’adoption ?
— Je crois que Pascal espérait un miracle pour la santé de son meilleur ami. Et quand il est mort, il n’a pas jugé nécessaire de s’encombrer de paperasses. Personne n’envisage que les choses puissent mal tourner à un moment ou à un autre. Pas à ce point-là, en tout cas. Après 1918, Pascal a souffert de mauvaises blessures mal soignées qui ont fini par le tuer à petit feu. Sa femme est décédée quelques années plus tard dans un accident de voiture en revenant du travail. Elle s’est endormie au volant. Elle accumulait les heures à l’hôpital. La femme d’Éric, mon demi-frère, est morte d’un cancer il y a cinq ans. Et pour finir, Ortense et Éric se sont fâchés pour des questions politiques. Il ne s’agit plus de mauvaise situation familiale, mais de malédiction, ironisa-t-elle.
— Vous n’avez plus personne ? demanda l’interrogatrice.
— Non.
— Il y a le petit. Il vous aime énormément.
— Je sais, souffla Aiyanna. Je sais. Puis-je… puis-je le garder jusqu’à la fin de la semaine ?
— Prenez le temps de réfléchir. Et tenez-moi au courant. Vous n’avez peut-être pas de lien de sang avec les Bretaudeau, mais la situation fait que vous seriez la mieux placée pour recueillir Elias. Personne n’y trouverait d’objection. Et vu qu’Ortense Janin a renoncé à ses droits sur lui, elle n’aurait pas son mot à dire non plus. Cela vaut la peine d’y penser.
Elle jeta ses dossiers sur le siège arrière de son véhicule et se dirigea vers le devant avant de stopper son pas, les sourcils froncés.
— Votre mère est décédée pendant la Première Guerre ? Vous faites au moins dix ans de moins que votre âge ! Il faudra me donner le secret, rit-elle. À bientôt !
Elle s’engouffra dans la voiture et suivit le même chemin que la précédente.
La nuit tomba lentement. Elias n’était pas ressorti de sa chambre depuis le départ de Thomas. Il était allongé sur le ventre sur le lit, les yeux hagards, attendant de savoir ce qu’il allait advenir de lui. Deux niveaux plus bas, Aiyanna tournait en rond, longeant les étagères de livres, ses doigts glissant sur chaque tranche. Elle en tira une volontairement et un loquet se déverrouilla, ouvrant le passage de la pièce secrète, comme l’appelaient les enfants. D’une main, elle écarta une toile d’araignée et releva le vieil interrupteur. L’endroit était lugubre. Plus effrayant en pleine lumière que dans le noir. Les plans de travail étaient recouverts de poussière, cachant une série d’instruments médicaux abîmés. Un immense bureau de chêne se tenait dans un coin de la pièce, encore doté de son encrier et de feuilles usées. Un petit tas de carnets, visiblement mieux entretenus que le reste, trônaient au milieu de diverses revues. Ils faisaient partie de la collection se trouvant dans la bibliothèque, mais, eux, étaient particuliers. Elle tira la chaise, faisant grincer les pieds sur le sol, et l’épousseta avant de s’assoir. Elle ouvrit le premier carnet devant elle. Elle le connaissait déjà par cœur. Elle les connaissait tous déjà par cœur. Sa propre obstination à vouloir les garder et les relire sans arrêt l’effrayait. Fallait-il y voir du sadisme envers sa propre personne ? Quel intérêt pouvait-elle trouver à revenir aux passages les plus cruels ? Comment pourrait-elle élever un enfant et l’aider à se trouver alors qu’elle-même se cherchait ? Les pages se tournaient, libérant toujours les mêmes mots.
« J’ai parfois l’impression furieuse de ne plus être à l’intérieur de mon propre corps. Je suis là, au-dessus, et je regarde, pétrifié, l’homme que je suis censé être et qui me dégoûte. Sa fragilité me dégoûte ! Son incompétence me dégoûte ! Et que dire de sa mortalité ? Je la sens au creux de moi. Elle est vicieuse. Elle s’insinue et me nargue. Croit-elle vraiment qu’elle me vaincra ? »