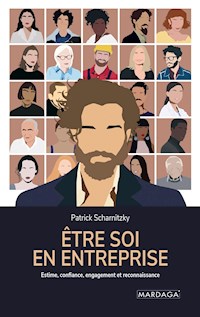
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Si vous vous interrogez sur qui vous êtes réellement et si vous demandez souvent comment trouver votre place dans une société sans cesse en évolution, n'hésitez plus, ce livre est fait pour vous !
Le monde de l’entreprise ne cesse d’évoluer : alors que l’obtention du CDI, autrefois tout-puissant, est en perte de vitesse, le bien-être au travail gagne en importance et devient facteur d’attractivité, de fidélisation ainsi que d’engagement. Et chaque entreprise se doit d’adapter son identité et ses valeurs à ces évolutions.
Alors, comment s'engager et engager les salariés dans un système en pleine mutation ? Plus précisément, comment se définir individuellement et au sein du collectif ? Comment avoir confiance en soi, en l'autre et dans ce système ? Selon Patrick Scharnitzky, il est plus que jamais nécessaire de repenser le bien-être au travail, dans une perspective identitaire respectueuse des différences de chacun. Dans cet ouvrage, l’auteur propose un modèle circulaire, où sont explorées les questions qui animent aujourd’hui l’entreprise et ses acteurs en mettant la notion d’« identité » au centre de sa réflexion.
En s’appuyant sur des théories en psychologie sociale, des travaux scientifiques et des exemples concrets de la vie en entreprise, Patrick Scharnitzky démontre que confiance, estime de soi et sentiment d'appartenance sont interdépendants de l'engagement et de la performance. Et la clé de voûte de cet ensemble est la reconnaissance sociale.
Un ouvrage incontournable, pragmatique et concret, qui donne les clés pour faciliter la réalisation de tout un chacun en entreprise !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Patrick Scharnitzky défend qu'il est plus que jamais nécessaire de repenser le bien-être au travail, dans une perspective identitaire respectueuse des différences de chacun." - Entreprendre Aujourd'hui
"Pour développer une confiance suffisante il faut non seulement interagir souvent ensemble, communiquer pour mieux se comprendre et surtout avoir quelque chose à y gagner mutuellement." - Pourquoi Docteur
À PROPOS DE L'AUTEUR
Patrick Scharnitzsky est docteur en psychologie sociale. Maitre de conférences pendant plus de dix ans à l'université, il est aujourd'hui conférencier et formateur pour les entreprises (notamment au sein du réseau APM). Il est également directeur associé au sein du cabinet de consultance AlterNego, qui accompagne les entreprises sur tous les sujets concernant le management de la diversité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Être soi en entreprise
Patrick Scharnitzky
Être soi en entreprise
Estime, confiance, engagement et reconnaissance
Je dédie ce livre à toutes les identités oubliées, à toutes celles et ceux qui ne trouvent pas leur place, ou qui se sentent exclu·e·s, car il n’existe sûrement nul autre sentiment aussi désagréable et dévastateur.
Préambule
La pertinence de ce livre ne repose pas sur un énième schéma visant à démontrer le lien entre bien-être individuel et performance collective dans les entreprises. Cet ouvrage n’est ni le plaidoyer d’un management bienveillant mettant l’humain au cœur des organisations, ni une leçon de morale cherchant à prouver de façon culpabilisatrice que l’entreprise a rompu la relation de confiance qu’elle doit entretenir avec ses acteurs.
Sans en être la finalité, nous aborderons néanmoins tous ces sujets, mais par le prisme d’un concept oublié, méprisé parfois, et flou car protéiforme. Un concept qui n’a pas trouvé sa place dans les modèles d’analyse de l’entreprise car sans doute perçu comme trop psychologisant, voire totalement inaudible : l’identité.
Au cœur de la relation entre l’acteur et le collectif, et entre le collectif et le système, l’identité nous distingue les uns des autres, nous positionne dans un système en respectant deux niveaux de besoins antagonistes : être unique, et perçu comme tel, et être inscrit dans un partage culturel. Beau challenge !
L’entreprise a, pour l’instant, quelque peu raté son rendez-vous avec cette notion d’« identité ». On a pensé des modèles de management et des stratégies de transformation, des systèmes d’organisation, de dynamiques de coopération et de bien-être au travail tout en escamotant les questions originelles inhérentes à ces actions : qui sont les acteurs qui composent et animent les systèmes organisationnels ? Comment se définissent-ils ? Comment se reconnaissent-ils les uns les autres ? Comment peuvent-ils partager une identité commune sans devenir confondables ? Comment cette identité et le sentiment d’appartenance qui lui est associé sont-ils intrinsèques d’une nécessaire image de soi positive ? Comment, par extension, peut se développer une confortable confiance en soi, dans les autres et dans le système ? Comment transformer cette confiance dans un engagement individuel et dans le collectif ? Et enfin, comment reconnaître l’engagement, les efforts et le travail fourni pour réalimenter le système du renforcement identitaire ?
Toutes ces questions constituent un préalable ignoré jusqu’à ce jour. Aussi cet ouvrage a-t-il l’ambition d’apporter des éléments de réponse concrets destinés aux acteurs des organisations qui souhaitent se repenser.
Sera d’abord abordé le concept d’« identité individuelle », introduit avec l’intention contre-intuitive de souligner, dans une approche psychosociale, la difficulté d’évoquer une identité qui ne soit pas sociale. Nous montrerons que la matrice composée de tous nos groupes d’appartenance et la valeur identitaire que nous accordons à chacun d’entre eux représentent les vecteurs préférentiels de notre identité sociale.
Ensuite sera examinée la place accordée à l’identité sociale au sein de l’entreprise. Comment trouver, dans ce système historiquement conformiste et codifié, mais aussi dynamique, son identité professionnelle, qui relève elle-même d’un subtil état d’équilibre entre respect de l’unicité et partage culturel avec le collectif ? Quelles sont les dérives possibles et les réponses proposées ?
Enfin, nous démontrerons que la notion de « reconnaissance sociale » est cruciale dans cette approche : par son impact, d’une part, sur l’estime de soi et la confiance en soi, en autrui et dans le système – postures nécessitant chacune un habile dosage –, et d’autre part sur l’engagement – posture motivationnelle clef de la performance.
Nous présenterons donc ici un modèle circulaire incluant de façon interdépendante sentiment d’appartenance à l’entreprise, estime du soi social, confiance, engagement et reconnaissance professionnelle, en étayant notre propos par des travaux scientifiques en sociologie, psychologie et psychologie sociale, et en nous appuyant sur des exemples concrets issus de la vie en entreprise, tout en adressant des conseils pratiques aux différents acteurs de l’entreprise.
À toutes fins utiles, précisons, que, bien qu’indispensable aujourd’hui, nous avons volontairement omis de recourir à l’écriture inclusive dans cet ouvrage, car elle aurait considérablement alourdi le texte. Il ne s’agit ni de mépris ni d’impudence, car notre réflexion concerne autant les femmes que les hommes, de tous les âges, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, toutes les diversités. En somme, toutes les identités.
CHAPITRE 1 L’identité individuelle : qui suis-je ?
Introduction
Le concept d’« identité » n’échappe pas à la règle de la diversité des approches théoriques en sciences humaines. Ce sont historiquement les approches psychologiques centrées sur la personne qui ont ouvert le bal pour définir l’identité, à travers le concept du « soi » (Lévi-Strauss, 1977 ; Kaufmann, 2004 ; Marc, 2005). Originellement portée par la psychanalyse et relayée aujourd’hui par les neurosciences, l’identité a été analysée comme le cœur de ce qui nous constitue, pour nous singulariser et nous décrire. Au cœur de notre identité individuelle et singulière, on retrouve notre personnalité, nos aptitudes et nos goûts. Mais peut-on envisager l’identité de façon « non sociale » ?
1. L’identité de reconnaissance
L’approche psychologique portée par le psychanalyste Erik H. Erikson (1974) s’inscrit dans les théories du développement affectif de l’individu. On cherche à comprendre les fondements de ce qui détermine le cœur de l’identité, c’est-à-dire la définition d’un « soi ». Le soi serait ainsi composé des caractéristiques que chaque personne identifie comme siennes. Qui pensons-nous être et quels sont les éléments centraux qui nous définissent ? On comprend d’entrée de jeu que le soi ne peut être qu’une perception subjective et qu’il est impossible d’imaginer l’identité délimitée dans une quelconque forme d’exactitude, hormis quand elle répond à un besoin de nous identifier et non de nous définir. C’est l’identité de reconnaissance.
Composée de tous les éléments distinctifs qui permettent de se reconnaître et d’être reconnu par les autres, elle se caractérise par trois constantes : l’unicité, la stabilité et la durabilité.
• L’unicité correspond au fait que cette identité de reconnaissance permet de nous singulariser, de nous rendre unique, c’est-à-dire sans confusion avec une autre personne. Notons néanmoins que la composante d’unicité de notre identité de reconnaissance, et nous y reviendrons, n’est pas si anodine, car elle peut prendre une valeur sociale forte. Nous avons plaisir à être uniques et non interchangeables, à être original et socialement distancié des autres, avec toutes les dérives que cela peut représenter dans les relations sociales.
• La stabilité caractérise le fait que notre identité de reconnaissance permet de nous identifier, quels que soient les contextes, à un instant T. On peut nous reconnaître indépendamment de notre tenue vestimentaire, du lieu dans lequel nous nous trouvons ou de la situation que nous vivons. Le physique, la voix, les rituels comportementaux sont autant de marqueurs de notre identité de reconnaissance, pour soi et pour les autres. Là encore, notons la composante sociale qui lui est associée. En effet, la stabilité est socialement appréciée car elle légitime la reconnaissance de soi et par les autres et est synonyme de « bon sens normatif » dans un environnement social donné. La stabilité émotionnelle est notamment une compétence recherchée en entreprise et calibrée dans les tests de personnalité. On retrouve aussi cette dimension sociale dans le fait d’être capable de « rester soi-même », sans être trop facilement sous l’influence des autres.
• Enfin, la durabilité donne à cette identité de reconnaissance une dimension immuable dans le temps. Nous évoluons mais nous sommes la même personne toute notre vie. Si on prend l’exemple schématique de l’apparence physique, celle-ci change mais, à chaque étape de notre vie, des caractéristiques immuables permettent de nous reconnaître et d’être reconnu, telles que la couleur des yeux, la forme globale du visage ou encore les empreintes digitales. Comme pour l’unicité et la stabilité, rester durablement le même est apprécié car le temps possède une valeur sociale sûre. On peut être admiratif d’un couple marié depuis cinquante ans sans même savoir si la relation fut harmonieuse, ou de la façon dont une personne a défendu les mêmes idées toute sa vie indépendamment de leur contenu. Dans le milieu professionnel, l’ancienneté d’un salarié est également très fortement associée à son engagement. Avoir « trente-cinq ans de maison » montre que l’on est un salarié loyal, ce qui sous-entendrait forcément un lien entre le temps et l’implication dans son travail.
Ces trois composantes de l’identité de reconnaissance se retrouvent par exemple dans notre numéro de Sécurité sociale. Référent utilisé à différentes fins, il est le même toute notre vie et nous rend uniques. Mais il ne dit rien de notre personnalité, de nos goûts ou de nos compétences.
2. L’identité descriptive
La seconde dimension de notre identité individuelle ne repose pas sur ce qui nous distingue, mais sur ce qui nous décrit. Imaginez que vous deviez répondre à la question « Qui suis-je ? ». Vous pourriez tout aussi bien dire « Je suis introverti », « Je suis fan de Mozart » ou encore « Je suis doué pour les maths ». Vos réponses pourraient donc être très nombreuses et très variées. Mais elles seraient toutes en rapport avec la question et toutes seraient le produit de votre discours et donc du regard que vous portez sur vous-même. Cela induit nécessairement une dimension perceptive, et donc subjective, car il est impossible d’isoler exactement les éléments objectifs de notre identité. Il existe bien sûr toutes sortes de tests dont l’objectif est de mesurer notre intelligence, nos émotions ou notre personnalité, mais, d’une part, ils sont calibrés selon un certain prisme socioculturel et, d’autre part, ils ne produisent qu’un résultat qui positionne chacun sur une courbe de Gauss représentant la distribution normale des personnes dans le même écosystème. Ces tests permettent certes de nous positionner et de réduire l’écart avec la perception sociale par soi-même et par les autres, mais ils ne peuvent en aucun cas nous décrire objectivement.
Dans cette identité descriptive, on retrouve trois grandes dimensions majeures : la personnalité (« comment je suis »), les aptitudes (« ce que je sais ou ne sais pas faire ») et les goûts (« ce que j’aime »). On ne retient ici que ces trois dimensions car, même si, comme nous le verrons plus tard, elles se construisent dans la relation indirecte ou inconsciente, elles peuvent se définir et être agies indépendamment d’une situation ou d’un contexte social. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, des opinions et valeurs qui sont constitutivement construites et actives dans des interactions sociales. Autrement dit, même si on considère qu’« aimer le bleu » peut être le fruit d’influences inconscientes dans la petite enfance liées à une exposition plaisante à cette couleur, cette caractéristique de goût peut exister en soi, sans objet et sans contexte. En revanche, avoir une opinion sur son manager et constater le degré de partage avec ses valeurs n’a de sens que par rapport à cet objet précis qui est forcément social.
La personnalité
Il s’agit d’un terme extrêmement vague et confus, compte tenu du nombre de définitions existantes selon les contextes dans lesquels on l’utilise. Petit détour par les théoriciens pour cerner la complexité de ce concept. On retrouve dans la personnalité ce qui fait de chaque personne un exemplaire unique et différencié.
Ainsi, le psychologue et psychanalyste Roger Perron (1986) la définit comme « l’ensemble des caractéristiques d’une personne donnée, qui définissent son individualité et permettent de la distinguer de tout autre être humain ». Dans son approche, il met l’accent sur l’unicité comme si la personnalité était une entité figée, composée d’une liste de caractéristiques, ce qui correspond davantage à ce qu’on appellerait le « caractère ». Or, la personnalité est une structure dynamique à l’intérieur de laquelle les caractéristiques sont en interaction. La curiosité associée à la méchanceté ne donne pas du tout le même cocktail que si elle est mise à disposition d’une posture bienveillante.
Le professeur de psychologie Gordon W. Allport (1950), dans une analyse pourtant antérieure et dans une approche davantage psychosociale, définit la personnalité comme une « organisation dynamique, régnant au plus profond de l’individu, des systèmes psychologiques qui déterminent sa façon unique de s’adapter à son environnement ». On retrouve ici trois composantes essentielles : la personnalité décrit ce qui est au plus profond de nous, elle nous agit de façon dynamique et elle est nécessairement sociale avec la notion d’« adaptation ». Capacité très recherchée aujourd’hui par les entreprises, tant les modes d’organisation et les modalités de travail évoluent vite, l’adaptation inscrit nécessairement la personnalité dans une relation sociale, quel qu’en soit l’objet.
Si on essaie de définir de façon plus standardisée la personnalité, on peut se référer à la psychométrie et aux dimensions prises en compte dans sa mesure. La référence en matière de test de personnalité est le modèle des « Big Five » (Goldberg, 1981), qui résume la personnalité en cinq axes bipolaires, couvrant ses différentes facettes et permettant de positionner les individus sur des échelles. Issu de travaux remontant aux années 1950, c’est dans les années 1990 que ce modèle devient très populaire au sein des entreprises. On y retrouve les cinq dimensions suivantes dans un modèle dit « OCEAN », acronyme de ces différentes dimensions :
• Ouverture d’esprit : ce qui se manifeste par la curiosité, la volonté de découvrir l’inconnu, de s’ouvrir à des idées nouvelles et/ou peu communes, la propension à ne pas se conformer, à imaginer et à créer ;
• Conscienciosité : on regroupe ici tout ce qui concerne l’autodiscipline, la persévérance, la rigueur, le respect des obligations, l’organisation et l’orientation de soi vers des buts bien définis ;
• Extraversion : c’est la capacité à interagir avec l’autre, à communiquer de façon enthousiaste, à prendre la parole en public ou à aborder un inconnu. Cela traduit une aisance sociale dans la relation avec les autres et un plaisir à être mis en lumière ;
• Agréabilité : cette dimension renvoie à la part émotionnelle et empathique de la relation à l’autre. Elle reflète une sensibilité aux problèmes des autres, mais aussi une capacité à être disponible, altruiste, à écouter et à faire confiance ;
• Névrosisme : ce dernier axe correspond au degré de stabilité émotionnelle et à la capacité à gérer ou non ses émotions, à contrôler son stress, à se libérer de ses tensions et à rester calme dans des situations difficiles.
Il est important de noter que ces dimensions sont analysées dans la façon dont elles interagissent et permettent de dessiner un profil global de personnalité à l’intersection du score obtenu.
Au sein des entreprises, la personnalité correspond au savoir-être, ou ce que l’on appelle les soft skills (Lévy-Leboyer, 2005). Elles sont aujourd’hui au cœur de la fameuse « guerre des talents » que les grandes entreprises se livrent sur le terrain de nouveaux enjeux liés à l’organisation du travail et des nouveaux modèles managériaux. Face aux attentes liées à la façon dont nous envisageons le travail aujourd’hui, les entreprises misent de plus en plus sur des candidats et des salariés capables de faire du feedback, de déléguer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas les meilleurs, de coopérer et de maîtriser leurs émotions. Désormais, la personnalité devient un enjeu important dans le partage d’une culture commune, au-delà des compétences techniques et des diplômes.
On retrouve également dans la personnalité la notion de « motivation », qui pourrait se définir par la capacité à mettre en marche une énergie nécessaire pour atteindre un but. Par exemple, plus on est déterminé, plus on sera capable de mobiliser de l’énergie, plus on sera motivé à atteindre un objectif. Dans l’entreprise, on fait la distinction entre les niveaux intrinsèque et extrinsèque (Deci & Ryan, 2002). La motivation intrinsèque génère une action conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que l’individu trouve à l’action, sans attente de récompense externe. Elle est donc structurelle, au sens où elle est sous-tendue par la personnalité, les valeurs et les croyances de l’acteur. Elle peut être mue par des besoins d’indépendance, de reconnaissance, de sécurité ou de sens (Pink, 2009). On lui oppose la motivation extrinsèque quand l’action est provoquée par une circonstance extérieure à l’individu : punition, récompense, pression sociale, obtention de l’approbation d’une tierce personne… Elle est donc plus conjoncturelle et dépendante du contexte de l’entreprise et de l’activité professionnelle. La motivation extrinsèque la plus visible est la rémunération, même si elle n’est pas toujours la plus importante.
Les aptitudes
Nous pouvons nous définir par notre personnalité mais aussi par tout ce que nous savons et/ou ne savons pas faire. On discerne deux dimensions importantes dans cette grande catégorie des aptitudes.
D’une part, l’intelligence logique, c’est-à-dire la capacité à raisonner : elle se mesure indépendamment de la matière sur laquelle on pense, elle caractérise la capacité à penser, à poser des arguments et des déductions pour répondre à des problèmes. On la définit par des tests d’intelligence, dont le fameux « quotient intellectuel », qui évalue l’écart entre son âge réel et son âge mental. Chez l’enfant par exemple, le résultat permet de le situer par rapport aux seuils déterminant un retard, une « normalité » ou une précocité mentale. Le raisonnement logique n’est pas la seule forme d’intelligence, mais il joue un rôle prépondérant en raison de l’importance qu’on lui accorde socialement.
D’autre part, la culture et le savoir, car on peut en effet aussi se définir par le degré de connaissances que l’on a accumulées. Le savoir correspond à la quantité d’informations emmagasinées dans la mémoire, sans référence à la façon dont on peut les utiliser. Et là encore, les codes sociaux accordent une importance considérable à cette dimension pour évaluer et situer les individus. Nous sommes bluffés par ceux qui pratiquent cinq langues, qui connaissent parfaitement tous les détails d’une période de l’Histoire ou qui emploient un vocabulaire très riche. Mais en quoi ces dispositions nous renseignent-elles sur leur personnalité, leurs valeurs ou leur capacité à penser ? Ce poids social démesuré donné à la connaissance est le produit de notre culture, de la façon dont l’école et l’instruction sont conçues. L’école fait malheureusement plus de place à la connaissance qu’à la compréhension. Comme il est fréquent de faire apprendre par cœur des récitations à des enfants qui les déclament sans vérifier qu’ils les comprennent ! La connaissance est un outil de valorisation sociale et de distanciation entre les individus, incarné le plus souvent par le diplôme, véritable étiquetage social. Ne sommes-nous pas plus impressionnés par un sachant, même sans intelligence pédagogique, que par un plombier peut-être moins cultivé mais qui saurait inventer une solution sur mesure à une fuite inédite ? La culture est une norme sociale forte qui impacte résolument notre identité au point de pouvoir nous rendre surconfiants ou, inversement, autoflagellants. Par ailleurs, au sein de ces savoirs, on trouve le savoir-faire, c’est-à-dire les compétences opératoires dans un champ d’expertise donné. C’est une forme de savoir appliquée à un domaine composée d’éléments de connaissances spécifiques, telles que l’expertise technique, ou encore issue du fruit de l’expérience.
Les goûts
Au-delà de notre personnalité et de nos aptitudes, nos goûts, nos zones de confort, de satisfaction et de plaisir définissent aussi notre identité. Dire que l’on est fan de Mozart décrit bien une identité et peut fortement conditionner les dépenses, les choix de vie, les relations aux autres ou même le choix du logement pour pouvoir l’écouter dans des conditions optimales. Et là encore, la marque du conditionnement social imprègne nos goûts. Ils sont informatifs pour les autres car très codifiés. Affirmer qu’on aime le sport plutôt que le cinéma, qu’on préfère le football au tennis et qu’on supporte Rennes plutôt que le PSG véhicule en soi des informations culturellement codifiées qui passent par le prisme des stéréotypes et des codes partagés ou non de celle ou celui à qui on le dit. De la même façon, ces goûts naissent et se développent toujours dans un contexte social, culturel et surtout familial fort. Le principe même de la culture, quel que soit le niveau de référence, est bâti sur le principe du partage des pratiques et des goûts. Sinon, comment expliquer que l’organe du palais soit plus ou moins sensible et friand de telle ou telle nourriture ? Comment interpréter que, dans un même groupe socio-économique, on donne les mêmes prénoms aux enfants, on choisisse les mêmes destinations de vacances, on roule dans les mêmes voitures ?
3. Le poids de l’éducation et de la petite enfance sur notre identité
L’étape de la petite enfance est un sujet crucial quand on veut comprendre la personnalité et l’identité individuelle tant elle alimente, encore aujourd’hui, une confrontation métaphysique entre l’inné et l’acquis. Comment expliquer qu’un nouveau-né présente des comportements et des goûts marqués dans son rapport au sommeil, à l’alimentation ou au fait d’aimer la tétine ou non ? Comment expliquer qu’on puisse observer chez un enfant les mêmes tics comportementaux ou la même personnalité que possède un de ses deux parents, et que ces manifestations s’expriment très tôt ? Comment expliquer que deux frères d’un an d’écart, élevés par les deux mêmes parents dans le même contexte familial, puissent avoir des personnalités et des goûts totalement différents ? Toutes ces questions sont posées et explorées de façon plus ou moins scientifique depuis plus d’un siècle. Les neurosciences apportent des explications et une modélisation assez indiscutables. Nous savons aujourd’hui que le cerveau est plastique et se développe anatomiquement au regard des stimulations extérieures, et ce, dès la vie intra-utérine. Par ailleurs, seulement 10 % des connexions neuronales en partie responsables des capacités cognitives, de la sensibilité sensorielle et donc, par extension, de la personnalité sont établies avant la naissance : toutes les autres ont lieu ensuite, au diapason des stimulations extérieures. En clair, les gènes transmettent notre capital physique et physiologique, tout le reste est construit par l’environnement au sens large. Alors, bien sûr, il peut y avoir des impacts indirects des gènes sur notre personnalité, par la valeur sociale accordée à certaines caractéristiques physiques par exemple. En effet, comment ne pas imaginer qu’il est plus facile d’avoir une bonne image de soi, et donc un meilleur niveau de confiance, quand on est grand et beau que l’inverse ?
Au-delà de cette épineuse question de l’origine innée ou non de notre personnalité, des travaux ont depuis longtemps montré de façon empirique l’impact de l’éducation et des valeurs précoces sur celle-ci. La référence historique en la matière est le philosophe et sociologue Theodor W. Adorno, et ses travaux sur la personnalité autoritaire (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1950). En choisissant l’angle de la discrimination, il veut démontrer que l’autoritarisme est un style de personnalité qui trouverait son origine au sein de la famille et engloberait différentes expressions de la pensée rigide.
Après la seconde guerre mondiale, Theodor W. Adorno et ses collaborateurs mettent en place une étude pionnière pour comprendre le fascisme, et particulièrement pour révéler les dispositions autoritaires pouvant mener à ce système politique, et ainsi mettre au jour les types de personnalité corrélés aux formes de discrimination. Quelque deux mille Américains blancs de « classe moyenne » acceptent le jeu de cette enquête basée sur différents outils de mesure : des questionnaires, des entretiens cliniques et des tests projectifs de personnalité.
Les questionnaires servent à comprendre et délimiter les opinions des répondants. Ces derniers devant situer leur opinion quant à des énoncés qui abordent différents thèmes psychosociologiques. Adorno répartit leurs réponses sur des échelles définies par lui-même. Par exemple, l’échelle F (fascisme), l’échelle E (ethnocentrisme) ou encore l’échelle A-S (antisémitisme). Les résultats de cette première partie de l’étude dévoilent des concordances particulières entre l’autoritarisme et les préjugés de participants dits « autoritaires » à l’égard de certains groupes ethniques. Plus précisément, les sujets affirment être indifférents à des points de vue divergents, admettent être influencés par quiconque possédant un statut supérieur au leur et déclarent se reposer sur les normes sociales et morales. Fait éloquent, ces « autoritaires » expriment également un a priori positif à l’égard des forces de l’ordre. Tout en excluant toute forme de différence, ils se réclament d’une supériorité raciale et nationale.
Les entretiens cliniques et les tests de personnalité projectifs (TAT ou Rorschach, par exemple) sont utilisés afin d’examiner de façon plus large les schémas psychologiques de certains des sujets soumis aux questionnaires. Sont notamment abordés les thèmes suivants : l’identité, la famille ou encore l’origine de la personnalité. Les résultats de cette seconde partie corroborent les précédents. Concernant l’identité, les participants dits « autoritaires » se distinguent par leur narcissisme et leurs stratégies constantes de comparaison sociale, quand les autres répondants se manifestent plus objectivement en favorisant entre autres l’égalité et la réciprocité dans leurs relations à autrui. Quant à leur représentation de la famille, les sujets dits « autoritaires » entretiennent une image sublimée de leurs parents et une image péjorative du sexe opposé. Ils ciblent chez le conjoint les qualités morales, l’ambition et le courage, contrairement aux autres sujets qui évoquent la sociabilité ou le partage d’intérêts communs. Enfin, relativement à leur perception de l’origine de la personnalité, quand les sujets dits « non autoritaires » définissent la personnalité par le parcours social, l’environnement et l’influence d’autrui, les personnes dites « autoritaires » estiment quant à elles que les gènes sont constitutifs de la personnalité, donc que celle-ci est héréditaire. Dans la dénégation des représentations du fonctionnement psychologique, ces individus sont détachés des dynamiques inconscientes et affichent clairement la volonté de se maîtriser.
Cette analyse fait ressortir deux conclusions corrélées :
1) La personnalité autoritaire serait structurée pendant l’enfance, en raison d’un modèle éducatif et d’un système familial la favorisant. En effet, dans les témoignages des sujets dits « autoritaires », diverses formes d’éducation sont récurrentes. D’une part, la rigidité dans un environnement social et affectif où l’autorité est imposée : l’enfant n’a pas la liberté d’exprimer son opinion au sein d’un environnement familial autoritaire qui le soumet sans explication à sa vision du monde. D’autre part, justement, cette absence d’explication : l’enfant reçoit une vision du monde social incontestable sans validation intellectuelle ni remise en question, où réflexion et construction personnalisée sont exclues. Par ailleurs, la vision du monde transmise à l’enfant est résolument manichéenne : la réalité sociale s’observe par le prisme du bien et du mal, le noir et le blanc, ce qui définit un homme et ce qui définit une femme. Sans demi-mesure ni nuances, selon un individu dit « autoritaire », un homme ne peut donc être considéré comme féministe.
2) La personnalité autoritaire présente des opinions radicales toutes reliées les unes aux autres dans un syndrome de personnalité formé d’un noyau de rigidité intellectuelle duquel se diffuse prises de position, attitudes et opinions. Les individus dits « autoritaires » se jugent omnipotents, en quête de contrôle et dénigrent leur propre fonctionnement psychologique, mais aussi l’influence des autres et la culture. Tout en excluant toute forme de disparité quant à l’appartenance ethnique, le genre, la religion, les pratiques sociales et morales, les individus dits « autoritaires » valorisent leur propre identité et leurs groupes d’appartenance et ont une haute estime d’un système autoritaire fondé sur l’ordre et la répression (Scharnitzky, 2006).
Même si le contenu des réponses recueillies par Adorno n’a de sens que dans un contexte historique et culturel donné, il fait malgré tout la démonstration implacable du poids de l’éducation, des identifications et des valeurs les plus précoces sur le style de personnalité et sur l’identité.
4. Peut-on parler d’une identité non sociale ?
Nous venons de passer en revue tous les constituants de l’identité individuelle. Ce qui nous distingue des autres et qui nous rend uniques afin d’être reconnus et non pas confondus. L’exemple caricatural du numéro de Sécurité sociale est parlant. Il s’agit d’un matricule unique, identique tout au long de notre vie. Mais à bien y regarder, de quoi se compose ce numéro ? Quinze chiffres, dont les dix premiers sont des référents sociaux. Le premier désigne le sexe avec un choix répondant à une norme sexuée, puisque le « 1 » correspond aux hommes et le « 2 » aux femmes, alors qu’un choix non connoté socialement aurait amené à les désigner en fonction de l’ordre alphabétique. Les quatre suivants correspondent à l’année et au mois de naissance, ce qui renvoie également à une catégorie d’appartenance liée à l’âge. Les cinq suivants caractérisent le département et la commune de naissance, et là encore, il s’agit d’une catégorie liée à l’origine régionale. En réalité, ce qui constitue notre identité et notre singularité correspond en grande partie à la composition de nos différents groupes sociaux d’appartenance.
Si on reprend les différentes dimensions de l’identité individuelle présentées dans ce chapitre, on constate chaque fois la connotation et l’influence sociale sur notre identité. L’unicité renvoie à l’originalité, tant l’interchangeabilité sociale est une valeur négative. La stabilité et la durabilité renvoient également à des codes sociaux valorisés : la cohérence, la fidélité et la permanence de nos opinions et de nos actes. Et que dire des composantes descriptives de notre identité ? La personnalité et les codes sociaux puissants qui sont associés à telle ou telle dimension, la valeur sociale que nous assimilons à la culture et à l’intelligence comme les marqueurs culturels attribués à nos goûts sont autant de preuves que notre identité se construit dans et par le contexte culturel dans lequel nous évoluons.
Depuis notre naissance, notre identité se construit par un jeu d’influences en miroir avec les autres, les normes, les valeurs, le système politique, la religion, tant au niveau micro de la famille qu’au niveau macro de la culture dans son ensemble. Du mimétisme du sourire de ses parents par le nouveau-né au destin professionnel, en passant par les choix des activités sportives et culturelles pendant l’éducation, quasiment tout ce que nous sommes est le produit de notre environnement au sens large. Même la psychanalyse développe, de son propre aveu, une explication psychosociale au sens propre du terme, bien qu’elle ne le clame pas haut et fort. Quand on observe la liste des mécanismes de défense mis en place pour gérer le décalage entre la toute-puissance et le principe de réalité, tout est affaire de relations à l’autre. Les déplacements qui consistent à choisir un bouc émissaire sur lequel déverser sa frustration, l’évitement, le déni ou encore la surcompensation sont autant de comportements d’autoprotection identitaire qui s’instaurent dans et à cause des relations sociales qui nous sont indispensables.
Comment alors imaginer répondre à cette simple question « Qui suis-je ? », suggérée au début de ce chapitre, sans faire automatiquement le lien avec des référents sociaux ? C’est précisément le point de départ d’une étude menée par Manford H. Kuhn et Thomas S. McPartland (1954). Le test proposé est composé de cette unique question, répétée vingt fois de suite, d’où son nom : Twenty Statements Test (TST). Les résultats des participants ont montré que les réponses font majoritairement référence à des groupes d’appartenance, comme l’âge, le sexe, la nationalité ou la couleur de la peau. Plus intéressant encore, la place et le pouvoir qu’occupent ces différents groupes sociaux sont différemment référencés dans les réponses. Par exemple, les femmes mentionnent plus souvent leur sexe que les hommes car, dans un contexte de sexisme culturel, être une femme est un marqueur identitaire plus fort qu’être un homme. Réciproquement, on évoque volontiers son métier comme référent identitaire quand celui-ci est socialement prestigieux plutôt que le contraire.
À la lueur de ces éléments, il ne nous semble pas raisonnable d’envisager le concept d’« identité » sans sa composante sociale, immanquablement et à chaque instant de notre vie constitutive de ce que nous sommes, pensons, faisons et décidons. Néanmoins, l’influence sociologique n’est pas l’unique élément qui nous intéresse ici. Certes, les rapports de force dans la société et le poids des idéologies dominantes nous influencent mais c’est bien au point d’équilibre entre les deux approches que nous nous situons pour aborder, dans le deuxième chapitre, le concept d’« identité sociale ».
SYNTHÈSE CHAPITRE 1
> 5 conseils pour mieux vous connaître1.Prenez du reculet faites de votre personne un objet d’observation en « sortant de vous-même ». Pour ce faire, vous pouvez vous aider d’un journal de bord que vous rédigerez à intervalles réguliers (par exemple une fois par semaine). L’idée est de noter de façon descriptive tout ce qui vous a touché, étonné ou fait plaisir sur cette période, sans analyser ou chercher à interpréter. La relecture après un certain temps de ces constats factuels peut vous en apprendre beaucoup sur vous-même !2.Questionnez-voussur ce qui vous ressource et vous motive. Sans chercher à l’analyser, identifiez ce qui vous fait du bien, dans la vie de tous les jours et dans votre quotidien professionnel. Préservez cette ressource autant que vous le pouvez. S’il est possible de vous accorder une sieste sur votre lieu de travail, n’hésitez pas !3.Faites régulièrement le point sur vos compétences en actualisant une sorte de curriculum laboris dans lequel vous notez toutes les tâches auxquelles vous avez participé, ainsi que les nouvelles compétences acquises, même les plus implicites. L’idée est d’avoir une vision la plus factuelle possible de vos aptitudes.4.Identifiez vos biais et vos limites: quelles sont vos zones d’inconfort, quelles petites stratégies mettez-vous en place pour contourner la réalité ? C’est important de connaître ses biais et ses mécanismes de défense. Êtes-vous souvent dans l’évitement, la projection, la régression ?5.Demandez dufeedback à votre entourage personnel et professionnel et prenez en compte avec humilité leur perception pour progresser. C’est dans la récurrence des constats extérieurs qu’on peut déceler une forme d’objectivité et de réalité sur soi-même. Encouragez donc les gens autour de vous à exprimer ce qu’ils pensent ou ce qu’ils ont ressenti face à vos comportements ou propos.





























