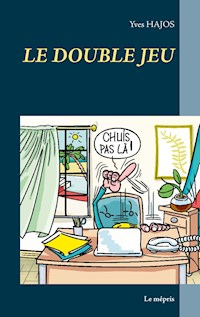Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce livre raconte le destin de ma mère Irène, née en Hongrie, seule survivante d'Auschwitz parmi sa famille, de mon grand-père Géza qui avait sauvé une vingtaine de Juifs à Budapest en 1945, dont le futur Chef de la Police secrète communiste de Hongrie, de mon père Joseph, premier modéliste de France dans les années 1950 à 1963. Irène et Joseph arrivèrent à Roubaix en septembre 1946. Je suis le fil conducteur de ce récit. J'explique mon rejet vis-à-vis de l'uniforme, tellement viscéral que j'avais fait la révolution à la caserne de Colmar en 1972. "La mode définit le corps, en trace les contours. Elle permet de s'inscrire dans une sociabilité. Elle est comme l'affirmation d'un vrai moi que l'on ne peut cacher ou rabaisser sous un uniforme ou par le port d'une étoile." Odile Ehret, professeure de Français. Les études supérieures de marketing achevées, l'auteur a exercé dans les domaines du Textile, de la Communication, de la Formation, de l'Import-Export, pour finir dans l'Immobilier et la Promotion. Il jouit, maintenant, d'une retraite active consacrée à l'écriture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À toutes les familles qui ont subi ce grand malheur qui ne doit pas être oublié.
Mes sincères remerciements à Dan Albo pour son tableau. Il exprime tout ce que je ressentais vraiment pendant l’écriture de mon récit véridique.
« L’idée qui m’a initialement mis devant la toile blanche était de créer un monde réaliste-figuratif, surréaliste-abstrait à la fois, une composition qui représente à la fois la réalité et le rêve, une réalité organisée-ordonnée et anarchique.
Il me semble que les couleurs riches et le dessin surréaliste des visages humains dans la peinture expriment désordre et ordre, réalité et hallucination comme je vois le monde tout en petit autour de moi.
Beaucoup de désarroi, d’absence de sens et de désintégration des valeurs humaines fondamentales, ainsi qu’un progrès technologique accompagné d’un grand espoir.
L’avenir comme nous l’avions supposé hier ne se réalisera jamais. Est-ce possible que c’est la source de notre mélancolie ou du moins de notre mécontentement ?
Ce sont les choses que les personnages se disent entre elles dans le tableau je suppose. »
DanAlbo
Ma gratitude envers Denise, mon admirable épouse, pour la réalisation de ce livre.
Du même auteur
Chroniques d’une décomposition française. BoD Février 2018
Une vie à Nice. BoD Mai 2019
Numéro de Copyright
00067640-1
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
1
2 octobre 1972.
En début d'après-midi, bardé d’un impressionant pansement sous le menton, suite à une efficace intervention chirurgicale, je certifie à ma famille, sceptique et angoissée sur mes chances de succès, d'être de retour à Eaubonne très rapidement.
Mon dossier médical est béton. Ma tactique d'une logique implacable et d'une simplicité extraordinaire, cependant audacieuse et périlleuse pour mes parents, mon père surtout, devrait surprendre les officiers les plus endurcis.
Je ne suis pas un objecteur de conscience mais, dès mon plus jeune âge, je refuse de toutes mes forces de revêtir l'uniforme. Même si aujourd'hui, il correspond plus à l'allure de l'honneur retrouvé grâce au Général de Gaulle qu’à celui de la lâche capitulation que nous infligea l'indigne Assemblée nationale en désignant Pétain, sous la houlette du général Weygand.
Pourquoi cette aversion viscérale contre l'armée, la police et un ordre psychorigide ? Moi, le premier à m’élever et à m'insurger contre le désordre.
Est-ce mon côté contestataire ou, malgré le haut degré de civilisation de l’Allemagne, de la France et de la Hongrie, les conséquences dramatiques de la sauvagerie la plus brutale qui avait sévi sans état d’âme ?
***
En vous relatant les évènements marquants qui ont influencé la vie tourmentée de Géza Hajos, mon grand-père paternel, le parcours professionnel de Joseph, mon père, et essentiellement celle, innommable, de ma mère Irène, j’espère que vous parviendrez à dénouer tous les fils inextricables qui ont jalonné ma petite enfance jusqu'à ce jour.
Ma chère famille peut se targuer d'avoir vécu une existence peu banale.
Mon père a supporté passivement la période très agitée durant la deuxième guerre mondiale.
Mon grand-père paternel, au contraire, se comporta en véritable héros.
Alors que ma mère, dont le seul grand tort fut d'appartenir au prétendu peuple élu. Fortement ballotée, elle subit, assommée et impuissante, le sommet de la folie humaine. Elle fut mise à mal par des êtres monstrueux dénués de toute morale.
***
Ces trois personnages m'ont inculqué les notions de remplir son devoir, connaître et croire aux sens des mots : respect, fraternité, solidarité…, tout en appréciant les aspects délicieux d'une atmosphère joyeuse et conviviale.
Même quand je découvris leur destin invraisemblable, l'ambiance à la maison était toujours une succession de repas pantagruéliques et de fêtes avec de nombreuses chansons hongroises certes, mais toujours avec le sentiment de respecter les valeurs de la République française.
Mes parents n'ont jamais dénigré leur pays d'adoption. À leur humble façon, ils ont apporté leurs modestes pierres à la contribution de notre République tolérante et protectrice. Aussi, moi l’enfant d'origine hongroise, je me suis toujours senti aussi Français que mes copains descendants de Jeanne d'Arc ou de Garibaldi.
2
N’occultons pas nos racines afin de mieux construire notre avenir.
Je retiens de mon grand-père que la grandeur d'un être humain ne se mesure pas uniquement sur des conditions de classe, de religion, de couleur de peau. Chaque personne possède des droits et des devoirs identiques et dispose des mêmes chances de réussite en fonction de ses capacités.
De tous ces critères fondamentaux, mon grand-père, un laïque chevillé au corps, pensa trouver à travers le communisme la voie pacifique vers un monde chaleureux et égalitaire. Un monde nouveau. Le fameux paradis que les adorateurs de Jésus préférèrent placer le plus haut possible, au cas où… Les mots : gloire et reconnaissance, n'étaient pas chez lui synonymes d'un ego démesuré.
L'idée de la maltraitance du faible par le fort lui était totalement étrangère.
Un bel idéaliste utopiste par excellence !
Joseph, mon père, avait le principe de la valeur incarnée dans le respect des gens et du travail. Toutefois, sa rigueur un tantinet janséniste, son tempérament nerveux et angoissé, ses réflexions trop tournées vers le passé et ses certitudes tranchées en politique, le bridaient. Il ne laissait pas jaillir cet irrésistible brin de folie, à la différence de mon grand-père ou de ma mère, expansifs et communicatifs. Il ne saisissait pas le léger ajout de piment qui agrémente une existence fleurie aux contours un peu distendus. Son côté méthodique, ordonné à l'extrême, où tout était soit blanc ou soit noir, sans la moindre nuance, l'empêchait de se libérer d’un carcan trop rigide, de s'éclater avec spontanéité.
Grandes furent ses désillusions. Cependant, il m'avoua en toute simplicité qu'il aurait été bien incapable d'imiter son désintéressé de père. Il se reprochait amèrement son manque d'audace.
Au fait ! Avez-vous croisé énormément de citoyens modèles, épris d’égalité et de justice aux parcours chevaleresques ?
Modéliste, s'il ne boudait pas son brillant succès professionnel, il n'étalait pas, pour autant, une vanité puérile. Il restait très discret sur les politiciens ou les acteurs qu'il avait fréquentés, heureux de porter ses créations. La seule photo qu'il prenait plaisir à me montrer était celle de Bourvil enfilant un splendide manteau. Il l’aimait bien ; tout en discrétion comme mon pater.
Sa fierté était toute en retenue, contrairement à la mienne. En effet, bien droit à côté de ma mère, je me délectais en voyant son nom : Jo Hajos, représentant la mode masculine Française en 1958 à l'Atonium de Bruxelles. L’Exposition Universelle avait réussi la gageure de réunir une cinquantaine de pays et de nombreux organismes internationaux. Les pavillons attractifs rivalisaient d’innovation et d’imagination. Celui de la France, avec sa flèche spectaculaire, longue de 80 mètres, illustrait parfaitement le brillant génie architectural et scientifique français. Sans oublier l’inoubliable touche romantique que le monde nous envie. J’imagine, pendant que le carillon jouait la chanson : Auprès de ma blonde, un long défilé d’hommes galants à la mine radieuse, vêtu du costume Jo Hajos, un bouquet de fleurs à la main, s'approchant d’un pas chaloupé des jolies femmes aux visages épanouies en chantant cet air célèbre.
Il faut dire qu’il avait de bonnes bases pour progresser et profiter des joies de la vie : la lutte et le violon. L’excellente combinaison de la force tranquille mise en musique. Champion de Hongrie de lutte gréco-romaine, il allait représenter sa Nation au prochain championnat d'Europe lorsqu'il se démit stupidement l'épaule droite au plongeoir de la piscine de l'île Marguerite. Un joyau dans le cœur de Budapest qui laisse encore couler quelques larmes d'émotion à mon père. Un an plus tard, l’ancien lutteur au cou de taureau, devint mince et continuait à passer le costume avec une prestance rare. Du tailleur de ses débuts prometteurs dans le métier, il est devenu le plus grand modéliste de France dans les années 1950 jusqu'à 1963.
À Bruxelles, j'éprouvais une joie non feinte. J'avais une furieuse envie de déclamer à chaque curieux qui contemplait le vêtement créé par un génie aux doigts d'orfèvre :
- C'est le modèle de mon papa ! Il est là !
Le réputé Prêt-à-porter masculin français rayonne à l'international.
Vous rendez-vous compte ! Mon père, l’immigré heureux de contribuer au dynamisme économique et culturel de la France qui lui a tout donné, remercie son pays d'adoption.
Quant à ma mère Irène, excessive et possessive comme peut l'être toute mère juive attentionnée, elle exalta les mérites et le succès.
- Mon fils ! Tu seras médecin ! m'affirmait-elle avec son légendaire accent.
Mais que furent nombreux les obstacles : la lâcheté, les bassesses, les traitrises…
3
2 octobre 1972.
Arrivé à la gare du Nord en début de soirée, je marche d’un pas trainant avec gravité parmi la cohorte d’appelés surexcités jusqu'à la morose gare de l'Est. Les jeunes campagnards, fiers d'accomplir leur devoir national, semblent quitter leur ferme pour la première fois. Par contre, les courageux révolutionnaires chevelus manifestent avec ardeur en criant : Ah bas l'armée ! Bande de fachos !
Vers 19 heures, le bruyant train en provenance de Colmar, fait son apparition dans un immense nuage de vapeur. Il libère une marée humaine survoltée qui, à l'aide du bruit strident de leurs sifflets, quitte les lieux en hurlant :
- C’est la quille !
Dans peu de temps, accompagné d’une autre masse aussi niaise, je suis bon pour un voyage analogue dans un monde qui m'est hostile. Les appelés, agglutinés dans la partie de la gare enfumée réservée aux départs pour la province, braillent de plus en fort. Il s’y dégage un climat trouble, comme si la Patrie était à nouveau en grand danger. À la différence de la gare Saint Lazare ou de la gare de Lyon qui m'évoquent des destinations de découverte et d'aventure, la gare de l'Est, terne, froide et austère comme son entourage proche, n'a aucune prise sur moi. Pire ! Aujourd'hui, ce lieu sale, aussi lugubre que l’aspect triste des banlieusards pressés de retrouver Jacqueline Huet, la Bardot du petit écran, et les informations de vingt heures, me révulse. Les jeunes écervelés, avec leurs baluchons portés à l'épaule, qui vont et viennent en clamant à tue-tête et en exhibant fièrement leur carte de convocation, me donnent la vague impression d'être revenu trente ans en arrière au cri vengeur de : À Berlin !
Cette pensée me glace.
Légèrement secoué par l’intervention chirurgicale effectuée, quelques jours auparavant à Paris, à la clinique Spontini de la rue de la Pompe, par l’habile professeur Elbaz, un des plus éminents spécialistes de la cicatrice chéloïde, je suis happé par une grappe humaine irrespectueuse qui se précipite violemment, pareil à des bêtes affamées, vers les rares places encore disponibles en seconde classe. Un exemple flagrant des méfaits du débordement sauvage de la foule incontrôlable.
En parvenant avec difficulté à me frayer un chemin dans les couloirs où le tabagisme règne en maître, je ne trouve point de place assise. « Si le ministère des Armées n'est pas fichu de nous transporter avec le minimum de conditions décentes, je perçois mieux la pitoyable débandade en 1940 », marmonnai-je alors.
Résigné, je rejoins une première classe quelques secondes avant le départ chez les commandos-chocs.
***
Le bataillon semi-disciplinaire du 152e RI, avec pour devise : « Ne pas subir », est la légende vivante de l'armée française. « Les Diables Rouges », surnom donné par les Allemands en 1915 en raison de leur bravoure, est également appelé : « Premier des régiments de France ». Un exploit supplémentaire ? Il serait une des rares unités à avoir battu des teutons en 1940.
Tel est la description élogieuse de la caserne fière qui permet à nos politiciens vantards depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, de clamer haut et fort que l'honneur est sauf.
Ce fatalisme s'estompe très rapidement. Le fait de voyager dans un compartiment feutré en compagnie d’heureux nantis ne va-t-il pas avantager mes desseins et effacer mes deux premiers échecs ?
Peaufinons cette aubaine, si elle se présentait, pour mieux narguer celui qui m'avait juré de me faire la peau le jour de mes études terminées :
Le rebutant Préfet du Val d'Oise.
4
En fait je ne connais pas Géza. Mon grand-père paternel achève paisiblement le dernier quart de sa vie avec sa femme Élizabeth à Budapest, ses illusions envolées. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu la chance de l'approcher. Il me fut révélé à travers les rares récits évoqués par mes parents. Ils sont fiers du geste accompli par cet homme enjoué qui appréciait la bonne bouffe et le bon vin. Pourtant, dès mon plus jeune âge, quelque chose me chiffonne. Mes parents, le regard embarrassé, camouflent un chapitre du livre de son existence héroïque.
Est-il si répréhensible ?
Mon père et ma mère entrèrent officiellement en France en septembre 1946 grâce au précieux contrat de travail obtenu avec le concours de Rudi, le bon ami hongrois de mon pater. Ce dernier travaillait déjà dans la société de textiles basée à Roubaix, appartenant aux Touret-Lepoutre, une des grandes familles du Nord de la France. Mon père le connût à Amiens, lors de son premier séjour en France dans les années 1930.
Ils n'ont jamais cessé de s'écrire.
En effet, au lendemain de la guerre, dans un pays encore en ruine, en manque de main-d’œuvre qualifiée, où tout était à reconstruire, rares étaient les spécialistes possédant un don aussi exceptionnel que celui de mon père dans la mode masculine.
Comment Joseph rencontra-t-il, en septembre 1945, ma mère Irène, la seule survivante d'Auschwitz parmi ses parents et un de ses frères ? Avant le déclenchement des hostilités, il était déjà en relation de travail avec une de ses cousines.
Il avait trente-huit ans, elle quinze ans de moins.
Pour des causes justifiées qui se rejoignaient, tous deux tenaient absolument à quitter leur pays d'origine. Ma chère mère, marquée sévèrement par une profonde cicatrice dans son esprit, voulait s’échapper de ce coin maudit qui l'avait trahie et déclassée. Mon père souhaitait s’expatrier pour des raisons économiques.
***
La population hongroise, déjà avilie et dépecée indignement en 1919, entrevoyait en 1945 un avenir brisé après les accords de partage du globe scellés uniquement entre l'URSS et les Etats-Unis à la fin de la deuxième guerre mondiale. Un futur, sans aucune perspective positive, dénoncé par Churchill et surtout par de Gaulle.
Après avoir subi pendant plusieurs siècles le joug terrifiant des Turcs qui ne les ont pas ottomanisés, après avoir, finalement, découvert le véritable visage de la barbarie nazie suite à la destitution de Horthy, les Magyars se soumettaient maintenant à l'ogre communiste russe et goûtaient, avec effroi, à une autre forme d’arbitraire, dont les racines du mal remontent dès le lendemain de la révolution des bolchéviks en octobre 1917.
Dans les années 1930, mon grand-père paternel, très dubitatif sur le futur de son pays talentueux amputé des deux tiers de son territoire, incita son fils à tenter sa chance ailleurs. Il lui conseilla les Etats-Unis, la région en devenir, jamais frappés par les guerres. Trop loin, trop risqué pour mon père peu aventureux, allergique au moindre risque de surcroît. Respectueux des règles, il a une sainte horreur de l'improvisation. Tout doit être programmé à l'avance dans un cadre bien défini. Aussi, il opta pour une société de confection à Amiens, une laborieuse agglomération urbaine qui ignorait, à cette époque, le tout à l'égout.
***
Si le quartier de St-Leu, la « Venise du Nord » ou la prestigieuse Cathédrale Notre-Dame d’Amiens ne lui ont pas laissé un souvenir impérissable, un an plus tard, il était intarissable au sujet d'Oran.
Cet endroit des pourtours de la méditerranée le rend encore nostalgique, pareillement aux Pieds-Noirs ainsi qu’aux ingénieurs et aux médecins venus de France, afin de contribuer à l'essor du département. La ville possédait tous les critères d'une cité moderne aux contours chaleureux et ensoleillés. Le lieu rêvé, illuminé et aux odeurs enivrantes, regorgeait de multiples plaisirs naturels. Ville attachante où toutes les religions et toutes les races cohabitaient en parfaite entente. Quel plaisir il éprouvait à savourer les poissons frais, les fruits gorgés de sucre naturel, attablé avec ses copains, le dimanche, dans des restaurants familiers, le verre de rouge à la main. Et à jouer, même pendant la semaine, d’interminables parties de jacquet sur les terrasses des cafés en plein air. Loin des bistrots sinistres d'Amiens où les mégots jonchés sur le sol gâchaient le plaisir d’un jeu entamé avec entrain avec son ami hongrois Rudi.
Son impression d’une promiscuité paisible et harmonieuse, ne serait-elle pas devenue trop idyllique au fil des temps ? Pour la cigarette, en revanche, elle n'a pas varié. Elle s'est même amplifiée quand les cartouches de Craven A de ma mère et de ma petite sœur Patricia succédèrent aux trains à vapeur à un rythme effréné.
- Nem kell bagószni ! Il ne faut pas fumer ! hurlait-il dans un argot peu reluisant.
5
Avant le déluge programmé, ma mère, peu attirée par les études théoriques, au grand regret de son père Simon, avait vécu durant plusieurs années à Budapest chez un membre de sa famille afin de perfectionner son apprentissage de la couture. Un métier où, dès son plus jeune âge, ses doigts de fée excellaient pour transformer le moindre tissu en vêtement sublime.
Cependant, son père, un homme généreux et bon, très attentif au suivi de l'éducation de ses trois enfants, admit qu'avant d'apprendre à lire et à compter, sa fille avec un fil et une aiguille débordait de créativité à une vitesse faramineuse. Aussi, il l'encourageait à exercer sa passion dans une maison de Haute Couture à Budapest, dans un premier temps, avant de rejoindre le must à Paris, la « Ville-lumière » par excellence. Avec l'aval de ses parents, en fait du paternel, elle connut, très jeune, l’intensité trépidante de la capitale hongroise, l'excitation d'aller au bal, à l'Opéra ou aux restaurants avec ses cousines et ses cousins en portant des robes chics, créées et cousues par ses soins, qui la distinguaient des autres.
Les Juifs de Nagykanizsa, la ville où grandit ma mère, suivaient les principes de leur religion avec une conception très libérale. Les deux ou trois fêtes principales juives étaient plus une occasion de festin que de recueillement. Le rabbin avait peu de prise sur ses ouailles, surtout sur le pater, d’origine Allemande. Simon Kluger supportait difficilement toutes les simagrées.
Pour son père et ses huit frères et sœurs, le sentiment de faire partie de la nation hongroise passait devant la religion. L’importante minorité juive, contrairement aux autres minorités : Roumaines, Tchèques, Croates, Slovaques… plutôt insatisfaites, se sentait appartenir pleinement à l’entité hongroise. La Hongrie, à la différence des pays de l’Est, n’avait pas connu les vagues successives de pogroms depuis la nuit des temps jusqu’au début du 20e siècle. Nombreux furent les médecins, les journalistes, les écrivains, les professeurs, les artistes, les ingénieurs ou les hommes d’affaires de religion juive à prospérer et à faire progresser le pays.
Sa mère dont les grands-parents avaient fui des pays de l’Est hostiles envers leur croyance, venait d'une famille composée de neuf frères et sœurs également, pour qui la religion tenait une place un peu plus importante. Pour autant, ils ne portaient pas l'affublement de ceux fraichement venus de Pologne ou de Russie, fuyant les pogroms. Ma mère avait juste conservé quelques mots en yiddish élucubrés par la sienne dont meshugué (idiot), shmates (tissu) ou schnorrer (mendiant). Des mots qui résonnent bien et qui me deviendront d’autant plus familiers lorsque les Polonais débarquaient chez nous.
Ses parents, considérés comme des juifs libéraux, ne se posaient aucune question biblique en savourant un ragoût de porc/pörkölt. En général, les enfants déchiffraient l’alphabet à la petite école Juive. Ensuite, ils étudiaient souvent dans les écoles secondaires Catholiques. Ils se sentaient avant tout Hongrois. Pour ma mère, le fait de se retrouver à la synagogue lui donnait surtout l'occasion de papoter avec toutes ses cousines et tous ses cousins.
Parler plutôt qu'écrire, elle étincelait. Je la crois volontiers. Aujourd'hui, avec un esprit de répartie vif, elle est intarissable. Par exemple, durant les années 1960, prospères et insouciantes, les Trente Glorieuses, un gars, coiffé à la Beatles, débarque à notre résidence secondaire située à Cavalaire. Il souhaiterait parler à Sheila, le nouveau prénom de ma sœur Chantal, bien enregistré dans nos crânes têtus l'an passé, le sien ne lui convenant pas. Ma mère lui répondit sans ambages :
- Jeune homme ! Vous êtes démodé. Il n'y a plus de Sheila ici. Cette année ? C’est Sophie !
***
Sa famille était de véritables patriotes. François Fejtö, un écrivain réputé, m’avait bien commenté le patriotisme des juifs hongrois lors de son passage à Paris en 1997 à l’institut Hongrois. Quelle lucidité pour un homme âgé de plus de 90 ans, né dans la même ville que ma mère ! Il confirme les assertions de ma mère. Les Juifs de Nagykanizsa ne vivaient pas comme une communauté fermée, repliée sur elle-même, vis-à-vis du reste de la ville.
C'étaient des progressistes.
Toutefois, son jugement sur la situation exacte en Hongrie pendant la deuxième guerre mondiale, en particulier pour la population juive, fut légèrement faussé à partir de 1939. François Fejtö, bien plus âgé que ma mère, s’échappa de justesse de son pays en 1938 afin d’éviter les désagréments de la prison en raison de ses intrépides actions antifascistes.
Pouvait-il commenter l’antisémitisme ambiant qui se répandait dans un climat haineux, avec la même douloureuse perception que ceux restés dans la terre de leurs ancêtres ou les quelques survivants de l’atroce génocide dont ma mère, miraculeusement en vie. Tout comme l’abasourdissement et la profonde humiliation qu’ils avaient ressentis.
6
Les signes avant-coureurs d’un désastre ignoble se confirment, hélas, le 19 mars 1944. Une meute belliqueuse envahit la Hongrie. L’armée allemande et les SS qui défilent au pas de l’oie dans Budapest, sonnent la fin d’une forme d’insouciance pour ma mère. Avec en tête du cortège, comme s’il jaillissait des ténèbres, le méprisable Eichmann au visage gravé par la mort, un des concepteurs de la solution finale. Elle qui poursuit son apprentissage de l'assemblage des vêtements avec beaucoup d’assuidité et de plaisir, voit, stupéfaite, les alliés de la Hongrie s’emparer sauvagement de son beau pays tant chéri.
Quelle cruelle désillusion lorsque ses grands beaux yeux bleus se dessillent. Consternée, son malheur se transforme en une incompréhension totale mêlée d’effroi en découvrant l'interdiction formelle de voyager pour les Juifs et l'obligation de porter une étoile jaune cousue sur son manteau.
Un satané bout de tissu qui la fait remarquer.
La jeune patriote, si fière de s’égosiller en scandant l'hymne national de la Hongrie, est KO debout. Elle plonge dans une incrédulité la plus totale en voyant son monde s’écrouler et ses dernières illusions parties en lambeaux.
***
Avait-elle pris conscience qu'avec l’application discriminante de plusieurs lois mises en vigueur dès 1939, les Juifs – une communauté de plus de 900 000 personnes en 1910 - ne possédaient plus les mêmes droits que les autres Magyars ?
Ils étaient devenus le bouc-émissaire de la tragédie Hongroise.
Un drame humain qui remonte, en fait en 1920, avec l'élaboration du numerus clausus par le gouvernement de Pál Teleki.
La première mesure limitait l'accès aux Juifs à l'Université en fonction du nombre de sa population. Elle fut considérée comme une loi anti-juive.
Malgré la discrimination, la majorité des Juifs n'avait pas saisi pleinement le premier opprobre. Une infime minorité qui poursuivait des études supérieures ailleurs, y compris des artistes et des hommes de lettres, quittèrent leur pays définitivement.
7
Son père, soucieux de la sécurité de sa fille, lui demanda de les rejoindre au plus vite. Ses multiples relations permirent à ma tendre mère, affreusement choquée par les premières mesures discriminatoires et par cette étoile jaune, de voyager en sûreté et en toute discrétion jusqu’à son domicile, bien loin des regards de groupes de plus en plus vindicatifs.
Toute la ville de trente mille habitants environ connaissait son père, un notable reconnu et respecté grâce à sa florissante activité de commerce de gros. Des voisins ont-ils envié leur élégante et grande bâtisse qui possédait des équipements peu courants à l'époque : un chauffage perfectionné ainsi qu’une salle de bains ?
De retour à Nagykanizsa au début du mois d'avril 1944, un lieu soi-disant épargné d'après son père, ma mère, la véritable Hongroise, est déclassée.
Oui ! Déclassée et exclue sans ménagement à cause de quatre toutes petites minuscules lettres.
Mais, quelles lettres ! JUIF !
Celle qui ressentait peu la religion et comprenait encore moins la signification de toutes ces parodies reçoit en ce jour printanier du 15 avril 1944 un coup de poignard dans le dos.
Elle est devenue une criminelle.
En effet, des employés de la ville placardent de grandes affiches honteuses sur les murs de la ville. Les Juifs, obligés de travailler en Allemagne, doivent préparer dans la précipitation des provisions pour un périple d’une durée de trois semaines.
Anéantis par l’incompréhensible, ils ne réalisent pas ce qu’il leur arrive. Ils ne cherchent même pas à protester, à réagir ou à contester. Impuissants, ils ne savent pas encore qu’ils sont devenus du jour au lendemain des sous-hommes.
Lors du regroupement brutal des juifs de sa ville, le comportement ignoble de la police hongroise qui tambourine à la porte du domicile de ses parents pour y pénétrer avec fracas la remplit de frayeur. La lente et inexorable dégradation se poursuit et accroit son bouleversement. Ses dernières illusions sont détruites lorsqu’un vil policier rudoie son père, coupable de posséder un aliment ou un savon acheté au marché noir. L’homme à l’uniforme l’assène d’une monumentale gifle cinglante. La fervente patriote, liquéfiée, tressauta. Son cœur bat à tout rompre. Des militaires et des policiers, censés venir porter secours aux plus faibles et aux plus démunis exécutent les ordres sans le moindre état d'âme. Les précurseurs du début de la déstructuration totale, bien représentés par le fumier de flic qui conserva certainement la nourriture ou l’objet de convoitise, la basculent violemment dans un autre monde. La fille est désemparée. Elle voit, avec effroi, son père humilié devant sa femme et ses deux enfants, dans l’impossibilité absolue de réagir. Un homme si bon qui fut toujours capable, même quand ses ultimes affaires professionnelles périclitaient à cause des mesures vexatoires mises en vigueur dernièrement, de réaliser, malgré tout, des prouesses inimaginables.
Un choc ! Un traumatisme !
L'ainé, le patriote intellectuel de santé fragile, guerroyait contre les troupes russes depuis 1941.