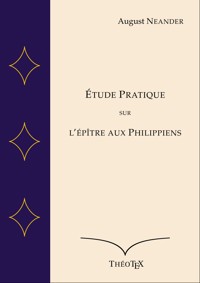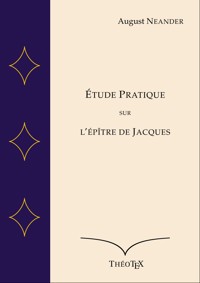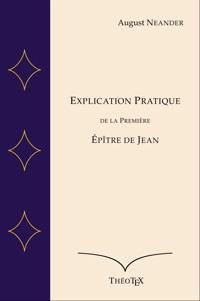
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Dernier survivant des douze apôtres, saint Jean a voulu laisser à l'Église un résumé de ce qu'il savait être le plus important pour la continuation de sa marche terrestre. Il ne s'agissait plus tant, à la fin du premier siècle, de rappeler le principe de la justification par la foi sans les oeuvres, suffisamment déjà établie par le ministère de l'apôtre Paul, que d'insister sur la nécessité d'une intimité personnelle avec le Sauveur. Le danger ne venait plus des judaïsants, qui auraient voulu asservir la liberté de la grâce aux exigences de la loi rituelle, mais des gnostiques qui dénaturaient la personne de Jésus-Christ, en en faisant un personnage fantomatique, sorti de leur imagination. Or toute la longue vie de Jean, depuis sa rencontre avec Jésus, s'était nourrie de cette contemplation intérieure du Fils éternel de Dieu, devenu Fils de l'homme, pour sauver la famille humaine ; c'est pourquoi dans toute son épître il ne cherche pas à démontrer logiquement des vérités spirituelles, mais il les affirme avec l'autorité du témoin. Cette Explication Pratique qu'en a donné August Neander (1789-1850) est elle-même aussi une sorte de testament qu'il laisse, sur ce qu'il a trouvé d'essentiel pour la vie chrétienne. Elle a été traduite de l'allemand par Jean Monod (1822-1907), fils de Frédéric Monod (1794-1863). Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1854.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322484119
Auteur August Neander. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Voici un ouvrage qui sera sans doute diversement apprécié : personne. toutefois, nous osons l'espérer, ne l'accueillera avec indifférence, quand on saura que c'est le dernier fruit de la pensée chrétienne d'un pieux docteur de l'Église contemporaine. Neander, presque aveugle, incapable de poursuivre les belles recherches historiques qui avaient rempli sa vie, voulut encore consacrer au bien spirituel de ses frères le reste de ses forces, en dictant à l'un de ses élèves quelques réflexions pratiques sur trois portions du Nouveau Testament qui avaient particulièrement fixé son attention. De là sont nés trois commentaires, uniques dans leur genre, courts, simples et substantiels, dans lesquels Neander a déposé le produit le plus pur de son expérience chrétienne et de ses études bibliques. L'Épître aux Philippiens et celle de saint Jaques ont déjà paru en français ; la publication actuelle complète l'œuvre modeste que nous avons entreprise de concert avec notre ami M. E. de Pressensé. Sans doute des traductions seront toujours plus ou moins entachées de faiblesse ; on ne dépouille pas impunément de son vêtement naturel la pensée d'un écrivain pour lui en faire prendre un autre ; cet habit nouveau ne lui sied jamais exactement ; elle y est nécessairement gênée, quelquefois faussée : le fond et la forme sont deux éléments si intimement liés entre eux qu'on ne peut guère toucher à l'un sans altérer l'autre. Il n'est point de traducteur consciencieux qui n'ait éprouvé à cet égard un sentiment pénible. Aussi appelons-nous de tous nos vœux l'avènement d'une littérature théologique nationale, française d'esprit comme de langage, qui, tout en puisant dans les riches trésors des peuples étrangers, vive de sa propre vie, tienne compte des habitudes de pensée et de la culture spirituelle de ceux auxquels elle s'adresse, et soit empreinte de ce cachet gaulois de force, de clarté et de noblesse sans lequel nos livres religieux seront toujours peu populaires en France. Ce temps viendra. Nous résignerons-nous à croire que le pays qui a vu briller dans son sein l'école de Saumur, et qui a donné naissance à Calvin, soit réduit à se nourrir d'une théologie de seconde main et d'une édification d'emprunt ? Non ! Ayons confiance en Dieu ! Il relèvera notre Église de ses ruines ; il y multipliera, quand le moment sera venu, les docteurs selon son cœur et la « remettra en un état renommé sur la terre ».
Mais dans la pauvreté actuelle de notre littérature religieuse – pauvreté qu'il ne faut cependant pas exagérer – et en attendant de nouveaux travaux originaux, n'y a-t-il point place pour quelques traductions ? Ne remplissent-elles pas provisoirement une lacune ? Ne servent-elles pas, à leur manière, à l'avancement du règne de Dieu ? Ne sont-elles pas en particulier la conséquence et la marque naturelle d'une époque de transition comme la nôtre ? Dans un temps de crise tel que celui où Dieu nous fait vivre, quand un monde nouveau se dégage lentement, douloureusement de l'ancien, quand tous les esprits sérieux sont en travail, n'est-il pas utile alors de profiter largement des lumières d'autrui, de rattacher nos expériences à celles de nos frères en la foi, et de faire entrer dans la solution cherchée tous les éléments que l'on peut rassembler ? Nous l'avons pensé ; c'est pourquoi nous offrons aujourd'hui avec confiance à ceux qui aiment l'étude de la Parole de Dieu la traduction du livre de Neander.
Cette traduction est libre : si elle eût été littérale, l'ouvrage eût été plus long, et – nous le croyons-plus diffus. Tel qu'il est, et malgré les divisions que nous y avons introduites, il paraîtra encore un peu vague, Nous n'avons pu entièrement éviter cet inconvénient qui tient à la manière même de Neander : il n'y a chez lui aucun travail de style ; il dicte ses idées dans l'ordre où elles se succèdent dans son esprit, sans que cet ordre soit toujours régulier ; aussi est-il fréquemment obligé de revenir sur ses pas, de renouer une pensée interrompue, de sacrifier à l'abondance des développements et à la ferveur du sentiment chrétien la précision que recherche le lecteur français. Il y a plus : sa théologie n'est pas sur tous les points entièrement arrêtée, ou du moins il ne la formule pas toujours avec netteté. Est-ce chez lui impuissance de conclure ? Nous n'affirmerions pas avec certitude le contraire ; mais c'est aussi, c'est plutôt, pensons-nous, de sa part, profonde humilité. « L'humilité, répétait-il souvent, est la première orthodoxie. » Assurément il faut tendre à une exposition complète et claire du christianisme ; mais cet idéal que chacun poursuit, qui peut se flatter de l'avoir atteint ? qui a découvert, pour le contenu de l'Évangile, une forme adéquate ? Entre les théologiens plus systématiques et ceux qui le sont moins la différence n'est donc que relative ; l'essentiel est d'être absolument vrai avec soi-même ; il n'y a de force que dans la vérité ; elle seule sanctifie. Or, entre le danger d'affirmations timides et celui de déductions téméraires, qui ne choisirait le premier ? Qui ne préférerait une foi humble et encore défiante d'elle-même, mais vivante et intime, à une croyance robuste que n'a jamais effleurée le souffle du doute et à laquelle manque tout caractère personnel ?
Ne pouvons-nous pas ajouter que l'inconvénient dont nous parlons tient aussi en grande partie à la manière de saint Jean ? C'est en vain que l'on chercherait chez lui la méthode ferme, lucide, didactique de saint Paul ; il règne dans ses enseignements une plénitude divine qui brise tous les moules du langage et défie l'analyse. Sa confusion apparente n'est qu'une sainte profusion.
Aussi, plus on lira l'épître de saint Jean, en s'aidant de l'explication pratique qu'en donne Neander, moins on songera à se plaindre du manque de suite dans les pensées et plus on admirera cet ordre spirituel et profond qui fréquemment rompt l'ordre logique. Seulement il faut aborder cette lecture, non en critiques, mais en chrétiens avides de vérité et de sainteté. Ce n'est point un livre de science ou de littérature, c'est un ouvrage d'édification que nous offrons aujourd'hui au public ; c'est comme tel qu'il demande à être apprécié. Qu'il nous soit permis de recommander à ceux qui le prendront en main de lire avec soin, avant de commencer un chapitre nouveau, la portion du texte sacré qui y est développée.
Aussi bien, le point important n'est pas de saisir la pensée de Neander, mais de se pénétrer de la pensée de saint Jean que Neander a cherché à mettre en lumière. Cette étude nous semble plus que jamais de saison. D'un côté saint Jean nous enseignera cette vraie largeur évangélique qui, regardant Jésus-Christ comme le centre, la mesure, le tout du christianisme, tolère les diversités et juge les opinions contraires non d'après des théories traditionnelles dont on admet d'avance et presque sans examen l'infaillibilité, mais d'après la place plus ou moins grande qu'y occupe Jésus-Christ. D'un autre côté, les enseignements de l'Apôtre sont la meilleure garantie contre certaines tendances actuelles qui croient pouvoir se réclamer de lui et qui, de degré en degré, arrivent à substituer à l'étroitesse dogmatique dont on se plaint un sentimentalisme religieux sans vigueur ni autorité morale. A la période de saint Paul, dit-on, doit succéder aujourd'hui celle de saint Jean ; aux systématisations de l'esprit les effusions du cœur, à l'Église du dogme l'Église de l'amour. Nous ne songeons pas à entrer ici dans l'examen de ce point de vue qui, malgré les éléments de vérité qu'il renferme, nous paraît beaucoup plus ingénieux que solide ; nous ne nous arrêterons pas à montrer quelles lacunes immenses offrirait une période où saint Paul se trouverait relégué sur l'arrière-plan ; nous nous bornerons à présenter une remarque qui nous a de plus en plus frappés à mesure que nous avancions dans ce travail : contre cet affadissement du christianisme qui s'abrite sous le nom de notre apôtre, nous en appelons de saint Jean mal compris à saint Jean mieux compris. Il est vrai que le point central de sa doctrine est l'amour ; mais quel amour ? sur quelles bases repose-t-il et quels sont ses fruits ? Il ne faut pas se laisser égarer par la similitude des mots : entre l'amour tel qu'il est souvent présenté par ceux qui en font la religion de l'avenir, amour vague, sans objet déterminé, inconscient de lui-même, qui n'est pour plusieurs qu'un ébranlement de l'imagination, presque une disposition du tempérament, entre cet amour-là et celui prêché par saint Jean il n'est, pour ainsi dire, aucun point commun. Celui-ci est essentiellement pratique et vivant ; il est le résultat immédiat de l'amour de Dieu pour nous et le principe fécond d'une conduite agréable à Dieu ; il est humble et actif ; il suppose qu'on se repent et fait qu'on obéit ; il se résout en reconnaissance et en obéissance ; faire la volonté de Dieu, tel est pour saint Jean le but de la vocation chrétienne ; s'il relève l'amour, il ne relève pas avec moins de force la sainteté, ou plutôt l'amour que prêche saint Jean, c'est l'amour saint. Nous ne saurions trop nous pénétrer de cette vérité, ni trop résister à toute influence qui tendrait à priver la vie chrétienne de ce caractère élevé, ferme, grave, positif, parfois austère qui lui convient. Un amour qui ne nous porterait pas à combattre le mal avec énergie et à glorifier Dieu dans les détails de notre vie, un amour qui ne serait qu'un facile instinct du cœur, mais où la conscience n'aurait pas toute la part. qui lui revient, un tel amour n'est pas celui qu'inspire Jésus-Christ. Sans doute, « c'est du cœur que procèdent les sources de la vie ; » cette belle parole a même pris pour le chrétien un sens tout nouveau ; mais chez lui la conscience morale n'a rien perdu de ses droits : au contraire, elle n'a fait, en devenant plus spirituelle sous l'action de l'Évangile, que gagner en rigueur et en véritable autorité. Nous ne nous plaignons nullement que l'on prenne pour maxime : « l'amour » et qu'on revienne avec une prédilection marquée à saint Jean, comme au disciple et au prédicateur de l'amour ; nous demandons seulement qu'on n'oublie pas cette autre devise chrétienne : « la conscience, » et qu'on approfondisse assez l'enseignement de saint Jean pour se convaincre qu'en insistant sur la charité, il ne fait qu'ouvrir la voie royale de la sainteté.
Que Dieu veuille accompagner ces pages de l'efficace de son esprit et les faire servir au relèvement, à l'édification, à l'affermissement de quelques âmes ! Tel est le vœu que je forme en mon cœur au moment de me séparer d'un travail qui m'a fait passer des heures bénies dans la société du disciple bien-aimé et de son divin Maître.
Au moment d'aborder l'étude de notre Épître, quelques mots sur la personne de l'écrivain sacré ne paraîtront pas déplacés. On comprend que nous n'avons nullement la pensée d'envisager ce sujet sous toutes ses faces ; traité à fond, il fournirait la matière d'un livre plein d'intérêt et d'édification. Après avoir retracé les circonstances de la vie de saint Jean, il faudrait encore essayer, à l'aide de ses écrits, de pénétrer dans son âme, et raconter sa vie intérieure ; sous le personnage historique, il faudrait rechercher le théologien, l'apôtre, le chrétien, l'homme. Tel n'est pas notre but : nous nous proposons simplement de rassembler ici les rares détails que nous possédons sur la vie du disciple bien-aimé.
Les Pères qui suivirent Eusèbe, les apocryphes du Nouveau Testament, la tradition ecclésiastique en général, nous ont transmis sur saint Jean une foule de légendes superstitieuses sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas, mais qui servent à prouver tout au moins la prédilection avec laquelle on s'attachait aux moindres particularités, vraies ou supposées, de son histoire. Voici à peu près tout ce que nous savons de certain sur lui. Jean (je — abréviation de Jéhovah ;han — a fait grâce), frère de Jaques-le-Majeur, et probablement plus jeune que lui, puisque quand son frère est nommé, il l'est en général avant lui, était fils d'un pêcheur de la Galilée nommé Zébédée. Il est permis de penser, malgré l'affirmation contraire de Chrysostôme, que sa famille possédait quelque aisance : en effet, le lac de Génézareth où pêchait Zébédée étant très poissonneux, l'état qu'il exerçait devait être lucratif ; il avait sous ses ordres plusieurs ouvriers (Marc.1.20) ; sa femme suivait Jésus en Galilée et l'assistait de ses biens (Luc.8.2-3 ; Marc.15.40-41 ; Matth.27.56) ; après la mort de Jésus, elle acheta des drogues aromatiques pour embaumer son corps (Marc.16.1) ; enfin, son fils possédait une maison où il recueillit la mère de Jésus (Jean.19.17). La mère de notre Apôtre s'appelait Salomé. Les deux traits que nous venons de citer de son affectueux dévouement à la personne du Sauveur, ainsi que la prière à la fois intempestive, naïve et pleine de foi, qu'elle adressa à Jésus en faveur de ses deux fils (Matth.20.21), concourent à nous montrer en elle une femme pieuse qui dans l'humble fils de Marie avait appris à reconnaître et à révérer le Messie. Nous ne possédons sur la piété de Zébédée aucune indication précise, si ce n'est qu'il ne paraît pas s'être opposé à ce que ses fils le quittassent subitement pour suivre le Sauveur (Matth.4.22). La famille de saint Jean appartenait sans doute à cette classe de Juifs simples et croyants que l'on rencontre en Palestine à cette époque, et qui, plus occupés de l'accomplissement des prophéties que de l'observance rigide de la loi, attendaient avec ardeur la délivrance d'Israël. De ce nombre étaient la famille de Zacharie et celle de la mère de Jésus. Ce furent peut-être les impressions religieuses reçues au milieu des siens qui poussèrent Jean à quitter ses filets pour venir, au moment où le fils de Zacharie commençait ses prédications sur le bord du Jourdain, se mêler à la foule de ses auditeurs. Envoyé par Jean-Baptiste à Jésus-Christ, il se sentit, dès le premier instant, vivement attiré vers lui ; toutefois, il ne demeura pas dans sa société : Jésus, après l'avoir reçu dans sa maison et l'y avoir gardé jusqu'à la fin du jour, avec André qui l'accompagnait, les renvoya à leurs travaux (Jean.1.35-39). Jean avait repris sa barque et ses filets quand Jésus l'appela définitivement, en même temps que Jaques son frère, Pierre et André (Matth.4.21). Comme la tradition universelle rapporte qu'il mourut à la fin du premier siècle, il paraît naturel d'admettre qu'il était encore jeune au moment de sa vocation. Nous ne savons pas quel était alors son développement religieux ; mais nous voyons que dans la suite lui, son frère et Pierre furent distingués entre les apôtres, et eurent le privilège d'accompagner partout le Sauveur. Clément d'Alexandrie appelle ces trois apôtres « élus entre les élus. » Nous les retrouvons à la pêche miraculeuse (Luc.5.9), à la résurrection de la fille de Jaïrus (Marc.5.37), à la transfiguration (Matth.17.1), dans le jardin de Gethsémané (Matth.26.37) ; et parmi ces compagnons privilégiés du Seigneur Jean eut encore une place à part, puisqu'il s'appelle lui-même, dans un sens spécial, « le disciple que Jésus aimait » (Jean.13.23).
Lorsque Jésus fut fait prisonnier, Jean prit la fuite avec tous les autres disciples (Marc.14.50) ; mais il ne tarda pas à revenir sur ses pas ; il entre avec Pierre dans la cour de la maison de Caïphe qu'il connaissait personnellement (Jean.18.15-16) ; il suivit probablement le Sauveur dans le cours de sa passion, et nous le retrouvons avec les saintes femmes au pied de la croix. Jésus mourant lui recommande sa mère, et dès cette heure il la prit chez lui (Jean.19.25-27). Trois jours après, Marie de Magdala vint lui annoncer, ainsi qu'à Pierre, la résurrection du Seigneur : ils coururent tous deux au sépulcre ; Jean, plus agile que Pierre, y arriva le premier, mais n'osa pas en franchir le seuil ; ce ne fut qu'à l'exemple de son compagnon, plus entreprenant que lui, qu'il se hasarda à entrer (Jean.20.2).
Ici se termine la première partie de la vie de saint Jean ; après la mort de son divin ami il entre dans une phase nouvelle de sa carrière ; au disciple de Jésus succède l'apôtre, le missionnaire, le prédicateur de l'Évangile. A partir de ce moment, son histoire se confond davantage avec celle des autres apôtres. C'est à Jérusalem qu'il commence à exercer son ministère dans la compagnie de Pierre (Actes.3.1) ; il eut à y souffrir de la part des chefs du peuple (Act.4.7,18-19), et se rendit bientôt à Samarie (Act.8.14). Après y avoir prêché quelque temps, il retourna à Jérusalem, où il paraît avoir fait un long séjour, puisque Paul, dix-sept ans après sa conversion (Gal.1.18 ; 2.1), l'y trouva encore (Act.8.25 ; Gal.2.9). Mais dans le dernier voyage que fit Paul à Jérusalem, environ l'an 60, il n'y rencontra probablement pas saint Jean, car il ne le nomme pas, tandis qu'il nomme Jaques son frère (Act.21.18). Quand s'éloigna-t-il de Jérusalem et où se dirigea-t-il alors ? Nous sommes réduits aux conjectures sur ces deux questions. Quant à la première, Nicéphore affirme dans son histoire ecclésiastique que son départ eut lieu à l'époque de la mort de Marie, après que sa mission de charité auprès de sa mère adoptive fut terminée. Quant à la seconde, on ne peut guère supposer que Jean se rendit immédiatement de Jérusalem à Ephèse où nous le trouvons plus tard, car Paul, dans tous ses travaux en Asie Mineure, ne fait point mention de lui ; d'ailleurs l'apôtre des Gentils avait pour principe de n'annoncer l'Évangile que dans les lieux où l'on n'en avait pas encore entendu parler (Rom.15.20 ; 2Cor.10.13-16) ; il n'aurait donc pas voulu entrer dans un champ de travail déjà cultivé par saint Jean. Ce dernier ne vint vraisemblablement à Ephèse qu'après le départ, et peut-être après le martyre de saint Paul, vers la fin du règne de Néron, ce qui explique entre autres le ton des épîtres de saint Jean, évidemment adressées à des églises ou à des individus qui connaissaient déjà l'Évangile. Il resta à Ephèse jusqu'à sa mort, dirigeant de là les églises de l'Asie Mineure et les visitant quelquefois (2Jean.1.12 ; 3Jean.1.13-14). Il fut vers la fin de sa vie transporté à Patmos, petite île rocheuse de la mer Egée, au sud-ouest d'Ephèse ; c'est là, dans le silence de l'exil, qu'il écrivit ses révélations prophétiquesa (Apoc.1.9). On ne sait combien de temps il y demeura. Clément d'Alexandrie raconte qu'à son retour il ramena à la foi chrétienne, par ses paternelles exhortations, un jeune homme autrefois pieux, mais qui, entraîné par de funestes exemples, était tombé dans le mal et s'était mis à la tête d'une bande de voleurs. Dans les dernières années de sa vie, ne pouvant plus adresser à ses disciples de discours suivi, il se faisait transporter au milieu d'eux et se bornait à leur dire de sa voix défaillante : « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ! » Il mourut, dans un âge très avancé, à Ephèse, sous le règne de Trajan. Les traces de sa piété simple et ardente se reconnaissent, bien qu'affaiblies, dans les docteurs de l'Asie Mineure qu'il avait instruits. Il ferma le siècle apostolique. On sait que d'après Jean.21.21, la croyance se répandit dans l'Église chrétienne qu'il n'était point réellement mort.
Pour bien comprendre la 1re Épître de saint Jean, il faut avant tout se représenter exactement le temps où il vivait, la mission spéciale que lui imposait cette époque et l'état spirituel des églises auxquelles il : s'adresse. En nous plaçant ainsi sur le vrai terrain historique, nous aurons un double avantage : celui de mieux nous pénétrer de la pensée de saint Jean, et celui d'en découvrir plus facilement l'application aux siècles qui suivirent et en particulier au nôtre. Notre siècle, en effet, qui, au sein des agitations qui le travaillent et des ruines qui le couvrent, semble destiné de Dieu à préparer une ère nouvelle dans le développement de son règne, présente avec l'époque où vécut saint Jean une frappante analogie. Les obstacles qu'eut à combattre l'Apôtre sont semblables à ceux que rencontre aujourd'hui la prédication de l'Évangile.
Du vivant de saint Paul, des doctrines antichrétiennes menaçaient déjà la vie spirituelle des églises de l'Asie Mineure ; ces dangers, un moment détournés par l'influence personnelle du grand apôtre, éclatèrent avec d'autant plus de force, après son martyre. Saint Jean fut appelé à le remplacer dans la direction de ces églises exposées à de si sérieux périls, et après avoir, durant plusieurs années, exercé son ministère au milieu d'elles, il leur adressa cette épître pastorale, dans le but de les préserver des fausses doctrines qui risquaient d'altérer l'Évangile. Celles-ci étaient en partie théoriques, en partie pratiques : les unes avaient leur source dans une conception étroite et incomplète de la vérité chrétienne ; les autres étaient des égarements moraux, qui ne se rattachaient à aucun principe profond. Mais il est à remarquer que toutes les erreurs combattues par saint Jean portent non sur certaines divergences dogmatiques et secondaires auxquelles on a accordé plus tard une valeur exagérée, mais sur l'élément vital, sur la condition essentielle du christianisme. Cette polémique de l'Apôtre est un modèle à suivre : on ne se rapprochera de la vérité qu'en établissant, comme lui, dans les discussions religieuses, cette distinction fondamentale et trop souvent négligée entre tout ce qui a quelque importance pratique et tout ce qui n'en a point.
Au temps de saint Paul, toutes les controverses revenaient à l'opposition entre la Loi et la Grâce ; il s'agissait de savoir si la foi en Jésus, le sauveur des pécheurs, suffisait pour justifier et sanctifier l'homme, ou bien s'il fallait en outre, afin d'être sauvé, se soumettre à l'observation de la loi mosaïque. A l'époque de saint Jean, la lutte avait changé de terrain ; elle se concentrait autour de la personne du Christ, et il devint toujours plus manifeste que la réalisation plus ou moins complète du christianisme dans la foi et dans la vie, dépend de la conception plus ou moins pure de la personne du Christ. Lors de la première captivité de l'apôtre Paul à Rome, les discussions avaient déjà commencé à prendre cet aspect, comme nous le voyons par les attaques qu'il dirige contre les faux docteurs de Colosses. L'épître aux Colossiens nous montre que la personne du Christ, dans ses rapports avec Dieu, avec l'univers, avec l'humanité, formait alors le centre du débat. Ce même fait se reproduit de nos jours, où toutes les questions religieuses de quelque importance sont forcément ramenées à celle-ci : « Que faut-il penser de la personne de Jésus-Christ ? » Ce qui, d'après saint Jean, constitue son essence propre, c'est que la Parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu et par laquelle toutes choses ont été créées, a été faite chair. Cette union de la nature divine avec la nature humaine, cet abaissement volontaire de la vie divine revêtant une forme humaine, afin que la vie humaine servît d'organe à la vie divine, telle est la différence capitale qui sépare la venue du Christ de tout autre fait historique. Or ce caractère distinctif de la personne du Christ est aussi celui du christianisme ; en effet, son but n'est autre que de consacrer au service de Dieu et de pénétrer en quelque sorte d'une vie divine tous les éléments de la vie humaine. Ainsi toute la morale chrétienne, la conception de la vie telle que la détermine le principe chrétien, dépend de l'idée qu'on se fait de la personne du Christ, la Parole devenue chair. Comme le trait caractéristique de cette personne est l'union absolue du divin et de l'humain, on vit bientôt s'élever sur ce sujet deux erreurs opposées, selon qu'on relevait exclusivement l'une ou l'autre des faces de la double nature du Christ. Mais ces deux erreurs contraires sont une preuve de plus en faveur de la vérité qu'elles méconnaissent ; car pour produire sur des esprits sérieux deux impressions si opposées, il fallait que la personne de Christ présentât réellement le double aspect sous lequel l'Évangile nous apprend à l'envisager. Les uns furent tellement frappés par le côté humain de sa nature, qu'ils ne virent dans le Christ qu'un homme, doué pour l'accomplissement de sa vocation toute humaine, d'une force surnaturelle et divine. Les autres tombèrent dans l'extrême opposé : n'envisageant que la gloire céleste qui rayonnait en Jésus, ils n'accordèrent aucune réalité à sa personne humaine ; elle n'était pour eux qu'une ombre, une vaine apparence, une enveloppe dans laquelle s'était caché un être divin pour mieux se mettre à la portée des hommes.
Entre ces deux points de vue contraires qu'attaque saint Jean, celui des Ebionites et celui des Docètes, vint s'en placer un troisième qui paraissait les concilier, mais qui, loin de s'approprier la part de vérité de chacune de ces doctrines, ne leur empruntait que leurs erreurs, affaiblissant tout ensemble, dans la personne de Christ, et l'élément humain et l'élément divin. Ce fut le système de Cérinthe : selon lui, Jésus n'était qu'un simple homme, que rien ne distinguait de tous les autres enfants d'Adam ; mais lors de son baptême, quand il entra dans son ministère public et qu'il fut solennellement déclaré Messie, dans cet instant-là l'Esprit divin, jusque-là entièrement distinct de lui, descendit sur Jésus et s'unit magiquement à lui. Cette manière de voir défigure la véritable image de Christ en brisant l'unité de sa personne ; en effet, tout en admettant en lui les deux natures, Cérinthe les considère comme séparées, isolées et accidentellement réunies. C'était méconnaître à la fois l'élément divin sous sa forme humaine, et l'élément humain purifié et ennobli par une pénétration divine. Ainsi que les précédentes, cette conception nouvelle voilait le vrai caractère de la personne du Christ, et, par suite, celui de la création nouvelle qui devait émaner de lui comme du Dieu-Homme, Rédempteur de l'humanité.
En face de toutes ces théories qui dénaturaient et la personne et l'œuvre de Christ, l'apôtre saint Jean se sentit pressé d'élever la voix. Comme témoin oculaire, il avait à faire connaître la vérité sur la vie de Jésus-Christ, dans lequel il avait vu briller « la gloire du Fils unique du Père. »
Les enseignements de l'Apôtre s'appliquent avec une convenance parfaite à notre époque ; car, sous des formes différentes, la vérité chrétienne rencontre aujourd'hui les mêmes adversaires.
Les uns ne voient en Christ que l'homme le plus éclairé, le docteur religieux le plus accompli, le modèle le plus achevé qui ait jamais été présenté aux regards humains ; le christianisme n'est pour eux qu'une doctrine ou un code de lois morales ; ils méconnaissent l'élément surnaturel et divin de la vie de Christ et n'admettent entre lui et les plus excellents d'entre les hommes qu'une différence de degré ; à force de tourmenter le texte, ils rabaissent l'histoire évangélique jusqu'à la faire rentrer dans le cercle étroit de notre vie de tous les jours ; aussi sont-ils incapables de comprendre les prodigieux effets du christianisme qui ne permettent d'établir aucune comparaison entre lui et toute autre puissance spirituelle, quelle qu'elle soit. Ils ne peuvent comprendre que la vie divine pénètre, purifie et rehausse tout ce qui est humain, et le christianisme même, dans son essence, reste pour eux un mystère.
D'autres reconnaissent que cette conception fait violence au récit des évangiles ; ce que nous savons de la vie de Christ réveille en eux des idées plus hautes ; mais ils se tiennent pour ainsi dire sans cesse dans les nuages, sans redescendre jamais sur la terre des vivants ; les faits historiques n'ont pour eux aucune réalité ; ce sont des mythes à travers lesquels percent des rayons de lumière céleste. Le Christ historique n'est plus qu'un fantôme sans vie, un être de raison, comme le considéraient autrefois les Docètes. Ainsi demeure béant l'abîme entre l'idéal éternel et la réalité terrestre, abîme que le Christ est venu combler et qui se comble tous les jours pour ceux qui entrent en communion avec lui, en l'acceptant comme leur Sauveur. Tandis que les uns s'en tiennent à un terre-à-terre sans noblesse, incapables qu'ils sont de s'élever jusqu'aux choses divines, les autres se contentent de conceptions idéales qui n'entrent jamais dans le domaine de la vie réelle, ombres vaines dans lesquelles on cherche inutilement de la chair et du sang, abstractions pâles, froides et mortes, qu'un souffle vivifiant n'est jamais venu animer, et qui par conséquent laissent ces stériles penseurs aux prises avec un monde de chimères dont ils ne parviennent pas à se dégager. Les uns ne veulent qu'un Christ idéal, les autres qu'un Christ tout ordinaire, qui ne dépasse pas le niveau du commun des hommes ; ceux-ci ne s'attachent qu'à la lettre, ceux-là qu'à l'esprit, et par là l'esprit et la lettre se perdent à la fois ; on ne les conserve qu'en les unissant.