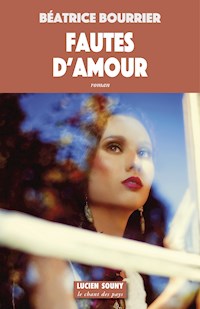— Hâte-toi, Raymond, l’omnibus ne nous attendra pas et nous allons rater le mariage de ma sœur !
Raymond entendit son épouse l’appeler depuis le corridor de l’entrée. Il jeta un coup d’œil complice vers sa mère qui lui sourit, sans bouger. Le salon était traversé par un rayon de soleil que laissaient filtrer les rideaux bonne femme de
velours vert cramoisi légèrement élimés aux embrasses. Le parquet de chêne consciencieusement ciré par Julienne embaumait l’encaustique et la pendulette de la garniture de cheminée en régule doré sonnait huit coups.
— Viens, mon petit, approche-toi, que je t’arrange la cravate.
Raymond tendit son cou de poulet, dont la peau fripée pendait comme un vieux chiffon, vers sa mère, la première et peut-être la seule femme de sa vie.
— Tu vois, mon garçon, c’est comme cela que l’on tourne une cravate élégante. Le morceau le plus large, là, passe devant. Julienne est de bonne volonté, mais elle aura beau essayer, elle ne saura jamais faire un vrai nœud !
Raymond lui sourit. Elle put lire dans ses yeux un air faussement désolé.
— C’est vrai, mais tu sais bien que ma femme n’a pas toujours les bonnes manières… Allez, j’y vais ! Passe une belle journée, maman. Nous serons de retour pour la soirée. Je crains de beaucoup m’ennuyer à ce mariage, mais que veux-tu, c’est la sœur de Julienne, et nous nous devons d’y assister.
— Ta présence leur fera honneur !
Julienne attendait dans le vestibule. Son mari arriva enfin, s’empara de son chapeau melon et de sa canne, et passa devant. Ils sortirent de la
demeure et Raymond extirpa de la poche de son veston une grosse clé pour fermer la porte. Il s’avança, elle lui emboîta le pas. Âgée d’une trentaine d’années, intelligente et tranquille, elle avait fait un mariage raisonnable et elle
vivait depuis sous le toit d’une belle-mère omnipotente. Descendue de Margeride à l’âge de seize ans, elle avait trouvé un emploi dans une riche famille de Montpellier, pour assister la gouvernante
qui lui avait appris beaucoup de choses sur la tenue d’une maison. L’intendante avait un fils, Raymond Kéravec, plus vieux que Julienne d’une dizaine d’années. Il faisait la fierté de sa maman, car il était clerc de notaire. Ils occupaient ensemble un appartement sombre et vaste. Mme Kéravec mère réfléchissait au choix d’une bru, car son vieux garçon prenait de l’âge et la femme qu’ils éliraient devrait être aussi souple de caractère que propre et travailleuse. Elle avait présenté le fiston célibataire à Julienne. Elle appréciait les qualités de la jeune bonne et elle avait manœuvré si finement qu’après seulement deux rendez-vous, ils s’étaient mariés. C’est de cette façon que Julienne était devenue Mme Raymond Kéravec, sans amour, mais sans dot et sans déplaisir. Elle avait alors quitté son travail pour une relative aisance d’épouse de clerc de notaire. Grâce à son époux, elle pouvait aujourd’hui « marier sa sœur », c’est-à-dire lui offrir deux paires de draps de lin, un foulard ainsi que des dormeuses
en or, très petites, presque un bijou d’enfant, qui s’ennuyaient dans leur coffret.
***
En cette journée de mars 1907 où la lumière s’étalait, disparaissait, puis à nouveau illuminait les garrigues, Armand Vernet se mariait avec Émilie Pradines. Une brise légère soufflait sur les nuages de Saint-Jean, petite bourgade blottie au pied des
Causses, dominant l’immense plaine du bas Languedoc qui borde la Méditerranée. C’était un modeste mariage qui ne comptait que huit convives, mais il était riche de l’amour que les deux promis se portaient. Le novi regardait sa demoiselle avec des éclats de diamant dans les yeux, et la bouche rubis d’Émilie s’étirait en un sourire ravi. Le petit groupe s’avançait vers l’église. Julienne était le témoin de la fiancée. Sincèrement heureuse, elle avait compris à quel point Émilie aimait Armand quand elle lui avait déclaré : « Il est toute ma vie ! » La grande sœur avait souri, consciente malgré tout de leur impécuniosité et du courage qu’il leur faudrait pour faire vivre un ménage. Émilie se savait sans le sou, mais pour elle l’amour remplaçait bien les pièces d’or ! L’absence de ses parents était la seule ombre à son bonheur. Ils habitaient dans la rude Margeride. Là où la misère comme la neige s’étendent sur la plupart des foyers chaque hiver et rendent les déplacements difficiles. Émilie ressentait une petite morsure au cœur de ne pas être menée par son père à l’autel. Mais elle connaissait la situation et elle pardonnait. En s’habillant ce matin, elle avait mis dans la poche de son joli tablier brodé le petit billet que ses parents lui avaient envoyé, où ils la félicitaient et l’embrassaient. Et puis Armand lui avait promis qu’à la fin des vendanges, ils monteraient en Lozère, et elle pourrait le leur présenter officiellement. De famille, pour Armand, en ce beau jour d’union, il n’y en avait point. Armand Vernet, vingt ans, était un homme sans passé. Né de père inconnu, élevé par une femme redoutable, une mère au cœur de pierre. Elle lui avait fait payer à coups de trique et d’humiliations sa propre culpabilité de fille-mère. Du plus loin qu’il s’en souvienne, son univers était rempli de gifles et de privations qu’il avait subies sans question ni réplique, la peur occupant tout l’espace. Vers l’âge de douze ans, il avait cependant réalisé que la nature lui faisait cadeau d’une bonne taille et de muscles secs, maigres mais puissants. Sa mère avait même commencé à se méfier de ce garçon apeuré qui grandissait. Et puis… L’impensable entre une femme et son fils était arrivé. Une chose terrible, qui était le secret d’Armand, sa honte. Il tentait vainement de ne plus y penser. Après, il avait pris la route, incapable de se fixer. Il avait souvent eu faim, mais
ce n’était pas nouveau pour lui. Peut-être avait-il volé un pain ou grappillé quelques raisins ? Un jour, il était arrivé à Saint-Jean où il avait appris que les frères Arnal, des potiers qui avaient réussi dans les tuiles vernissées, étaient en quête d’un ouvrier. Il s’était présenté, avait menti sur son âge, et ils lui avaient fait confiance. Achille et Hippolyte Arnal étaient de ces gens droits, simples et menés par leur cœur, qui ne cherchaient pas le mensonge derrière les paroles. Armand s’était alors mis à taper la croûte de la terre de toutes ses forces. Dans les profondeurs souterraines se prélassait une couche énorme d’une argile exceptionnelle, d’un jaune crémeux, soyeuse et douce comme nulle part ailleurs. Déjà les hommes du Moyen Âge avaient creusé et ils avaient trouvé ce trésor. Ne racontait-on pas que les Romains se servaient de cette matière somptueuse ? Cet artisanat séculaire permettait à la plupart des habitants de vivre sinon dans la prospérité, tout au moins à l’abri de la misère. La poterie requiert bon nombre de qualités, mais au début de la chaîne il faut savoir extraire l’argile, et Armand devint rapidement un des meilleurs ouvriers de la région. Il mettait un tel cœur à l’ouvrage qu’un observateur perspicace n’aurait pu ignorer la fureur qui l’habitait. Chaque fois qu’il enfonçait son pic, il tentait d’éteindre la rage qui grondait dans sa poitrine. Chacun de ses coups répondait à une gifle maternelle et repoussait la souffrance qu’il en avait retirée. Comme si la terre le soignait, il oubliait sa douleur dans l’effort et peu à peu devenait calme, si ce n’est heureux. Ses patrons n’avaient de cesse de le féliciter. Ils le nourrissaient, le blanchissaient et ne lui faisaient jamais un
tour de travers pour lui régler son salaire. Mais Armand n’avait connu le vrai bonheur que le jour de sa rencontre avec Émilie. Elle arrivait de Saint-Chély en Lozère, pour travailler comme aide-cuisinière chez les Arnal, et, au premier regard échangé, Armand avait été éclaboussé par l’amour. Cette sorte d’amour fou réservé à ceux qui aiment pour la première fois, qui dompte le torrent de peine et de violence des êtres tristes. Par sa simple présence, Émilie avait permis à une foule de choses bonnes de prendre naissance à l’intérieur d’Armand, pour nourrir la douceur de ses jours. Et quand elle avait accepté de parler avec lui, le soir, puis d’aller danser et de l’embrasser, Armand s’était senti définitivement serein. Son cœur s’était déployé. Il découvrait la vie vraie avec le bonheur pour lanterne.
Et ce 21 mars Armand tenait la main d’Émilie qui sautillait légèrement pour suivre son pas décidé vers l’église. Sur le parvis, le curé, tout en sourcils et en sourire, les accueillit avec sa tête de brave homme qui, c’est assez rare dans ce ministère pour être noté, aimait les enfants et les pauvres. Lucio, le copain du marié, ouvrier comme lui, dont toute la famille était restée là-bas, en Italie, prit le bras d’Émilie et avança, mine sérieuse et mise modeste. Honoré de conduire la future, il avait sorti son vieux veston noir du dimanche, devenu
si serré avec les années que sa respiration était saccadée et qu’il avait les joues rouges. Ses cheveux couleur de paille, hirsutes, et son
pantalon de velours trop court lui donnaient l’air d’un épouvantail à moineaux. Armand s’effaça pour laisser entrer la noce aussi humble que la naissance entre le bœuf et l’âne. Le cortège ne comprenait que quelques proches : Louison, l’amie d’Émilie depuis qu’elle était arrivée au village, et Paulo, son mari, devenu le copain d’Armand, puis Raymond et Julienne qui proposait son bras à Armand afin de l’amener vers l’autel où Lucio avait déjà installé Émilie. Le curé les fit s’agenouiller et manifesta par un large sourire son plaisir d’unir deux oisillons tombés du nid. Avec une voix paternelle, presque enveloppante, il demanda :
— Armand Jacques Vernet, voulez-vous prendre Émilie Marthe Myrta Pradines pour épouse, la chérir, l’honorer et la garder dans la maladie ou la santé, jusqu’à ce que la mort vous sépare ?
Armand fixait l’abbé, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. Puis, d’un coup il tomba, la tête tapa le marbre glacé des marches de l’autel nuptial, tout son corps s’effondra. Était-il mort ? Se pouvait-il qu’en cette belle journée d’union, la mort dérobe Armand au bonheur ?
Armand entendait une voix féminine. Il flottait dans une sorte de brouillard.
— Lâche ça !
Sa mère bavait de fureur en le poussant de toutes ses forces et Armand s’accrochait encore plus à la rampe du wagon. Il avait dix ans et il pleurait ; ses larmes salées, sur les écorchures récentes, lui piquaient les joues.
— Maman ! Maman, non, je veux pas y aller !
— Sors de là, je te dis, et cesse de faire l’enfant.
Le gitan sur le quai, au fort accent andalou, s’inquiétait :
— Moi, madame ioulia, ie ne suis pas sûr que ie vais vous le prendre, il a l’air si pleurnichard et il est tellement maigre.
Mme Julia, mielleuse et décidée à se débarrasser de ce gosse si encombrant, rassurait son interlocuteur :
— Mais non, allons ! Il est émotif, mais il travaille dur. Vous verrez, vous ne le regretterez pas.
Laissez-lui un petit moment et il s’habituera. Il oubliera très vite sa vie d’avant, croyez-moi !
Puis, se retournant vers le fils, son visage reprenait instantanément sa dureté.
— Écarte-toi et dépêche-toi.
Elle tira d’un geste si brusque la porte du wagon qu’elle se referma, éjectant en même temps Armand qui laissa au passage la phalange de son petit doigt sur la
rampe. Il se releva et regarda ce bout de chair sanguinolent couler lentement
le long de la barre, telle une limace sanglante. Le petit garçon se disait que ce n’était pas possible, qu’elle ne pouvait pas l’abandonner sur le quai, comme un ballot qu’on oublie dans une gare. Il n’avait pas imaginé… Quand il aperçut les pièces dans la main de sa mère, il comprit : elle venait de le vendre ! L’épouvante le saisit. Pour quelques pièces qu’elle pourrait boire immédiatement, elle n’aurait plus à héberger ce fils mal nourri, mal aimé. Elle se débarrassait de lui comme on jette d’une paire de souliers trop usés ou telle la tinette qu’on balance au matin.
Le brouillard, toujours, et loin, très loin, il percevait des cris :
— Armand ! Armand !
Il sentit un parfum âcre sous ses narines. Doucement il ouvrit les yeux et revint à lui, allongé au milieu de cette chapelle où sa future épouse lui tapotait la main avec amour. L’émotion avait été trop violente ; cette femme qui le voulait pour mari boxait, dans sa mémoire, celle qui l’avait rejeté. Son cerveau avait vacillé sous le choc. Armand attrapa le bras de Lucio, se remit debout en le
remerciant. Il avala une grosse goulée d’air frais, regarda sa main au petit doigt raccourci et savoura cet instant. Il
redevenait un homme en chassant ses malheureux souvenirs d’enfance.
— Ça va, on peut continuer, c’est passé, tout va bien…
Le curé renouvela sa demande. Dans un murmure de source qui n’ose jaillir au grand soleil, tout plein de cette force qui se retient encore,
Armand dit oui. Un oui pour la vie, un petit oui tout doux qui s’envolait vers Émilie. L’émotion ne lui laissait qu’un mince ruisselet d’air, mais son « oui » était chargé de promesses et gonflé de bonheur.
— Et vous, Émilie Marthe Myrta Pradines, voulez-vous prendre Armand Jacques Vernet pour époux, l’honorer, le chérir et le garder dans la santé ou la maladie, jusqu’à ce que la mort vous sépare ?
Le son franc et rond sortit de la bouche d’Émilie. Étonnée de la puissance de son vœu, elle se reprit et dit oui plus doucement, avec sur le visage ce que les
enfants possèdent et que les grands cherchent toujours, l’humanité. Une affirmation forte de son amour pour cet homme, une passion tendre dans
laquelle elle calerait sa vie, confiante, tranquille, protégée.
— Je vous déclare unis par le mariage devant Dieu, et ce que Dieu a uni, lui seul peut le désunir. Bonne route, mes enfants !
Le bedeau sonna les cloches à toute volée afin d’annoncer aux vignes et aux campagnes qu’Armand prenait Émilie pour épouse. Le jeune marié était si heureux qu’il ne pouvait ni parler ni bouger. Il caressait sa femme du regard. Dans un
mouvement léger, elle fit voler son joli jupon, avec ce fameux tablier blanc que son amie
Louison avait finement brodé. Elle portait sur les épaules un foulard décoré de roses enlacées de bleuets, offert par Julienne tout comme la paire de minuscules dormeuses
en or à ses oreilles. Son bonheur lui faisait retrousser délicatement la lèvre supérieure sur ses petites dents blanches et brillantes comme des perles d’eau. Brune et lumineuse, à la manière des filles du Midi, elle était parée d’une guirlande de muguet qui éclairait sa chevelure soyeuse. Elle souriait avec son visage de squaw décidée et Armand se sentait l’homme le plus heureux du monde. S’il se l’était permis, il aurait hurlé à la terre, au ciel et à tous les anges qu’elle devenait sa femme. Désormais ils seraient deux pour affronter la vie dans le triomphe de l’amour. Être ensemble suffirait pour tout créer et tout réparer.
Après la célébration, ils partirent vers le magasin qu’Achille Arnal avait consenti à leur prêter pour le modeste banquet. Louison avait économisé un mois entier afin de préparer un canard à l’orange qu’Émilie et Armand découvrirent avec joie. Au moment du gâteau, Achille arriva, du champagne dans les mains. Lucio ouvrit une bouteille de
cette liqueur jaune comme du colza qui éclatait en milliers de gouttes de citrons dans le palais, le limoncello d’Italie. Raymond récita un compliment fort bien tourné et Lucio interpréta des chants de chez lui, que personne ne comprenait, mais dont on était sûr qu’ils parlaient de l’amour resté au pays, des oranges douces comme du miel et de la mamma qui espérait le retour du fils. Émilie se leva à son tour et s’adressa à son mari :
— Armand, je veux te remercier devant tout le monde pour cette merveilleuse journée. Tu sais que mes parents me manquent, mais ma sœur et mon beau-frère nous ont permis, par leur présence, d’effacer cette petite tristesse. Par leur présence et leurs cadeaux ! Merci encore à vous deux pour les draps, le joli foulard, et les ravissantes boucles !
À ces mots, Émilie pencha la tête pour caresser de l’index les dorures qui ornaient ses oreilles et Raymond blêmit. Il tourna son visage vers son épouse et la fusilla du regard. Julienne avait-elle omis de demander à son mari l’autorisation d’offrir ce petit bijou à sa sœur ? Qu’est-ce qui pouvait mettre Raymond dans pareille colère ? Louison, qui ne s’était aperçue de rien, décida que l’état de Paulo justifiait qu’elle se lève et propose de rentrer à pied dans la journée finissante. Le beau brun aviné, Paulo, serait bien resté un peu plus, mais il avait le vin docile. Il entama une révérence à l’adresse des nouveaux époux, qui finit par le déséquilibrer et qui l’envoya le nez dans la sciure. Tous éclatèrent de rire. Lucio but encore un petit verre de cette fameuse liqueur. Il
voulait être « il ultimo, le dernier, à quitter les jeunes mariés ». Alors qu’ils reprenait le chemin de la gare. Sans attendre la sortie du village, Raymond
interrogea Julienne.
— Mais bien sûr que oui, il y a quelques mois, je t’avais demandé si je pouvais offrir à ma sœur ces petites boucles !
— Je suis certain du contraire !
— De toute façon, elles sont tellement minuscules que je n’aurais jamais pu les porter.
— Et ma mère ?
— Mais pas plus ta mère que moi ! Et puis je me souviens que tu m’avais dit les avoir achetées lors d’une vente aux enchères il y a de nombreuses années de cela. Ce n’est donc pas un bijou de famille ! Elles ont d’ailleurs si peu d’importance que tu ne te rappelles même pas que nous en avions parlé.
Raymond ne desserra plus les mâchoires pendant tout le trajet de retour, réfugié en lui-même à cause de son mécontentement et d’une petite inquiétude qui lui grignotait l’estomac. Quelle serait la réaction de sa mère lorsqu’elle s’apercevrait de l’absence des boucles ? Peut-être s’en était-elle déjà rendu compte ?
À Saint-Jean, dans le hangar du repas de noces, ne planait dans l’air que le bonheur de cette belle journée. Finalement, l’ultime participant à rester encore dans la remise n’était pas l’Italien, mais le gros Babi, le chat noir des Arnal qui se faisait un régal des os de canard et des divers reliefs du banquet qui avaient atterri dans
son écuelle. Émilie prit Armand par la main et le guida vers son antre, la petite chambre de
bonne qu’elle occupait sous l’escalier, au rez-de-chaussée de la maison Arnal. Ils se couchèrent dans le lit de fer. Ils n’avaient pas attendu le mariage pour se caresser, mais désormais Émilie pouvait s’abandonner sans crainte. Elle éprouvait la délicieuse liberté du corps offert au mari. Dans le ravissement des chairs, ils goûtèrent l’accord parfait, sous le crucifix charitable.
***
Maintenant qu’ils étaient mariés, Émilie et Armand avaient décidé de « s’installer », comme elle disait. Célibataires, ils étaient logés par les patrons, elle dans la chambre en soupente et lui dans les écuries, au-dessus du cheval, où le foin lui servait de matelas. Depuis la célébration de leur union, ils partageaient le petit lit d’Émilie, mais la jeune épousée avait de l’ambition, elle voulait sa maison. Elle connaissait une modeste bâtisse, vers la route d’Aniane, qui appartenait à M. Crouzat, une construction en pierres blondes, inoccupée depuis plusieurs années. Les parents Crouzat qui l’avaient habitée étaient morts depuis longtemps. Leur fils unique, un garçon d’une quarantaine d’années, bourru et solitaire, résidait dans une autre demeure. Le célibataire accepterait-il de lui louer son bien ? Elle était parfaitement consciente de n’être pas « d’ici », ce qui justifierait un refus. Se pourrait-il que M. Crouzat soit plus ouvert que certains de ses compatriotes ? Émilie était convaincue qu’il existe toujours des raisons d’espérer.
Deux semaines après le mariage, à l’heure où la rosée est agréable au troupeau, elle se résolut à aller lui parler. Elle savait que la timidité d’Armand lui aurait interdit une telle démarche. Le fils Crouzat se montra sensible à la fraîcheur et la bonhomie de cette jeune femme. Elle n’avait peur de rien et certainement pas de son abord froid et inquiétant. En quelques mots, l’ours agréa sa proposition. Pour un loyer très modique et en lui demandant de rattraper le jardin envahi de sauvagine, il lui
remit la clé. Elle repartit avec le précieux sésame dans sa poche. En remontant la rue principale, elle décida de faire la surprise à Armand qui était encore sur le chantier. Elle croisa des femmes de peine avec leurs paniers
d’osier remplis d’argile. Certaines les portaient sur la tête et avaient une démarche de reine. Elle les salua gracieusement. Il faisait doux, le soleil
descendait derrière les falaises de calcaire blanc. L’odeur suave des myrtes et des giroflées sauvages embaumait la garrigue. Le chemin bordé de pins serpentait entre vignes et olivettes. Émilie entendit le pic de son mari. Elle s’approcha et contempla son homme dont la divine beauté était mise en valeur par l’effort. Ses épaules étaient nues et de fines traces de sueur veinaient sa peau. Quand il aperçut sa femme, la surprise agrandit son regard.
— Qu’est-ce qui te mène ici, ma mie ?
Émilie ne lui avait rien dit. Avec un air mutin, elle sortit de sa poche la
grosse clé et la balança comme un pendule devant les yeux d’Armand. En un instant, il comprit. Il lâcha son pic et vint la prendre dans ses bras. Il mit ses mains autour de sa
taille et la souleva.
— Notre maison !
— Alors Crouzat a dit oui ! Tu as su le convaincre… Tu es forte, ma mie, que tu es forte ! Je suis si fier de toi !
Dès le lendemain, Émilie demanda à Achille Arnal si elle pouvait utiliser la charrette, pour le déménagement. Non seulement il le lui accorda, mais, n’ayant pas oublié les heures moins fastes, ce qui est assez rare chez les nouveaux bourgeois, il
lui proposa de choisir avec son mari quelques meubles parmi ceux entreposés dans la remise.
En fin de journée, dans la chaleur du printemps, le couple chargea la carriole. Armand y posa
une valise avec son habit de rechange, une paire de souliers propres et son
calendrier. Émilie remplit une grande bassine avec le linge offert par Julienne et la plaça sur la table, près des deux chaises paillées récupérées dans le magasin Arnal. Une jarre d’huile d’olive et un panier dans lequel elle conservait ses précieuses dormeuses en or complétaient le chargement. Armand l’aida à monter sur le banc et commença à marcher à côté du cheval en le guidant par le licol. Ils partaient vers leur maison ! La jeune femme riait aux anges dans la poussière du chemin. Elle aimait cet homme qui tenait la lanière et qui avançait d’un pas calme. Elle ne se lassait pas de le regarder pour mieux l’adorer. Au début de la route d’Aniane, la petite façade de la demeure Crouzat leur sourit avec ses yeux aux volets verts et ses
muscaris bleus aux pieds. Émilie donna la clé à son mari, mais l’arrêta net dans son élan. Il ne connaissait pas la tradition ! Elle comptait bien la lui faire respecter !
***
L’ambiance au foyer des Kéravec était un peu pesante. Depuis que son mari et elle étaient revenus du mariage d’Émilie, Julienne se sentait épiée. Elle ignorait que, le soir même, Raymond avait livré un récit circonstancié à sa maman. Subitement, Mme Kéravec mère s’était découvert un attachement inédit à ces petits bijoux. Elle avait rugi : « Je vais la voir de ce pas et lui apprendre à respecter la famille qui l’a accueillie. » Il l’en avait dissuadée. Il lui avait expliqué que Julienne se fâcherait si elle comprenait qu’il avait tout raconté à sa mère. « Et alors ? Tu n’es pas le chef de famille ? » avait-elle rétorqué. « Certes ! Mais il nous faudrait être plus fins… que tu découvres l’absence des boucles sans qu’elle sache que je t’en ai parlé. Tu sais, elle me reproche parfois d’avoir une intimité avec toi trop… comment dit-elle… trop envahissante. » À ces mots, Mme Kéravec mère avait blêmi, son visage s’était allongé, ses joues s’étaient raidies. « Envahissante ? Moi qui t’ai donné toute ma vie, qui t’ai élevé seule à la mort de ton père ! Moi qui n’ai eu que toi comme horizon et unique enfant ! Comment peut-on se montrer aussi ingrate ? Je suis bien déçue ! Je croyais Julienne douce et soumise et je découvre qu’être devenue Mme Kéravec lui monte à la tête. Mais il n’y en a qu’une, tu entends, mon petit, ici, il n’y a qu’une seule Mme Kéravec et c’est moi ! »
Julienne vaquait à ses occupations, intriguée par des clins d’œil, des mauvais sourires entre son mari et sa mère. Pour autant elle n’imaginait pas l’orage qui grondait au-dessus de sa tête. Raymond, plus mielleux que jamais, lui offrait une mine polie quand le soir,
réunis, ils lapaient en silence leur soupe. Il attendait, sans un merci, l’allumette rituelle que lui tendait sa femme pour allumer le cigare qu’il mâchouillerait toute la soirée. À la fin de la semaine, profitant de la nouvelle promotion de son garçon, Mme Kéravec mère ouvrit le feu.
— Mon petit, mon Raymond ! Comment t’exprimer ma fierté ! Devenir premier clerc de l’étude ! Quelle promotion, mon fils !
— Merci, maman. C’est vrai que je l’attendais depuis quelque temps, mais, quand Me Jourdan en personne est venu m’annoncer que j’allais changer de bureau pour assumer ces nouvelles responsabilités, j’en ai rougi d’émotion.
— Il y a de quoi ! Je te comprends ! Et vous, Julienne ? Vous ne dites rien, vous n’en revenez pas d’être l’épouse d’un premier clerc !
Un léger rictus étira la bouche de Julienne en un sourire se voulant humble mais masquant mal une
pointe de moquerie.
— Je n’ai jamais douté de la qualité de mon mari.
— Moi non plus, non, mais je voulais dire que vous devez être excessivement flattée d’être l’épouse d’un homme de la valeur de mon fils.
Julienne baissa les yeux sans répondre. Elle n’oubliait pas qu’elle venait de la montagne, sans argent ni dot. En se mariant, elle avait
cependant offert sa jeunesse à quelqu’un de presque quinze ans son aîné. Elle se savait assez peu jolie ; était-il nécessaire que sa belle-mère le lui rappelle aussi vertement ?
— Une fois n’est pas coutume, j’ai décidé que nous allions célébrer cette promotion en donnant une petite réception.
Raymond appréciait. Julienne restait dubitative :
— Une réception ? Vous voulez inviter combien de personnes ?
— Eh bien, j’ai pensé au commis de l’apothicaire, le jeune Octave Loublié, à M. Monteil et sa femme qui nous avaient reçus lors de la communion de leur fils et au collègue de travail de Raymond, le jeune Valette.
— Voilà une idée réjouissante.
Finalement, Julienne se plaisait à la perspective d’organiser une petite soirée. Elle savait pourtant que sa belle-mère ne la laisserait même pas inviter sa sœur Émilie et son beau-frère. Mme Kéravec mère poursuivait, installant son redoutable piège :
— Pour cette occasion, nous sortirons le Limoges avec le filet doré et il nous serait agréable que vous portiez votre robe de mousseline bleue ainsi que les petites
dormeuses d’or. Cela donnera le ton : habillée, mais sans faire trop de chichi. J’aime l’élégance dans la simplicité.
À ces mots, Julienne eut une intuition, une vague inquiétude. Elle tenta d’accrocher le regard de Raymond, qui fuyait.
— Pour la robe bleue, ce sera bien volontiers, mais les dormeuses…
— Quoi… ?
Julienne, contrariée, n’arrivait pas à formuler correctement sa pensée. Elle observa sa belle-mère, puis chercha un appui auprès de son mari qui se dérobait sans cesse.
— Les boucles d’oreilles… Elles ne sont plus là.
— Comment ?
Le ton de la répartie était inquisiteur et agressif.
— Je… Ni vous ni moi ne pouvions les porter, car elles étaient bien petites, et j’ai proposé à Raymond de les offrir à ma sœur comme cadeau de mariage…
Elle la coupa sèchement :
— Raymond n’a rien à voir avec cette affaire ! C’est à moi qu’il fallait le demander et je vous l’aurais refusé !
Le traquenard se refermait. Julienne ne pouvait attendre d’aide de personne et certainement pas de son époux.
— Vous vous êtes servie dans nos bijoux de famille ! Votre comportement me déçoit énormément…
— Ce n’étaient pas des bijoux de famille ! Raymond les avait acquises lors d’une vente aux enchères il y a quelques années… Raymond, dis-le à ta mère !
Mais Raymond ne répondait pas. Il dodelinait de la tête ; sa lèvre inférieure se retournait et la salive affleurait à la commissure.
— Ces dormeuses appartenaient aux Kéravec, quel que soit leur mode d’acquisition, et vous vous en êtes emparée !
— Comment ça « emparée » ? Laisseriez-vous entendre que je suis une voleuse ? Je ne le supporterai pas, je n’ai jamais rien volé de toute ma vie. J’ai cru que je pouvais offrir ce petit cadeau à ma sœur pour ses noces, car Raymond disait qu’elles n’avaient pas beaucoup de valeur et que, de toute façon, ni vous ni moi ne les porterions.
Julienne sentait les larmes lui monter aux yeux, mais elle n’était pas femme à laisser voir son émotion. Intimement blessée, elle inspira profondément, elle serra les dents et retint ses pleurs. Pourquoi sa belle-mère devenait-elle si venimeuse ?
— Ma bru, il est peut-être nécessaire de mettre les choses au point. Voilà plusieurs années que vous êtes l’épouse de mon fils et je constate qu’avec le temps, vous en prenez un peu trop à votre aise.
Julienne était dévastée. Raymond se rendait-il compte que sa mère allait trop loin ? Elle le fixa. Il tenta mollement :
— Maman… !
— Je sais ce que je dis, et, maintenant que tu es en train d’acquérir une position enviable, il faudrait rappeler à Julienne d’où elle vient. Je ne la laisserai pas, avec ses largesses inconsidérées, mettre en péril ton ascension.
Julienne ne parlait plus. Elle fixait désespérément son mari. Allait-il se ranger de son côté ou hurlerait-il avec les loups ?
— Non, non, c’est vrai que mon épouse a été bien cavalière dans sa prodigalité… Elle aime beaucoup sa sœur et en oublie…
Julienne serrait les mâchoires pour ne pas exploser.
— Je pense qu’elle aura compris, je suis certain qu’elle s’en excuse. Dis-le, dis à mère que tu t’excuses !
Mme Kéravec la toisait.
— Vous entendez, Julienne, c’est encore moi la maîtresse de maison !
— Excusez-moi, mère, lâcha Julienne dans un souffle.
Et elle s’enfuit vers sa chambre où, la tête dans l’oreiller, elle laissa exploser sa colère et sa peine. Quel affront !
Raymond, lui, éprouvait une joie perverse d’avoir fait remontrance à son épouse, dont l’initiative lui déplaisait, tout en satisfaisant à la jalousie de sa mère, qui se mettait en place au fur et à mesure. Vieillissante, ne travaillant plus, Mme Kéravec avait l’impression que Julienne, en additionnant les années de mariage, prenait une place plus grande que la sienne dans le cœur de son garçon, et cette perspective la rendait amère. L’aigrie doit nécessairement trouver un responsable pour s’éviter une remise en cause par trop douloureuse. Mme Kéravec était en train de trouver Julienne !
***
— Allez, soulève-moi, il faut que tu me prennes dans tes bras !
Les petites pervenches du fond des prunelles d’Armand s’illuminèrent. Émilie lui sauta au cou et en profita pour l’embrasser.
— C’est donc cela, la tradition ? Les bras et les baisers ! Eh ben, clairement, ça a du bon, la tradition !
— Mais non, nigaud, ce n’est pas mes petites caresses. La tradition, c’est que la mariée passe le seuil dans les bras de son époux, pour que la maison porte bonheur au couple toute la vie.
— Je ne connaissais pas…
Alors, ému et presque solennel, Armand tourna la clé dans la serrure puis appuya sur le loquet. Il porta sa femme quelques secondes
encore, afin de profiter de cet instant. Il aimait autant qu’il admirait son Émilie. Grâce à elle, il se sentait comme invité à la table des dieux. Il embrassa la pièce d’un regard. C’était une cuisine avec, contre un des murs, une grosse pierre, creusée en son centre, en guise d’évier. La jeune épouse sauta par terre. Elle ouvrit les vieux volets verts. La lumière inonda la salle.
— Elle est bien exposée, tu vois ? Même en fin de journée, regarde comme il fait clair !
Armand secoua la tête en signe d’approbation. Il n’avait pas de mot pour la joie qui l’envahissait. Ils entendirent du bruit derrière eux.
— Oh la ! La compagnie ! Besoin d’un coup de main ?
C’était Lucio qui portait sur son dos un matelas roulé.
— Lucio ! Merci, mon ami ! La chambre doit être à côté.
Émilie traversa la pièce, actionna l’espagnolette et poussa les volets. Elle découvrit une salle poussiéreuse meublée d’un lit de style Henri II, en bois peint d’un noir mat, qui semblait encore solide.
— C’est du châtaignier, ça ne craint rien, aucune bête ne peut l’attaquer, dit Lucio en clignant de l’œil.
— Quelle chance ! Je vais le passer à la cire et, tu as raison, il pourra reprendre du service sans problème.
Armand, tellement heureux, ne cessait de répéter :
— C’est épatant ! C’est épatant !
Sans attendre, Émilie commença à balayer pendant qu’Armand et Lucio apportaient la table et les chaises. Dans la cuisine, un vieux
placard dans le mur contenait quelques assiettes ébréchées, des verres et des bocaux vides. Deux heures plus tard, ils étaient installés et la maison commençait à revivre. Armand posa une bouteille de vin blanc sur la petite table, Lucio tira
de son pantalon Le Petit Méridional.
— Vous avez lu l’article sur ce qui s’est passé dimanche ?
— Non.
— À Bize, il y a eu une manifestation et on parle de plus de cinq cents personnes
autour de Marcellin Albert.
Armand, toujours un peu inquiet, demanda :
— Ça va nous mener à quoi, ces rassemblements pour les ouvriers de la vigne ? Je me rends compte que les viticulteurs sont dans une misère qui s’accroît, qu’il faut bien faire des vagues pour que ces messieurs de Paris s’occupent de nous, mais souvent c’est la politique qui gagne et pas les bonshommes.
Émilie ne l’entendait pas ainsi :
— Moi, j’ai lu ce qu’écrit Albert et je le comprends. Tout le Midi produit des quantités énormes de vin parce qu’on lui a demandé de fournir. En laissant rentrer, depuis l’Algérie et l’Espagne, des vins frelatés, ils vont empoisonner le peuple, les gens simples comme nous qui ne pouvons
pas acheter du vin bouché. Les cours vont s’effondrer. Et sans parler des barons du Nord qui sucrent le vin avec leurs excédents de betteraves alors que ça nous est interdit ici. Non, vraiment, ça ne tourne pas rond !
Lucio acquiesça :
— Tu as raison, Émilie, le Midi gronde parce qu’il a faim et qu’il désire vendre son vin dignement. Ce Marcellin Albert dit à qui veut l’entendre que ce n’est pas pour faire de la politique. On est des hommes, bon sang ! On a le droit de gueuler : « Vive l’anarchie ! »
Armand sourit à Lucio qui se laissait emporter par sa fougue d’Italien. Émilie reprit :
— L’anarchie, je ne sais pas s’il faut aller jusque-là, mais, pour le moment, ce qui me met en joie, c’est d’avoir un jardin où nous pourrons faire un potager, mettre quatre lapins et manger en attendant… ta révolution !
Tous les trois se regardèrent en riant, imaginant les fumets de soupes à venir, les tomates et salades qu’ils récolteraient, les soirées d’hiver réchauffées à la flamme du cantou