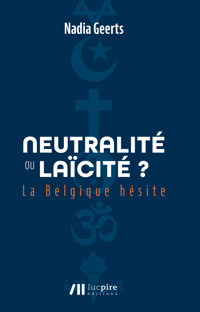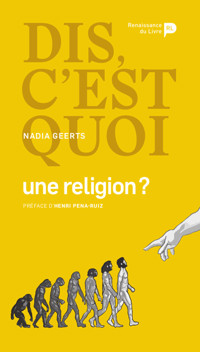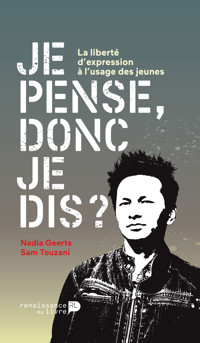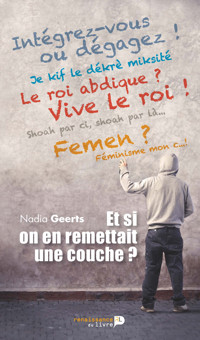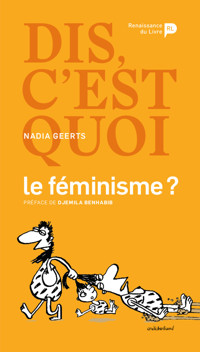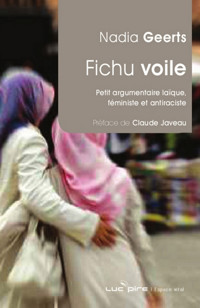
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Ces dernières années, la question du port du voile a pris de l’ampleur. D’abord centrée sur l’école, cette question a touché successivement le monde du travail et singulièrement la fonction publique, le Parlement, le barreau et même la rue, avec les débats relatifs au port de la burqa. Que s’est-il passé pour qu’un phénomène qui paraissait inexistant en devienne soudain assez central pour que des rentrées scolaires soient perturbées, des associations luttant contre les discriminations s’en emparent, les défenseurs de la laïcité, les démocrates et les féministes se divisent et qu’il devienne impossible de parler d’interculturalité sans qu’aussitôt, cette question ne surgisse comme incontournable ? Faut-il accepter le port de signes religieux en général, et du voile en particulier, au nom de l’émancipation, de la tolérance, du multiculturalisme et de la liberté d’expression ? Ou en limiter l’autorisation au nom de la laïcité, de l’égalité des sexes et d’un vivre ensemble interculturel ? Au-delà du simple bout de tissu, le voile nous interpelle car il nous contraint à réfléchir à des questions essentielles, liées au type de société dans lequel nous voulons vivre et à la place que l’État de droit doit accorder aux appartenances religieuses des uns et des autres : société de coexistence entre diverses communautés repliées sur elles-mêmes, ou société de brassage ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fichu voile !
Nadia Geerts
Tournesol ConseilsSA/éditions Luc Pire
Quai aux Pierres de Taille, 37/39 / 1000 Bruxelles
www.lucpire.eu / [email protected]
couverture: emmanuel bonaffini
illustration de couverture : © boulevard – fotolia
mise en pages: cw design
imprimerie: novoprint, barcelone (espagne)
isbn: 978-2-507-00387-6
dépôt légal: D/2009/6840/144
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
nadia geerts
Fichu voile !
Petit argumentaire laïque,
féministe et antiraciste
Préface de Claude Javeau
Postface de Caroline Fourest
Préface
S’il est un sujet qui de nos jours fait couler beaucoup d’encre et de salive, c’est bien celui du « voile », sémantiquement camouflé souvent en « foulard », ce qui semble moins « hard » – porté par un nombre croissant, semble-t-il, defemmes se réclamant de la religion musulmane. Se réclamantou acceptant,nolens volens, de feindre de s’en réclamer, c’est d’ailleurs là une dimension du problème.
Car problème il y a. Certes, dans une société démocratique, il ne peut être question pour le législateur de décider des vêtements que l’on peut ou non porter en public, mis à part les uniformes que doivent porter dans l’exercice de leurs fonctions diverses catégories d’agents professionnels. Libre aux femmes, comme aux hommes du reste, d’opter pour tel ou tel costume, dans les limites, comme on dit,qu’impose le respect de l’Ordre public et des bonnes mœurs. Limites dont on reconnaîtra qu’elles sont floues : à partir de combien de centimètres au-dessus du genou, par exemple,une minijupe pourra-t-elle passer pour indécente, du moinsdans la rue « ordinaire » ? La question, du reste, ne se posera pas dans pas mal de pays, au premier rang desquels ceux où l’islam règne sans partage. La minijupe y est tout simplement interdite, comme l’est même parfois le pantalon portéles femmes, ainsi qu’on l’a appris d’événements qui se sont récemment produits à Khartoum.
Chez nous, le voile islamique ne fait l’objet d’aucune interdiction dans les lieux publics. L’ affirmation d’appartenance religieuse, puisque c’est de cela, quoi qu’on en dise, qu’il s’agit, est admise, alors que la liberté de se vêtir à sa guise est refusée aux femmes dans certains pays où domine l’islam, et même si celles-ci ne sont pas de religion musulmane. Mais invoquer la réciprocité des perspectives (militer pour le droit de porter le voile à Bruxelles, oui, mais alors oui aussi pour celui d’arborer minijupe et cheveux au vent à Téhéran… ou à Bruxelles !) est généralement jugé inconvenant et relève du politiquement incorrect.
Où le problème se pose effectivement, c’est à l’école et dans l’exercice de diverses fonctions publiques. Les jeunesfilles désirant afficher leurs croyances musulmanes peuvent-elles porter le voile dans l’enseignement obligatoire (dans l’enseignement supérieur et universitaire, on a affaire à desfemmes majeures, et le problème se pose d’une autremanière, notamment en termes de prescriptions de sécurité dans les laboratoires) ? En Belgique francophone, seulsquelque5 % des écoles autorisent ce port : ce sont les directions des établissements qui en sont juges, quoique parfoisdes pouvoirs organisateurs se sont emparés de la décision, à l’exemple de la Province de Hainaut, qui a édicté l’interdiction du voile dans toutes les écoles qui relèvent d’elle à partir de l’année scolaire 2010-2011.
Le débat qui s’est instauré autour de ces interdictions, alimenté par quelques « bons apôtres » qui pratiquent, en l’occurrence éventuellement de bonne foi, la trahison des clercs en prétendant prendre le parti des jeunes filles ainsi discriminées, entretient une confusion qu’il importe de mettre en évidence, celle d’une liberté proclamée au niveau individuel et d’une liberté à défendre au niveau collectif. La jeune fille, parfois impubère, qui est amenée à prétendre que son choix de porter le voile (voire un accoutrement plus complet qui pourrait aller jusqu’à la burqa) est libre et personnel, ignore que son geste, qui peut d’ailleurs lui êtreimposé par son milieu familial, est d’abord d’ordre politique. Il s’agit de réclamer un droit à une différence, née du retour sous nos cieux de nouvelles formes de religiosité, qui s’inscrit en faux contre les valeurs fondamentales de liberté et d’égalité fondant nos espaces publics et dont l’école est le bastion prioritaire. Liberté de choix après réflexion critique, égalité des sexes, ces valeurs méritent d’être défendues et illustrées, et elles transcendent nécessairement les avatarsreligieux de l’individualisme contemporain, dont les « sœurs »iraniennes, saoudiennes ou encore soudanaises de nos « volontaires » porteuses de voiles, je le répète, seraient bien en peine de pouvoir se prévaloir.
Pierre Bourdieu a qualifié de « symbolique » la violence dont les individus qu’elle prend pour cibles ne sont pas conscients. Il en va ainsi, par exemple, de la publicité, ce discours apologétique de la société de consommation, et des propagandes de tous acabits. Parmi lesquelles la propagande à base de religion, visant à faire sortir celle-ci de lasphère privée pour l’installer dans l’espace public, au risque de fragmenter celui-ci en divers ghettos d’inspiration communautaire. L’ école a parmi ses missions les plus importantes de fournir aux élèves les moyens de démasquer lesdiverses formes de violence symbolique, afin que ceux et celles qui s’y soumettent le fassent en connaissance de cause.
*
* *
Nadia Geerts, qui avait déjà proposé un livre sur le sujetdu voile en 2003, y revient de manière plus approfondie dansce nouveau texte, écrit de manière adroite et bien documentée, avec une capacité d’argumentation digne de vifs éloges. S’intéressant principalement à la Belgique (et en premier lieu à sa partie francophone), ce pays qui n’est pas « laïque » comme en dispose la Constitution de son voisin méridional, mais mollement neutre, elle décortique et met à mal les déclarations des partisans du voile, à commencer par celles des « bons apôtres » cités plus haut. Elle le fait avec un art consommé de la polémique, en descendante de Voltaire, capable de s’engager au risque des fustigations en tous genres dont ne sont jamais avares les « affirmatifs », pour reprendre une expression de Georges Balandier.
Comportement politique, le port du voile doit être combattu, là où il pose problème aux valeurs fondamentales des sociétés ouvertes, par des arguments politiques. On admirera ici la solidité de ceux que déploie Nadia Geerts, orfèvre en la matière, dans ce nouvel ouvrage que je suis heureux et fier de préfacer.
Claude Javeau
Lettre ouverte à celles qui portent le voile volontairement
Ce livre n’est pas un livre contre vous, ni contre votre religion. Et ce n’est d’ailleurs pas à vous que j’en veux, lorsque je prends la parole pour m’opposer au port du voile à l’école, dans la fonction publique ou pour les représentants politiques.
Non, en vérité, j’en veux à ceux qui vous persuadent que porter le voile partout est un combat légitime. Ceux-là ont décidé de vous traiter une fois pour toutes en victimes : du racisme, du colonialisme, de l’« islamophobie »1; et ils vous convainquent que seule l’hostilité à ce à quoi vous croyez et, plus profondément encore, à ce que vous êtes, peut expliquer l’opposition au port du voile présenté comme un droit fondamental ne souffrant aucune restriction.
Je ne cherche pas à vous convaincre d’ôter votre voile, même si je ne vous cache pas ne pas comprendre votre obstination à le porter.
Je comprends difficilement, je l’avoue, que vous puissiezparfois justifier le port du voile par une obligation de pudeur,ce qui ferait de moi, qui ne suis pas voilée, une femme impudique. Mais tant que vous m’accordez le droit de me promener les cheveux au vent et en tenue estivale, je vous accorde celui de vous voiler.
Je comprends difficilement, de la même manière, ce besoin que vous semblez avoir d’afficher votre islamité. Je ne pratique aucune religion, mais lorsque je tente de mereprésenter la foi, je l’imagine comme quelque chose de profondément intime, à mille lieues de toute exhibition. Alorsoui, je trouve paradoxal que vous choisissiez de porter, pourdes raisons de pudeur, un voile qui attire de toute évidence les regards sur vous plus qu’une quelconque tenue plus classique. J’y vois, je vous l’avoue, quelque chose de l’ordrede ce que Kant appelait la « foi servile » : une observance stricte de gestes, de rites, de pratiques, très éloignée de la véritable foi. Pour moi, comme pour le poète syrien Adonis :
Cette insistance à paraître différent a aussi un aspect théâtral et exhibitionniste, qui ne s’accorde pas avec le concept de religion. À la base de l’expérience religieuse, il y a une dimension intime, presque secrète, toute de simplicité, de pudeur, de silence et de retour à soi, très éloignée de ce culte des apparences2.
Je m’interroge aussi, de ce fait, sur les raisons qui poussent certains prédicateurs musulmans à tant insister sur le portdu voile. Je les soupçonne, pour dire vrai, de vous utiliser, sansque vous en soyez conscientes, pour promouvoir un projet qui vous dépasse, exactement comme cela s’est passédans d’autres pays, où le voile a été le point de départ d’un « autre chose » qui a limité dramatiquement les droits des femmes.
C’est pourquoi je ne veux pas vous parler de religion, mais de politique ; de l’utilisation qui, trop souvent, est faitedu religieux pour asseoir un projet politique rarement émancipateur. Et c’est parce que ma préoccupation est politique que je n’ai pas jugé utile de m’intéresser en profondeur à la question de savoir si le voile était ou non un authentiqueprescrit coranique : à mes yeux, que le voile soit ou non uneobligation religieuse, c’est à la société civile de déterminer,en toute indépendance, de la compatibilité de cette pratiqueavec les règles du vivre ensemble. Cependant, je sais que certains musulmans considèrent que la seule recommandation faite à leurs coreligionnaires (hommes et femmesd’ailleurs) est une recommandation de pudeur, dont le voilen’est pas la seule expression possible, loin s’en faut, dans la société duxxiesiècle.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas prioritairement à vous en tant que croyantes que je m’adresse, mais en tant que citoyennes. J’aimerais que vous lisiez ce livre en vous départant autant que possible du soupçon qui pèse trop souventsur le discours laïque. J’aimerais que vous examiniez librement, sans a priori, les raisons que j’avance pour interdire le voile dans certains lieux.
Beaucoup d’entre vous comprennent ces raisons. Vousêtes très nombreuses à enlever votre voile en entrant à l’écoleet à comprendre qu’il n’est pas compatible avec l’exercicede certaines professions. J’y vois un signe d’espoir : le signe d’unepossibilité que nous vivions ensemble demain dans un contexte apaisé. Oui, j’aimerais que bientôt, nul ne parle plus du voile. Non pas nécessairement parce qu’il aurait totalement disparu, mais parce que les femmes qui le portent auraient accepté de ne plus en faire un étendard et un enjeu de luttes politiques.
Introduction
Ces dernières années, la question du port du voile prendde l’ampleur et envahit tous les domaines de la société. D’abord centrée sur l’école, cette question a touché successivement le monde du travail et singulièrement la fonction publique, le Parlement – avec l’entrée au Parlement bruxellois, en juin 2009, de la première députée voilée –, le barreau de Bruxelles, les piscines, avec l’apparition du « burkini » – maillot de bain islamique couvrant la totalité du corps féminin – et même la rue, avec les débats relatifs au port de la burqa ou du niqab, soit du voile dit intégral.
Que s’est-il passé pour qu’en quelques années, un phénomène qui paraissait inexistant devienne soudain assezcentral pour que des rentrées scolaires soient perturbées, que des associations luttant contre les discriminations s’enemparent, que les défenseurs des droits humains, les laïqueset les féministes se divisent et qu’il devienne impossible de parler d’interculturalité sans qu’aussitôt, cette question ne surgisse comme incontournable ?
Foulard ou voile ?
Lorsque j’ai écrit « L’ école à l’épreuve du voile »3, j’avais choisi d’utiliser quasi indifféremment les termes « voile » et «foulard », pour désigner le tissu dont certaines musulmanes secouvrent les cheveux, et parfois la nuque, le front, le cou, etc. J’estimais alors que la distinction parfois établie entre « foulard » et « voile » – le premier étant une parure, un élément de coiffure ne couvrant que les cheveux, et le second un prescrit religieux explicitement destiné à soustraire unepartie du corps aux regards – n’était pas opportune, dès lorsque le sujet que j’avais choisi de traiter était non ce morceaude tissu, mais bien l’importance symbolique dont il était investi par celles qui le portent, à telle enseigne que l’ôter leur posait problème.
Cependant, force m’a été de constater à quel point l’emploi des mots n’est pas innocent : pas un partisan de l’autorisation du voile à l’école ou pour les fonctionnaires publiques qui ne parle de « foulard », si bien qu’on peut déterminer sans aucun doute possible quelle est l’opinion d’un locuteur à ce sujet en fonction du terme qu’il choisit d’utiliser.
Or, le terme « foulard » me paraît en réalité singulièrementpeu approprié au phénomène qui nous occupe. En effet, le voile n’est pas qu’un foulard. Il est, bien sûr, un morceau d’étoffe, mais il est beaucoup plus que cela : un morceaud’étoffe sacralisé, porté d’une manière rigoureusement codifiée, et dont on refuse de se séparer, tout au moins en présence d’hommes non apparentés.
Le foulard chatoyant, le voile austère, blanc ou noir et de longueur variable, ou l’odieuse burqa ne me paraissentdès lors que la déclinaison d’un même phénomène de sacralisation/diabolisation d’une partie du corps féminin, lequel devient « intouchable » – ou plutôt littéralement « invisible » : qui ne peut être vu – sorti du strict cercle familial.
C’est d’ailleurs le sens du mot « hijab », qui désigne un « voile placé devant un être ou un objet pour le soustraireà la vue ou l’isoler»4et fait ainsi figure non de vêtement, mais de rideau, d’écran. Son but est de séparer, à la manière d’un paravent, l’espace public de l’espace privé.
Ce qui me semble donc poser problème, ce n’est pas qu’une jeune fille décide un jour de se faire des nattes, pour le lendemain laisser ses cheveux flotter librement et un autre jour les maintenir serrés par une étoffe. C’est qu’elle manifeste son intention de maintenir cachée une partie de son corps dans d’innombrables circonstances et ce quelles que soient les limitations que ce fait entraîne danssa vie publique, ou, plus exactement, en récusant par avancetoute légitimité à ces limitations.
Dans notre société largement – bien qu’imparfaite-ment –sécularisée, les codes vestimentaires qui subsistent sont en effet largement fonction des circonstances, et la nudité elle-même a ses lieux publics. La plage naturiste, le carnaval, la cité balnéaire, l’école, le cocktail mondain, le bar SM,l’entreprise ou le casino : autant de lieux, autant de codes vestimentaires, et il ne viendrait à personne l’idée de passer de l’un à l’autre sans adapter sa tenue. Et c’est précisément cette contestation du caractère relatif des codes vestimentaires au profit d’un voile absolutisé qui me paraît poser problème.
Un voile, deux voiles, trois voiles...
Premier constat : le port du voile se multiplie dans nos contrées. Et ce phénomène ne peut s’expliquer par l’immigration. D’abord parce que les grandes vagues d’immigrationqu’à connues la Belgique sont derrière nous, et ne permettent donc pas d’expliquer pourquoi tant de jeunes filles nées ici adoptent soudain ce voile que bien souvent, leurs mères etgrands-mèressoit ne portaient pas, soit se sont battues pour pouvoir ôter. Ensuite parce que nombre de jeunes femmes arrivent à présent de pays musulmans sans voile, et se mettent à le porter ici. Enfin parce qu’on ne saurait ignorer les converties, ces jeunes femmes qui, bienqu’ayant grandi dans un milieu étranger à l’islam, choisissentun jour d’en adopter jusqu’au voile. La question du voile ne saurait donc s’appréhender sans lien avec la recrudescence d’un islam radical, actif dans les mosquées, mais aussi surinternet ou via des publications – comme cet ouvrage édifiant, intitulé « Pour toi, sœur musulmane » qui était distribuésur le campus de l’ULB, à Bruxelles, à la rentrée académique2008, et qui recommandait aux femmes de « se voiler complètement », partant du constat que
Le voile a disparu, ce qui a entraîné également la disparition de toute pudeur. Ainsi, les femmes osent sortir dans la rue en montrant toute leur parure (…). D’autant plus, elle ne voit aucun tabou à discuter avec les hommes, à s’isoler avec euxet à échanger des sourires (…). La recherche du travail a poussénombre d’entre elles à pratiquer des professions dégradantes, qui les empêchent de bien élever leurs enfants et d’entretenir leurs foyers5.
Le voile banalisé
Second constat : pendant que certains, par ailleurs nullement hostiles à la diversité culturelle et religieuse, commencent à s’alarmer de la recrudescence du port du voile, d’autres s’obstinent à prétendre banaliser le phénomène. Non seulement, ils s’obstinent à parler d’un simple bout detissu ou d’un « foulard », mais surtout, alors qu’on discutait il y a quelques années de savoir si des adolescentes devaient être autorisées à porter le voile au sein de leur établissement scolaire, eu égard à leur liberté religieuse, on en est venu à se poser très sérieusement la question de savoir s’il est légitime d’interdire ce voile à l’école primaire, voire maternelle ; la cellule diversité du Ministère de la justice a recommandé en juin 2009 l’autorisation des signes religieux à ses fonctionnaires, au motif que la neutralité des agents « n’est pas garantie par leur apparence » ; il s’est trouvé de bonnes âmes pour se féliciter de l’arrivée d’une députée voilée au Parlement bruxellois ; et même les projets d’interdiction duport de la burqa sur la voie publique suscitent les commentaires outrés de ceux qui voient dans cette bâche immonde un choix religieux éminemment respectable, qu’on ne saurait dénier à nos concitoyennes sans êtrede factosuspectd’intolérance. De toute évidence, on assiste à un phénomène inquiétant d’estompement de la norme, de mise sur le même plan de la minijupe et de la burqa, des talons aiguille et du voile, du monokini et du burkini.
La sacralisation de la liberté semble interdire désormais tout jugement, mais aussi tout rappel d’une norme ou toute évocation des valeurs d’émancipation, de liberté et de progrès. Et aller à contre-courant de ce relativisme, c’est attirer sur soi à coup sûr les soupçons, voire les accusations de racisme, d’intolérance, d’occidentalocentrisme, de néo-colonialisme, et bien sûr d’« islamophobie ».
Le voile, facteur de divisions
Troisième constat : sur la question du voile, féministes, laïques et démocrates sont singulièrement divisés.
Les féministes, tout en étant généralement conscients des aspects problématiques du voile en termes d’égalité des sexes, balancent entre une approche stratégique visantà laisser les femmes choisir elles-mêmes leurs modes d’émancipation, convaincus qu’elles ôteront d’autant plus volontiers leur voile qu’on ne les y aura pas contraintes, et une approche principielle, refusant d’emblée tout marquage du corps des femmes et tout signe rappelant douloureusement des siècles de patriarcat. C’est ainsi que si les Femmes prévoyantes socialistes se sont prononcées le 10 septembre 2009 pour l’interdiction du voile à l’école au nom du rejet de tout marqueur discriminatoire imposé aux filles, la Plateforme laïque au féminin s’y oppose, arguant notamment du fait qu’« aucune émancipation ne peut être imposée de l’extérieur »6. Le « libre choix » devient ainsi pour certains laclé de voûte de l’émancipation, comme si la contrainte était toujours suspecte, jamais libératrice, nonobstant le mot d’Henri Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le richeet le pauvre, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».Il est interdit d’interdire, proclament ainsi certains, comme la députée écologiste bruxelloise Zoé Genot et laPrésidente du Conseil des femmes francophones de BelgiqueMagdeleine Willame-Boonen proclamant que :
Dans le débat du voile comme dans d’autres, nos critères sont égalité hommes-femmes, liberté des femmes à disposer de leur corps, à faire respecter leur droit à l’expression, à choisir leur partenaire, à avoir accès à un enseignement de qualité, à pouvoir gagner leur vie, à pouvoir se déplacer, à avoir accès aux loisirs…
Et c’est en fonction de ces critères que nous examinons tous les projets concernant les femmes7.
Les laïques hésitent entre une laïcité « inclusive », qui, prônant la tolérance et le respect égal de tous, se laisseséduire par les « accommodements raisonnables » importés du Québec et postulant que l’égalité ne consiste pas à traiterde manière égale des individus objectivement différents,mais à les traiter de manière différenciée, et une posture plusradicale qui refuse, au nom de la séparation des Églises et de l’État, toute immixtion du religieux dans la sphère institutionnelle.
Ainsi le 18 septembre 2009, le Centre d’ Action Laïque, qui représente la laïcité officielle en Belgique francophone,a pris position en faveur de l’interdiction des signes religieuxdans tout l’enseignement bénéficiant de subsides publics, s’alignant en cela sur la position défendue par le R.A.P.P.E.L. depuis 2006 :
(…) le CAL demande qu’un décret garantisse que l’école nepuisse être le champ clos des particularismes quels qu’ils soientet qu’en conséquence, les signes distinctifs, religieux ou partisansen soient exclus à l’égard de toutes et tous sans discrimination8.
Suite à cela, Peuple et Culture, association fondatrice et membre du Centre d’ Action Laïque, a tenu à se distancer radicalement de la position du C.A.L., estimant que
les représentants de la laïcité institutionnalisée ont aujourd’hui le vent dans les voiles.
En toute hypothèse, Peuple et Culture refusera de s’inscriredans tout discours ou action qui pourrait battre le rappel de l’intégrisme laïque en Wallonie et à Bruxelles.
Auparavant, les auteurs duBon usage de la laïcité9avaient eux aussi défendu une position qui s’opposait à l’interdiction du voile au nom de la laïcité.
Et les démocrates – précisons au passage qu’on peutêtre à la fois féministe, laïque et démocrate – restent extrêmement embarrassés à l’idée que la préservation de certains principes démocratiques, qu’ils ne contestent pas par ailleurs, puisse passer par des mesures d’interdiction.
Qui plus est, s’il est des lieux où le port de signes religieux devrait à mon sens être interdit au nom de la laïcité – concept politique d’organisation de l’État qui, sans se prononcer en faveur d’une quelconque conviction religieuse, se fonde sur la séparation du politique et du religieuxet, singulièrement pour le cas qui nous occupe, le refus de l’immixtion du religieux dans la sphère dévolue au politique –, la question se pose en des termes différents pour ce qui concerne les écoles, d’une part, et la burqa de l’autre. La laïcité de l’État n’a en effet jamais consisté à imposer auxusagers une quelconque neutralité, et ce n’est donc pas parceque l’école serait laïque que les élèves devraient nécessairement s’abstenir d’y afficher leurs appartenances religieuses. De même, la laïcité n’a jamais prétendu régenter le comportement des gens dans les lieux publics, et on ne saurait donc interdire le port du voile ou de la burqa en rueau nom de la laïcité sans en pervertir le sens profond. La laïciténe constitue donc pas l’alpha et l’oméga de touteréflexion sur le voile dans la société – contrairement à ce queprône le site français Riposte Laïque, qui prétend interdire partout le voile comme la burqa au nom de la laïcité.
Le voile est-il de gauche ou de droite ?
Quatrième constat : on assiste, dans ce débat, à une curieuse inversion des rôles traditionnels de la gauche et dela droite. Alors que la gauche a toujours privilégié une approche sociale et sociétale, parfois au détriment des libertésindividuelles – culminant, à l’extrême gauche, avec le sacrificede l’individu,hic et nuncet parfois très littéralement, sur l’autel d’une humanité au futur radieux –, c’est elle qui estaujourd’hui massivement acquise à la nécessité de défendreles droits individuels10des musulmanes brimées dans leurslibertés. Et les libéraux, traditionnellement méfiants vis-à-visde toute limitation des droits de l’individu, se découvrent soudain les chantres d’un ordre social reposant inévitablement sur des mesures coercitives envers les individus.
Cela s’explique de toute évidence, à tout le moins enpartie, par un autre découpage traditionnel du paysage politique, qui oppose quant à lui une gauche qui lutte aux côtés des opprimés, même lorsque leur contestation de l’ordre établi passe par l’infraction aux règles, à une droite plus sécuritaire, notamment lorsqu’il s’agit d’opposer au droitinaliénable des femmes à porter la burqa le danger que cettetenue peut faire courir à l’ordre public, dès lors qu’elle rend toute identification impossible.
Je ne mentionnerai que pour mémoire les attitudes extrêmes qui consistent, à gauche de la gauche, à justifier, comme le fait Nadine Rosa-Rosso, l’alliance avec des organisations terroristes islamiques telles que le Hamas ou le Hezbollah par le fait que, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, les organisations de lutte d’extrême gauche doivent s’allier avec tout ennemi des États-Unis ; et, à droite de la droite, à dissimuler un racisme patent sous un vertueux manteau de louables préoccupations vis-à-vis des femmes opprimées, de la laïcité menacée et des droits de l’homme galvaudés.
Le voile, emblème de l’interculturalité
Cinquième constat : le débat sur le voile se déroule sur fond de projets relatifs à l’interculturalité, ce qui sous-tendl’idée qu’il s’agit de favoriser l’intégration de personnes issuesde cultures différentes. Or, sans dénier le moins du mondeson intérêt à toute démarche visant à favoriser le vivre ensemble dans une société de plus en plus diversifiée, on peut néanmoins s’interroger sur le passage du droit à la différence, fondement des démocraties, à la différence des droits, dont les tenants de l’autorisation du voile se font trop souvent les défenseurs. Car si l’on considère que l’expression des convictions religieuses doit être libre et ne saurait souffrir aucune entrave, se pose immédiatement laquestion de la réciprocité : quid, en d’autres termes, du droitd’afficherurbi et orbison athéisme ? N’y a-t-il pas quelque chose d’étonnant à ce qu’alors que certains, à l’instar de la députée Ecolo Zoé Genot, ont ferraillé pour permettrel’accès aux tribunes parlementaires de filles voilées, un athéeexhibant sa conviction que Dieu n’existe pas11soit emmené aupostemanu militariau motif qu’il s’agit là de « provocation » ? Qui peut affirmer avec certitude qu’il n’entre jamais aucune dimension provocatrice dans le port du voile ?
En outre, si l’on considère, comme les trois partis issusdes dernières élections régionales à Bruxelles et en Wallonie, que le droit d’exprimer ses convictions ne peut être entravé,alors il faudra accepter que les convictions religieuses ne soient pas seules visées, et que l’on puisse pareillement afficher son athéisme, mais aussi sa sympathie pour tel ou tel parti politique, tant en classe que dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. Faute de quoi, ce sont les athées, les socialistes et les protecteurs des baleines qui pourront à juste titre s’estimer discriminés, et solliciter la protection du Centre pour l’Égalité des chances, voire du MRAX12.
La question qu’il faut à mon sens aujourd’hui se poser n’est donc pas celle de l’islam en Belgique, mais, bien plus généralement, du type de société dans laquelle nous voulons vivre : voulons-nous d’une société patchwork, juxtaposition de diverses communautés ne se mélangeant guère, ou d’une société réellement interculturelle, fondée sur la reconnaissance d’un socle de valeurs communes qui transcendent nos divers particularismes, fussent-ils religieux ?
Le voile, étendard politique
Dernier constat : la question du voile ne peut être limitéeau voile. Malgré tous les efforts de ses adeptes pour en faireun « simple bout de tissu », il est évident que le voile est bien plus que cela, sans quoi nul ne bataillerait avec autantd’énergie pour le voir autoriser partout. Signe religieux, le voilesemble être aussi et surtout, ces dernières années, laporte d’entrée d’autre chose ; et cet autre chose, c’est un projet de société islamiste, qui tend à introduire à l’école, mais aussi dans l’ensemble de la société civile, une représentation du monde dans laquelle la religion est première et l’État second ; dans laquelle le corps des femmes est contrôlé par les hommes ; dans laquelle la mixité est contestée ; dans laquelle enfin c’est tout le corpus référentiel des démocraties occidentales qui est subrepticement mis à mal.
Fantasmes ? À chacun d’en juger.
chapitre1
Les symboliques du voile
Impossible d’écrire quoi que ce soit sur le voile sans en passer d’abord par une tentative de mise à plat de ce qu’il symbolise. Et, que ce soit dans le camp des partisans ou dans celui des adversaires de l’interdiction du port du voile dans certains lieux – école et fonction publique –, le débat fait rage quant aux interprétations à donner à ce « bout de tissu ». Certains y voient un signe de soumission à un ordremasculin, d’autres l’expression d’un engagement envers Dieu,d’autres encore un étendard politique, d’autres enfin uneinnocente pratique culturelle, comparable à celle de nosgrands-mèresà fichu. Et les adeptes du « foulard » elles-mêmes, lorsqu’elles acceptent d’en parler, rivalisent d’inventivité pour expliquer ce que ce voile représente pour elles. Les propos des uns et des autres étant sans doute biaisés,d’ailleurs, par l’usage qui risque immanquablement d’être faitde leurs réponses. Les lycéennes françaises bataillant pourle port du voile l’ont bien compris, qui s’attachent le plus souvent à démontrer farouchement leur intégration dans la société française, et glorifient les valeurs de la République lorsqu’elles défilent, comme ce fut le cas en 2004, contre l’interdiction du port du voile à l’école et sous la bannièrede « Liberté, Égalité, Fraternité ». « Mon voile, c’est ma liberté »est à cet égard indéniablement plus porteur, en effet, que « Mon voile, ce sont mes chaînes et j’y tiens ».
Il est un fait que pour beaucoup, la signification du voile constitue une question essentielle pour déterminer l’attitude à adopter envers lui. Est-il choisi ou subi ? Reflète-t-ilune soumission à la loi du mâle, ou constitue-t-il au contraireun moyen d’y échapper avec les moyens du bord ?13Est-ce un « authentique » prescrit religieux, ou le fruit d’une interprétation fondamentaliste du Coran ? Ces questions divisent l’opinion, mais aussi les professionnels de l’éducation, les associations et les politiques, et jusqu’au monde musulman, partout où la question du voile fait surface.
Pourtant, dès lors que le voile revêt manifestement plusieurs significations, complémentaires souvent, paradoxales parfois – comme lorsque des jeunes femmes par ailleurs joliment maquillées et coquettement vêtues y voient l’expression de leur identité de jeunes femmes musulmanes modernes, affirmation de leur autonomie tant envers l’Islam qu’envers l’Occident – on voit mal comment ces questions pourraient nous aider à adopter une position de bon sens. La morale de l’intention, qui n’accepte de juger un acte qu’en fonction des intentions de son auteur – et non en fonction des conséquences qu’il a entraînées, par exemple, ou du caractère plus ou moins moral de l’acteen soi –, est certes très louable dans son souci éthique, mais est parfaitement inapplicable en l’occurrence. À moins d’instaurer une police de la pensée peu compatible avec les principes de la démocratie…
Il est donc nécessaire de se garder de toute interprétation au cas par cas. Si en effet on en venait à agir différemmenten fonction de la signification accordée par chaque jeune femme au morceau d’étoffe dont elle se voile la tête, on en viendrait vite à une situation aberrante où, dans une même école ou une même administration publique, coexisteraient les porteuses de voile – celles qui auraient eu l’intelligence de présenter celui-ci comme un pur accessoire esthétique – et celles qui en auraient été interdites au motif qu’elles y voient l’expression de leur foi. Il importe donc que la règle, quelle qu’elle soit, vaille pour tous.
Qui plus est, il semble difficilement concevable qu’un voile ne soitnil’expression de l’assujettissement à la loi masculine,nicelle de la foi islamique. Pourquoi, en effet, ces jeunes filles revendiqueraient-elles avec tant de détermination, parfois – et sous virile escorte souvent…14–, le droit de conserver ce qui ne serait à leurs yeux qu’une vulgaire pièce de vêtement, à l’instar d’une écharpe, d’un polo ou d’un jeans ? Peut-on vraiment soutenir sérieusement qu’« il n’est question ici que d’accessoires vestimentaires, de fringues, quoi ! »15?
La Cour européenne des droits de l’homme, en tout cas, a répondu par la négative, en déboutant une étudiante en médecine stanbouliote qui protestait contre l’interdiction qui lui était faite de porter le voile, affirmant, dans son arrêt du 29 juin 2004, qu’« au-delà d’une simple habitude innocente, le foulard est en train de devenir le symbole d’une vision contraire aux libertés de la femme et aux principes fondamentaux de la République »16. Et si l’arrêt traite d’une affaire turque, on ne peut cependant ignorer qu’en Belgique et en France, les voiles bigarrés et fleuris ont progressivement cédé le pas à des tissus unis, foncés ou blancs, évoquant bien davantage des étendards que de simples accessoires esthétiques.
Quoi qu’il en soit, revendiquer le droit de porter le voile partout, c’est indéniablement récuser la relativité des codes vestimentaires en lui opposant l’absolu du voile. Commentmieux mettre en évidence le fait que le port du voile exprime une attitude de repli sur son quant-à-soi, une manière de mettre un paravent entre soi et le monde, d’accéder à l’espace public tout en en refusant le principe, même en un lieu qui devrait être synonyme d’ouverture la plus large possible à celui-ci ?
On pourra certes soutenir qu’il n’y est pas fondamentalement inadapté, mais ce serait en négliger les symboliques : défiance envers les hommes, inégalité foncière de l’hommeet de la femme, primat du religieux sur le temporel, repliidentitaire. Une symbolique qui fait du voile bien autre chosequ’un simple vêtement, et qui le distingue radicalement d’autres éléments d’habillement qui se trouvent investis à l’occasion d’une symbolique ou d’un message.
Le voile contre la femme
Il est temps (…) de rappeler qu’aucune religion, aucune culture, ne peut avoir le dernier mot contre l’égalité des sexes. Qu’on le veuille ou non, celle-ci est mieux garantie par la loi universelle qui s’impose à tous que par le relativisme qui ouvre la voie à toutes les exceptions17.
Plus encore qu’un signe religieux, le voile est un signe sexué. En tant que prescrit religieux qui ne s’impose qu’auxfemmes, il véhicule une conception bien particulière des rôlesde l’homme et de la femme. Car si la femme doit se voiler, c’est pour ne pas attirer les regards des hommes – et le fait que cela lui soit prétendument recommandé par Allahlui-même est secondaire. Leïla Babès affirme même :
Le voile n’a donc rien de religieux. Il a à voir avec des hommes qui ont un rapport obsessionnel avec le corps de la femme.
Rien d’étonnant à ce que les femmes soient l’objet principald’une telle fixation lorsqu’on défend une conception liberticide.Le voile est à un tel point un symbole essentiel pour l’ordre islamiste qu’il permet de marquer une stricte différenciation des sexes, en assignant les femmes à une place particulière. En accentuant l’interdit qui pèse sur le corps de la femme, on rend celle-ci inapte à se découvrir, à se rendre visible, à investir l’espace public, à accéder au pouvoir, en somme, à être l’égale de l’homme18.
C’est en effet sur la fille seule que repose la responsabilité de sa pureté, laquelle ne peut être garantie que par le port du voile.
Voici par exemple ce qu’en dit l’épouse de Tariq Ramadan :
Le voile est fait pour faciliter la vie sociale, simplifier les relations, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. En islam, la femme ne l’utilise que quand elle sort. Et c’est vrai qu’il aide quand il s’insère dans une attitude générale. Les regards sont différents. Le foulard n’est pas une prison. Il permet de se libérer du regard des autres et des hommes en particulier19.
Le voile donc, contrairement à d’autres signes d’appartenance religieuse, ne vise que les femmes. Et qui plus est d’une manière qui tend à nier leur féminité en dissimulant les attributs spécifiques de celle-ci. Alors que le musulman se voit, au pire, enjoint de porter la barbe – signe extérieurde virilité20