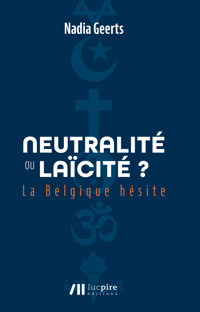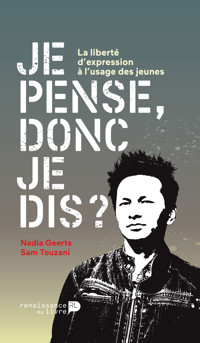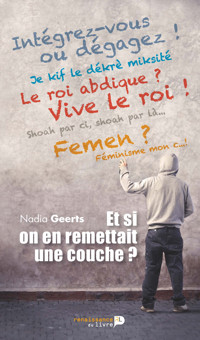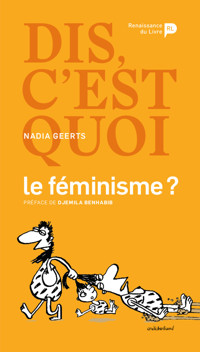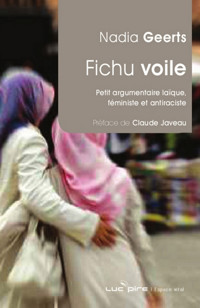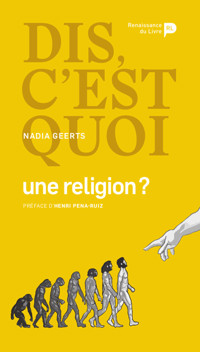
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Définir une religion est un exercice plus périlleux qu’il n’y paraît. Une fois sortis de nos sentiers battus – les grandes religions monothéistes – nous sommes bien démunis pour déterminer ce qui fait une religion. Faut-il nécessairement croire en une ou plusieurs divinités ? Les sectes sont-elles fondamentalement différentes des religions ? Et d’ailleurs, comment sont nées les religions ? Pourquoi certaines ont-elles aujourd’hui totalement disparu ? A quels besoins répondent-elles ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Dis,
c’est
quoi
une religion ?
Copyright
Nadia Geerts
Dis, c’est quoi une religion ?
Renaissance du Livre
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
directrice de collection : nadia geerts
maquette de la couverture : aplanos
illustrations : © tanguy maerten
isbn : 978-2-507-05614-8
dépôt légal : D/2018.12.763/18
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Page de titre
Préface
Voici un petit livre de grande importance. Un livre limpide, qui fait le point sur des notions essentielles, et propose des repères simples pour penser. Penser la religion, les religions, et aussi le fanatisme religieux qui en donne une version détestable. Oui, il est grand temps de faire le point sur la différence entre croire et savoir, que l’on croyait bien établie depuis la philosophie des Lumières, mais qu’un certain obscurantisme religieux entend remettre en question. Oui, il est grand temps de rappeler que des textes écrits par des hommes d’une autre époque ne sauraient prétendre dicter la loi d’aujourd’hui, surtout quand ils consacrent la soumission de la femme, une vision mutilée de la sexualité, et aussi une division de l’humanité en groupes hostiles du fait de leurs religions respectives. Nadia Geerts s’attache à le faire sous une forme dialoguée parfaitement maîtrisée, et c’est une véritable réussite. Quelques remarques pour souligner la portée de son travail.
Penser clairement la question du sens des religions est aujourd’hui décisif. Le fanatisme religieux n’est pas le propre de notre seule époque. Il a sévi dès le Moyen Âge et ensanglanté la France de la Renaissance avec huit guerres de religion entre catholiques et protestants. Le sommet de l’horreur a été atteint avec la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, quand sur ordre de Charles IX les catholiques fanatisés, dirigés par le duc de Guise, ont tué à Paris environ 3000 protestants, hommes, femmes et enfants. Au nom du catholicisme. C’est à peu près autant de morts que lors des 4 attentats du 11 septembre 2001 contre les Twin Towers, à New York, où périrent 2 773 personnes. Des fous de Dieu projetèrent des avions pleins de civils sur des tours pleines de civils. Au nom de l’Islam. Quant aux bûchers de l’Inquisition, notamment en Espagne, ils ont supplicié des milliers d’« hérétiques », de juifs, de musulmans et d’athées. L’intolérance religieuse s’est donné libre cours, en contraste avec l’amour en principe recommandé par le christianisme. Sommes-nous en train de revivre le cauchemar de l’intolérance religieuse et des guerres qui en résultent ? Et si c’est le cas, comment expliquer que les religions puissent engendrer une telle violence ? Les religions… ou une certaine façon de les concevoir, qui n’a rien de fatal ? La démarche explicative de Nadia Geerts est essentielle pour tenter de répondre à ces questions et par là même d’armer la conscience citoyenne.
Quelle modalité de la foi engendre le conflit ? Une première étape de la réflexion consiste à définir le phénomène religieux, afin de savoir si c’est lui, par essence, qui est responsable, ou si les violences qui s’en réclament en constituent le dévoiement. Une distinction majeure s’impose entre croire et savoir, foi et raison. Admettre que l’on sait, que l’on ignore, que l’on ne fait que croire est le propre de la conscience éclairée, qui sait distinguer ce qui se passe en elle. Tout au contraire, confondre les registres et accorder à la croyance le statut d’une connaissance, c’est sombrer dans l’obscurantisme. L’obscurantisme va souvent de pair avec le fanatisme, façon de vivre sa foi sans respect pour d’autres convictions, sans égard pour celui ou celle qui a le malheur de ne pas croire comme il faut. Tout fidèle n’est pas fanatique, on le sait, et c’est même un petit nombre de croyants qui deviennent fanatiques. Il faut donc expliquer avec rigueur cette dérive, et se garder d’emblée de tout amalgame.
Revenons à la foi, forme de croyance qui admet sans démonstration ni preuve l’existence de Dieu comme être transcendant, c’est-à-dire extérieur et supérieur au monde des êtres et des choses. En principe, le fait d’être conscient que l’on croit, et que croire n’est pas savoir, devrait avoir une double conséquence. D’une part éviter tout dogmatisme dans l’affirmation, et d’autre part ne pas régler son action comme si elle reposait sur une certitude inébranlable. Je sais que l’eau bout à 100 °C, mais je ne sais pas que Dieu existe. La certitude du savoir permet d’agir à coup sûr ;par exemple s’il s’agit de tuer les microbes d’un biberon, je dois l’ébouillanter. En revanche toute action qui présuppose l’existence de Dieu reste incertaine. Bien des croyants, conscients du fait que leur croyance ne saurait avoir le statut d’une connaissance, admettent qu’elle n’engage qu’eux-mêmes, et ne saurait être imposée aux autres. Cela n’empêche nullement cette croyance d’être fervente, mais de la ferveur au fanatisme intolérant il y a un pas que seuls franchissent les fanatiques. La foi du poète Victor Hugo était vécue par lui comme une chose personnelle, et s’assortissait du respect des personnes adeptes d’autres convictions. Ce qui ne veut pas dire qu’il respectait ces convictions elles-mêmes, et s’abstenait de les critiquer. Mais il reconnaissait la liberté de les choisir. D’où une approche laïque du statut de la religion. Une telle approche n’est solidaire ni de l’athéisme ni de la croyance religieuse, convictions particulières qui doivent rester libres et être traitées à égalité par la loi civile.
Laïcité ne veut donc pas dire rejet de la religion, mais construction du cadre commun sur des fondements universels, à savoir des droits humains reconnus aux athées, aux croyants, et aux agnostiques. « L’État chez lui, l’Église chez elle. » Telle est la formule impeccable par laquelle Hugo définit la laïcité le 20 Janvier 1850. Nul rejet de la religion dans un tel idéal, mais l’exigence pour les croyants de vivre leur foi religieuse avec une retenue qui leur permette d’admettre à côté d’eux des humanistes athées qui ne partagent pas leur option spirituelle. C’est donc bien une certaine façon de vivre sa foi, ou sa conviction athée, qui rend possible la paix civile et même la concorde. Soucieuse de l’intérêt général, donc du bien commun à tous, la puissance publique, en se choisissant laïque, se fait bonne pour toutes et tous, par-delà les différences. Voilà ce que permettent de comprendre parfaitement les explications si patientes et si convaincantes de Nadia Geerts.
En distinguant plusieurs façons de vivre sa foi religieuse, Nadia Geerts conduit ses lecteurs à éviter tout amalgame de l’ensemble des fidèles d’une religion avec le petit nombre de terroristes qui prétendent agir en leur nom. Qu’est-ce donc que le fanatisme ? Une certaine façon de vivre sa foi, sans distance aucune, et de l’imposer à autrui, le cas échéant par une violence mortifère. Voltaire a consacré au fanatisme un article du Dictionnaire philosophique. Le fanatique s’identifie à sa religion et en vient donc à considérer toute critique de celle-ci comme une atteinte portée à son être même. D’où sa violence, souvent extrapolée en meurtre. « Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ? » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article « fanatisme ».) Vivre sa croyance comme un savoir incontestable, puis comme une identité profonde de l’être, c’est être prêt à tuer pour venger le prophète, voire le Dieu qu’il représente. Ici le dogme fait mal. Admis sans preuve, il est de surcroît posé comme sacré, et sa critique est interdite. Bref, au lieu d’être un vecteur éthique de tolérance, le dogmatisme théologique piétine les valeurs que la religion prétend défendre.
Reste que la foi elle-même ne débouche pas nécessairement sur le fanatisme. Pour prévenir le fanatisme, il faut reconnaître que l’on peut tenir quelque chose pour vrai sans avoir de preuves, sinon de simples arguments qui ne permettent pas de conclure de façon certaine et incontestable. Cette lucidité sur soi est une forme de modestie, comme celle que pratiqua Socrate en affirmant qu’une ignorance consciente d’elle-même est déjà un pas vers la sagesse. Il inaugura ainsi la philosophie comme quête de sagesse, en soulignant l’importance décisive de la distinction consciente entre l’ignorance, la croyance, et la connaissance. Tel est le sens premier de l’esprit critique, à ne pas confondre avec l’esprit de critique. Selon l’étymologie grecque (crinein), le mot critique qualifie la démarche qui consiste à savoir distinguer ce qui doit l’être.
Kant, croyant, a su indiquer que l’existence de Dieu n’est pas démontrable. Et il affirma que sa non-existence non plus. Admettre la différence des registres de la conscience humaine est nécessaire à la lucidité. Je peux croire qu’un monde sans guerre existera un jour, et le souhaiter ardemment. Mais je ne peux apporter aucune preuve d’une telle perspective. Mais cela ne m’empêche pas de lutter pour la paix. Si la croyance ainsi affirmée peut guider mon action, elle est bonne, mais elle le fait sans certitude. Son rôle est alors d’autant plus remarquable qu’il est désintéressé. Le rationalisme philosophique ne cherche nullement à éradiquer toute croyance, mais tout simplement à faire en sorte que chaque être humain sache faire intérieurement une telle distinction, et régler sa conduite en conséquence. Dans cet esprit, la tolérance va de pair avec la conscience de l’indémontrable.
Un dernier mot sur l’étymologie controversée du terme religion. Pour les chrétiens le mot religio renvoie au verbe religare, qui veut dire relier. Mais Cicéron évoque plutôt comme source relegere, dans le sens de vénérer, respecter une réalité reconnue comme supérieure. Une synthèse souvent avancée consiste à dire qu’une religion relie ceux qui se reconnaissent en elle par une référence commune à un principe divin, transcendant à toute réalité, donc extérieur et supérieur au réel dans lequel nous nous mouvons. Mais comme on l’a vu la soumission plus ou moins volontaire à une transcendance peut s’interpréter de plusieurs manières. Il en va de même des textes dits sacrés, donnés comme inspirés par Dieu, voire dictés par lui, et par conséquent acceptés littéralement. Là encore, Nadia Geerts nous éclaire en soulignant que l’on peut interpréter ces textes de différentes manières, notamment en se délivrant de toute lecture littérale. Et en rappelant les contextes historiques etsociaux de leur rédaction. Nadia fait un constat déterminant par sa portée : les religions ressemblent souvent aux sociétés qui les ont vu naître… Quelle conséquence ? Les trois monothéismes sont nés dans des sociétés patriarcales, et ce n’est pas un hasard si tous les trois, en leurs textes sacrés respectifs, hiérarchisent les sexes au détriment de la femme. Doit-on aujourd’hui se soumettre à une telle hiérarchie ? Laissons le lecteur en décider. Averroès lui soufflera peut-être la réponse : « quand un verset du Coran heurte ma raison, il me faut l’interpréter ». Même consigne pour les deux testaments, l’Ancien et le Nouveau…
Henri Pena-Ruiz
Dis, c’est quoi une religion ?
En 2005, un certain Bobby Henderson inventait le « pastafarisme ». Dans une lettre ouverte, cet étudiant professait sa foi dans le Monstre en spaghetti volant, créateur du monde, et demandait que sa croyance soit enseignée au même titre que le dessein intelligent et la théorie de l’évolution :
« Je pense que nous pouvons nous réjouir à l’idée qu’un jour ces trois théories aient une part de temps égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi du monde entier : un tiers du temps pour le dessein intelligent, un tiers du temps pour le Monstre en spaghetti volant et un tiers du temps pour une conjecture logique fondée sur une masse écrasante de preuves observables. »
En réalité, il voulait protester contre la décision du Comité d’éducation du Kansas d’autoriser l’enseigne