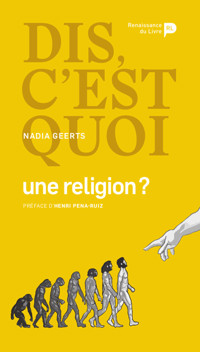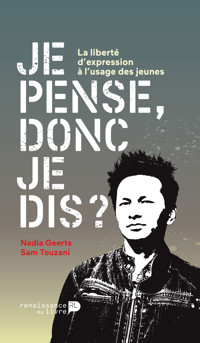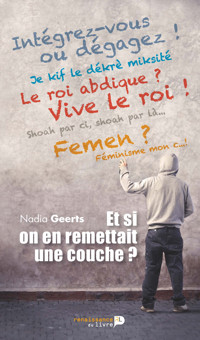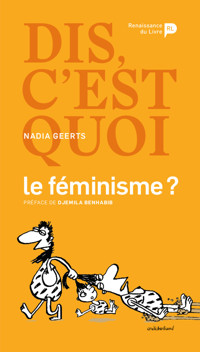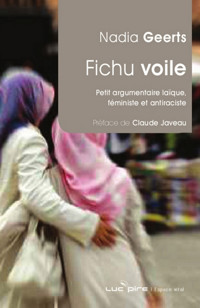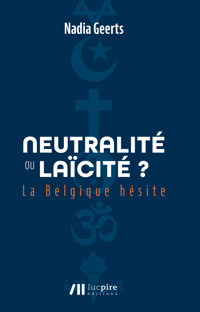
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luc Pire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Géographiquement et culturellement située entre une France laïque et une Grande-Bretagne multiculturaliste, la Belgique se déclare quant à elle volontiers « neutre ». Mais que recouvre cette neutralité ? Comment s’est-elle construite, de 1830 à nos jours, au départ d’un compromis historique entre libéraux et catholiques ? Et quel corps les différents partis politiques belges donnent-ils aujourd’hui à l’exigence d’impartialité de l’État ? Quel terme utiliser, quel contenu concret lui donner, et dans quel objectif ? Comment, à tout le moins, garantir le respect de quelques principes majeurs et sortir enfin des incessantes arguties juridiques qui, en ramenant sans cesse la question religieuse au centre de l’actualité, nuisent à la sérénité, voire à la paix sociale ? La réponse, bien plus que par le choix d’un mot ou d’un autre, passera par l’affirmation claire de quelques balises, telles que le primat de la loi civile sur la loi religieuse, l’impartialité de l’État ou l’affirmation de la mission émancipatrice de l’école.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Neutralité ou laïcité ?
Éditions Luc Pire [Renaissance SA]
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.editionslucpire.be
Neutralité ou laïcité ?Création graphique couverture : (Nor)production – www.norproduction.eu Mise en page intérieure : CW Design Relecture : Catherine Meeùs
Dépôt légal : D/2022/12.379/06e-ISBN : 9782875422767
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Nadia Geerts
Neutralité ou laïcité ?
La Belgique hésite
Introduction
La Belgique est-elle ou non un État laïque ? Faut-il modifier la Constitution pour clarifier la manière dont notre pays entend gérer les questions liées à la diversité convictionnelle ? Ou encore, comment la neutralité de l’État doit-elle être comprise ?
Le débat public s’enflamme régulièrement autour de ces questions, les uns insistant sur la différence fondamentale qu’il y aurait entre la neutralité belge et la laïcité française, les autres arguant de ce qu’au fond, nos systèmes seraient plus proches qu’on ne le croit.
En tout état de cause, il est un fait indéniable : ces cinquante dernières années, la Belgique a adopté de nombreuses lois et directives visant à laïciser l’État (dépénalisation de l’adultère, de l’interruption de grossesse ou de l’euthanasie, ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, introduction de cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l’enseignement officiel, etc.)
D’autres questions, en revanche, continuent de faire polémique et suscitent chaque fois qu’elles reviennent à l’agenda des passes d’armes entre défenseurs d’une approche « inclusive »et partisans d’une attitude davantage inspirée du modèle laïque français. Et parmi celles-ci, figure de toute évidence la question de la neutralité dansles services publics et de ce qu’elle implique, concrètement, pour les agents de l’État, en ce qui concerne leur apparence.
Inutile de tourner plus longtemps autour du pot, il s’agit donc de déterminer si la neutralité de l’État peut ou non s’accommoder du port du voile dit « islamique » par certaines de ses agentes, et si oui, à quelles conditions et dans quelles limites. Et derrière cette question s’en profile une autre, fondamentale : est-on prêt à placer la liberté religieuse au-dessus d’autres formes de liberté d’expression ? Car c’est évidemment de cela qu’il s’agit, sauf à considérer – ce que personne ne défend aujourd’hui, fort heureusement, d’ailleurs – que les agents de l’État doivent pouvoir afficher leurs convictions politiques dans l’exercice de leurs fonctions. Autrement dit, il s’agit bien, quellesque soient les dénégations, d’admettre un principe d’exception religieuse, comme on l’a d’ailleurs fait en prévoyant une exception religieuse à l’obligation d’étourdissement avant l’abattage – une exception sur laquelletant la Flandre que la Wallonie sont aujourd’hui revenues, mais qui reste en débat à Bruxelles.
Le professeur de droit constitutionnel Marc Uyttendaele, auditionné par le Parlement bruxellois le 30 mai 2022, le rappelait en effet très clairement : rien dans le texte constitutionnel belge, pourtant élaboré à une époque où la religion catholique détenait un pouvoir important, ne prévoit un traitement différent pour la liberté de religion et la liberté d’expression ; au contraire, elles sont placées exactement sur le même pied. Et c’est donc bien parce qu’un nouveau courant doctrinal tend aujourd’hui à imposer une hiérarchie entre ces deux libertés qu’il importe de légiférer.
Le système belge
La préhistoire
Le système belge est un système hybride, né d’un compromis historique entre catholiques et libéraux en 1831 : comme le rappelle la chercheuse au CRISP Caroline Sägesser, « la Constitution belge consacre tant la non-ingérence de l’État en matière religieuse que le financement public des cultes »1.
Les territoires qui forment l’actuelle Belgique sont, depuis des siècles, de religion catholique. Il faut attendre l’empereur Joseph II (1741-1790) pour que naisse sur ces terres appartenant alors aux Pays-Bas autrichiens une première tentative de « laïcisation », ou plus exactement d’affirmation de la suprématie de l’État sur l’Église : « Déjà le 12 novembre 1781, rappelons-le, il avait décrété que l’édit de tolérance serait appliqué aux Pays-Bas, ce qui n’était pas une mince affaire dans ces provinces belgiques qui s’étaient reconstruites autour du catholicisme, lors des grandes luttes avec les protestants du Nord au XVIe siècle. Le 28 septembre 1784, un édit faisait du mariage un contrat civil. Le 23 janvier 1785, les sermons des curés étaient soumis à la censure ordinaire. D’autres textes s’en prenaient aux mœurs, à la convivialité et à la religion populaires. Rejoignant curieusement certains évêques rigoristes de la Contre-Réforme, Joseph II décidait, le 11 février 1786, de fixer toutes les kermesses le même jour, et ce, dans un pays où le “Calendrier des kermesses” rythmait fêtes et distractions de la jeunesse et des populations. Le 8 avril, toutes les confréries, si nombreuses en cette région, étaient abolies et fondues en une seule, “de l’amour actif du prochain, ayant comme patron le Sauveur Jésus-Christ” »2.
En 1796, la Belgique est incorporée au territoire français, et toute la législation française – partiellement inspirée de Joseph II, d’ailleurs – y est donc d’application : confiscation et vente des biens de l’Église, constitution civile du clergé, suppression des congrégations religieuses, réglementation de l’exercice public du culte, etc. Ces mesures sont très impopulaires auprès d’une grande partie de la population, très attachée à la pratique religieuse.
Le Concordat signé en 1801 entre la France et le pape Pie VII, qui rend à nouveau l’exercice du culte public et libre, est également d’application sur le territoire de la future Belgique.
Tout bascule cependant en 1814, lorsque ces territoires sont rattachés aux anciennes Provinces-Unies, après la défaite française à Leipzig. Désormais, la future Belgique est placée sous l’autorité d’un prince protestant, Guillaume Ier, qui tente de contrôler l’Église catholique autant que possible, notamment en instaurant un monopole d’État sur l’enseignement – au grand dam de l’Église catholique.
De 1830 à 1958
Dans ce contexte, la Constitution belge de 1831 apparaît comme le fruit d’un compromis entre les tendances libérale et catholique qui, ensemble, sous la bannière de l’unionisme, permettent l’indépendance de la Belgique.
Comme l’écrit Anne-Marie Henkens, « [l]e but ducompromis est de se débarrasser du régime hollandais qui ne respecte pas la liberté d’enseignement, chère aux catholiques, et la liberté de la presse, donc la liberté d’opinion, revendiquée par les libéraux. Si les deux partis évitent de préciser le sens explicite que chacun donne au concept de liberté, ils s’entendent néanmoins sur l’ennemi à abattre »3.
L’attachement de principe des libéraux à un régime parlementaire garant des libertés fondamentales rejoint ainsi largement l’intérêt des catholiques, désireux quant à eux de se dégager de la mainmise de l’État instaurée par le régime hollandais, sans pour autant vouloir la restauration de l’Ancien Régime.
C’est donc grâce à cette alliance entre libéraux et catholiques que pourront être consacrées, dès la mise sur pied d’un gouvernement provisoire en 1830, les libertés d’enseignement, d’association, de la presse et de l’exercice des cultes.
Ensuite, le Congrès national aura pour mission de rédiger une Constitution. Si les catholiques l’emportent numériquement sur les libéraux dans cette assemblée, la volonté commune qui se dégage néanmoins est de consacrer l’indépendance réciproque de l’Église et de l’État plutôt que de revenir au régime concordataire qui prévalait à la fin de la période française.
Comme l’écrit l’historienne Micheline Zanatta, par le biais de ce compromis, « [l]’Église renonce au statut de religion officielle, mais se réserve des avantages qui luipermettent de créer un véritable État dans l’État et d’imprimer sa marque sur les institutions naissantes, au nom du principe de liberté »4.
Le choix de l’époque est donc clairement celui d’une indépendance réciproque plutôt que d’une séparation ou, selon la formule utilisée en 1918 par le juriste Paul Errera, un système « d’indépendance mutuelle entre les cultes et l’État, dans lequel l’État doit aux cultes moraux professés en Belgique non seulement la liberté, mais encore aide et protection »5.
C’est ainsi que si la Constitution énonce un ensemble de droits des citoyens particulièrement progressiste pour l’époque, le principe d’indépendance pour lequel opte le Congrès national admet d’emblée le financement public des cultes, qu’une séparation radicale n’aurait pas autorisé. Par contre, si ce financement est une revendication de l’Église catholique – financement que cette dernière considère comme une compensation pour la confiscation de ses biens décidée par l’Assemblée nationale française en 1790, alors que la plupart des parlementaires n’y voyaient qu’un simple traitement6 –, le principe en est d’emblée élargi aux autres cultes « qui avaient été reconnus à l’époque de l’annexion des territoires “belges” à la République et à l’Empire français »7, c’est-à-dire les cultes protestant et israélite et, dès 1835, le culte anglican8.
L’alliance, sous la bannière unioniste, entre catholiques et libéraux fera cependant long feu : le développement d’un puissant réseau d’écoles catholiques ainsi que les avantages de plus en plus étendus dont bénéficie l’Église catholique renforcent en effet progressivement le camp anticlérical et mènent à la naissance, en 1846, du premier parti politique belge, le Parti libéral.
Et c’est sur le terrain de l’enseignement que se déroulera par la suite l’essentiel du combat libéral – rejoint ensuite par les socialistes – contre les prétentions cléricales.Un combat d’une virulence telle que, comme lerappelle l’historien Jean-Pierre Nandrin, « l’historien Jean Stengers n’hésitera pas à parler d’un état de quasi-guerre scolaire civile opposant deux systèmes axiologiques très idéologisés tendant à s’exclure sans concession »9.
Certains libéraux, d’emblée, voient en effet dans la liberté d’enseignement un danger, celui de laisser presque toutes les écoles libres dépendre du clergé et donc de renforcer le cléricalisme. Quant aux catholiques, ils n’acceptent l’union avec les libéraux que par intérêt bien compris : la liberté d’enseignement leur garantit la pleine liberté religieuse, mais en même temps elle impose qu’ils reconnaissent aux non-croyants la liberté qu’ils revendiquent pour eux-mêmes. Or, certains voient là une manière de mettre sur le même pied l’erreur et la vérité.
C’est ainsi que dans les faits, les principes libéraux qui sont établis par la Constitution seront utilisés d’abord et avant tout par les catholiques pour renforcer le pouvoir de l’Église.
En effet, l’article 17 de la Constitution prévoit que « [l]’enseignement est libre. Toute mesure préventive est interdite. La répression des délits n’est réglée que par la loi. L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi ». Mais une grande partie de l’histoire des guerres scolaires en Belgique s’explique par le heurt de deux interprétations divergentes de cet article, qui correspondent à des conceptions diamétralement opposées de la liberté d’enseignement : l’une, avancée par le camp catholique, défend la liberté d’enseignement comme un droit fondamental de créer des écoles privées (dans les faits essentiellement catholiques) et de bénéficier de subventions pour organiser cet enseignement ; l’autre, essentiellement défendue par des libéraux – rejoints ensuite par les socialistes –, considère au contraire la liberté d’enseignement comme un droit de fonder certes des écoles privées à côté des établissements d’enseignement organisés par l’État, mais sans que ces écoles doivent nécessairement être subventionnées par l’État et sans que cet enseignement privé puisse se substituer à la mission de l’État en matière d’enseignement.
De plus, dès les commencements, l’éducation morale et religieuse se trouve en filigrane des débats sur l’enseignement. Alors que les partisans de l’école privée catholique ne conçoivent pas d’enseignement qui ne soit imprégné de religiosité, les défenseurs de l’école officielle s’attacheront à distinguer progressivement l’enseignement de l’instruction morale et religieuse, puis l’instruction morale et l’instruction religieuse. C’est ainsi qu’émergera peu à peu l’idée d’un cours de morale.
De 1842 (première loi organique de l’enseignement, dite « loi Nothomb ») à 1958 (loi du Pacte scolaire), l’histoire de la Belgique est donc marquée par des conflits incessants concernant l’organisation de l’enseignement. En toile de fond, outre la question du financement, celle de la neutralité : car les catholiques voient à l’époque cette neutralité comme fondamentalement néfaste, équivalant à une morale sans religion, livrée au prolétariat et au syndicalisme. Quant aux libéraux et aux socialistes, ils cherchent à promouvoir, via le développement d’un enseignement officiel public, laïque et neutre, un instrument de lutte contre le cléricalisme.
Entre 1950 et 1952, sous le gouvernement Pholien – un gouvernement social-chrétien homogène –, le ministre de l’Instruction publique Pierre Harmel prend des mesures avantageuses pour l’enseignement catholique, ce qui suscite l’ire des socialistes et des libéraux. Le libéral Fernand Blum annonce ainsi dès le 14 mars 1951 à la Chambre : « Nous vous disons qu’en cas de renversement de votre majorité, notre premier soin sera de supprimer les effets de votre politique en matière scolaire. »10
Et en 1954 se constitue en effet un gouvernement « laïque » socialiste-libéral, qui prend des mesures (communément appelées « loi Collard », du nom du ministre socialiste Léo Collard) en faveur de l’enseignement officiel, qui déclenchent en retour la fureur du pilier catholique.
La situation sera finalement pacifiée en 1958 par l’adoption de la loi du Pacte scolaire, concédant à l’enseignement « libre » un financement assez généreux et instituant un enseignement optionnel de la morale non confessionnelle à côté du cours de religion.
Depuis la fondation de la Belgique jusqu’au Pacte scolaire, la question de la neutralité a donc agité le monde politique belge, essentiellement autour de deux axes essentiels : celui du financement et celui de l’enseignement, avec évidemment, en « cœur de cible », le financement de l’enseignement « libre ».
De 1958 à nos jours
La loi du Pacte scolaire a sonné comme une sorte d’armistice dans le débat politique sur la neutralité de l’État.
Comment expliquer alors qu’il revienne aujourd’hui à l’avant-plan ? Est-ce vraiment, comme le prétendent certains, à cause de ce que le sociologue Marc Jacquemainnomme une « vision conspirationniste »11de l’islam,résumée à une politique antivoile qui, seule, expliquerait le regain d’intérêt pour la laïcité ou la « neutralité exclusive » ?
Ce serait faire l’impasse sur quelques décennies d’histoire et d’avancées en matière de séparation du politique et du religieux qui sonnent comme autant de conquêtes en matière de liberté de conscience.
Ainsi, en 1974 est modifiée la formule du serment utilisée en matière judiciaire et administrative, qui est amputée de la mention « Ainsi m’aide Dieu ».
En 1987 est dépénalisé l’adultère.
En 1990 est adoptée la loi de dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, malgré l’opposition explicite et religieusement motivée du roi Baudouin.
En 2001, leTe Deumde la fête de la dynastie (15 novembre) devient une cérémonie privée, tandis que la cérémonie officielle et publique est célébrée au Parlement.
En 2002, la Belgique fait office de précurseur en adoptant une loi dépénalisant l’euthanasie, ensuite élargie aux mineurs en 2014.
En 2003, le mariage est ouvert aux couples de même sexe, tandis que l’adoption leur est ouverte dès 2006.
En 2004, les crucifix sont retirés des salles d’audience et autres lieux accessibles au public des tribunaux et cours de justice en vertu d’une circulaire du ministère de la Justice12.
Enfin, depuis 2016, un processus de réforme est entrepris qui conduit à remplacer l’une des deux heures de morale ou de religion hebdomadaires dans l’enseignement officiel obligatoire par une heure de philosophie et de citoyenneté, la possibilité étant même offerte aux élèves d’obtenir la dispense totale du cours de morale/religion au bénéfice de deux heures de philosophie et de citoyenneté.
Toutes ces lois, d’une manière ou d’une autre, signent l’indépendance des lois civiles vis-à-vis du religieux : elles marquent la volonté du législateur de ne poursuivre, dans l’élaboration de la loi commune, que l’intérêt général, sans marquer de préférence pour l’une ou l’autre famille religieuse. Pour autant, il ne s’agit pas non plus de lois athées, dès lors qu’elles n’imposent à aucun citoyen une quelconque pratique qui serait contraire à ses convictions.
La question des signes convictionnels apparaît donc,au vu de ce qui précède, non pas comme la seule question liée à la neutralité de l’État qui agite le monde politique aujourd’hui, mais au contraire comme l’une desseules à rester non tranchées.Et c’est bien cette absence de décision, depuis que la question a surgi en Belgique dans les années 1990, qui explique une telle présence médiatique et politique.
N’en déplaise à Carlo Crespo, alors président du MRAX, qui écrivait en 2016 que « [n]ul ne peut sérieusement feindre d’ignorer qu’aujourd’hui la plupart de ceux qui invoquent la nécessité d’une réaffirmation de la séparation entre l’Église et l’État ne défient plus une institution religieuse mais toisent une minorité de croyants »13.
Et c’est d’autant plus vrai que cette « minorité » ne bénéficie en réalité de pareille audience que parce qu’elle constitue un poids relativement important, en particulier à Bruxelles. C’est d’ailleurs un argument constant des partisans de l’autorisation des signes convictionnels : il s’agirait de lutter contre la prétendue « exclusion » de nombreuses femmes musulmanes de la fonction publique, voire plus largement de l’emploi. Faut-il en conclure que si ces femmes voilées se comptaient sur les doigts d’une main, leur sort n’émouvrait que fort peu une certaine gauche islamo-complaisante ? Voilà qui suffirait à démontrer que ce n’est pas de droits fondamentaux dont il est question, mais d’électoralisme.
Le procès en islamophobie fait par ces derniers aux défenseurs d’une stricte neutralité de la fonction publique est de surcroît intellectuellement malhonnête. Car si le port du voile est en effet le point de départ d’un regain d’intérêt pour la question, ce sont évidemment tous les signes convictionnels, religieux et politiques, qui sont visés. De plus, comme on l’a vu précédemment, la question de la neutralité est loin d’être neuve, puisqu’elle a déjà agité le monde politique belge de 1831 à 1958 autour des questions de financement et d’enseignement et que quantité d’autres questions relatives à la neutralité ont été soulevées et réglées ces dernières années.
Il n’est donc que normal qu’elle se pose aujourd’hui une nouvelle fois, dès lors qu’il s’agit de régler des questions qui ne se posaient pas il y a cinquante ans, ou plus exactement qui étaient déjà réglées, mais que d’aucuns remettent aujourd’hui en cause. En effet, l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’État stipulait déjà :
« § 1. – L’agent de l’État traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d’égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. »
Et la suite du texte levait toute ambiguïté quant à l’interprétation à donner à ce « respect strict des principes de neutralité », puisqu’il précise :
« Lorsqu’il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l’agent de l’État évite toute parole, toute attitude, toute présentation14 qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité. »
Il semble donc clair que si l’on parle tant des signes convictionnels, c’est uniquement à cause des atermoiements sur cette question, depuis qu’elle a commencé à se poser dans les années 1990.
Que dit la Constitution aujourd’hui ?
Plusieurs articles de la Constitution concernent d’une manière ou d’une autre la question des religions et des relations que l’État entretient avec celles-ci.
« Titre 2. Des Belges et de leurs droits
Article 10. Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.