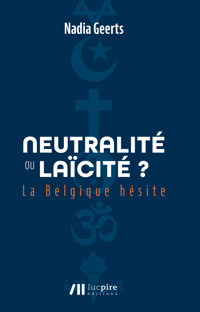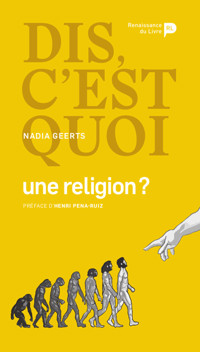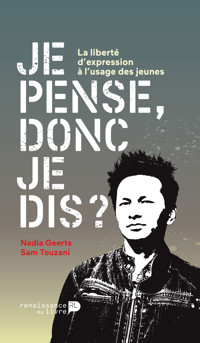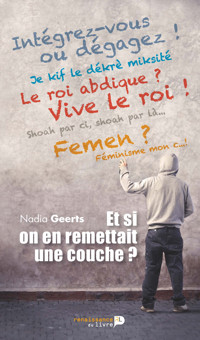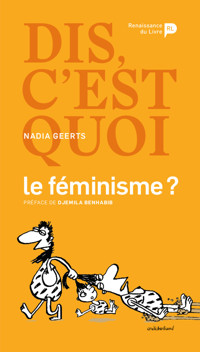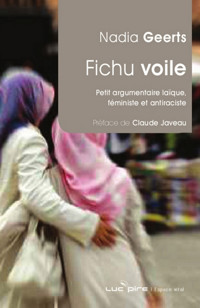Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Avant d’être un texte de loi en France, ou un idéal en Belgique, la laïcité est un outil qui, en séparant le religieux du politique, assure l’égalité et la liberté de conscience de chacun. C’est cette fonction d’outil qu’il importe de garder à l’esprit pour lui conserver sa force de pacification de nos sociétés démocratiques modernes, mais aussi sa visée émancipatrice. Car les défis sont nombreux, de l’abattage rituel aux caricatures du prophète Mahomet, en passant par le financement des cultes et le rôle de l’école.
À travers un dialogue ouvert et pédagogique, Nadia Geerts revient sur les origines d’un concept de nos jours bien malmené, et pourtant incontournable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIS, C’EST QUOI
la laïcité ?
Nadia Geerts
Dis, c’est quoi la laïcité ?
Renaissance du Livre
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Directrice de collection : Nadia Geerts
Maquette de la couverture : Corinne Dury
Mise en page : CW Design
e-isbn : XXXXX
dépôt légal : D/2021.12.763/10
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Nadia Geerts
DIS, C’EST QUOI
la laïcité ?
Préface de Fatiha Boudjahlat
Préface
Nous sommes à la fois très proches et très loin des Belges. Les débats sur la laïcité me font sentir plus proche du Québec que de la petite Belgique. Ils nous sont indispensables, parce qu’eux ont opté pour un modèle politique opposé au nôtre : le multiculturalisme. Ce pays ne tient qu’à un roi. Ceci expliquant cela. Quand on s’intéresse à ces sujets, on connaît Molenbeek. On sait comment le maire de la ville, après un remariage avec une Marocaine, a livré sa ville avec zèle aux rigoristes islamiques. Multiculturalisme ? Multiculturalité ? Apartheid plutôt : des peuples vivent séparément.
Chaque Français devrait avoir un Belge sous la main, pour mesurer l’écart de nos conceptions politiques. Et quand on a la chance comme moi que ce Belge soit une Belge, universitaire, laïque, universaliste, on en profite. Comment une femme d’un pays aussi différent appréhende-t-elle ce patrimoine politique le plus précieux et le plus français qu’est la laïcité ? Je ne suis pas certaine d’être d’accord avec elle sur l’aide à la fin de vie par exemple. Mais le désaccord n’est pas grave et n’endommage rien, c’est aussi un effet de la laïcité. Nadia est une authentique libérale au sens politique du terme. Son analyse est d’autant plus intéressante, depuis son pays étrange et à la structure fédérale fragile, alors que notre pays reste, et je m’en réjouis, résolument jacobin.
Nadia choisit la forme pédagogique du dialogue avec elle-même. Aucun effort n’est plus intellectuellement sain et salutaire que de penser d’abord contre soi-même pour tester la validité et la valeur de ses convictions. Un livre de plus sur la laïcité, nouveau marronnier éditorial ? Quand on recense la quantité et la variété des attaques que ce principe subit, on n’a pas trop d’un livre de plus, surtout d’une Belge, en Belgique. Quiconque prétend définir la laïcité en une phrase se moque de vous. Le Conseil d’État, la Cour de cassation, les tribunaux administratifs, un Observatoire aveugle et sourd à l’esprit de la lettre, le Défenseur des droits ont été amenés à se prononcer. Au cas par cas. C’est dire sa complexité. Et la lâcheté des politiques conduit à s’arcbouter derrière la loi de 1905 telle la tablette des dix commandements, oubliant que celle-ci a fait l’objet d’une quinzaine de modifications et qu’une loi n’a pas vocation à être éternelle, immuable. Ce n’est pas pour rien que nous en sommes à la cinquième Constitution...
En France, la laïcité est à la fois un principe organisationnel et constitutionnel, qui se traduit par la neutralité de l’État et de ses agents dans l’exercice et le lieu de leurs fonctions. Neutralité religieuse, mais aussi politique et philosophique. Enseignante, je ne pourrai arborer un t-shirt réclamant la dépénalisation du cannabis. Principe constitutionnel, les habitants n’ont pas à être d’accord avec pour le respecter. Mais la laïcité se décline aussi comme valeur, c’est-à-dire comme idéal moral auquel chacun est libre ou nond’adhérer. On confond souvent les deux registres. C’est d’autant plus compliqué que notre Constitution de 1958 ne parle plus de laïcité après son article premier...
Nadia passe en revue toutes les situations pratiques mettant en question, à l’épreuve ou en tension le principe laïque. Il faut lire cet ouvrage pour comprendre que plus que le mot si souvent ânonné, ce sont bien ses effets qui importent :construire une communauté politique, alors que la mode est au tribalisme façon McDo, venez comme vous êtes. Les convictions de Nadia, argumentées, jamais abruptes ni agressives, lui ont valu nombre d’attaques et de menaces. Ne nous trompons pas : nous, laïques, n’avons pas choisi la voie de la facilité, ni la voix de la démagogie.
Fatiha Boudjahlat
Le contact enclenché, la radio de ma voiture se met automatiquement en route. C’est justement l’heure d’une émission dans laquelle, chaque semaine, un invité est interviewé à propos de son dernier livre, traitant en général de questions philosophiques. Ce jour-là, pile au moment où je démarre, j’entends lavoix de l’auteur déclarer : « Je suis laïque, évidemment. La laïcité est un principe essentiel en démocratie. Mais je suis pour une laïcité inclusive. »
J’appuie sur le bouton « off », furieuse.
Mais enfin, pourquoi éteins-tu la radio ? C’est pourtant un sujet qui t’intéresse, la laïcité !
Oui, bien sûr, mais quand j’entends quelqu’un parler de laïcité inclusive, je sais déjà qu’il va m’énerver… Ça ne veut rien dire, « laïcité inclusive » ! C’est juste une manière de contenter tout le monde, en réalité.
Je ne te comprends pas. Tu n’arrêtes pas de dire qu’il faut confronter ses idées à celles des autres, et là tu refuses d’écouter quelqu’un parce qu’il a dit deux mots qui ne te plaisent pas ? Tu as quelque chose contre l’inclusion ? Tu préfères l’exclusion ?
Ben voilà, tu as compris pourquoi j’ai éteint la radio. Forcément, se déclarer en faveur d’une laïcité inclusive, c’est sous-entendre que la laïcité pourrait être exclusive, c’est-à-dire qu’elle pourrait servir de prétexte à rejeter des gens. Or, la laïcité n’a pour vocation ni d’inclure ni d’exclure. Son ambition est tout autre, et elle va de pair avec l’exigence démocratique de liberté et d’égalité.
Attends, faut que tu m’expliques là… Tu veux dire que si on n’a pas la laïcité, on n’a pas non plus la liberté et l’égalité ? Pourtant, tu dis toujours qu’on n’est pas dans un État laïque, et il me semble quand même qu’on est libres et égaux en Belgique, en tout cas devant la loi, en théorie. Non ?
Oui… et non. Par exemple, tu as entendu parler de cet arrêt récent de la Cour de justice européenne à propos de l’abattage rituel ?
Non, c’est quoi cette histoire ? L’abattage rituel, c’est quand on tranche la gorge de l’animal, c’est ça ?
Oui, à peu près. C’est surtout une méthode d’abattage sans étourdissement préalable. Normalement, la loi impose, au nom du bien-être animal, qu’il soit étourdi, assommé si tu veux, avant d’être tué. Ce qui contrevient à la pratique traditionnelle de la cacherout, chez les juifs, ou de l’alimentation halal, chez les musulmans. Et en septembre 2020, la Cour de justice européenne a estimé qu’interdire l’abattage rituel était illégal, car cela équivaudrait à porter atteinte à la liberté religieuse. Il faut donc selon elle prévoir une dérogation à la loi générale qui impose l’étourdissement.
C’est plutôt bien ça, non ? Comme ça, chacun peut faire comme il veut. On est dans un pays libre après tout !
Justement, ce qui m’ennuie dans cette histoire, c’est que la loi n’est plus la même pour tous. À quoi bon faire une loi sur le bien-être animal, qui se fonde sur l’idée qu’il est important de diminuer autant que possible la souffrance des animaux lors de leur abattage, si c’est pour accepter ensuite que la religion puisse être un motif de ne pas respecter cette loi ?
Tu dis ça parce que tu aimes les animaux, mais c’est quand même plus important que les gens puissent manger conformément à ce que leur religion prescrit, non ?
C’est certainement ce que pensent ceux qui se réjouissent de cet avis de la Cour de justice européenne. Mais moi, j’y vois un précédent dangereux. La logique de l’exception religieuse me semble pouvoir nous mener très loin, et mettre en danger les principes de liberté et d’égalité de tous devant la loi, qui fondent nos démocraties modernes.
Tu peux me donner un exemple ?
Oui, bien sûr, il y en a plein ! Ça peut aller du refus de travailler le samedi parce que c’est le jour du shabbat à l’autorisation des mutilations génitales parcequ’elles seraient imposées par la religion.
Oui mais bon, là tu exagères ! Il y a quand même une différence entre ne pas vouloir travailler le samedi et mutiler son enfant !
Oui, il y a une différence de degré, mais pas de nature, comme disent les philosophes. Dans les deux cas, ona affaire à une mise en cause d’une norme civile (la loi) aunom d’une norme religieuse. Et si on accepte ça, on met le pied dans un engrenage dangereux, puisqu’on accepte l’idée qu’une norme religieuse puisse l’emporter sur une norme civile. Et ça, c’est le contraire de l’idée de citoyenneté.
Tu me parais bien radicale, comme s’il n’y avait pas moyen de concilier les deux. L’idéal, ce ne serait pas de trouver une manière de vivre ensemble en permettant à chacun de vivre selon sa religion ?
Ah ben oui, l’idéal, c’est toujours le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière en prime ! Non, je te taquine, parce que je trouve ta remarque très symptomatique de ta génération :vous voulez désespérément être tolérants, en fait, et du coup vous n’arrivez plus à accepter les interdits. Surtout si vous avez l’impression qu’ils atteignent la religion. En ce sens, Malraux avait raison quand il disait que : « Le XXIe siècle sera religieux1. » Et le plus fort est que même des jeunes comme toi, qui ne sont pas croyants pour un sou, sont pétris de l’idée qu’il faut respecter la religion…
Et toi, tu trouves qu’il ne faut pas la respecter ?
Évidemment que non, il ne faut pas respecter les religions ! Il faut respecter les personnes, ça oui. Mais pourquoi faudrait-il respecter les religions ? Et ça voudrait dire quoi ? Qu’on n’aurait plus le droit de les critiquer ? Ce serait refermer une parenthèse qui s’est timidement ouverte vers leXVIIe siècle, car avant ça, il n’était en effet pas question de critiquer la religion. On risquait les pires ennuis si on s’y risquait, jusqu’à des supplices épouvantables comme ceux qu’on infligea au malheureux chevalier de La Barre en 1766, alors qu’il avait à peine vingt et un ans, parce qu’il avait eu le malheur de ne pas ôter son chapeau au passage d’une procession religieuse !
C’est parce qu’on a osé critiquer les religions que nous vivons dans une société libre aujourd’hui. De Jésus chassant les marchands du temple àCharlie Hebdodessinant le prophète Mahomet gémissant sur les« cons »qui commettent des attentats en son nom, il s’agit toujours de la même chose :penser librement, oser dire qu’on n’est pas d’accord, critiquer les dogmes !
Oui, mais que devient la tolérance dans tout ça ?
Ah, la tolérance ! Vous n’avez que ce mot à la bouche… Moi, tu vois, ce mot m’insupporte en fait. La tolérance, c’est à la fois trop et pas assez : c’est trop s’il s’agit des idées, qui sont là pour être critiquées, débattues, contestées, mais ni tolérées ni encore moins respectées. Et ce n’est pas assez pour les personnes, qui ont droit quant à elles au respect, qui est bien plus que la simple tolérance.
En fait, ce mot « tolérance » me renvoie à John Locke ou à l’édit de tolérance, donc à un passé que j’espère définitivement révolu, même si ce sont bien les premiers balbutiements de la laïcité qu’on trouve là…
Ah bon, comment ça ?
Il est difficile de retracer l’histoire de la laïcité sans