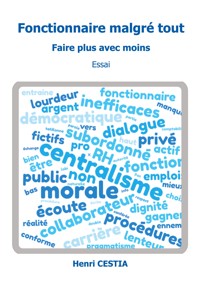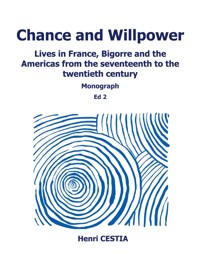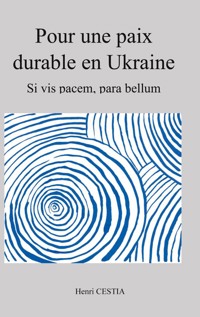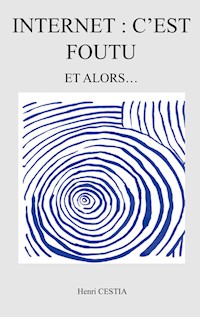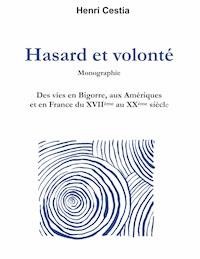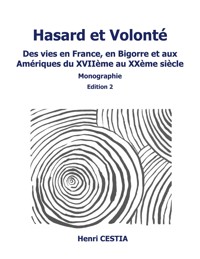
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans Hasard et Volonté Henri Cestia vous propose un voyage qui vous mènera du XVIIème au XXème siècle , en Béarn, en Uruguay, en Louisiane, en Argentine et en Guadeloupe. En suivant le fil rouge de la généalogie du patronyme Cestia, l'auteur vous fera connaître des gens plus souvent pauvres que riches, qui ne sont ni princes, ni rois, mais des hommes et des femmes dont la vie ordinaire est faite de hasard et de volonté. Ce livre n'est pas un roman. Tout est vrai, Les documents d'archives sont disponibles sur le site de l'auteur. Ainsi par des récits de vies, dans une démarche de micro-histoire, Henri Cestia nous fait rencontrer l'Histoire. Dans la première édition le plan du livre était antéchronologique. Pour faciliter la lecture, le récit est maintenant chronologique et agrémenté de photos extraites de l'album familial. Un index des personnes citées est présent en fin d'ouvrage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je remercie :
Mes parents qui ont initié les recherches généalogiques de la branche Cestia de notre famille,
Mon épouse qui depuis plus de 15 ans apporte à mes travaux son avis et ses remarques,
Lionel Dupont qui m'a transmis l’histoire de ma famille en Uruguay,
Mes cousines Luciani qui m’ont ouvert leur boite à chaussures pleine de souvenirs,
Raymonde Aubian, et lui rends hommage. Bénévole infatigable aux archives départementales de Tarbes elle m’a toujours avec gentillesse, fait parvenir les relevés d’actes demandés,
Les nombreux généalogistes rencontrés sur la toile : Jean Paul Abadie, Georges Ano, Simone Arrizabalaga, Christian Auguin, Jean Borderes, Sandrine Braun, Laetizia Castellani, Michèle Cazaux, Thierry Cenac, Burton Cestia, Christine Cestia, Michel Cestia, Martine Dagnino, Dominique Delluc, Paulette Faivre, Pierre Frustier, Bernard Herrou, Jean Yves Herve, Roland Larre, Jeannette Legendre, Ana Malbos, Myriam Managau, Alain Medina, Jean Marc Nougues, Jean-François Quarre, Nadine Sahoune, Christine Saintupery, Michel Sauvee, Roberte Thomaset, avec qui depuis 1999 nous avons partagé nos généalogies.
Ma passion pour la généalogie n’est pas motivée par l’établissement compulsif de listes d’ancêtres, mais s’exprime dans une démarche de micro-histoire [1], une manière de rencontrer l’Histoire à travers des histoires de vies de gens ordinaires aux destins parfois passionnants qui ont tous fait l’Histoire.
Le nom patronymique Cestia est rare ; peu de gens portent aujourd’hui ce nom de famille, ce qui attisa ma curiosité pour en connaitre l’origine, d’autant que certaines hypothèses proposées par les linguistes ne sont guère valorisantes, …simple d’esprit, crétin [2].
Satisfaisant cette double curiosité, l’une concernant la micro-histoire, l’autre concernant le nom de famille Cestia, j'essaie ainsi, tout simplement, en suivant le fil rouge de la transmission d'un patronyme, de raconter des histoires, de raconter l'histoire de vies, de familles et de terroirs, de redonner vie à des personnes que l'Histoire n'a pas retenues… et peut-être, en définitive, de mieux comprendre l'Histoire.
Je ne souhaite pas avec ce livre me draper de la gloire passée de quelques uns de mes ancêtres, mais pas plus supporter les fautes de quelques autres. Mon seul guide est de témoigner de leurs vies.
Les recherches généalogiques s’apparentent parfois à une enquête policière. A partir d’un événement trouvé, parfois par hasard, par exemple présence d’une personne sur une liste d’embarquement, on cherche d’autres éléments en lien avec l’information trouvée. Il faut pour cela explorer différentes archives disponibles pour trouver des données complémentaires et ainsi découvrir les événements de la vie de la personne. Mais la réussite n’est pas assurée à 100%. Ainsi mes recherches sur 604 personnes répertoriées entre le XVIIème et le XXème siècle n’ont pu aboutir d’une manière satisfaisante pour 73 personnes, soit 12%.
Ce livre n’est pas un roman. Il relate des faits avérés. Toutefois quelques filiations notamment au XVIIème siècle ne sont que très probables. Les informations fournies sans les « preuves » par des généalogistes amis ont été vérifiées.
La première édition, le brouillon de celle-ci, a raconté l’histoire des Cestia à l’envers, c’est-à-dire à la manière dont les généalogistes font leurs recherches, c’est-à-dire en commençant par leurs parents, puis leurs grands-parents et ainsi de suite en remontant le temps. Ce choix délibéré de ma part m’a été reproché. Effectivement il nuisait à la clarté du récit. La deuxième critique était l’absence d’index des personnes cités, index si cher aux généalogistes !
Dans la présente édition j’ai remis l’histoire à l’endroit, je veux dire que le récit est chronologique. On trouvera à la fin de l’ouvrage un index des noms cités. Les généalogistes trouveront sur mon site Web pour toutes les personnes citées dans l’index toutes les sources généalogiques, actes divers, preuves de filiation et autres informations.
Enfin pour agrémenter la consultation du livre j’ai puisé dans les albums de photos de la famille.
http://www.genea-cestia.fr/
1 Influencée par Edward Palmer Thompson, la micro-histoire propose aux historiens de délaisser l’étude des masses ou des classes pour s’intéresser aux individus. En suivant le fil du destin particulier d’un individu, on éclaire les caractéristiques du monde qui l’entoure. Les microhistoriens italiens prônent une réduction d’échelle, afin d’examiner les phénomènes à la loupe (Wikipedia).
2 Le dictionnaire des noms de famille Dauzat établit un lien entre Cestia et le terme crestian qui signifie "chrétien" en occitan. Au féminin, crestiana. Toutes ses formes ont pour sens général bénis de Dieu, simples d'esprit. Les linguistes nous apprennent aussi que le mot chrétien a donné le mot crétin…
Sommaire
1. Origine et histoire du patronyme Cestia
2. De 1600 à 1700
3. De 1700 à 1750
4. Lescurry de 1639 à 1891
5. De 1750 à 1800 travailler pour survivre
6. L’esclavage en France au XIXème siècle
7. Migrer pour fuir la misère
8. De 1800 à 1850, sortir de la misère
9. Conscription en France de 1789 à 1998
10. de 1850 à 1900
11. Les Cestia en France au XXème siècle
12. de 1900 à 1946 Felix Cestia
13. 1914-1918 Emile et Jules Cestia
14. 1914-1918 Juan-Carlos Dupont
15. Les Cestia en France de 1900 à 1946
16. Les Cestia aux Etats-Unis d’Amérique de 1900 à 1946
17. Conclusion
18. Index alphabétique des individus cités
1. Origine et histoire du patronyme Cestia
La recherche de l’origine d’un patronyme est un sujet complexe. La généalogie permet de connaître la forme ancienne du patronyme. Les linguistes apportent des interprétations que je vous propose de confronter aux apports de la généalogie des Cestia et à l’étude toponymique.
Selon les linguistes
Le Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons de Michel Grosclaude 2003, indique pour le nom de famille Cestia : « Patronyme rare. En Pyrénées-Atlantiques : 5 foyers à Oloron, Nay, Moumour et Pau. Obscur : Peut-être du nom d'homme latin Sextianus ? Ou contraction de Sebastian ? − Sestia. Orthographe restituée : Sestian Sestiaa. »
Le linguiste Albert Dauzat [3] propose une autre hypothèse. Selon lui ce patronyme aurait son origine dans les populations de cagots présentes dans le Sud-ouest de la France au Moyen Âge. On appelait cagots des personnes appartenant à certains groupes sociaux défavorisés groupés en isolats dans les hautes vallées d'accès difficile des Pyrénées centrales et occidentales. Les cagots étaient victimes de diverses discriminations, à l'église notamment un bénitier leur était réservé. Ainsi, selon lui, les noms de Chrétien et Chrestien attribués à ces populations, donnent Chrestia et en Bearnais Crestiaa.
Le terme Crestian signifie « Chrétien » en occitan. Au féminin, Crestiana. Toutes ces formes ont pour sens général bénis de Dieu, simples d'esprit. Dans le Valais, Chrétien a donné le patronyme Crétin, patronyme de nos jours encore très répandu, notamment en France dans les départements du Jura et du Doubs, mais a donné aussi le mot de la langue française crétin.
Selon la généalogie
La généalogie nous apprend que tous les porteurs actuels du patronyme Cestia ont pour ancêtre Guilhem Sestian , Arnauld Sestian , Bernard Sestian , Guilhaume Sestian ou Pierre Jean Sestian -, propriétaires de terres et maisons à Lescurry. Ainsi, Sestian est la forme ancienne du patronyme actuel Cestia. Ces cinq Sestian dont on peut supposer qu’ils appartiennent à une même famille, sont, vers 1600, des propriétaires bien implantés dans le village de Lescurry. Ils possèdent à eux cinq 10% du foncier et de l’immobilier du village. Il semble donc probable qu’ils soient présents dans ce village de Lescurry depuis au moins quelques générations.
L’hypothèse avancée par le linguiste Albert Dauzat mentionnée ci-dessus ne résiste pas à l’analyse des faits, car il y a entre les montagnes et Lescurry, où apparait le patronyme avant 1600, beaucoup d’autres villages ou des Sestian auraient pu faire souche ce qui n’est pas le cas. En effet, de nombreux relevés systématiques des registres paroissiaux sont disponibles pour les XVIIème et XVIIIème siècle. Sur une base de données [4] de 35 000 actes concernant 300 communes du département des Hautes-Pyrénées [5] on ne trouve pas de Sestian ou autres variantes ailleurs que dans les villages proches de Lescurry. La piste des montagnes pyrénéennes étant écartée, les linguistes nous orientent vers un nom latin, ce qui rejoint l’approche toponymique.
En effet la proximité de Lescurry avec les terres de Sestias conduit à envisager l’hypothèse que nos lointains aïeux de Lescurry soient originaires du hameau de Cestias. La migration d’un ou plusieurs habitants du hameau de Cestias vers Lescurry pourrait être intervenue au XVème ou au début du XVIème siècle.
Ces migrants venus de Cestias sont alors désignés par un nom patronymique qui désigne leur village d’origine, Sestias, Sestianum dans la forme qui désigne l’origine. Ce qui donne en Gascon Sestian. En effet en latin la dernière syllabe ne porte jamais l’accent tonique donc disparait quand on passe du latin à l’occitan. Aussi, des mots qui se terminent en latin par -anum, se terminent en occitan par -an. [6]. Ainsi naquit vraisemblablement le nom de famille Sestian dont la forme actuelle est Cestia ou Cestiaa.
Les ancêtres lointains des Cestia ne se sont pas toujours appelés Cestia. En effet, c’est l’apparition du livret de famille vers 1877 qui a permis en France de transmettre sans altération les noms de famille d’une génération à l’autre. Jusque là l’état civil paroissial ou républicain est établi sur la base des déclarations verbales qui entrainent donc des variations, parfois importantes sur la manière d’écrire les noms de famille notamment dans les périodes où peu de gens savaient écrire leur nom.
Le graphique ci-après représente le recensement (nombre de porteur du nom en ordonné) des différentes formes du nom patronymique Cestia, recensement établi sur la base des fiches constituées lors de mes recherches. On observe le remplacement de la lettre initiale S par la lettre C, sauf dans la forme régionale Sestiaa à Nay puis la disparition progressive de la terminaison en « an » .
Sans que ce soit une certitude, ces chiffres nous disent que ces patronymes rejoindront, tôt ou tard, la longue liste des noms patronymiques disparus notamment en France.
Selon la toponymie
Le hameau de Cestias est distant de Lescurry par un parcours pédestre d’environ 19 kilomètres, ce qui représente environ 4h30mn de marche.
L’histoire gallo-romaine et du Moyen Âge de ce hameau nous apportent des informations intéressantes. A propos de Sestias, Charles Brun signale la présence, au début du siècle [7], d’« un château au point culminant du lieu, à 50 mètres au couchant de la métairie. La route de Miélan passe juste au milieu de l'emplacement du château. On voit encore quelques traces des fossés qui permettent de voir que le château formait un quadrilatère de 30 à 40 mètres de côté environ ».
Epoque gallo-romaine
Selon Stéphane Abadie [8], « Le quartier de Sestias, aujourd'hui Cestias, se trouve dans la partie ouest du territoire communal. Ce toponyme viendrait du nom de famille gallo-latin Sestianus (Sestius), identifié par certains auteurs avec l'emplacement d'une villa de Sulpice Sévère dans l'antiquité tardive, et où fut enterré Saint Justin [9]. Aucune trouvaille gallo-romaine n'est cependant venue confirmer cette hypothèse. »
Cestius est un nom de famille romain. Sextus est un prénom romain. A l'époque romaine, des Cestius sont cités par Cicéron dans son discours sur Flaceus et dans sa lettre à Atticus. Le troisième Cestius, également cité par Cicéron, est Caiius Cestius préteur (magistrat) en 44 avant J.C. De cette époque, il reste à Rome, à l’extrémité de là via Cestia, le mausolée du magistrat Caïus Cestius mort en 12 avant JC. Ce monument est une pyramide couverte de marbre. « Tombeau digne d'un pharaon » selon l’expression du Guide Michelin de Rome (édition 1988). Après la mort de César, on retrouve un Lucius Cestius préteur dont le nom figure sur un Aureus. Sur cette monnaie, le buste évoque l'Afrique, et fait allusion au rôle que Lucius Cestius doit avoir joué dans cette contrée.
Rome – Pyramide Cestia
Au début de notre ère Cestius venant de Rome, arrive et s’installe dans le sud de la Gaule à proximité de Trie-sur-Baïse. Ce fait historique n’est pas prouvé. Cependant, c’est une hypothèse probable avancée par l’historien Stéphane Abadie dans sa monographie du canton de Baïse. Il faudrait fouiller les terrains du hameau de Cestias pour en savoir plus, et confirmer que c’est bien ce nom de famille romain qui a donné son nom au hameau actuel de Cestias. Jusqu’à preuve du contraire, nous reteindrons donc cette hypothèse.
Epoque médiévale
L'ancien château seigneurial de Sestias se trouve dans la partie sud du hameau actuel de Cestias, à 1 km au nord de Lapeyre et à 2,2 km de la bastide de Trie. C'est une forteresse de type plate-forme résultant d'un aménagement par « retaillement » du relief préexistant afin d'augmenter la superficie de la plate-forme sommitale.
Au Moyen Âge le territoire de Sestias est indépendant. On possède plusieurs mentions des seigneurs de Sestias dans le cartulaire de Berdoues [10] :
On trouve mention d'un de Guillaume Sestias au début du XIII
ème
siècle. En 1202 apparait sur le Cartulaire de Berdoues (acte n° 324) la première mention de la Seigneurie de Sestias (famille Sestiano)
En 1323, Condorine de Sestias épouse Géraud d'Esparros. On retrouve ces deux noms dans le paréage de Trie.
En 1331, ils vendent la terre de Sestias à
« puissant Centulle, comte d'Astarac »
pour 1 220 livres tournois.
En 1489, enfin, Jean d'Astarac donne en fief aux habitants de Trie, les territoires de Trie et de Maroncères.
La seigneurie de Sestias appartient au comté d'Astarac. Le comté d'Astarac est situé au nord-est du comté de Bigorre. Au Moyen Âge, les relations entre les différents comtés sont souvent conflictuelles. Les comtés de Bigorre et d'Astarac ne font pas exception.
Le 25 mars 1331, Centule IV achète à Condorine de Sestias et à son mari Géraud d’Esparos la terre de Sestias pour 1 220 livres tournois. Située dans l’actuel département des Hautes-Pyrénées, cette seigneurie se trouve au centre d’un ensemble de terres relevant du Comte d’Astarac par les hommages [11] successifs du 23 octobre 1374 et du 3 mai 1392. [12]
Condorine de Sestias est seigneur de Sestias, puis Comtesse de Sestias après son mariage en 1323. La vente des terres de Sestias en 1331 donne la seigneurie à Centule IV d'Astarrac qui gouverne le comté d'Astarac sous la tutelle de sa mère de Cécile Comminges . En 1489 Jean d'Astarrac est le seigneur de Sestias.
Au Moyen Âge, ce sont des seigneurs et des comtes qui dirigent la contrée. Les seigneurs de Sestias construisent sur le point le plus haut de leurs terres, un château de 30 mètres de large sur 40 mètres de long. Ils disposent ainsi, derrière les murs épais de leur château, d’un solide abri qui leur permet de faire la guerre à leurs voisins. Condorine de Sestias qui n’est que Seigneur de Sestias comme son père, lorsqu’elle épouse le jeune comte d’Astarac dont le comté est situé au nord de la Bigorre, devient, par son mariage, comtesse de Sestias.
XVIème et XVIIème siècle
C’est au XVIème siècle que le nom de famille Sestian serait apparu dans le village de Lescurry. Sans doute parce que des habitants des terres de Sestias décident de s’installer un peu plus loin plus au sud. Sestias donne en Gascon Sestian.
Dans la première moitié du XVIIème siècle, Lescurry compte environ 40 maisons dont 5 sont des maisons appartenant à des Sestian. Les familles Sestian possèdent alors environ 10% des maisons et de terres du village. Certains ont bien réussi. Ils sont collecteurs d’impôt. Mais les autres sont paysans.
La vie de paysan est dure au XVIIème siècle. En 1694, une terrible famine touche durement le village. Pierre Jean Sestian décide alors de quitter son village natal et de s’installer à Nay dans le Béarn où les métiers du textile se développent beaucoup. Ainsi Pierre Jean d’une famille d’agriculteur de Lescurry devient bonnetier.
XVIIIème siècle
Au XVIIIème siècle les Sestian de Nay sont de plus en plus nombreux. Ils sont souvent ouvriers dans l’industrie textile de Nay naissante qui prend le relais de l’artisanat de la période précédente. Le nom de famille se transforme en Cestian, Sestia, Cestia ou Sestiaa.
Pendant ce temps, Lescurry connait, en 1713 et 1747, deux terribles années. D’autres Sestian quittent alors le village de Lescurry pour rejoindre les Sestian de Nay, tandis que quelques autres s’installent à l’occasion d’un mariage dans les villages voisins de Beccas, Louit, Collongues ou Dours dans l’espoir de trouver une terre moins ingrate. Des villages où souvent ils retrouvent un membre de leur famille qui y est déjà installé. La possibilité de solidarité familiale, sans doute moyen de faire face à l’adversité du siècle, semble un élément déterminant pour le choix du village de destination.
Au XVIIIème siècle à Lescurry, comme partout en France chez les paysans, la vie continue d’être rude et ce malgré la légère embellie des conditions d’existence constatées à partir de 1725. La proportion d’une classe d’âge qui dépasse les 10 ans est seulement de 60%, et seulement 50% atteint l’âge de 25 ans. Famines, disettes, épidémies transforment la vie en un combat contre la mort. Il faut se nourrir pour survivre. Pour se nourrir il faut travailler dur, mais il faut aussi que les conditions climatiques soient favorables. Conditions parfois impossibles à réunir.
Pendant la seconde moitié du XVIIIème siècle, les Cestia de Lescurry sont de plus en plus nombreux à quitter leur village pour s’installer dans des villages situés au nord et au sud de Lescurry et à l’est d’une ligne Tarbes-Maubourguet.
Au XVIIIème siècle, la plus grande partie de la population ne sait ni lire, ni écrire, ni même signer son nom. Pourtant en 1768, Arnauld Cestian (1716-1788) est collecteur d’impôt. A la veille de la Révolution Jean Cestia est membre du corps municipal et à ce titre signataire du cahier de doléances du village de Lescurry qui demande moins d’impôt et plus de libertés « qui sera toujours l'âme de tout commerce » peut-on y lire.
Mais être un notable de son village ne présente pas que des avantages. En 1790, on décide de faire les comptes de la collecte d’impôt entre 1761 et 1789. Il en résulte que le fils de feu Guillaume Cestia doit rembourser 18 livres tournois, l’équivalent de 15 jours de salaires.
A Nay, la grande famille des Cestia s’est encore agrandie. Ils continuent à travailler dans l’industrie textile mais aussi dans celle du bois. Salariés des manufactures, ils vivent au jour le jour, d’un maigre salaire, libres juridiquement mais dépendants économiquement. Cette dépendance organisée par le royaume les maintient à Nay. Aucun autre choix n’est possible pour eux.
XIXème siècle
Le XIXème siècle est d’une extraordinaire vitalité. La « révolution industrielle » du XIXème siècle fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Les porteurs du patronyme Cestia n’échappent pas à cette transformation de la société. Entre 1800 et 1875, c’est près de 30% d’entre eux qui abandonnent les métiers de la terre au profit des professions d’artisan, commerçant et employé. Les Cestia sont présents dans de nombreux villages des Hautes-Pyrénées et à Nay où ils sont ouvriers mais aussi artisans ou commerçants.
Ces changements de métiers sont souvent la conséquence d’une migration. On quitte son village pour trouver une meilleure vie ailleurs, dans les villes et villages de la Bigorre jusqu’au sud du Gers. Mais aussi pour les plus aventureux vers des destinations plus lointaines telles que l’Argentine, l’Uruguay, la Louisiane, et les îles de Guadeloupe et de Porto-Rico.
Les Amériques
Jean Alphe Cestia (1834-1860), originaire de Vic-en-Bigorre, migre très jeune en Louisiane où il rejoint un Cestia de Vic. Il s’installe à Abbeville et y fonde une famille qui est à l’origine de la présence actuelle en Louisiane du nom de famille Cestia.
D’autres Cestia, également originaires de Vic, migrent aussi vers la Louisiane pour y exercer le plus souvent des métiers de commerçants. Ainsi se forme au XIXème siècle en Louisiane une communauté de Cestia originaire de Vic-en-Bigorre bien implantée dans le commerce.
L’Argentine est aussi une destination qui attire les Cestia, de Vic, de Dours, Pujo et de Lacassagne.
Mon arrière-grand-père, Honoré Cestia , décide, lui, de partir en Uruguay où il devient commerçant. Vers 1900, devenu veuf, il rentre au pays avec ses trois enfants. L’ainé mon grand-père, Felix, est Uruguayen tandis que ses deux frères, Emile et Jules, ont la double nationalité. Un détail ? Non, la suite prouve que non.
L’Uruguay est dans la deuxième moitié du XIXème siècle une destination appréciée par beaucoup de Français qui trouvent dans ce pays un dynamisme économique favorable à une réussite rapide dans les affaires.
Le frère de mon arrière-grand-père, Auguste-Sylvain Cestia qui ne souhaitait pas passer 5 ans de sa vie comme militaire, et éventuellement faire la guerre, part lui, en Argentine. Comme lui, de nombreux Cestia sont ainsi déclarés insoumis par les autorités militaires. Auguste-Sylvain meurt à Buenos-Aires en 1897, il a 33 ans.
La Guadeloupe
Les îles de Guadeloupe et de Porto-Rico sont également une destination choisie par ceux qui aspirent enfin à une vie meilleure, pour ainsi, en quelque sorte, tourner la page du XVIIIème siècle fait de souffrances et de malheurs. La pratique de l’esclavage qui est légale en Guadeloupe jusqu’en 1848, ne les arrête pas. De 1800 à 1848, cette main-d’oeuvre « servile » selon le terme employé dans les recensements de populations, est la seule disponible pour exploiter les habitations, nom donné aux complexes agro-industriels de production de sucre. Les droits de l’homme mettront longtemps à pénétrer la société du XIXème siècle, d’abord par l’interdiction de la traite de Noirs qui consiste à aller chercher des Noirs en Afrique, puis en 1848 par l’abolition qui est l’interdiction de leur utilisation comme esclave.
Bertrand Cestia (1805-1876), le fils du boucher de Vic, est le premier Cestia à migrer vers la Guadeloupe où il connait dans le négoce une réussite rapide. Son métier de négociant consiste à acheminer à Bordeaux le sucre produit, et à faire venir de Bordeaux vêtements, nourriture et outils agraires. Sur place, c’est aussi un homme d’affaires dont l’avis est sollicité. Trois ans avant son retour, en 1833, il achète le domaine de St Aunis situé sur les communes de Vic et de Pujo, et devient un peu plus tard un notable maire de sa commune et membre de la société académique des Hautes-Pyrénées.
Vers 1830 Pierre Cestia et Philippe Cestia de Louit migrent vers la Guadeloupe qui connait à cette époque une crise économique. La révolte des Noirs dans l’île voisine de Saint-Domingue a conduit à l’indépendance d’une partie de l’île, et à la création de l’état d’Haïti en 1804. En Guadeloupe, à la même époque, la répression sanglante du soulèvement des Noirs a découragé toute révolte. La baisse passagère de la production de sucre en Haïti, puis la reprise de la production, provoque en Guadeloupe une surproduction qui conjuguée à la pénurie d’esclave, conduit à de graves difficultés économiques.
C’est dans ce contexte économique difficile que Pierre Cestia et Philippe Cestia de Louit arrivent en Guadeloupe à Port Louis. Ils y retrouvent la famille Fabares de Louit, une famille alliée. Fabares Martial est le frère de Jeanne Fabares de Louit, la tante des frères Cestia. En Guadeloupe, Martial Fabares a épousé l’héritière de l’habitation Dadon. C’est une grosse habitation. Pierre et Philippe Cestia n’arrivent donc pas sans un appui local.
Dés son arrivée, Pierre Cestia est en affaire avec Cestia Bertrand au sujet d’une habitation de 160 ha dans la commune de Sainte Rose. Mais cet accord scellé devant notaire ne tient que quelques mois. La rupture de l’accord permet à Pierre Cestia d’être indemnisé pour un montant de 5 406 francs, somme qui représente plus de 10% du prix d’achat initial de l’habitation.
Quant à Philippe, il est d’abord commerçant puis propriétaire, ce qui lui permet après son mariage de redresser la situation financière de son épouse Marie-Anne-Zeline Dumornay-Matignon née en Guadeloupe, fille d’un colon et veuve sans enfant.
En 1843, un tremblement de terre détruit presque totalement Pointe-à-Pitre situé à 30 km au sud de Port-Louis. Une épreuve qui vient s’ajouter aux difficultés déjà présentes dans l’île. C’est alors qu’un autre Philippe Cestia , mon aïeul, dit Bernard en famille, rejoint ses deux frères en Guadeloupe. Les trois frères sont rapidement gérant d’habitation. Philippe est aussi régisseur d’une très grosse habitation de 280 ha d’un propriétaire rentré en Gironde.
Au moment de l’abolition, en 1848, Philippe possède 23 esclaves pour lesquels il est indemnisé par l’état, ce qui lui permet de rembourser une dette contractée auprès de Despalanques de Vic, un ancien associé de Bertrand Cestia .
Avec l’abolition de l’esclavage se terminent les années de prospérité économique de la Guadeloupe. Beaucoup décident de rentrer mais les trois frères Cestia décident de rester.
En 1855, Philippe meurt à Port-Louis sans descendance, âgé de 46 ans. Il laisse une épouse veuve pour la deuxième fois. Philippe, dit Bernard, ne reste pas très longtemps sur l’île. Après le décès de son frère, il rentre au pays après avoir auparavant touché l’indemnité coloniale pour les quelques esclaves dans lesquels il a investi pour travailler sur l’habitation de son frère. En novembre 1856 à Louit, Philippe Cestia dit Bernard qui se dit maintenant rentier, épouse Magdelaine Dortignac qui a 19 ans. Il a lui, 41 ans... Elu maire de Louit en 1865, réélu en 1870, il le reste jusqu’à son décès en 1874.
En 1860, un Cestia de Vic, François, migre très jeune avant le recensement militaire des jeunes hommes de 20 ans, recensement auquel il ne se présente pas. Il est donc déclaré insoumis. Mais il peut, un peu plus tard, se faire exempter du service militaire à cause d’une infirmité. Il épouse en Guadeloupe, Marie Cécile Eugénie Aquart-Pieton fille d’Eugène Pieton, industriel dans le sucre. Eugène Pieton a eu, avant son mariage avec Modestine Aquart, une liaison avec une esclave qui lui a donné trois enfants qu’il reconnait en 1833. La mère et ses enfants ainsi que la grand-mère, bien évidemment aussi esclave, sont alors affranchis.
Porto-Rico
Dans l’île voisine de Porto-Rico il y a les cousins germains des frères Cestia de Louit. Ce sont Pierre Cestia et Catherine Cestia , les enfants de Martial Cestia et Jeanne Fabares . Pierre est médecin. Ils s’installent à Mayaguez à l’extrémité ouest de l’île. Peu de temps après son arrivée, Pierre rencontre, en Guadeloupe, sa cousine germaine à l’occasion d’une transaction financière portant sur une importante somme d’argent. A cette époque le financement de l’activité économique se faisait essentiellement par la famille ou des amis et non par des banques comme c’est le cas aujourd’hui. En 1843, Catherine Cestia épouse Ange Toussaint Giorgi originaire de Farinole en Corse. C’est là qu’elle se retirera après son passage à Porto-Rico.
Ainsi, les Cestia formaient dans les îles dans la première moitié du XIXème siècle un clan familial et d’affaires, condition indispensable à la réussite.
Le XXème siècle
Les guerres mondiales sont pour cette période deux épreuves terribles qui sont aussi l’occasion d’une solidarité mondiale pour défendre l’Europe contre les Allemands. Des Cestia de Louisiane participent à cet élan de solidarité et viendront défendre la France dans les deux conflits mondiaux. Ils se battent, lors du premier conflit, au côté de Jules Cestia et Emile Cestia qu’ils ne connaissent pas, sans savoir, sans doute, qu’ils défendent la terre de leurs ancêtres. C’est aussi le combat de Juan-Carlos Dupont qui est venu très jeune de Montevideo pour défendre la France « sa seconde patrie » selon ses propres termes. Il a juste 17 ans, les autorités militaires de Tarbes n’acceptent pas de l’enrôler. Il doit attendre que ses parents signent une autorisation, ce qu’ils finissent par faire. Il peut alors se battre. Il devient un homme dit-il. Il est décoré de la croix de guerre.
Deux des trois frères rentrés d’Uruguay avec leur père Honoré Cestia sont mobilisés. Jules Cestia reviendra de la guerre avec des décorations, Emile Cestia lui est mort pour la France. Il laisse une veuve et une fille. Felix Cestia qui lui est uruguayen n’est pas mobilisé. La France gagne la guerre mais le malheur répandu fait beaucoup de perdants.
Et puis 30 ans après, c’est à nouveau la guerre. Mon grand-père, Felix Cestia , devenu diplomate est chassé de France par les Allemands. Son épouse reste seule à Marseille. Son fils devenu volontairement Français, fait la guerre et en revient avec des médailles qui attestent de son courage. Son oncle André Cestia , fils d’Honoré et de sa seconde épouse Anna, est mobilisé. Il meurt pour la France à Vienne-le-Château le 11 juin 1940.
3 Albert Dauzat, « Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France », 1973, Larousse.
4http://jme.webhop.net/relhp65/index.php
5 Statistiquement les 300 communes observées sont un échantillon représentatif des 343 communes du département. Les statisticiens s’accordent à dire qu’un échantillon de taille 300 qui représente 88% de la population étudiée, est représentatif de la population étudiée avec une marge d’erreur proche de 2%.
6 Note de bas de page de Michel Grosclaude − Toponymie sur le site des archives départementales des Hautes-Pyrénées.
7 Cité par Stéphane Abadie, Brun, ibidem, pp.XXX-XXXII et 46. Il ne reste rien semble-t-il de ce site.
8 Stéphane Abadie, « Maîtrise d'histoire. Monographie du canton de Trie-sur-Baïse ».
9 Jean Francez, BSR 1973, Sextiacum/ Sestias à Trie-sur-Baïse; Alcide Curie Seimbres, Recherches sur les lieux habités par Sulpice Sévère, 1875
10 J. Cazauran, « Le cartulaire de Berdoues » , acte 324, p.221 de 1202: Guillelmus Sestianum, sacerdos; idem, acte 562 p.386 de 1221: Willelmus de Sistian, clericus.
11 Au Moyen Âge, l'hommage vassalique est la cérémonie au cours de laquelle un homme libre, le vassal, se place sous la protection d'un autre homme libre plus puissant, le suzerain.
12 Nicolas Guinaudeau, « Fortifications seigneuriales et résidences aristocratiques gasconnes entre le Xe et le XVIe siècle », Thèse Histoire médiévale 2012.
2. De 1600 à 1700
Avant 1650, le patronyme Cestia est présent uniquement à Lescurry. En fait il s’agit plutôt du patronyme Sestian qui est la forme la plus ancienne du nom de famille Cestia.
Jeanne Sestian
Jeanne Sestian est la dernière rencontre de mon voyage généalogique qui remonte le temps de 1946 à 1600. On aimerait en savoir plus, malheureusement c’est ici que tombe en panne de carburant notre machine à remonter le temps, je veux dire en panne de documents d’archives pour alimenter la machine. Mais ami lecteur c’est ici que commence pour vous, le récit des Cestia.
Jeanne Sestian dit Peyrou serait née en 1586, si l’on en croit son acte de décès du 9 décembre 1676 qui indique l’âge de 90 ans. Un âge très étonnant à une époque où très peu de personnes connaissent leur âge. J’en veux pour preuve la statistique cidessous que j’ai établie sur la base des âges déclarés lors des décès de Lescurry entre 1660 et 1800. On constate qu’à partir de 40 ans les décès interviennent principalement à 45, 50, 55 ans etc. Ces chiffres ronds démontrent que les gens ont une connaissance très approximative de leur âge. Donc Jeanne Sestian est vraisemblablement née vers la toute fin du XVIème siècle.
Pierre Sestian
Enfourchons une dernière fois notre monture à remonter le temps pour faire la connaissance de Pierre Sestian. Son épouse est Anne Marie Lespiau avec qui il a 3 enfants entre 1636 et 1648. L’ainé est Jean Sestian Coutillou propriétaire. Puis vient Bertrande (1642-1707) qui épouse Jean Casaux avec qui elle a 4 enfants entre 1671 et 1681. Puis vient Gabrielle qui épouse Jean Costabadie avec qui elle a 10 enfants entre 1671 et 1684.
Les Sestian propriétaires
Selon le terrier de Lescurry établi en 1677, il y a environ 40 maisons dont 5, selon les termes employés dans ce document sont « tenus et possédées » par des Sestian. Les terres agricoles, bois ou friches des habitants du village de Lescurry sont évaluées au total à environ 1 000 journaux soit en unité actuelle 350 ha dont 31 ha pour les 5 Sestian propriétaires. Cet inventaire des terres possédées par les habitants du village ne décrit pas celles du Seigneur du village, Philippe de Podenas et son épouse Louyse Montbartsier. Par différence on peut évaluer la surface du domaine seigneurial à environ 150 ha.
Les Sestian propriétaires dans la seconde moitié du XVIIème siècle sont :
Arnaud Sestian (1635-1681) dit Berne qui possède environ 4 ha de terre. Il a, avec son épouse Jeanne Abadie, 3 enfants entre 1658 et 1663 dont Bernard dont la descendance s’installe à Nay.
Jean Sestian Coutillou (1636-1726) qui est le fils de Pierre Sestian. Il possède environ 7 ha de terre. Entre 1652 et 1680, il a, avec son épouse Marguerite Laforgue, 8 enfants dont 6 atteignent l’âge adulte et dont 5 lui donnent une descendance.
Guilhem Sestian (1638-1713) qui possède environ 6 ha de terre. Entre 1660 et 1690, il a avec son épouse Bernarde, 3 enfants dont 2 lui donnent une descendance
Sestian Guilhaume (1642-1726) dit Bernis ou Bicata qui possède environ 6 ha de terre. En 1672 et en 1677, il a avec Jeanne Darric, 2 enfants dont Pierre Jean Sestian qui lui donne une nombreuse descendance à Nay.
Bernard Sestian (1646-1691) dit Camus qui possède environ 9 ha de terre. Il a, entre 1665-1691 avec Marie Marthe Laforgue, 3 enfants dont 2 atteignent l’âge adulte et lui donnent une descendance.