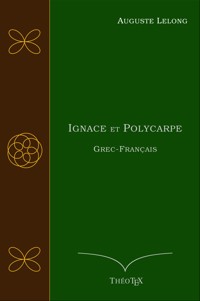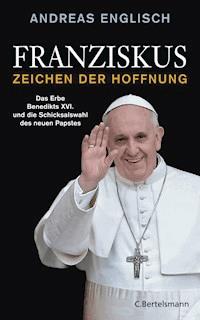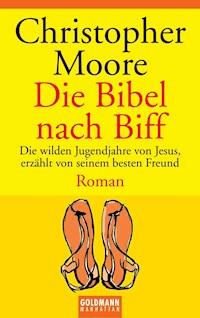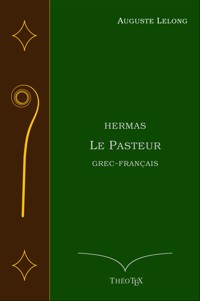
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le Pasteur d'Hermas est un document que doit connaître tout étudiant de l'histoire de l'Église : son ancienneté, son étendue, sa large diffusion dans la communauté chrétienne primitive, en font un livre unique, plus que son contenu, dont le caractère bigot et niais étonne au premier contact le lecteur moderne. Le flou théologique des convictions d'Hermas rend même très surprenant le fait que certains pères apostoliques aient pu un temps le croire inspiré, au point de l'agréger aux Écritures saintes (c'est ainsi que le célèbre Codex Sinaiticus en contient une partie). Néanmoins, les visions, similitudes ou paraboles du Pasteur, aussi controuvées soient-elles, restent une réflexion intéressante sur la construction de l'Église et sur son devenir. Ajoutons à cela que le but de cette réédition reste principalement d'offrir à l'amateur de grec biblique l'occasion d'étendre sa lecture à la littérature ecclésiastique des premiers siècles. Cette numérisation ThéoTeX part du texte de 1912.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322469437
Auteur Auguste Lelong. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Le traducteur et l'auteur des notes de cette édition du Pasteur d'Hermas est un abbé catholique, assez énigmatique, soupçonné d'avoir écrit sous divers pseudonymes, dont l'un au moins est avéré : André Siouville. Sous ce nom, il fit paraître des traductions du grec ancien, un Poème gnomique pythagoricien, les Homélies pseudo-clémentines, et deux études Le prince de ce monde, Le péché originel.
En réalité, né Auguste Lelong, en 1855 à Yvetot, il commença des études de théologie à Saint-Sulpice, qu'il termina au Canada, à Montréal, où il fut ordonné prêtre en 1883. Agrégé de l'Université en 1893, il enseigna à la Faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris jusqu'en 1896, puis devint ensuite vicaire de plusieurs paroisses de la région parisienne. Accusé de modernisme, probablement à cause de son amitié avec un franc-maçon notoire, Oswald Wirth (1860-1943), il se fit mettre à la retraite dès 1907. Dès lors il se consacra entièrement à l'écriture et à la traduction des documents de l'Église primitive.
On lui doit ainsi deux volumes de la collection Textes et documents pour l'étude historique du christianisme, éditée par Hemmer et Lejay, au début du XXe siècle. Ils contiennent Les épîtres d'Ignace, Polycarpe de Smyrne, Le Martyre de Polycarpe et le Pasteur d'Hermas. La qualité de ces ouvrages, où transparaît au premier coup d'œil, la perspicacité, l'érudition et la connaissance supérieure du grec ecclésiastique d'Auguste Lelong, appelait à leur réédition. Nous n'avons cependant pas reproduit dans leur intégralité l'Introduction et les Notes, en particulier les lignes relatives aux questions des sources et de leurs variantes, le but restant d'offrir à l'amateur de grec biblique, un document commode, lui permettant d'étendre sa lecture aux pères apostoliques. Les mots mis en italique dans la traduction française correspondent à des expressions du texte grec tirées des Écritures ; là non plus nous n'avons pas cru utile, pour ne pas alourdir la lecture, d'en indiquer la référence ; on peut aujourd'hui les retrouver facilement dans une Bible numérique, avec la fonction recherche.
Titre. — Nous disons le Pasteur d'Hermas comme on dit l'Athalie de Racine ou le Télémaque de Fénelon, le Pasteur étant le titre de l'ouvrage et Hermas le nom de l'auteur.
La raison de ce titre, c'est que le principal interlocuteur de ce long dialogue, l'Ange de la Pénitence, s'appelle le Pasteur,ὁ ποιμήν. C'est sous ce nom et en cette qualité qu'il se présente lui-même à Hermas : « Je suis, lui dit-il, le Pasteur auquel tu as été confié. » C'est sous les traits et dans l'attirail d'un berger, la besace sur l'épaule et la houlette à la main, qu'il lui apparaît (5Vis.1.3-4). En droit, la seconde partie du livre mériterait seule ce titre : car le Pasteur n'entre en scène qu'à la cinquième Vision ; mais, en fait, vu l'importance du personnage et la grande étendue de ses discours, qui forment, presque à eux seuls, la matière de la Ve Vision, de tous les Préceptes et des neuf premières Similitudes, on a donné son nom à l'ouvrage entier.
But. — Le but du Pasteur est très simple, et, de la première à la dernière ligne, il est poursuivi avec une remarquable unité de vue : c'est une invitation solennelle à la pénitence, adressée d'abord et principalement à l'Église romaine, dont Hermas fait partie (1Vis.1.1), et aussi à la chrétienté tout entière (2Vis.4.3).
Pour bien comprendre la portée de ce livre étrange, il faut faire abstraction de nos conceptions actuelles sur la pénitence et nous reporter par la pensée dans un monde encore très différent du nôtre.
Une croyance, sinon générale, du moins fort répandue dans l'entourage d'Hermas, c'est que l'unique remède au péché est le baptême et que par conséquent les péchés commis après le baptême sont irrémissibles. « Seigneur, j'ai entendu dire à certains docteurs qu'il n'y a pas d'autre pénitence que celle que nous avons faite le jour où nous sommes descendus dans l'eau et où nous avons reçu le pardon de nos péchés antérieurs. — Ce qu'on t'a dit est juste, répond le Pasteur, et c'est l'exacte vérité » (4Com.3.1-2). Naturellement il ne s'agit ici que des péchés graves, mortels, comme la fornication, l'adultère, le meurtre, l'apostasie. Rayer à tout jamais du nombre des fidèles quiconque aurait, ne fût-ce qu'une seule fois, brisé par le péché le sceau de son baptême, faire ainsi de l'Église un corps uniquement composé de saints, tel était le rêve de ces générations héroïques : idéal sublime, sans doute, mais, hélas ! irréalisable pour l'humaine faiblesse et auquel, dès cette époque, la triste réalité se chargeait d'infliger tous les jours de cruels démentis.a
Justement, au temps d'Hermas, une persécution vient de fondre sur la communauté romaine et de mettre à l'épreuve sa fermeté et sa constance. Beaucoup de Chrétiens ont soutenu vaillamment le choc et préféré la mort ou la ruine à l'infidélité. Hermas lui-même est du nombre de ces confesseurs, qui ont courageusement souffert pour leur foi. Mais les défections aussi ont été nombreuses : pour échapper aux supplices, des Chrétiens ont eu la faiblesse de renier leur Maître, de blasphémer leur Dieu, de trahir leurs frères. Maintenant que, la tourmente passée, ils se sentent hors de danger, tous ces faibles, tous ces lâches rentrent en eux-mêmes et sondent à loisir l'horreur de l'abîme sans issue dans lequel ils sont tombés. Bourrelés de remords, ils rôdent autour des portes de l'Église. Mais la morale courante les repousse impitoyablement : pour ces apostats, désormais plus de pardon ! Alors, pris de désespoir, ces malheureux s'abandonnent à tous les désordres : qu'ont-ils à perdre, puisqu'ils n'ont plus rien à espérer ? Les enfants mêmes d'Hermas sont dans ce cas, et parmi les plus gravement compromis. Le bon cœur d'Hermas n'y tient plus : Dieu peut-il donc abandonner ainsi sans pitié ses pauvres créatures ? Ses enfants à lui, Hermas, ces enfants qu'il aime si tendrement malgré leur ingratitude, seraient-ils donc perdus sans retour ? Il ne peut le croire ! Aussi imagine-t-il que Dieu, dans sa miséricorde, veut bien pour cette fois, mais pour cette fois seulement, accorder aux Chrétiens pécheurs le pardon de leurs fautes passées, quelque graves qu'elles soient. Qu'on ne s'y trompe pas : cette rémission des fautes commises depuis le baptême est une grâce exceptionnelle, qui ne se renouvellera pas ; d'ailleurs le monde actuel touche à sa fin.
C'est le Pasteur, l'Ange de la Pénitence, qui est préposé à ce jubilé extraordinaire ; et c'est Hermas qui en est, pour ainsi dire, le prédicateur, chargé de faire connaître à tous les desseins miséricordieux de Dieu.
Comme on le voit, cet appel à la pénitence n'est pas l'exhortation plus ou moins maussade d'un prédicateur ordinaire : c'est la joyeuse annonce de la plus heureuse nouvelle qui se puisse concevoir ; c'est la porte du ciel ouverte toute grande à des gens qui se la croyaient irrévocablement fermée ; c'est la perspective inespérée du salut pour des malheureux qui n'attendaient plus que la damnation. Sans doute, à côté de ces pécheurs qui ne demandaient qu'à faire pénitence, pour peu qu'on leur en laissât la possibilité, il y avait ceux qui ne s'en souciaient guère. Hermas ne les oublie pas : aussi son message, tout de consolation pour les désespérés, devient-il facilement une menace à l'adresse des frivoles et des indifférents.
Naturellement, cette rémission inattendue des fautes commises depuis le baptême, Dieu ne peut pas l'accorder sans conditions. Il en impose donc trois au pécheur : le repentir, l'expiation et surtout le changement de vie. cette troisième condition est d'autant plus importante que le pécheur converti ne peut plus compter sur un nouveau pardon : « car les serviteurs de Dieu n'ont qu'une seule fois pour faire pénitence (4Com.1.8). De là, la place considérable qu'occupent dans le livre les préceptes moraux, destinés à servir de règle de vie aux Chrétiens en général et aux nouveaux convertis en particulier.
Consolante annonce d'un jour de pardon ; exhortations réitérées à profiter de cette occasion unique ; instructions morales pour la direction de la vie nouvelle que doit désormais mener le pénitent : tel est le sujet de l'ouvrage entier.
Dans la pensée d'Hermas, l'apparition de son livre devait constituer un événement extraordinaire et provoquer une sorte de révolution : c'est elle en effet qui allait sonner l'ouverture du grand jubilé et inaugurer la renaissance du christianisme. — En fait, le coup de théâtre si naïvement attendu ne s'est pas produit, et, en ce sens, Hermas n'a pas atteint le but qu'il se proposait. Mais ses généreux efforts ne sont pas pour cela restés stériles : c'est sans doute sous l'influence du Pasteur que les idées d'indulgence firent de si rapides progrès dans l'église pendant la seconde moitié du iie siècle. Hermas avait promis le pardon pour une fois et pour un jour déterminé : on supprima la date fixe et on garda la possibilité de la pénitence pour une fois, tout simplement. Cette règle du pardon unique, à l'exception de quelques cas réservés, semble n'avoir plus fait aucune difficulté au temps de Tertullien. Le Pasteur a eu ainsi la bonne fortune de marquer le premier et le plus important moment dans l'histoire agitée de la pénitence : c'est lui qui a ouvert, dans le mur du rigorisme, la brèche que le pape Calliste et S. Cyprien n'auront plus qu'à élargir au siècle suivant (cf. Batiffol, Les origines de la Pénitence, dans Études d'Histoire et de Théologie positive, Paris, 1902).
Forme. — Venant d'un homme, quel qu'il fût, une innovation aussi hardie que l'admission des pires pécheurs à la pénitence n'eût eu aucune chance d'être acceptée : aussi Hermas la présente-t-il comme venant de Dieu, souverain dispensateur du pardon, seul capable de « guérir » la plaie du péché. C'est Dieu, non pas directement, mais par l'intermédiaire de divers personnages surnaturels, qui intime à Hermas l'ordre d'écrire son livre et lui en dicte toutes les parties. Hermas se dissimule soigneusement derrière ses interlocuteurs célestes : jamais, en son propre nom, il ne se permet d'adresser au peuple chrétien la moindre instruction. Son rôle, bien plus modeste, est celui d'un simple rapporteur, se bornant à transmettre aux fidèles les lumières qu'il reçoit du ciel. Il ne prend même au dialogue qu'une part des plus restreintes et s'y contente de poser des questions pour provoquer des éclaircissements. Le Pasteur n'est donc, d'un bout à l'autre, qu'une série de visions et de communications surnaturelles, et c'est ce qui lui a valu d'être rangé, dès son apparition, parmi les Apocalypses ou Révélations, à côté de l'Apocalypse de Jean, de celle de Pierre et de l'Ascension d'Isaïe. Cependant, malgré la forme apocalyptique qu'il revêt extérieurement, le Pasteur est bien plutôt, au fond, l'œuvre d'un prophète qu'une apocalypse proprement dite.
Division. — Tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, le livre se divise en trois grandes parties : les Visions, les Préceptes ou Commandements, les Similitudes ou Paraboles. On compte cinq Visions, douze Préceptes, dix Similitudes.
La distinction des Visions, des Préceptes et des Similitudes remonte à Hermas lui-même. Quant à la division en cinq Visions, douze Préceptes, dix Similitudes, elle n'est pas tout entière de lui, et même, sur un point particulier, elle est en contradiction formelle avec le plan de l'ouvrage, tel qu'il l'avait conçu. C'est ainsi qu'Hermas ne compte que quatre Visions ; celle que nous appelons la cinquième, il l'intitule simplement Révélation, et, de fait, elle n'appartient pas au groupe des Visions, mais se rattache par les liens les plus étroits aux Préceptes et aux Similitudes, dont elle n'est que la préface.
Bien qu'étrangère en partie à l'auteur, la division actuelle est néanmoins fort ancienne, puisque nous la trouvons déjà dans les versions latines, dont l'une est presque contemporaine d'Hermas.
La distinction en Visions,Préceptes et Similitudes est sans aucun doute légitime et répond réellement aux divers aspects du sujet traité. Cependant il ne faut pas la prendre avec trop de rigueur : car les Préceptes et les Similitudes contiennent presque autant de visions que les Visions proprement dites, comme aussi les Visions et les Similitudes sont bourrées de préceptes. Ce n'est donc, entre ces différentes parties, qu'une question de plus ou de moins. En fait, l'ouvrage n'est, d'un bout à l'autre, qu'une série d'instructions morales données à Hermas dans des visions.
Les quatre premières Visions sont chacune un groupement assez arbitraire de plusieurs visions différentes : c'est ainsi que, dans la première, nous voyons apparaître d'abord l'âme de Rhodé, ensuite l'Église personnifiée. Ces apparitions successives sont autant de tableaux distincts, dont l'ensemble constitue une Vision, tout comme au théâtre un ensemble de scènes forme un acte.
Seulement cette affection, si pure soit-elle, est encore de trop : Rhodé, après sa mort, apparaît à Hermas pour lui reprocher ce sentiment comme « un péché, et un grand péché. » Toutefois elle s'empresse de le mettre en garde contre le découragement et de l'assurer du pardon de Dieu pour ses propres péchés, ceux de sa famille et de tous les fidèles. Par là se trouve énoncé avec une parfaite netteté, dès ce premier tableau de la première Vision, le but de l'ouvrage entier, qui est d'inculquer à tous les Chrétiens, quelques fautes qu'ils aient commises, la possibilité, l'efficacité et le devoir de la pénitence.
Malgré cette consolante promesse, Hermas reste atterré de la sévérité inattendue des jugements de Dieu. Mais une femme, qui n'est autre que l'Église personnifiée, vient le rassurer. La véritable raison de la colère de Dieu contre lui, c'est sa déplorable faiblesse envers ses enfants, cause de tous leurs déportements et de ses propres malheurs. Mais tout espoir n'est pas perdu ; Dieu a eu pitié d'Hermas et de sa famille ; qu'il ramène au bien ses enfants, et alors ceux-ci, malgré leurs fautes passées, seront inscrits de nouveau avec les saints sur les Livres de Vie. Dans cette perspective inespérée du salut final pour des gens coupables de crimes réputés impardonnables, nous voyons réapparaître l'idée maîtresse du livre, la possibilité du pardon pour les plus grands pécheurs, et cette fois sous une forme plus concrète et d'un intérêt plus palpitant, puisqu'il s'agit des enfants mêmes de l'auteur.
L'Église donne ensuite lecture à Hermas d'un écrit plein de menaces contre les païens et les apostats et d'encouragements pour les justes ; puis elle disparaît du côté de l'Orient. Ainsi se termine la première Vision.
La deuxième Vision a lieu un an après la première. Elle se compose de quatre tableaux.
Dans le premier, la femme âgée, c'est-à-dire l'Église, confie à Hermas, pour en prendre copie, un petit écrit.
Mais ce n'est qu'après quinze jours de jeûnes et de prières que le Voyant obtient de Dieu l'intelligence de ce communiqué céleste. Il ne contient pourtant rien de bien nouveau, et n'est guère que la répétition, en termes plus précis, des instructions données par l'Église dans la première Vision : les enfants d'Hermas ont commis les pires péchés ; Dieu charge leur père de les exhorter à la pénitence, eux et tous les Chrétiens coupables. A l'occasion de cette sorte de mission qu'Hermas va prêcher, Dieu veut bien promettre à tous les pécheurs, mais pour cette fois seulement, le pardon de leurs fautes passées, quelles qu'elles soient. C'est, pour ainsi dire, un jubilé extraordinaire, dont il faut se hâter de profiter ; car il ne reviendra plus. D'ailleurs on est à la veille de la grande tribulation, prélude du jugement.
Hermas, lui aussi, doit pardonner à ses enfants et à sa femme leurs torts passés et n'avoir plus, vis-à-vis d'eux, qu'un souci : leur relèvement moral.
Dans un troisième tableau, un jeune homme vient révéler à Hermas que la femme âgée, qui lui est déjà deux fois apparue, c'est l'Église.
Enfin, et c'est le quatrième tableau, l'Église se montre pour la troisième fois à Hermas et lui donne ses instructions pour la diffusion du petit écrit ; néanmoins il doit surseoir à cette publication jusqu'à ce que l'Église ait complété son œuvre dans une vision ultérieure.
Cette Vision ainsi annoncée est la troisième, la plus importante de toutes. Le sujet principal en est la construction de la tour, figure de l'Église. Plus tard, dans la neuvième Similitude, Hermas reprendra ce même sujet, mais sous une forme un peu différente et avec de plus amples développements.
Cette troisième Vision se subdivise en cinq tableaux, d'une importance très inégale.
Dans le premier, nous voyons l'Église apparaître à Hermas pendant la nuit et lui fixer un rendez-vous dans un champ d'épeautre pour la grande révélation qu'elle doit lui faire.
Deuxième tableau : le lendemain, Hermas voit arriver dans le champ d'épeautre la femme accompagnée de six jeunes hommes. Elle le fait asseoir avant les presbytres, mais réserve la première place aux martyrs. Puis elle lui montre une grande tour, que les six jeunes hommes sont en train de bâtir sur l'eau, tandis que des ouvriers, par milliers, leur apportent pour la construction des pierres de toute espèce.
Elle lui explique ensuite les diverses allégories que présente cette vision : la tour, c'est l'Église ; si elle est bâtie sur l'eau, c'est qu'elle a le baptême pour fondement ; les six jeunes hommes sont les six principaux anges ; les manœuvres sont aussi des anges, mais inférieurs aux premiers ; quant aux pierres, très variées de forme, de qualité et de provenance, elles figurent les diverses catégories de Chrétiens et de candidats au christianisme. Mais ne sont admises dans la bâtisse que les bonnes pierres, c'est-à-dire que les hommes qui, après avoir reçu le baptême, en ont gardé toute la sainteté ou du moins l'ont recouvrée par une prompte pénitence.
Toute cette partie de la troisième Vision est très précieuse pour l'historien, en raison de la curieuse peinture qu'elle nous présente des mœurs chrétiennes.
L'Église montre ensuite à Hermas sept femmes, qui soutiennent la tour et sont le symbole des sept principales vertus chrétiennes.
Puis elle charge Hermas de transmettre, dans trois jours, aux fidèles et à leurs chefs, une admonestation assez sévère qu'elle leur adresse. Enfin elle disparaît, emportée vers la tour par les six jeunes hommes.
Dans un quatrième tableau, nous voyons l'Église apparaître encore à Hermas pour l'exhorter à se préparer par la prière, et surtout par le jeûne, à la nouvelle révélation qu'il a sollicitée.
Cinquième tableau. — Dès la nuit suivante, un jeune homme vient découvrir à Hermas le mystère, qui le préoccupait tant, des trois formes différentes que la femme avait revêtues dans les trois premières visions et de ses rajeunissements successifs. Ces rajeunissements sont l'image du bien progressivement opéré dans l'Église par les révélations dont Hermas est l'organe et par ses exhortations à la pénitence.
La quatrième Vision a lieu vingt jours après la précédente. Sur le chemin qui conduit à sa propriété, Hermas rencontre un monstre marin, d'une taille prodigieuse, portant sur son énorme tête quatre couleurs différentes. Il s'avançait avec fureur contre Hermas, mais, ô miracle ! il le laisse passer sans lui faire aucun mal.
Tout de suite l'Église apparaît à Hermas, cette fois sous les traits d'une vierge « parée comme l'épouse qui sort de la chambre nuptiale ». Le monstre est la figure de la grande tribulation qui approche. De même que lui, Hermas, a échappé au monstre grâce à sa confiance en Dieu, de même les Chrétiens peuvent échapper, eux aussi, à cette grande tribulation ; ils ont pour cela un moyen unique, mais infaillible : la pénitence.
Elle explique ensuite à Hermas la signification des quatre couleurs qu'il avait remarquées sur la tête du monstre. Puis elle disparaît pour ne plus revenir. C'est ici sa septième et dernière apparition. Désormais c'est à un autre personnage céleste, au Pasteur, qu'Hermas va avoir affaire.
En effet, dans la cinquième Vision, l'Ange ou Messager de la pénitence se présente à lui sous les traits d'un pasteur. Il déclare à Hermas qu'il est envoyé par l'Ange très vénérable (sans doute le Christ), pour demeurer avec lui tout le reste de sa vie. Il lui ordonne de mettre immédiatement par écrit les Préceptes et les Similitudes qu'il va lui dicter (les douze Préceptes et les huit premières Similitudes) ; plus tard il remettra sous les yeux d'Hermas les visions antérieures, au moins dans leurs traits essentiels : ce sera la dixième Similitude, reprise et complément de la troisième Vision, et la dixième Similitude, conclusion du livre entier. C'est ainsi que se trouve dès maintenant annoncé et assez nettement dessiné le plan de la seconde partie de l'ouvrage, comprenant les Préceptes et les Similitudes. Cette cinquième Vision en est la préface.
Maintenant que, par une grâce inespérée de Dieu, les pécheurs sont admis, mais pour cette fois seulement, à la pénitence et au pardon, il s'agit pour eux de marcher désormais dans la voie droite, sans jamais plus en dévier. C'est cette voie droite que les Préceptes vont leur tracer. Ces Préceptes sont au nombre de douze.
Le premier se contente de signaler brièvement au Chrétien les devoirs de la foi, de la crainte de Dieu et de la continence (ou tempérance). Ces trois vertus feront encore l'objet, avec de plus amples développements, des Préceptes 6, 7 et 8.
Le 2ePrécepte prescrit la simplicité et l'innocence.
Le 3e le respect de la vérité.
Le 4e la chasteté dans le mariage.
Ici s'ouvre une parenthèse sur la pénitence en général ; cette digression est peut-être le passage le plus important du livre entier. En principe, il n'y a pas de pardon pour les péchés commis après le baptême, et dorénavant cette règle sera rigoureusement appliquée. Mais, pour cette fois et cette fois seulement, Dieu veut bien déroger à ce principe et remettre à tous les Chrétiens repentants les fautes commises depuis leur baptême. C'est le Pasteur, l'Ange ou Messager de fa pénitence, qui a été préposé par Dieu à ce jubilé extraordinaire, et c'est Hermas qui doit en être, auprès des fidèles, le prédicateur.
Revenant à la question du mariage, le Pasteur déclare que les secondes noces sont tolérées.
Le cinquième Précepte a pour objet de recommander au Chrétien la patience et de le mettre en garde contre la colère.
Dans les Préceptes 6, 7 et 8 le Pasteur revient sur les trois vertus de foi. de crainte et de tempérance qu'il n'a qu'effleurées dans le premier Précepte.
Mais ces trois dispositions de l'âme peuvent se prêter indifféremment à un bon ou à un mauvais usage ; il s'agit donc de les tourner au bien, et c'est le but des Préceptes 6, 7 et 8.
Le sixième Précepte concerne la foi, ou plutôt la confiance. A qui faut-il donner sa confiance ? — A l'ange de la justice.
A qui faut-il la refuser ? — A l'ange du mal.
Le septième Précepte traite de la crainte.
Qui devons-nous craindre ? — Le Seigneur.
Qui devons-nous ne pas craindre ? — Le diable.
Le huitième Précepte a pour objet la tempérance ou plutôt l'abstinence.
De quoi doit-on s'abstenir ? — Du mal.
De quoi ne doit-on pas s'abstenir ? — Du bien.
A ce propos le Pasteur signale les principaux vices que le Chrétien doit soigneusement éviter, puis les vertus qu'il lui faut, pratiquer, ainsi que les bonnes œuvres qui en sont comme l'épanouissement.
Le neuvième Précepte combat l'esprit du doute (διψυχία) : ce vice frappe nos prières d'une absolue stérilité, tandis que la vertu opposée, la foi ou plutôt la confiance en Dieu (πίστις), est douée d'une merveilleuse efficacité pour assurer le succès de toutes nos demandes.
Le dixième Précepte met le Chrétien en garde contre la tristesse, le plus malfaisant de tous les esprits, et lui recommande la gaieté, perpétuel objet des faveurs et des complaisances divines.
Le onzième Précepte est particulièrement intéressant au point de vue historique : il nous montre en effet les prophètes exerçant encore, au temps d'Hermas, leur ministère au sein des églises chrétiennes. Mais il y a le vrai et le faux prophète, et l'essentiel, c'est de les distinguer l'un de l'autre. A quels signes les reconnaître ? — A leur vie et à leurs œuvres, répond le Pasteur ; et, à ce propos, il nous fait une curieuse et piquante peinture des mœurs des deux espèces de prophètes.
Le douzième Précepte peut être considéré comme une sorte de récapitulation des onze premiers. Car la vie morale se résume tout entière dans la lutte éternelle entre les bons et les mauvais penchants : arracher de son cœur la mauvaise convoitise et s'abandonner sans réserve aux bons désirs, pour les servir et les suivre, tel est l'objet du douzième et dernier Précepte.
Suit un assez long épilogue. Le Pasteur confie de nouveau à Hermas la mission de faire connaître ces Préceptes aux Chrétiens pénitents. Mais, objecte Hermas, ces Préceptes, précisément parce qu'ils sont si beaux et si élevés, ne sont-ils pas impraticables pour la faiblesse humaine ? — En tout cas, répond le Pasteur, leur observation est une condition absolue du salut. D'ailleurs cette observation, loin d'être impossible, est au contraire très facile, pourvu qu'on veuille bien mettre en Dieu toute sa confiance. Inutile d'objecter les tentations du diable ; il est impuissant contre le véritable serviteur de Dieu.
Le Pasteur termine par un nouvel appel à la pénitence, dont il est le messager. Pas de désespoir, quelque péché qu'on ait commis ! Il faut seulement revenir à Dieu par une sincère conversion et pratiquer désormais la justice par l'observation fidèle des commandements précédents : à cette double condition, Dieu garantit au pécheur le pardon de ses fautes passées et la vie éternelle. C'est sur cette consolante perspective que se clôt la série des Préceptes.
Les Similitudes sont, de tout point, la continuation des Préceptes ; comme ceux-ci, elles consistent surtout en recommandations morales, généralement présentées sous forme de comparaisons et d'allégories : d'où leur nom de παραβολαί, paraboles, similitudes. Elle sont au nombre de dix.
La première Similitude est celle des deux cités ennemies. Le Chrétien n'est, en ce monde, qu'un étranger de passage dans un pays hostile. Sans cesse menacé d'expulsion, il peut être, au premier moment, forcé d'abandonner les biens d'ici-bas. Dans ces conditions, n'est-ce pas une folie de chercher à les acquérir ? Et le plus sage, pour lui, n'est-il pas de les échanger au plus tôt contre les biens, éternellement stables, de sa véritable patrie ? C'est ce qu'il fera, en consacrant aux bonnes œuvres les richesses de ce monde.
La deuxième Similitude est celle de l'orme et de la vigne, figures du riche et du pauvre et du mutuel appui qu'ils doivent se prêter : le riche aidera le pauvre de sa fortune et le pauvre donnera au riche le précieux concours de ses prières.
La troisième et la quatrième Similitudes sont toutes deux une réponse à cette troublante question : pourquoi est-il impossible, dans ce monde, de distinguer les justes des pécheurs ? — C'est, répond le Pasteur, que le monde actuel est l'hiver, pendant lequel les arbres, dépouillés de leurs feuilles, se ressemblent tous (troisième Sim.) ; mais le siècle à venir sera l'été : les justes seront alors reconnaissables à leurs fruits, tandis que les méchants et les païens resteront du bois mort, destiné au feu (quatrième Sim.).
La cinquième Similitude est le passage le plus important du livre au point de vue dogmatique : c'est là en effet qu'Hermas expose, très confusément d'ailleurs, ses idées sur la Trinité, l'Incarnation et la Rédemption. Cette Similitude, assez dépourvue d'unité, a pourtant un noyau central : la parabole du vignoble et de l'esclave fidèle, à laquelle se rattachent tant, bien que mal quatre questions différentes : le jeûne, les œuvres surérogatoires, la christologie et l'importance de la pureté de la chair.
La sixième et la septième Similitudes traitent toutes deux de l'expiation, qui est l'une des trois conditions mises par Dieu au pardon du péché. Cette expiation doit être à la fois active et passive, c'est-à-dire que le pécheur, non content de subir avec patience et soumission les peines que Dieu lui envoie, doit encore se punir lui-même, en pratiquant la mortification volontaire.
La sixième Similitude nous montre l'ange de la volupté et de l'imposture sous les traits d'un jeune et séduisant berger, et l'ange du châtiment sous ceux d'un pâtre farouche. Ce dernier reçoit les brebis que le premier a conduites non à la mort, mais à la corruption, c'est-à-dire les pécheurs encore susceptibles de conversion, et, pour les faire rentrer en eux-mêmes, il les afflige de toutes sortes de tourments, qui ne sont autre chose que les différentes épreuves de la vie.
Dans la septième Similitude, nous voyons Hermas prier le Pasteur d'éloigner de lui l'ange du châtiment : les tribulations dont il est accablé lui paraissent disproportionnées aux fautes qu'il a commises. « Tes épreuves ne viennent pas tant de tes propres péchés que de ceux de ta maison, » lui répond le Pasteur. Un peu de patience ! car l'expiation, spontanée ou subie, est la condition préliminaire et nécessaire du pardon. D'ailleurs, qu'Hermas et sa maison persévèrent dans la justice, et ils seront bientôt délivrés de toutes leurs épreuves.
La huitième Similitude nous présente la parabole du saule. Cet arbre est vivace entre tous, si bien que ses rameaux, une fois coupés et plantés en terre, prennent racine avec une rapidité extraordinaire : c'est l'image de la faculté qu'a le Chrétien pécheur de puiser dans la pénitence une vie nouvelle. La possibilité, la facilité même de la pénitence, voilà ce que l'auteur entend mettre ici en pleine lumière.
Au point de vue historique, cette huitième Similitude est, avec la troisième Vision et la neuvième Similitude, le passage le plus intéressant du livre : Hermas y range les Chrétiens, suivant leur état moral, en treize catégories distinctes et passe successivement en revue chacun de ces groupes. C'est de cette Similitude surtout qu'on peut dire, avec Mgr Duchesne, qu'elle est « un vaste examen de conscience l'Église romaine ».
A remarquer, dans cette Similitude, un fait assez nouveau : le Pasteur n'y parle plus seulement de la pénitence au futur, mais aussi au passé. Il ne s'y contente plus, comme dans les parties précédentes, d'exhorter les fidèles à se convertir : il décrit encore les effets produits dans la communauté chrétienne par la mission pénitentielle d'Hermas, comme si cette mission avait déjà eu lieu. Mais ces descriptions ont-elles un caractère historique ou prophétique ? L'auteur expose-t-il des faits réellement accomplis ou escompte-t-il simplement l'avenir ? C'est là un problème malaisé à résoudre (cf. 3Vis.11 ; 12 ; 13).
La neuvième Similitude se présente comme une récapitulation générale des Préceptes et des Similitudes et surtout comme une nouvelle édition, revue et corrigée, de la troisième Vision : le Pasteur s'y propose de donner à Hermas une connaissance plus approfondie et plus précise de tout ce qu'il a vu ou entendu jusque-là. Comme la troisième Vision, la neuvième Similitude a pour sujet principal la construction d'une tour. Cette tour est la figure de l'Église ; elle s'élève sur un rocher et une porte qui lui servent de hase et qui par là symbolisent le fils de Dieu, fondement de l'Église. Les pierres destinées à la construction sont tirées les unes du fond de l'eau, les autres de douze montagnes, les autres enfin d'une grande plaine. Dans la troisième Vision, les bonnes pierres seules étaient admises dans les murs de la tour ; ici, au contraire, il entre tout d'abord dans la construction des pierres de toute qualité, des mauvaises comme des bonnes. Mais le maître de la tour, le Fils de Dieu, vient faire un examen minutieux de la bâtisse : toutes les pierres trouvées défectueuses sont, sur son ordre, arrachées des murs et confiées au Pasteur, à l'ange de la pénitence, pour être soumises à une nouvelle taille : celles-là seules dont le Pasteur parvient à corriger les défauts sont réintégrées dans la bâtisse ; les autres, sont définitivement rejetées. Cette nouvelle taille est la figure de la mission pénitentielle confiée au Pasteur et à Hermas.
Notons qu'ici, comme dans la huitième Similitude, cette mission semble parfois présentée comme un fait déjà accompli ou au moins en cours d'exécution.
Dans la troisième Vision, la tour, uniquement bâtie de bonnes pierres, symbolisait l'Église idéale, exclusivement composée de saints ; ici, elle figure tout d'abord l'Église réelle, mélange de justes et de pécheurs. Mais, après la sévère inspection du Fils de Dieu et le travail du Pasteur, c'est-à-dire après l'accomplissement de la mission d'Hermas, l'Église, purifiée et renouvelée par la pénitence, ne contient plus que des saints, tout comme dans la troisième Vision.
La troisième Vision et la neuvième Similitude ne s'opposent donc pas entre elles comme si celle-là s'adressait exclusivement ou presque exclusivement aux catéchumènes et celle-ci aux Chrétiens pécheurs : ce qu'Hermas a toujours en vue, dans la troisième Vision aussi bien que dans la neuvième Similitude, ce n'est pas le recrutement de l'Église, auquel d'ailleurs il n'est pas insensible, mais bien sa purification par la pénitence, objet propre de l'ouvrage entier. Nulle part il ne s'occupe de la pénitence antébaptismale ; la pénitence qu'il prêche, c'est toujours et partout la pénitence post-baptismale. Seulement le symbolisme de la troisième vision est assez gauche et maladroit ; dans la neuvième Similitude. Hermas l'a corrigé, pour l'adapter plus exactement à la réalité des faits et le rendre ainsi plus transparent et plus saisissant.
Dans la dixième et dernière Similitude, ce n'est plus l'Église, ni le Pasteur, mais un personnage bien autrement important, le Fils de Dieu lui-même, qui vient adresser à Hermas et à toute la communauté chrétienne les exhortations et recommandations finales.
A première vue, le Pasteur semble un livre très simple et très clair. Mais, dès qu'on veut l'approfondir tant soit peu, on sent surgir de toutes parts des difficultés, et cet ouvrage, si lucide en apparence, se transforme bientôt en une longue série d'énigmes.
Quel est cet Hermas qui se donne comme l'auteur du Pasteur ? Dans quel pays et à quelle époque a-t-il vécu ? Le Pasteur est-il sorti tout entier de sa plume, ou bien n'est-il qu'une compilation de plusieurs ouvrages dus à des écrivains différents ? Si Hermas est l'auteur unique du Pasteur, l'a-t-il composé d'un seul jet ou par tranches successives ? Le Pasteur est-il antidaté ? Est-ce une œuvre sincère et pour ainsi dire historique, que nous puissions et devions prendre à peu près à la lettre, ou bien une œuvre artificielle, dans laquelle tout, jusqu'aux détails autobiographiques, ne serait qu'allégorie pure ?
Ces questions qui, si diverses qu'elles paraissent, sont cependant toutes solidaires les unes des autres, ont reçu, dans les temps modernes comme dans l'antiquité, les réponses les plus contradictoires. Si énigmatique est ce livre bizarre, que les problèmes qu'il soulève ne sont pas, pour la plupart, susceptibles d'une solution définitive et catégorique. Nous devrons donc souvent nous contenter de la vraisemblance.
Lieu. — D'après Nirschl (Lehrbuch der Patrologie, I, 1881), Hermas aurait été évêque de Cumes, en Campanie, et c'est là qu'il aurait composé son livre. H. Lisco (Roma peregrina, Berolini, 1901) prétend que la Rome dont il est question dans le Pasteur n'est pas la capitale de l'empire romain, mais un quartier ou faubourg de la ville d'Éphèse, en Asie, qui aurait porté, lui aussi, le nom de Rome. C'est dans cette Rome asiatique qu'auraient vécu et écrit, non seulement Hermas, mais encore Clément, l'auteur de l'Épître aux Corinthiens ; c'est également là qu'Ignace d'Antioche aurait souffert le martyre.
Est-il besoin de dire que ces deux opinions, surtout celle de Lisco, sont de simples fantaisies, que personne n'a jamais prises au sérieux ? C'est bien dans la Rome d'Italie, dans la grande Rome, que le Pasteur a été composé, comme il ressort avec évidence et du livre lui-même, et des documents romains les plus anciens, tels que le Canon de Muratori, et du témoignage constant de la tradition. Sur ce premier point, pas de doute possible.
Date. — Quel est cet Hermas et à quelle époque a-t-il vécu ?
Témoignages externes. — Le traducteur éthiopien (ou peut-être le scribe qui a copié le manuscrit) identifie Hermas à S. Paul lui-même. Nous lisons en effet dans l'appendice de la version éthiopienne : « Ici finissent les Visions, Préceptes et Similitudes du prophète Hermas, qui n'est autre que Paul. » Inutile d'insister sur la candide ignorance que suppose une telle assertion.
Sur la question qui nous occupe, nous sommes en présence de trois hypothèses sérieuses ; dans la première, Hermas serait un disciple de S. Paul et un contemporain des Apôtres ; dans la deuxième, il serait le frère de Pie Ier, qui occupa le siège épiscopal de Rome entre les années 140 et 154 environ ; dans la troisième, il ne serait ni le disciple de S. Paul, ni le frère de Pie, mais un autre Hermas contemporain de Clément Romain (vers la fin du ier siècle).
La première hypothèse a pour père Origène. Parlant de Hermas que S. Paul salue à la fin de son Épître aux Romains (Rom.16.14) : « Je pense, dit-il, que c'est cet Hermas qui est l'auteur du livre intitulé le Pasteur » (Commentaires sur l'Épître aux Romains, l. 10, 31, PG de Migne, 14. col. 1282). Telle semble avoir été, dès avant Origène, l'opinion d'Irénée et de Clément d'Alexandrie ; seulement, à la différence d'Origène, ils ne l'expriment nulle part en termes formels. Elle fut adoptée par tous les Orientaux, et S. Jérôme lui-même paraît bien la partager (De viris illustribus, ch. 10, PL de Migne. 23, col. 625-626). Dans les temps modernes, elle a régné, presque sans conteste, jusqu'à la découverte du Canon de Muratori, c'est-à-dire jusqu'au milieu du xviiie siècle. Par contre elle n'a plus maintenant que de très rares défenseurs.
La deuxième hypothèse, qui fait d'Hermas le frère de Pie Ier (vers 140-154), s'appuie, comme nous allons le voir bientôt, sur les traditions romaines les plus anciennes et les plus autorisées, représentées ici par le Canon de Muratori et le Catalogue Libérien. C'est l'opinion la plus vraisemblable et la plus communément admise aujourd'hui. Dès 1755, c'est-à-dire presque aussitôt après la découverte du Canon de Muratori, elle fut mise en avant par Mosheim (Institut, hist. eccles., 1755, p. 51), et depuis lors elle a été successivement adoptée par la plupart des savants modernes, tels que Héfélé, Lipsius, Heyne, Behm, Harnack, Funk, Brüll, Renan, Duchesne, Batiffol, Weinel, Bardenhewer, etc..
Dans la troisième hypothèse, l'auteur du Pasteur serait un contemporain de Clément de Rome, de Domitien, de Nerva, et aurait composé son livre entre 96 et 100. Proposée par Gaab (Der Hirte des Hermas, 1866), cette hypothèse a été reprise et développée par Th. Zahn (Der Hirt des Hermas, 1868) et adoptée par Peters, Mayer, Caspari, Nirschl et quelques autres. Chez plusieurs auteurs, par exemple chez Nirschl, elle se combine avec la première : ce serait Hermas salué par S. Paul qui aurait écrit le Pasteur sous les règnes de Domitien et de Nerva ou au plus tard dans les premières années de Trajan.
Inutile de réfuter la première hypothèse, qui ne compte plus guère aujourd'hui de partisans ; d'ailleurs les arguments que nous ferons valoir contre la troisième portent avec encore plus de force contre la première.
Nous regardons donc comme très probable, sinon comme absolument certain, qu'Hermas est le frère ou au moins le contemporain de Pie, et que le Pasteur date, non de l'époque de Domitien et de Nerva, mais de celle d'Adrien et d'Antonin.
Cette opinion a d'abord pour elle l'autorité de la vieille tradition romaine représentée, comme nous l'avons déjà dit, par le Canon de Muratori et le Catalogue Libérien.
Dans le Canon de Muratori, fragment d'un ouvrage qui semble avoir été composé à Rome ou dans les environs entre les années 180 et 300, nous lisons, autant que le mauvais état du texte le permet, les paroles suivantes : « Quant au Pasteur, il a été écrit tout récemment, de « notre temps, dans la ville de Rome, par Hermas, pendant que Pie, son frère, occupait comme évêque le siège de l'Église de la ville de Rome ; et, pour cette raison, il faut à la vérité le lire, mais il ne peut pas en être fait lecture publique au peuple dans l'église, ni parmi les [œuvres des] prophètes, [car] leur nombre est complet, ni parmi [celles des] Apôtres, à la fin des temps. »
De son côté, le Catalogue Libérien dit à propos de Pie Ier : « Sous son pontificat, son frère Ermès (Hermas) écrivit un livre dans lequel sont contenus les préceptes que lui donna un ange, venu à lui en costume de Pasteur. » (Duchesne, Liber Pontificalis, t. I, p. 4). Sans doute le Catalogue Libérien est très postérieur à Pie, puisqu'il n'a été rédigé qu'au milieu du ive siècle (vers 354) : mais, selon toute vraisemblance, l'auteur de ce Catalogue a puisé ses renseignements dans la Chronique d'Hippolyte, document romain de la première moitié du iiie siècle, et Hippolyte lui-même a probablement tiré les siens d'une vieille liste des évêques de Rome remontant à l'année 170 environ, c'est-à-dire à quinze ou seize ans seulement après la mort de Pie.
Du Catalogue Libérien, ces données historiques sur la parenté de Pie et d'Hermas ont passé dans le poème contre Marcion (seconde moitié du ive siècle), dans le Liber Pontificalis (commencement du vie siècle) et dans les Décrétales de Pseudo-Isidore (Adversus Marcionem, l. III, ch. 9, PL 2, col. 1078 ; Duchesne, Liber Pontificalis, t. I, p. 58 et 132 ; Hinschius, Décrétales Pseudo-Isidori, 1863, p. 116). Evidemment ces trois derniers ouvrages, qui se copient les uns les autres, sont trop tardifs pour constituer par eux-mêmes une preuve solide. Mais il nous reste deux documents sérieux et vraiment probants : le Catalogue Libérien en tant qu'il se rattache a Hippolyte, et surtout le Canon de Muratori.
Comme nous l'avons vu, c'est certainement à Rome qu'Hermas a vécu et a rédigé son livre. Tout renseignement venant de Rome a donc déjà, de par son origine même, une valeur exceptionnelle.
Or le Canon de Muratori a été composé à Rome ou dans les environs immédiats vers 180-200, par conséquent de 25 à 45 ans seulement après la mort de Pie, arrivée vers 154. A si peu d'intervalle, les Romains devaient encore être exactement renseignés sur des hommes qui, comme Pie et Hermas, avaient joué dans leur Église des rôles si importants, l'un comme évêque, l'autre comme prophète et auteur d'un livre célèbre. Le Pasteur, en effet, n'était pas alors un ouvrage obscur et indifférent, mais discuté et controversé : les uns le tenaient en si haute estime qu'ils le mettaient au nombre des Écritures inspirées, tandis que les autres lui refusaient l'entrée du Canon. L'auteur du fragment de Muratori partage l'avis de ces derniers. Mais, qu'on le remarque bien, ce n'est pas pour des raisons tirées du contenu même du livre qu'il en interdit la lecture publique ; il le juge au contraire un ouvrage si utile, qu'il en recommande vivement la lecture privée : « Il faut (oportet) le lire, » dit-il ; l'unique motif qu'il allègue pour l'exclure du Nouveau Testament, c'est que, venu trop tard, « à la fin des temps, » il était trop moderne pour prendre rang parmi les œuvres prophétiques ou apostoliques. Quand donc un Romain, comme l'auteur du Canon de Muratori, vient nous dire que le Pasteur a été composé tout récemment, de son temps même, par le frère de Pie, il est difficile de ne pas ajouter foi à une assertion si nette et si catégorique.
Quant à Hippolyte, c'était également un Romain, un membre très distingué du clergé de la grande ville. Autant que nous en pouvons juger par son vaste ouvrage des Philosophumena, c'était un érudit et un curieux du passé. Postérieur d'un siècle seulement à Pie et à Hermas, il fut à même de recueillir, sur ces deux hommes si marquants, des traditions relativement encore fraîches. Rappelons en outre que lui-même semble avoir puisé ses renseignements dans un document plus ancien, remontant à l'année 170 environ, c'est-à-dire presque à l'époque de Pie (Harnack, Chronologie, I, p. 191-192). Si donc, comme c'est très vraisemblable, le (Catalogue Libérien ne fait que reproduire, sur le point qui nous occupe, le texte de la Chronique d'Hippolyte, il constitue une confirmation sérieuse des données historiques que nous avons déjà trouvées dans le Canon de Muratori.
Raisons internes. — Non moins impérieusement que ces témoignages externes si autorisés, plusieurs raisons d'ordre interne nous obligent à fixer à l'époque des Antonins la date de composition du Pasteur. Ces raisons internes sont surtout la nature des persécutions dont il est question dans l'ouvrage, l'état de l'Église romaine au moment où il a été écrit et les allusions que nous y trouvons au gnosticisme naissant.
Au moment où Hermas conçoit le projet d'écrire son livre, l'Église romaine sort d'une persécution assez violente, mais semble jouir, dans le présent, d'une accalmie relative. Seulement Hermas prévoit, pour un très prochain avenir, une nouvelle crise, bien plus redoutable que la précédente : ce sera « la grande tribulation, » la tribulation suprême, aurore sanglante du jour radieux qui verra le retour triomphal du Christ et l'établissement définitif du règne de Dieu (2Vis.2.7 ; 3.4 ; 4Vis. en entier).
Dans la persécution passée, les fidèles, traduits devant les magistrats, ont été interrogés sur leur qualité de chrétiens et mis en demeure d'y renoncer, de blasphémer le Christ et de sacrifier aux idoles (9Sim.28 en entier, mais surtout ch. 4 ; voir aussi 9Sim.21,3). Un trop grand nombre, cédant à la peur ou aux tourments, ont lâchement apostasié ; quelques-uns même ont poussé l'infamie jusqu'à trahir leurs frères, en les dénonçant à la police (2Vis.2.2 ; 9Sim.19.1). Tous ces apostats ont été acquittés ; il leur a suffi de renier le Christ pour recouvrer la liberté : c'est ce qui ressort nettement de tous les passages où il est question de persécution. Ceux au contraire qui ont eu le courage de persévérer dans la profession du christianisme ont été frappés de différentes peines : la prison, le fouet, la croix, les bêtes féroces (3Vis.2.1). Les uns ont souffert jusqu'à la mort, d'autres ont survécu à leurs épreuves (8sim.3.6-7) ; quelques-uns, comme Hermas, paraissent n'avoir été atteints que dans leur fortune. Voilà pour la persécution passée.
Quant à « la grande tribulation » qu'Hermas, au début de son livre, entrevoyait comme très prochaine, elle semble n'avoir pas eu lieu : lorsque, quelques années après, il rédige les Préceptes et les Similitudes, il n'y fait plus la moindre allusion. Sans doute il parle encore de poursuites devant les tribunaux, de martyres, d'apostasies ; mais ces faits sont absolument identiques à ceux qu'il a signalés dans les visions et paraissent bien se rapporter, au moins ordinairement, à la même persécution antérieure. Seulement, si la seconde partie du Pasteur ne nous présente plus comme imminente cette tribulation extraordinaire, par contre elle nous donne l'impression très nette d'une hostilité plus ou moins sourde, mais irréductible et permanente, entre l'Empire et l'église. Qu'on lise en particulier la première Similitude : l'on y verra que le fidèle n'est en ce monde qu'un étranger domicilié en pays ennemi, toujours sous le coup d'une expulsion possible. Pour Hermas comme pour Tertullien, le Chrétien n'a pas de lendemain : une perpétuelle insécurité, l'attente journalière du martyre, telle est désormais sa vie normale.
Ce tableau des persécutions dans le Pasteur, à quelle période de l'histoire romaine correspond-il ? Assurément pas au règne de Domitien. Ce qu'on appelle « la persécution de Domitien » a été avant tout une inquisition fiscale, dirigée essentiellement contre ceux des Juifs qui cherchaient à se soustraire à l'impôt de capitation (Suétone, Domitien, 12). Le fisc ayant étendu ses prétentions, non seulement aux Juifs de race, mais aussi aux simples judaïsants, il est probable, certain même, que des Chrétiens ont été impliqués dans ces poursuites. Mais, si ces tracasseries ont abouti à des amendes, à des confiscations, à la prison peut-être, nous n'avons aucune raison de croire qu'elles soient allées jusqu'aux supplices.
Nous savons également que Domitien fit disparaître, sous divers prétextes, mais en particulier sous celui d'athéisme, un certain nombre de personnes qui le gênaient. Quelques Chrétiens ont encore pu être victimes de ces exécutions arbitraires. Mais les cruautés de Domitien n'ont guère atteint que des personnages importants, comme le consul Flavius Clemens. La masse chrétienne principalement composée de petites gens, était, par son humilité même, à l'abri des rancunes impériales et ne paraît pas en avoir souffert.
Des tracasseries purement fiscales, quelques exécutions, nécessairement exceptionnelles, de grands personnages, voilà tout ce que nous trouvons au temps de Domitien. Il n'existe pas encore d'hostilité systématique entre l'État et l'Église, autant que nous en pouvons juger par l'Épître deClémentaux Corinthiens.
Dans le Pasteur, au contraire, les supplices sont chose courante ; d'ailleurs, nulle trace d'inquisitions fiscales ni de poursuites pour attaches au judaïsme ; ce qui est proscrit, c'est la profession du christianisme, et cela seulement. Le Chrétien est maintenant hors la loi et considère l'État comme un ennemi naturel (première Sim.). Sans doute Hermas n'est pas encore l'anarchiste que sera plus tard Tertullien, mais il n'est plus le patriote que fut Clément Romain. Impossible que l'Épître aux Corinthiens et le Pasteur aient été écrits sous le même règne !
Mais, entre le Pasteur, d'une part, et la correspondance de Pline et de Trajan, de l'autre, la ressemblance est frappante, absolue : on dirait les deux documents calqués l'un sur l'autre (9Sim.28 ; Lettres de Pline, X, 96-98). Au temps de Trajan, la qualité de Chrétien constitue par elle-même un crime punissable de mort. Sans doute, par politique et esprit de modération, l'empereur ordonne aux magistrats de fermer les yeux le plus possible et de faire grâce à tous les apostats. Mais n'empêche que la loi est la loi et que tout Chrétien, régulièrement déféré comme tel aux tribunaux, doit être mis à mort s'il ne sacrifie aux dieux. Le fidèle est à la merci du premier dénonciateur venu. De cette contradiction flagrante entre l'intolérance de la loi et la tolérance du gouvernement, résulte non pas encore la guerre d'extermination qui éclatera plus tard sous Dèce et Dioclétien, mais la persécution à l'état de fièvre lente et de menace perpétuellement suspendue sur la tête du Chrétien. Et ce régime de crises intermittentes et d'insécurité permanente sera celui de l'Église pendant toute la période Antonine (98-180). La procédure suivie contre Polycarpe, en 155, est encore exactement celle qui, quarante-trois ans auparavant, avait été recommandée par Trajan (Martyre de Polycarpe,vii-xii, trad. Lelong. p. 139-147).
Ce système de persécution est, point pour point, celui que nous avons déjà trouvé dans le Pasteur (1Sim en entier 9Sim.28). Ici, comme dans les Lettres de Pline et dans le Martyre de Polycarpe, c'est uniquement pour le nom qu'ils portent, pour « le nom du Fils de Dieu, » que les martyrs souffrent. On a souvent remarqué, non sans étonnement, que les mots de Chrétien, Christianisme, Christ, Jésus ne se rencontrent jamais sous la plume d'Hermas. Il les évite avec le plus grand soin, même dans les passages où leur emploi serait tout indiqué, comme dans 9Sim.28. Cette abstention bizarre et systématique ne tiendrait-elle pas au danger que ces mots pouvaient présenter au point de vue de la légalité, dans un temps où un nom suffisait pour conduire à la mort ? Ne serait-ce pas une précaution de l'auteur pour ne pas attirer sur son livre et sur sa personne l'attention des malintentionnés ?
Les persécutions dont parle Hermas se rapportent donc à l'époque des Antonins : ce point est de toute évidence. Mais à quel moment précis de cette longue période, qui va de 98 à 180 ? C'est ce qu'il est plus difficile de déterminer.
En 112, quand Pline écrit à Trajan, la mystérieuse loi qui fait du nom de Chrétien un crime capital est déjà portée. Il y a des procès pour cause de christianisme (cognitiones de christianis) : Pline en a entendu parler ; seulement ce devait être un fait assez récent, puisque, dans sa carrière déjà longue d'avocat et de magistrat, il n'avait jamais eu l'occasion d'y assister. Cette loi date donc des premières années du règne de Trajan, ou, si elle est plus ancienne, c'est seulement sous Trajan qu'on l'a remise en vigueur et qu'on a songé sérieusement à l'appliquer. Il S'ensuit que les persécutions dont parle Hermas pourraient, à la rigueur, se rapporter à celle époque (entre 98 et 112). Mais, à en juger par l'ignorance de Pline, les procès contre les Chrétiens, pendant cette période, ont dû être assez, rares ; de plus, nous ne trouvons guère trace de persécutions à Rome au commencement du iie siècle. Ces données ne conviennent donc pas à la violence relative de la persécution dont Hermas a été témoin, et force nous est de chercher une date postérieure. Or nous savons que Télesphore, compté parmi les évêques de Rome, a souffert le martyre sous Adrien, vers 136 : peut-être la persécution dont il est question dans le Pasteur est-elle celle dont Télesphore fut victime. Mais ce n'est là qu'une pure hypothèse.
Concluons : le tableau des persécutions dans le Pasteur ne s'applique en aucune façon au temps de Domitien, mais convient au contraire parfaitement à l'époque des Antonins (98-180) et plutôt au milieu qu'au commencement de cette période. Nous placerions donc volontiers ces persécutions entre 130 et 140.
Non moins clairement que la nature des persécutions, l'état général de l'Église romaine, tel qu'il est dépeint dans le Pasteur, nous reporte au milieu du iie siècle bien plutôt qu'à la fin du ier.
Dans la Vision III et les Similitudes VIII et IX, Hermas soumet l'Église romaine à une sorte d'analyse et passe successivement en revue les divers éléments qu'elle renferme. De ce minutieux examen, il ressort jusqu'à l'évidence qu'elle n'est plus, à cette époque, l'une de ces petites communautés naissantes, composées de quelques dizaines de fidèles : c'est une très nombreuse et très importante chrétienté. Elle comprend des gens de toute sorte, appartenant aux classes les plus différentes de la société : on n'y trouve pas seulement des pauvres, des ouvriers, mais aussi des riches, des hommes d'affaires, des mondains qui ont su gagner la considération des Gentils et partagent malheureusement leur genre de vie (8Sim.9). C'est, à peu de chose près, la composition d'une grande Église d'aujourd'hui. Un tel accroissement et une si extrême complexité ne supposent-ils pas un passé déjà long ? Or, en 90 ou 100, l'Église romaine ne comptait encore, tout au plus, que cinquante à soixante ans d'existence : est-ce vraiment assez pour expliquer le développement considérable que nous lui voyons dans le Pasteur ?
De plus, l'Église romaine n'est déjà plus, à proprement parler, une société de saints. Évidemment la majorité est encore formée d'excellents Chrétiens qui ont gardé intact le sceau de leur baptême (8Sim.1.16 ; 3.8) ; au-dessus d'eux, des confesseurs de la foi et des martyrs font à cette Église une auréole glorieuse. Mais il y a aussi bien des misères : des diacres, administrateurs des biens de l'Église, n'ont pas eu honte de s'enrichir aux dépens des veuves et des orphelins (9Sim.26.2) ; sans parler des apostats, qui ne sont sans doute qu'une exception, on compte un grand nombre de tièdes, d'indifférents, d'indécis (δίψυχοι). Cette peinture affligeante et qui, vu la modération habituelle d'Hermas, n'est sans doute pas exagérée, nous donne l'impression d'une chrétienté déjà vieille (3Vis.11-13) plutôt que d'une jeune communauté, encore dans tout le feu de la ferveur primitive. Ce relâchement s'explique mieux à une époque tardive, quand les foules, commençant à entrer dans l'Église, en abaissent par là même le niveau moral.
Enfin, à l'époque d'Hermas, la discorde règne entre les chefs de l'Église romaine, et cela à l'état permanent : car il est question de ces rivalités à la fois dans la première et dans la seconde partie du Pasteur (3Vis.3.7-9 ; 8Sim.7.4-6). Il y a lutte pour la première chaire (πρωτοκαθεδρία), pour le rang suprême (περὶ πρωτείων) et pour un certain honneur (περὶ δόξης τινός), évidemment l'épiscopat. Bref, il se passe à Rome, au temps d'Hermas, ce qui se passait à Corinthe au temps de Clément. Or ce trait ne convient pas du tout à l'Église romaine de la fin du ier siècle : car, à en juger par l'Épître de Clémentaux Corinthiens, la concorde la plus parfaite semble avoir régné alors entre les chefs de cette Église ; il s'applique au contraire fort bien à l'époque d'Hygin et de Pie (136-154).
En résumé, le développement considérable de l'Église romaine, le relâchement assez grand qui s'y est introduit, supposent une époque plus tardive que la fin du ier siècle ; et les divisions qui troublent cette Église nous font naturellement penser à la période vraisemblablement agitée qui a précédé Anicet, c'est-à-dire précisément aux temps d'Hygin et de Pie,
Hermas ne prononce jamais le mot de gnostiques, mais il fait au gnosticisme plusieurs allusions très claires. Ainsi, dans 5Sim.7.2