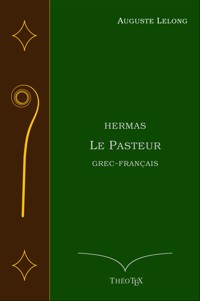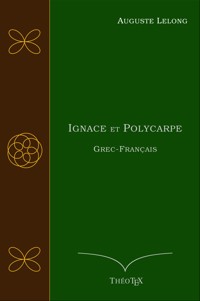
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Depuis Jean Daillé les protestants auraient bien aimé pouvoir rappeler le martyre de Polycarpe de Smyrne, sans avoir à mentionner celui d'Ignace d'Antioche : ils admirent le premier pour la fermeté de sa foi sur le bûcher, et n'ont guère de sympathie pour le second, à cause d'une étrange obsession pour l'épiscopat dont ses fameuses lettres sont remplies. Cependant il n'est guère possible de raconter séparément l'histoire de ces deux héros chrétiens morts au deuxième siècle de notre ère. En route pour son supplice dans l'arène de Rome, vers 110, Ignace écrit une lettre d'exhortation et d'adieu à Polycarpe. Polycarpe, de son côté, dans une épître aux Philippiens, leur signale qu'il possède la collection des lettres d'Ignace ; il serait donc difficile d'admettre l'historicité de l'un des deux martyrs et de rejeter celle de l'autre. C'est cependant bien à tort que les catholiques romains utilisent les lettres d'Ignace pour justifier leur hiérarchie pyramidale. Si Ignace demande sans cesse que l'on obéisse à l'évêque, c'est justement parce que l'autorité épiscopale n'était pas encore bien établie au moment où il écrivait, et qu'il redoutait une invasion des hérésies dans l'Église ; pour sa part, Polycarpe ne parle jamais de l'évêque. D'un aveu général la traduction d'Auguste Lelong, à partir du grec d'Ignace, souvent elliptique et obscur, reste la meilleure que nous possédions en français. Ajoutons que son Introduction et ses notes perspicaces sont aussi précieuses pour saisir la psychologie de ces deux personnages si différents. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1932.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322486090
Auteur Auguste Lelong. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]La question de l'authenticité des lettres d'Ignace d'Antioche n'a jamais été bien sereine à cause des arrières-pensées ecclésiologiques qu'elles suscitent : leurs mentions incessantes de l'autorité supérieure de l'évêque semblent donner raison aux catholiques contre les protestants quant à l'existence d'un système épiscopal institué par les apôtres. Aussi dès Calvin les réformés rejetaient les lettres d'Ignace tandis qu'ils gardaient leur considération pour l'épître de Polycarpe aux Philippiens, qui ne mentionne jamais d'évêque, et pour le récit de son martyre. Ce n'est qu'au xixe siècle qu'apparaît un revirement d'opinion chez les théologiens protestants au sujet d'Ignace, principalement grâce au travail de Joseph Barber Lightfoot (1828-1879). William Dool Killen (1806-1902), son plus virulent adversaire, maintint par contre la thèse de l'inauthenticité des lettres d'Ignace, toutes écrites selon lui vers 220 par Callixtus, évêque de Rome, dans le but d'asseoir la conception d'un épiscopat monarchique. Bien que le consensus des exégètes se soit mis petit à petit à converger vers la reconnaissance de la recension moyenne des lettres ignatiennes (c-à-d les sept présentes dans ce volume), au xxe siècle, leur authenticité est encore contestée ; Robert Joly (1922-2011) notamment, situe leur rédaction vers 165, à Smyrne.
Prendre connaissance de tous les arguments externes, pour ou contre l'authenticité, demanderait un investissement extrême de temps, sans rapport avec le peu de certitude que l'on en retirerait. En revanche les arguments internes, portant sur la psychologie de l'écrivain paraissent très convaincants en faveur de l'authenticité des lettres. Le caractère maladif de l'obsession d'Ignace pour l'autorité de l'évêque, ainsi que pour le martyre, frappe au premier coup d'œil, et on imagine mal qu'un faussaire eût l'idée d'inventer un tel personnage, dont les injonctions ad nauseam de « ne rien faire sans l'évêque » décourageraient plutôt les lecteurs d'entrer dans ses vues. Mieux, ce comportement voisin de la paranoïa, s'observe assez couramment dans nos temps modernes, en plein milieu évangélique, dans de petites églises sectaires où le leader occupe une position d'autorité absolue. Qu'il suffise de remplacer le mot évêque par celui de pasteur, et on y retrouvera les objurgations d'Ignace dans toute leur violence : nous avons personnellement connu une assemblée où l'on ne pouvait déplacer un porte-manteaux sans l'avis du pasteur !
De la sincérité et de la spontanéité de ses paroles, de la teneur de sa doctrine, nous pouvons être assurés qu'Ignace d'Antioche était un vrai chrétien, quoiqu'un chrétien psychiquement déséquilibré ; beaucoup d'autres mystiques l'ont été, et cette faiblesse personnelle, une fois reconnue, n'enlève rien à l'intérêt que présente son testament unique et touchant, pour la connaissance des débuts du christianisme.
Les Actes du Martyre de S. Ignace, qui se présentent à nous sous deux formes, Actes de Rome et Actes d'Antioche sont purement légendaires et sans aucune valeur historique. Nous sommes donc réduits, pour tous renseignements authentiques sur la vie et la mort du célèbre martyr, à ses propres épîtres et à celle de S. Polycarpe aux Philippiens.
De son origine, de son éducation, de son épiscopat, nous ne savons absolument rien. Était-il de condition servile ? Il semble le dire dans l'épître aux Romains, 4.3 ; mais ce n'est pas certain, ses expressions devant sans doute être prises au sens métaphorique. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas citoyen romain : sinon, il n'eût pas été condamné aux bêtes.
Il portait deux noms : un nom latin, Egnatius ou Ignatius, et un nom grec, Θεοφόρος. On a longuement disserté sur l'origine et la portée de cette dernière appellation. En fait, Théophore n'est pas autre chose qu'un simple nom propre ajouté au premier, selon un usage courant dont nous avons maints exemples (cf. Σαῦλος, ὁ καὶ Παῦλος).
De quelques expressions tirées de ses épîtres, on peut conclure avec une certaine vraisemblance qu'il n'était pas né chrétien, et qu'il ne s'était converti qu'à un âge plus ou moins avancé. Quelque chose de violent, d'anormal et de tardif semble avoir présidé à sa naissance spirituelle : c'est ainsi que, comme S. Paul, il s'appelle lui-même un ἔκτρωμα, un avorton (Rom.9.2), et qu'il met une bizarre insistance à se déclarer le dernier des chrétiens d'Antioche, indigne d'appartenir à cette église (Rom.9.2 ; Éph.21.2 ; Trall.13.1 ; Smyrn.11.1).
Les plus anciennes traditions représentent Ignace comme le deuxième successeur de S. Pierre sur le siège d'Antioche. Il y remplaça Évodius on ne sait en quelle année (Eusèbe, H. E., III, ch. 23). Comme la date de sa naissance est totalement inconnue, on ignore à quel âge il mourut martyr. La date même de sa mort ne peut être fixée avec précision ; on ne risque cependant pas de se tromper beaucoup en la plaçant aux environs de 110.
Une persécution, dont nous ignorons la cause et les circonstances, vint s'abattre sur l'église d'Antioche. Elle semble n'avoir été ni très violente, ni de longue durée ; elle était déjà terminée quand Ignace arriva à Troas. Peut-être même l'évêque en fut-il la seule victime ; en tout cas il est remarquable que, dans ses épîtres, il ne fasse jamais la moindre allusion à d'autres martyrs.
Ce qui est certain, c'est qu'Ignace, en quittant la Syrie, était déjà condamné aux bêtes, et qu'il n'allait pas à Rome en appel devant le tribunal de l'empereur, comme autrefois S. Paul, mais pour y subir sa peine. Il était confié à la garde de dix soldats, qu'il qualifie de léopards à cause de leur brutalité (Rom.5.1). Ce détachement était sans doute chargé de recueillir en route les divers condamnés qui devaient être dirigés sur Rome ; car, à son arrivée à Philippes, Ignace a pour compagnons de voyage d'autres chrétiens envoyés come lui à la capitale pour y souffrir le martyre (Philipp.1.1 ; 9.1 ; 13.2).
De la première partie de son voyage, d'Antioche à Philadelphie, nous ne savons rien, sinon qu'il la fit tantôt par mer et tantôt par terre (Rom.5.1). C'est à Philadelphie, au cœur même de l'Asie, Mineure, que nous le trouvons pour la première fois (Philad.3.1 ; 7.1-2 ; 8.1-2). De là, le convoi dont il faisait partie suivit très probablement la route qui, passant par Sardes, aboutissait à Smyrne. En tout cas, il fit dans cette ville une halte qui paraît avoir été assez longue. Ignace reçut de l'église de Smyrne et de son illustre évêque, S. Polycarpe, l'accueil le plus cordial et le plus empressé. Parmi les Smyrniotes avec lesquels il fut en rapport, il cite une femme, nommée Alcé, qui est sans doute la même qu'Alcé, sœur de Nicète et tante d'Hérode, dont il sera plus tard question dans le Martyre de Polycarpe (Smyrn.13.2 ; Polyc.8.3 ; Martyre.17.2).
Apprenant l'arrivée à Smyrne du saint martyr, les églises voisines d'Éphèse, de Magnésie et de Tralles se firent un devoir et un honneur d'envoyer des délégués le saluer et lui prodiguer leurs consolations.
La députation d'Éphèse fut la plus nombreuse : elle comprenait l'évêque Onésime, le diacre Burrhus, et trois autres délégués dont la qualité n'est pas indiquée, Crocus, Euplus et Fronton.
Magnésie du Méandre envoya son évêque Damas, les deux presbytres Bassus et Apollonius, et le diacre Zotion.
La chrétienté de Tralles, plus éloignée, n'était représentée que par son évêque Polybe.
A Smyrne, Ignace écrivit quatre de ses épîtres : trois sont adressées aux églises dont les délégués étaient venus le consoler, c'est-à-dire aux églises d'Éphèse, de Magnésie et de Tralles, et la quatrième à l'église de Rome. Cette dernière lettre est la seule qui porte une date : elle fut écrite le 24 août (Rom.10.3).
De Smyrne, le convoi se rendit, sans doute par mer, à Alexandria Troas. Le saint martyr fut accompagné jusque-là par Burrhus : ce diacre lui était si utile, qu'Ignace avait prié les Éphésiens de le laisser à sa disposition pondant quelque temps. A Troas, Ignace fut rejoint par Philon, diacre de Cilicie, et par Rhéus Agathopus, diacre, semble-t-il, de l'église d'Antioche : ils lui apportaient l'heureuse nouvelle de la fin de la persécution en Syrie.
De Troas, Ignace écrivit trois lettres adressées à deux églises et à un évêque qu'il avait personnellement visités : aux églises de Philadelphie et de Smyrne, et à l'évêque Polycarpe. A ses recommandations ordinaires sur le dogme et la discipline, s'ajoute maintenant un thème nouveau qui lui est inspiré par son zèle ardent pour sa chère église d'Antioche : il exprime le plus vif désir de voir les diverses églises envoyer en Syrie des délégués ou au moins des lettres pour encourager les chrétiens d'Antioche et les féliciter de la paix enfin recouvrée. Il se disposait à écrire à ce sujet à toutes les églises qu'il connaissait, quand un ordre subit d'embarquement vint traverser son pieux dessein ; il n'eut que le temps d'écrire à Polycarpe, pour lui confier l'exécution de son projet.
De Troas, le convoi se rendit par mer à Néapolis, point de départ de la voie Egnatia qui, passant par Philippes et Thessalonique, traversait toute la Macédoine pour aboutir à Dyrrachium (Durazzo) sur l'Adriatique : c'est évidemment la route qu'on fit suivre aux prisonniers. Leur troupe venait de se grossir de plusieurs autres chrétiens, dirigés sur Rome dans les mêmes conditions qu'Ignace ; les noms de deux d'entre eux, Zosime et Rufus, nous sont connus par l'épître de Polycarpe (9.1). Les chrétiens de Philippes reçurent les martyrs avec la plus touchante charité, et les escortèrent jusqu'à une certaine distance de leur ville ; (Philipp.13.1). Ignace avait engagé les Philippiens à envoyer, eux aussi, une lettre de félicitations aux chrétiens d'Antioche. Les Philippiens écrivirent à Polycarpe pour le prier de faire porter leur lettre en Syrie par son propre messager (Philip.13.1) ; ils lui demandaient en même temps de leur communiquer toutes les épîtres d'Ignace qu'il pouvait avoir en sa possession. Polycarpe les joignit à la lettre qu'il leur écrivit en réponse et que nous possédons encore ; c'est peut-être à cette requête des Philippiens que nous devons la conservation de la correspondance du saint martyr.
Ici, le rideau tombe sur la carrière d'Ignace ; dans le silence de l'histoire, c'est la légende qui va s'emparer de ses derniers jours et composer les Actes de son martyre, ceux de Rome et ceux d'Antioche.
Il n'existe peut-être pas de texte qui ait été plus remanié, plus torturé, que celui des épîtres de S. Ignace : il se présente à nous dans trois collections et sous trois formes différentes :
1oLa petite collection, comprenant seulement, et sous une forme très abrégée, les trois épîtres à Polycarpe, aux Éphésiens, aux Romains. Sous cette forme courte, nous ne possédons les trois lettres susdites que dans une version syriaque découverte par H. Tattam en 1839 et 1842 et publiée pour la première fois par Cureton en 1815 (The ancient Syriac version of the Epistles of S. Ignatius, London, 1845).
2oLa collection moyenne, comprenant, sous une forme déjà plus longue, les trois lettres précédentes et quatre autres, en tout sept : aux Éphésiens, Magnésiens, Tralliens, Romains, Philadelphiens, Smyrniotes et à Polycarpe.
3oLa grande collection, comprenant, sous une forme encore plus allongée, les sept lettres précédentes, avec six autres : lettre de Marie de Cassobola à Ignace, et lettres d'Ignace à Marie de Cassobola, aux Tarsiens, aux Antiochéens, à Héron et aux Philippiens.
Ainsi trois épîtres se présentent à la fois sous les trois formes courte, moyenne et longue : ce sont celles aux Éphésiens, aux Romains et à Polycarpe.
Quatre nous sont parvenues sous les deux formes moyenne et longue : ce sont les épîtres aux Magnésiens, aux Tralliens, aux Philadelphiens et aux Smyrniotes.
Les six autres n'existent que sous la forme longue.
Ces six dernières lettres, de l'aveu de tous les critiques, sont l'œuvre d'un faussaire, semi-arien d'après les uns, apollinariste selon les autres, qui, vers la fin du ive siècle, les a composées dans un intérêt théologique, en les attribuant à S. Ignace pour donner à ses propres doctrines l'appui d'un grand nom. En même temps qu'il fabriquait de toutes pièces les cinq lettres pseudo-ignatiennes et la lettre de Marie de Cassobola, il interpolait largement les sept autres : il est donc à la fois l'auteur de la grande collection des treize lettres et de la longue [orme sous laquelle se présentent les sept premières.
Après la publication par Cureton, en 1845, de la petite collection, d'assez nombreux critiques crurent être en possession de la traduction syriaque ou texte primitif, qui aurait ainsi été la forme courte. Ce texte aurait subi deux allongements successifs représentant la forme moyenne et la forme longue. Mais cette idée est complètement abandonnée de nos jours : la forme courte n'est qu'une abréviation de la forme moyenne.
Si l'œuvre authentique d'Ignace se trouve quelque part, ce n'est certainement ni sous la longue forme ni sous la forme courte ou il faut la chercher, mais sous la forme moyenne ; tout le monde aujourd'hui est d'accord sur ce point.
C'est donc de cette dernière forme exclusivement que nous nous occuperons désormais.
On trouvera une étude détaillée des trois recensions de leurs manuscrits et de leurs versions, dans Lightfoot, The apostolic Fathers, vol. I. Le texte syriaque de la recension courte et le texte grec de la longue recension ont été reproduits dans le vol. III du même ouvrage.
Le texte grec des sept épîtres ne nous a été transmis que par deux manuscrits : l'un, le fameux Mediceus ou Laurentianus de Florence, contient les six lettres de l'Asie Mineure, c'est-à-dire aux Éphésiens, aux Magnésiens, aux Tralliens, aux Philadelphiens, aux Smyrniotes et à Polycarpe ; l'autre (Paris, Bibliothèque nat., Grec 1451, auparavant Colbert. 460), contient l'épître aux Romains insérée dans les Actes du martyre de S. Ignace. Ces deux manuscrits sont du xie siècle.
Sans doute il y a encore le Casanatensis, à la bibliothèque de la Minerve, à Rome ; le Barberinus 7 et le Barberinus 301 à la Bibliothèque Barberini, à Rome ; mais ce ne sont que des copies relativement récentes (xve siècle) du Mediceus, qui n'ont aucune valeur indépendante et dont il n'y a pas à tenir compte. Pas une des sept épîtres ne se lit dans les deux manuscrits à la fois : nous n'avons donc à notre disposition, pour chaque lettre, qu'un seul manuscrit grec.
Outre la version syriaque, de forme abrégée, publiée par Cureton, il existe quelques courts fragments d'une traduction syriaque (ive siècle) de notre forme moyenne. De plus, nous trouvons l'épître aux Romains insérée dans la traduction syriaque des Actes d'Antioche.
Il y a aussi une version arménienne, peut-être du ve siècle, faite, non sur l'original grec, mais sur une version syriaque. Cette version arménienne fut imprimée pour la première fois en 1783, à Constantinople. Elle a été reproduite par Petermann dans son édition d'Ignace, Leipzig, 1849.
Nous possédons aussi une version latine, composée en Angleterre vers le milieu du xiiie siècle, découverte par Ussher, et publiée par lui à Oxford en 1644. Cette traduction, très littérale et par là même très précieuse pour la critique, a été faite sur un texte grec parfois assez différent de celui de nos deux manuscrits actuels.
Signalons enfin une version copte de l'épître aux Smyrniotes.
On trouve ces différentes versions, syriaques, latine et copte dans la grande édition de Lightfoot, The apostolic Fathers, part II, vol. III. Le texte grec que nous avons adopté et qui sert de base à notre traduction est celui de Funk, édition de 1901.
La question de l'authenticité n'a pas subi moins de complications que celle du texte lui-même.
Comme nous l'avons déjà dit, les lettres de S. Ignace, jusqu'aux découvertes d'Ussher n'étaient guère connues que dans la longue recension : or, sous cette forme, elles prêtent réellement à de formidables objections ; il n'était pas nécessaire d'être un critique bien exercé pour sentir que ces lettres étaient l'œuvre d'un faussaire, et qu'elles avaient été ou fabriquées de toutes pièces ; ou au moins largement interpolées. Aussi avaient-elles un fort mauvais renom au point de vue critique. Après la publication, par Ussher et Voss, des épîtres connues d'Eusèbe, c'est-à-dire de celles qui forment aujourd'hui la recension moyenne, celles-ci héritèrent, dans une certaine mesure, de la mauvaise réputation qui s'était attachée à la longue recension, et cette tare originelle ne s'est jamais complètement effacée.
Mais le plus puissant obstacle à la reconnaissance de l'authenticité vint des passions religieuses. Dans la collection des sept lettres tout autant que dans la longue recension, S. Ignace apparaît comme le champion décidé de la hiérarchie ecclésiastique et surtout de l'épiscopat unitaire. La découverte d'Ussher n'était donc pas pour plaire aux ennemis de l'épiscopat : aussi les Calvinistes français, Saumaise (1645), Blondel (1646), et les Presbytériens anglais s'attaquèrent-ils aussitôt à son œuvre. Vingt ans plus tard, parut le fameux livre de Daillé : De scriptis quæ sub Dionysii Areopagitae et Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur libri duo, Genève, 1666 ; toute authenticité y était refusée aussi bien à la recension nouvelle qu'à la longue collection, qui se trouvaient confondues dans la même réprobation. En 1672, l'anglican J. Pearson réduisait à néant l'argumentation de Daillé dans son célèbre ouvrage : Vindiciae epistolarum S. Ignatii, Cantabr., 1672.
Au xixe siècle, la lutte n'a pas été moins vive : tandis que R. Rothe se déclarait pour l'authenticité, F. Chr. Baur et A. Hilgenfeld se prononçaient nettement contre. Pendant une vingtaine d'années, on ne put admettre l'authenticité des lettres d'Ignace sans se voir refuser le titre de critique éclairé. En 1845, Cureton publiait la courte recension, nouvellement découverte, et la donnait comme le seul véritable texte de S. Ignace : il fut suivi dans cette voie par Bunsen, A. Ritschl et R. A. Lipsius ; de Pressensé s'était d'abord rangé à cette opinion ; mais dans sa dernière édition du Siècle apostolique il reconnut l'authenticité de la recension moyenne.
A partir de 1873, on voit se dessiner une réaction sérieuse en faveur de l'authenticité, avec les travaux de Funk, de J. Réville, et surtout do Lightfoot (1885). Ce dernier a, pour ainsi dire, épuisé la question, et démontré magistralement la valeur de la recension moyenne. Dans ses leçons lithographiées sur les Origines chrétiennes, chap. vi), Mgr L. Duchesne consacre tout un appendice à établir l'authenticité des lettres de S. Ignace et de S. Polycarpe. Renan ne considérait comme authentique que la seule épître aux Romains ; pour Bruston au contraire, ce sont les six lettres aux églises d'Asie qui sont authentiques, et l'épître aux Romains qui ne l'est pas.
Ce simple exposé historique de la controverse met en relief la confusion qui règne encore dans les esprits sur cette importante question. Néanmoins, il est vrai de dire que l'authenticité gagne tous les jours du terrain, et qu'elle n'a plus, en ce moment, qu'un fort petit nombre d'adversaires sérieux.
Au commencement du ive siècle, Eusèbe de Césarée, dans ses divers écrits, témoigne d'une grande familiarité avec l'histoire et les épîtres de S. Ignace.
Dans sa Chronique, il rapporte qu'Ignace fut le deuxième évêque d'Antioche ; il fixe son accession au siège épiscopal à la première année de Vespasien, et son martyre à la dixième année du règne de Trajan. Ces dates, il est vrai, surtout la première, ne doivent pas être prises trop au sérieux, le catalogue des évêques d'Antioche à l'usage d'Eusèbe étant manifestement dépourvu de valeur historique.
Dans son Hist. Eccl., l. III, ch. 22 et 38, il fait encore mention d'Ignace, de son épiscopat et de ses lettres.
Mais c'est surtout au ch. 36 de ce même livre III qu'il faut se reporter : c'est le passage le plus décisif de toute la littérature chrétienne sur Ignace, Polycarpe et leurs écrits. Ignace, dit Eusèbe, fut le deuxième successeur de S. Pierre sur le siège d'Antioche ; il fut conduit à Rome pour y être livré aux bêtes ; de Smyrne, il écrivit quatre lettres : aux églises d'Éphèse, de Magnésie, de Tralles, de Rome. Étant déjà loin de Smyrne, il écrivit de nouveau aux chrétiens de Philadelphie, ainsi qu'à l'église de Smyrne et en particulier à Polycarpe son évêque. » Voilà bien les sept lettres reconnues aujourd'hui pour l'œuvre authentique d'Ignace. Eusèbe cite textuellement deux passages de l'épître aux Romains et un autre de l'épître aux Smyrniotes, tels que nous les possédons dans notre recension moyenne.
Dans les Quæstiones ad Stephanum I, il cite encore textuellement un autre passage de l'épître aux Éphésiens (19.1).
Ces divers témoignages d'Eusèbe en faveur des sept lettres sont tellement clairs, tellement frappants, qu'ils se passent de tout commentaire.
Du ive siècle, remontons à la première moitié du iiie : dans Origène, nous trouvons cités deux passages de l'épître aux Romains (de Oratione, 20, et Canticum canticorum, Prolog.), ainsi qu'un passage de l'épître aux Éphésiens (Homilia VI in Lucam). Origène indique, comme auteur de ces lettres, « le second évêque d'Antioche après Pierre, Ignace, qui lutta contre les bêtes à Rome pendant la persécution. »
Remontons plus haut encore, à la fin du xiie siècle. Dans son grand ouvrage contre les Hérésies, publié vers 180, Irénée cite la phrase la plus célèbre de l'épître aux Romains : « Quemadmodum quidam de nostris dixit, propter martyrium in Deum adjudicatus ad bestias, quoniam frumentum sum Christi, et per dentes bestiarum molor, ut mundus panis inveniar. » (A. H., V, 28,4). Le texte grec de ce passage d'Irénée nous est donné dans l'important chap. 36 du livre III de l'Hist. Eccl. d'Eusèbe dont nous venons de parler.
Arrivons enfin au contemporain, au confident de S. Ignace, c'est-à-dire à S. Polycarpe. Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de l'authenticité de sa lettre aux Philippiens. Dans cette lettre (ch. 1 et 9), il fait allusion à Ignace et à l'escorte d'honneur que les Philippiens lui avaient faite dans son voyage vers le martyre ; mais le passage décisif, c'est le chap. 13 dont le texte grec nous a été conservé par Eusèbe (H. E., III, 36) : « Vous m'avez écrit, vous et Ignace, pour que, si quelqu'un va en Syrie, il se charge aussi de votre lettre… Les épîtres d'Ignace, tant celles qu'il nous a adressées que les autres que nous possédons de lui, nous vous les envoyons selon votre demande : elles sont jointes à la présente lettre… De votre côté, st vous avez des nouvelles sûres d'Ignace et de ses compagnons, veuillez me les communiquer. »
Ce texte se rapporte si exactement à notre collection actuelle, que sa clarté même a éveillé des soupçons, d'ailleurs injustifiés : on s'est demandé si ce n'était pas là un post-scriptum ajouté par un faussaire à la lettre aux Philippiens tout exprès pour faire croire à l'authenticité des épîtres d'Ignace.
En supposant la lettre aux Philippiens authentique dans toutes ses parties, et elle l'est en effet, comme nous le montrerons bientôt, nous voyons que S. Polycarpe, alors que le martyre d'Ignace n'était peut-être pas encore un fait accompli, quelques semaines à peine après son passage à Smyrne, possédait déjà une collection de ses lettres correspondant à la nôtre, et était en mesure d'en envoyer une copie aux Philippiens.
Outre ces témoignages directs, on trouve encore, dans la littérature chrétienne des trois premiers siècles, une multitude de réminiscences des épîtres ignatiennes : il y en a dans le Martyre de S. Polycarpe, dans la lettre des églises de Vienne et de Lyon, dans Méliton, Athénagore, Théophile d'Antioche, Clément d'Alexandrie, Tertullien (V. Lightfoot, Apostolic Fathers, vol. l). Selon l'expression d'Eusèbe (H. E., III, 36), S. Ignace était alors très célèbre : παρὰ πλείστοις εἰς ᾽'τι νῦν διαβόητος Ἰγνάτιος.
Lucien semble bien avoir connu non seulement l'histoire d'Ignace, mais ses lettres elles-mêmes, et s'en être inspiré dans la Mort de Pérégrinus, écrite vers 165-170. Il est fort intéressant de comparer les passages de cet ouvrage relatifs à la période chrétienne de la vie de Pérégrinus avec les épîtres d'Ignace. Renan, pourtant hostile à l'authenticité des lettres de S. Ignace, celle aux Romains exceptée, avoue que les allusions de Lucien constituent en leur faveur un assez fort argument.
La force exceptionnelle des preuves extrinsèques n'est contestée par personne. Aussi est-ce presque uniquement par des arguments tirés delà critique interne qu'on essaie de saper l'authenticité des épîtres d'Ignace.
Naturellement nous ne pouvons donner ici qu'un aperçu sommaire et très incomplet des objections et des réponses, renvoyant le lecteur pour plus de détails à la savante et décisive dissertation de Lightfoot.
Les objections peuvent se ranger sous quatre chefs principaux : 1o invraisemblance de la situation d'Ignace, telle qu'elle ressort de ses lettres ; 2o la hiérarchie ecclésiastique ; 3o les hérésies ; 4o le style.
Ignace, déjà condamné aux bêtes à Antioche, est envoyé jusqu'à
Rome pour y subir sa peine : un tel voyage, pour un pareil motif, n'est-il pas invraisemblable ?
Non, car on sait l'effrayante consommation de vies humaines faite dans les amphithéâtres de Rome pour les plaisirs du peuple ; on n'y pouvait subvenir qu'en mettant les provinces à contribution. Aussi dirigeait-on, sur Rome, de tous les points de l'Empire, beaucoup de condamnés, surtout les beaux hommes, dignes d'être montrés au peuple romain : Si ejus roboris vel artificii sint ut digne populo romano exhiberi possint, dit le Digeste, XLVIII, 19, 31. Le cas d'Ignace n'est nullement isolé ; c'est un fait qui, à cette époque, se renouvelait tous les jours.
Il est invraisemblable, a-t-on dit encore, qu'un prisonnier ait pu recevoir ainsi des députations entières, correspondre librement avec ses coreligionnaires, écrire ou dicter des lettres, etc.
Cette objection, comme la précédente, ne peut venir qu'à l'esprit de gens peu versés dans la connaissance de l'antiquité. La condition des prisonniers, à cette époque, n'était nullement celle d'aujourd'hui : S. Paul, prisonnier, a pu faire, soit pendant son voyage de Césarée à Rome, soit pendant sa captivité à Rome, tout ce que nous voyons faire à Ignace, et l'on n'a jamais élevé le moindre doute contre le récit de la captivité de S, Paul.
D'ailleurs, que les lettres d'Ignace soient vraies ou supposées, il est certain que l'histoire de son voyage, telle qu'elle ressort aujourd'hui de ces lettres, était connue et admise comme vraie avant la fin du iie siècle. C'est donc que les contemporains ne trouvaient rien d'invraisemblable, ni dans le voyage lui-même, ni dans la manière dont il s'est opéré.
Qu'on relise la Mort de Pérégrinus : on y verra ce faux chrétien jouir dans les fers de la même liberté relative. Or Lucien était presque un contemporain d'Ignace, et c'était un littérateur trop avisé pour placer son héros dans des conditions invraisemblables.
Ignace, on le sait, est le grand champion de l'épiscopat unitaire et monarchique. Dans ses lettres, la hiérarchie ecclésiastique nous apparaît définitivement constitué avec ses trois ordres nettement distincts, les diacres, les presbytres et l'évêque qui, élevé au-dessus de tous, résume en lui toute l'Église et représente Dieu sur la terre.
Or l'épiscopat, ou du moins le pouvoir épiscopal qu'il est dépeint dans les lettres d'Ignace, serait, nous dit-on, un anachronisme au temps de Trajan. La conclusion s'impose ! puisque l'épiscopat n'existait pas au temps de S. Ignace, ces lettres, qui en sont le panégyrique, ne peuvent pas être de lui ; elles ont été composées à l'époque, postérieure d'un demi-siècle, où l'épiscopat a été constitué, et mises sous son nom vénéré.
Mais qu'est-ce qui prouve que l'épiscopat unitaire n'existait pas au temps de Trajan et d'Ignace ? C'est là une idée à priori, une assertion gratuite. En calculant la durée probable de l'évolution de la hiérarchie, on s'est dit qu'il en devait être ainsi : mais on en sait rien d'une manière positive. Car les documents relatifs à l'épiscopat nous font défaut pour cette période, ou plutôt il n'y en a pas d'autres que les épîtres de S. Ignace. Nous devons régler nos conceptions historiques sur les documents, et non pas sacrifier les documents à des idées à priori, qui ne sont pas étayées sur des documents contraires. C'est une question de savoir si l'épiscopat existait ou n'existait pas au début du iie siècle. Rejeter les lettres ignatiennes parce qu'elles nous montrent l'épiscopat déjà constitué, c'est supposer prouvé ce qui est justement en cause. Jusqu'à découverte de documents opposés, nous devons donc admettre l'existence de l'épiscopat sur la foi des épîtres ignatiennes, et non pas repousser celles-ci parce qu'elles contrarient une vue purement théorique.
Tandis que les six lettres aux églises d'Asie sont un véritable dithyrambe à la gloire de l'épiscopat, l'épître aux romains garde sur cette institution un silence presque complet : il n'y est pas une seule fois question de l'évêque de Rome, et, si S. Ignace ne s'y était pas une fois en passant désigné lui-même comme l'évêque de Syrie, elle ne contiendrait pas la moindre allusion à l'épiscopat. De ce contraste, Renan conclut à l'authenticité de l'épître aux Romains et à la supposition des six autres lettres qui, d'après lui trahissent les préoccupations et la méthode d'un faussaire.
Il est certain que, au point de vue de l'épiscopat, le contraste entre l'épître aux Romains et les autres lettres est tout à fait frappant ; nous sommes surpris, en particulier, de ne pas trouver dans la première une seule mention d'un évêque de Rome. Mais, dans l'épître de S. Clément, écrite peu de temps avant la date présumée de la lettre aux Romains, comme dans le Pasteur d'Hermas, composé à Rome même quelques années après S. Ignace, nous constatons le même silence sur l'évêque de Rome dont il n'est pas une seule fois question. C'est évidemment là un fait singulier au premier abord, mais dont l'explication ne rentre pas dans le cadre du présent travail. Il est également certain que, lorsqu'on passe de l'épître aux Romains aux autres épîtres, on éprouve quelque étonnement devant l'insistance, presque fatigante, avec laquelle Ignace prône la hiérarchie en général et l'épiscopat en particulier, et l'on ne peut se défendre, au premier moment, d'un mouvement de défiance.
Mais, s'il est relativement difficile d'expliquer le silence absolu d'Ignace sur l'évêque de Rome, il est facile de deviner pourquoi, dans sa lettre aux Romains, il s'abstient de ces exhortations à l'union et à la discipline, de ces panégyriques de la hiérarchie, qui forment le fond des autres épîtres.
Ces autres épîtres, en effet, sont adressées aux églises dans leur propre intérêt ; c'est pour leur donner des conseils qu'Ignace leur écrit, et, dans ces temps troublés par l'hérésie et le schisme naissants, il ne connaît rien de plus pressant à leur recommander que l'union et l'obéissance de tous les fidèles à leurs chefs. C'est dans son propre intérêt, au contraire, qu'il écrit aux Romains et non pour leur donner des conseils. La seule exhortation qu'il leur adresse, et qui est le but unique de sa lettre, c'est de ne pas lui ravir, par leur charité intempestive, la palme du martyre.
Quant à l'insistance, très réelle, qu'Ignace met dans ses six autres épîtres à recommander la hiérarchie et l'épiscopat, elle s'explique très simplement par deux causes : 1o C'était l'époque où le schisme et l'hérésie commençaient à travailler l'Église ; on était à l'aurore de cet orageux iie siècle, le plus fertile en hérésies : Ignace sentait venir l'orage, et il ne voyait de salut que dans l'obéissance à la hiérarchie. C'était chez lui une idée fixe, qui l'obsédait. De là ses appels enflammés à l'union, ses exhortations réitérées à tous les fidèles de se serrer autour de leurs pasteurs. Quel est l'homme, profondément convaincu, et comme possédé par une idée qui ne la répète sans cesse ? N'est-ce pas là l'histoire très naturelle de la delenda Carthago de Caton ?
2o