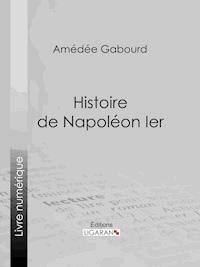
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le jour même où l'Église célèbre l'Assomption de la Mère de Dieu, dans cette contrée peuplée d'une race plus dure que ses rochers, plus sauvage que ses bruyères, et que les Romains n'avaient point osé appeler au honteux honneur de leur fournir des esclaves ; plusieurs mois après que la Corse, soustraite à la domination génoise, eut été cédée à la France..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C’est en quelque sorte un livre nouveau que nous donnons au public, car notre ouvrage a été entièrement modifié et soumis à une révision attentive. Nous n’avons point fait aux circonstances le sacrifice des droits de l’histoire, de pareilles concessions n’entrent pas dans nos habitudes ; mais il ne nous coûte guère d’avouer que depuis douze ans, c’est-à-dire depuis le jour où nous publiâmes pour première fois la vie de Napoléon, les grands évènements qui se sont produits dans le monde nous ont éclairé sur la portée, le caractère, les actes et la mission du fondateur de la quatrième dynastie. Nous ne sommes pas de ceux qui s’opiniâtrent dans une idée, et ne tiennent compte des faits que lorsqu’ils s’accommodent avec leur système. Et comment aurions-nous vu l’incompréhensible orage du 24 février jeter à bas et renvoyer en exil un roi dont la fortune semblait assise sur les plus solides bases ? Obscurément mêlé à cette histoire, il nous a été donné d’assister à l’inauguration de la seconde république, à la guerre civile, aux crises formidables qui se sont succédé en quatre ans ; et comment aurions-nous pu être témoin de ces choses inattendues sans essayer de comprendre et sans entrevoir le doigt de Dieu qui écrivait notre avenir ?
D’autres retraceront ces phases politiques que notre patrie a traversées : pour nous, si nous les rappelons, c’est pour reconnaître qu’elles ont contribué à nous éclairer sur le rôle historique de Napoléon Ier, sur ce qu’il y avait de mystérieux et de vague dans sa mission. Nous avions cru, comme tant d’autres, qu’il avait été suscité pour une œuvre de réparation sociale, mais de transition, et que son nom à jamais illustre ne surgirait plus que dans les livres comme un problème et un sujet de méditation livrés aux hommes d’État et aux philosophes. Et voilà que par la permission de Dieu, qui fait et défait les rois, et de qui relèvent les empires, ce nom a reparu sur la scène du monde, et a présidé une fois encore au salut de la France et à la restauration de la société européenne. Il ne s’est plus présenté aux rois étrangers comme une menace, mais comme un appui ; il est devenu un gage de gloire et une promesse de paix ; l’Église l’a béni de nouveau, et ne lui a fait acheter par aucun sacrifice et par aucune douleur les services qu’il a rendus à sa cause. Nous serions ingrats d’oublier de pareils bienfaits, aveugles de les méconnaître.
Napoléon Ier, comme Napoléon III, a été le représentant, le symbole réel du peuple français. Ce peuple a identifié en lui sa gloire, ses institutions, ses intérêts : il a été victorieux avec lui, vaincu avec lui, et on a toujours senti que leur cause était commune. C’est à cette étrange solidarité entre l’empereur et le peuple qu’on distingue entre toutes la mission réelle de Napoléon, et que cet homme apparaît réellement aux yeux du monde comme l’élu et l’adopté de la France. La France s’est associée à ses triomphes et à ses fautes, et quand Dieu, qui consacre toutes les dynasties par le malheur, a permis que l’exil de Sainte-Hélène fût comme l’expiation d’une fortune démesurée et sans exemple, le cœur de la France était avec le captif, et le peuple souffrait douloureusement dans ses sympathies.
Les réflexions qui précèdent sont le fruit de l’expérience, et elles expliqueront le nouveau point de vue auquel s’est placé l’auteur de ce livre, alors que, sans méconnaître l’autorité imprescriptible de la vérité et de la justice, il a cru devoir modifier son livre, et le mettre mieux en harmonie avec le sentiment national.
A.G.
Paris, 1833.
Le jour même où l’Église célèbre l’Assomption de la Mère de Dieu, dans cette contrée peuplée d’une race plus dure que ses rochers, plus sauvage que ses bruyères, et que les Romains n’avaient point osé appeler au honteux honneur de leur fournir des esclaves ; plusieurs mois après que la Corse, soustraite à la domination génoise, eut été cédée à la France ;
Vers le temps où l’auteur du Contrat social annonçait que cette île allait bientôt étonner le monde, où se formait en Pologne la confédération de Bar, où éclatait en Amérique l’insurrection des Massachussetts, où la Grèce chrétienne se réveillait de sa longue servitude, en cette année 1769 qui vit naître aussi Chateaubriand, Walter-Scot, Soult, Wellington et une pléiade d’hommes célèbres ;
Letizia Ramolino, femme d’un gentilhomme d’Ajaccio nommé Charles Bonaparte, voulut se rendre à l’office divin malgré les représentations qui lui furent faites sur son état de grossesse très avancée. À son retour elle fut prise des douleurs de l’enfantement, et mit au monde sur un tapis qui représentait les héros d’Homère, un fils auquel, en mémoire de l’un de ses ancêtres, on donna le nom de NAPOLÉON.
La famille Bonaparte, ou Buonaparte si l’on veut se conformer à l’orthographe italienne, était originaire de San-Miniato, en Toscane. Elle avait joué un rôle dans les annales de l’Italie. À une date fort reculée, elle avait donné des souverains à Trévise et des patrices à Florence. Son nom était inscrit sur les livres d’or de Venise et de Bologne ; des alliances l’avaient unie aux maisons des Ursins, des Médicis et des Lomellini ; c’était un Jacques Buonaparte qui avait écrit l’histoire du siège de Rome par le connétable de Bourbon ; une dame de cette famille avait été la mère du pape Nicolas V, et un Buonaparte attaché à l’ordre des Capucins avait été béatifié canoniquement. Compromis par leur fidélité aux Gibelins, les Buonaparte avaient été contraints par une réaction favorable aux Guelfes, d’abandonner l’Italie et de se réfugier en Corse. Ils y vécurent nobles, mais sans patrimoine, et contractèrent de nouvelles alliances avec les puissantes familles du pays. Charles Buonaparte, leur héritier, mourut, en 1784, à Montpellier, âgé de 35 ans ; de treize enfants qu’il avait eus de son mariage avec Letizia Ramolino, huit seulement lui survécurent : Napoléon était le second dans l’ordre de la naissance.
« Je n’étais qu’un enfant obstiné et curieux. » C’est ainsi que Napoléon résume lui-même l’histoire de ses premières années. Cependant, si l’on étudie dès cet âge les développements de son caractère, il n’est point permis de méconnaître en lui ces marques certaines qui signalent l’enfance des hommes illustres. Il était turbulent, dominateur et fier. On le vit supporter en silence une punition de sept jours dans le seul but d’épargner une réprimande à sa sœur Élisa. Dans une autre circonstance, comme la chute imminente d’une poutre épouvantait toutes les personnes de la maison et les faisait fuir, on le vit demeurer seul dans la pièce menacée, et lever ses petits bras pour braver ou conjurer le danger. Il avait sur Joseph, son frère aîné, un ascendant extrême. Celui-ci était battu, mordu ; des plaintes étaient déjà portées à la mère, la mère grondait, que Joseph n’avait pas eu le temps d’ouvrir la bouche. Leur oncle Lucien, archidiacre d’Ajaccio, avait pressenti ce que révélaient ces commencements d’une grande histoire : étant sur son lit de mort et entouré de ses neveux, il dit à Joseph : « Tu es l’aîné de la famille, mais Napoléon en est le chef ; aie soin de ne pas l’oublier. On n’a pas besoin de songer à sa fortune ; il la fera lui-même. » Cette scène, selon la réflexion de Napoléon, rappelait la substitution du droit d’aînesse d’Ésaü à Jacob.
Sans vouloir donner une importance puérile à des incidents qui n’appartiennent pas à la gravité de l’histoire, nous dirons que le jeune Napoléon ne fut baptisé qu’à l’âge de deux ans, en même temps que sa sœur Marie-Anne, née le 14 juillet 1771, et décédée peu de temps après. Il voulut se tenir agenouillé pendant que son parrain (Laurent Giubega) et sa marraine (Gertrude Bonaparte) en faisaient autant. Lorsqu’il vit le prêtre verser de l’eau sur sa petite sœur, il s’effraya pour elle, et s’élança vivement en criant : « Ne la mouillez pas ! » et il fallut beaucoup de peine pour calmer sa colère enfantine, qui manifestait déjà un esprit ardent et dominateur. Quelques années plus tard, de petites guerres ayant continué de s’élever entre les enfants d’Ajaccio et ceux des faubourgs, le jeune Napoléon exerça des commandements militaires dans ces luttes, qui aboutissaient trop souvent à des accidents graves. À la tête des Ajacciens, il vainquit plus d’une fois les Borghigiani, et on le vit souvent suppléer au nombre par les ruses et les manœuvres. Ces souvenirs sont encore conservés à Ajaccio, où Napoléon résida jusqu’à l’âge de dix ans.
Membre de la cour souveraine d’Ajaccio et envoyé aux états généraux par la noblesse de Corse, Charles Bonaparte n’en était pas moins hors d’état de pourvoir à l’éducation de sa nombreuse famille. Par la protection de M. de Marbœuf, gouverneur de l’île, il obtint pour Napoléon une bourse à l’école militaire de Brienne. Il paraît que la pauvreté de cet enfant lui fit éprouver, de la part de ses camarades, des humiliations que sa fierté dévora en silence ; son accent corse, très prononcé, était pour lui une source de moqueries. Ces épreuves donnèrent à son caractère une sorte d’âpreté et de concentration qui prédisposaient mal en sa faveur, et lui conciliaient médiocrement la bienveillance de ses condisciples et de ses maîtres. Il savait néanmoins inspirer à ceux qui l’observaient de près une sorte de respect involontaire qui tenait autant à l’énergie de sa volonté qu’à la singularité de ses allures. Instinctivement passionné pour les traditions historiques de la Corse, il s’accoutumait avec peine à l’idée que son pays natal, désormais réuni à la France, était déchu de son indépendance nationale. Cette préoccupation rendait son abord sombre et difficile. Il vantait à tout propos la résistance patriotique de Paoli, et il lui arriva un jour de dire : « Jamais je ne pardonnerai à mon père, qui a été l’adjudant de Paoli, d’avoir concouru à la réunion de la Corse à la France. Il aurait dû suivre sa fortune et succomber avec lui. » Qu’était devenu ce respect pour la nationalité, lorsque, dans le cours de sa vie, il abolit tant de fois la patrie, les traditions, les coutumes et jusqu’au nom des peuples subjugués par ses armes ?
La première fois que Napoléon aperçut, dans une des salles de l’école, le portrait du duc de Choiseul, il s’approcha d’un air sombre du tableau, et dit tout haut, du ton de la menace : « Tu me rendras compte un jour du sang que tu as fait couler dans ma patrie et de la liberté que tu nous as ôtée. » Cette incartade patriotique mécontenta les professeurs, et les disposa mal contre le jeune Corse.
Bonaparte apprit assez promptement la langue française ; mais, soit affectation de sa part, soit effet des impressions ineffaçables de son idiome paternel, il ne parvint jamais à s’asservir aux règles de l’orthographe. Il montra une telle répugnance pour le latin, qu’à l’âge de quinze ans il était encore très faible en quatrième. Sa supériorité ne se manifestait que dans l’étude des sciences mathématiques ; sous ce rapport, il surpassait tous ses camarades. Dédaigneux des lectures frivoles, il affectionnait l’histoire des grands hommes de l’antiquité. Il lisait souvent Arrien, Polybe, surtout Plutarque, et ne faisait pas grand cas de Quinte-Curce. Il n’avait aucune disposition pour les belles-lettres, la musique et les arts d’agrément.
Un jour le maître de quartier, brutal de sa nature, le condamna, pour une légère faute, à porter l’habit de bure et à dîner à genoux à la porte du réfectoire : c’était une espèce de déshonneur. Napoléon avait dans le cœur un sentiment profond de sa dignité et de ses devoirs. Il se soumit à l’ordre ; mais au moment de l’exécution il fut pris d’une violente attaque de nerfs. Le supérieur, qui passait par là, l’arracha au supplice en grondant le maître de son peu de discernement, et le père Patrault, son professeur de mathématiques, accourut, se plaignant de ce que sans nul égard on dégradait ainsi son premier mathématicien.
Plus tard, Napoléon eut un maître de quartier bien autrement digne de lui. C’était un jeune homme issu d’une famille de cultivateurs de Franche-Comté, et qui, après avoir été élevé comme par charité à Brienne, y était devenu répétiteur. Il songeait à entrer dans l’ordre des Minimes ; mais il en fut dissuadé par le père Patrault, qui l’engagea à s’enrôler dans l’artillerie, où la révolution le prit sous-officier. Ce maître de quartier était le futur conquérant de la Hollande, et se nommait Pichegru.
Quoique peu remarqué dans ses études purement littéraires, Napoléon ne laissait pas de faire éclater dans ses compositions quelques étincelles de génie. M. Domairon, son professeur de belles-lettres, appelait les amplifications de son jeune élève du granit chauffé au volcan. En revanche, Napoléon ne faisait aucuns progrès dans la langue allemande. Son inaptitude à cet égard avait inspiré à l’un des professeurs, M. Bauer, un mépris très profond. Un jour que l’écolier était absent de la classe, M. Bauer demanda où il pouvait être ; on répondit qu’il subissait en ce moment son examen pour l’artillerie. « Mais est-ce qu’il sait quelque chose ? disait ironiquement le maître d’allemand. – Comment, Monsieur ! mais c’est le plus fort mathématicien de l’école, lui répondit-on. – Eh bien ! je l’ai toujours entendu dire et je l’avais toujours pensé, que les mathématiques n’allaient qu’aux bêtes. » – Si M. Bauer vivait encore vingt ans après cette conversation, il est probable, disait Napoléon, qu’il aurait réformé son jugement.
La note suivante, extraite du rapport de M. de Keralio, inspecteur des écoles militaires, date de 1784 ; elle peut donner une idée de l’opinion que Bonaparte avait laissée de lui à Brienne : « M. de Buonaparte (Napoléon), né le 15 août 1769, taille de 4 pieds 10 pouces 10 lignes, a fait sa quatrième ; de bonne constitution, santé excellente, caractère soumis, honnête, reconnaissant, conduite très régulière ; s’est toujours distingué par son application aux mathématiques. Il sait très passablement son histoire et sa géographie. Il est assez faible pour les exercices d’agrément et pour le latin, où il n’a fait que sa quatrième. Ce sera un excellent marin ; il mérite de passer à l’école militaire de Paris. » Ce qui résulte bien clairement de ce peu de lignes, c’est que personne à Brienne n’avait compris ni pressenti l’avenir du jeune Napoléon. Exceptons-en toutefois M. de l’Éguille, son professeur d’histoire, qui rendait ainsi compte du caractère de son jeune élève : « Corse de naissance, il ira loin, si les circonstances le favorisent. » Elles le favorisèrent. Mais, à cette période de sa vie, Napoléon se faisait lui-même peu d’illusions : il ne cachait à personne que le terme le plus exagéré de son ambition était d’arriver au grade de colonel d’artillerie. Et, en effet, sans la révolution, qui ouvrit une porte si large à toutes les carrières, il eût été heureux d’obtenir sa retraite avec ce grade et la croix de Saint-Louis.
Le jeune Bonaparte, voué à la carrière des armes, préludait, avec ses camarades de Brienne, aux guerres sérieuses par des guerres simulées. On connaît les gravures populaires qui le représentent livrant, avec ses condisciples, un combat dans les cours de Brienne, et n’ayant pour munitions et ouvrages de siège que des boules et des murailles de neige. Ce fait eut lieu dans l’hiver de 1783 à 1784 D’après les conseils de Napoléon, les élèves creusèrent des tranchées, élevèrent des parapets, construisirent des redoutes ; les uns furent préposés à la défense, les autres à l’attaque ; Bonaparte dirigeait les opérations. Cette petite guerre dura environ quinze jours, et se termina à la fonte des neiges.
La sévérité de ses mœurs était remarquable. Un seul désir le tourmentait, celui de vivre dans le souvenir de la postérité : c’était là pour lui, disait-il, une nouvelle immortalité de l’âme. Le jour de sa première communion l’avait trouvé bien préparé à ce grand acte de la vie chrétienne. En sortant de l’église, il écrivit à son oncle Fesch, depuis cardinal, une longue lettre qui contenait les épanchements si rares de son jeune cœur, et portait l’empreinte d’une pieuse exaltation. Les orages de la vie militaire et les funestes exemples du siècle n’effacèrent que trop ces sentiments du premier âge.
En 1784, Bonaparte passa à l’École militaire de Paris; Il fut remplacé à Brienne par Louis, son frère ; quelque temps après, sa sœur Marianne (Élisa) fut placé à Saint-Cyr.
À peine arrivé à l’École militaire de Paris, le jeune Napoléon donna des preuves de son esprit organisateur. Il s’aperçut que cet établissement était plus propre, par le luxe et la recherche qui présidaient aux mesures intérieures, à fournir aux rois des courtisans qu’à donner à la France de braves et utiles officiers. Dès lors, et quoique à peine âgé de quinze ans et deux mois, il rédigea un mémoire qu’il adressa à ses supérieurs, pour leur démontrer jusqu’à quel point le plan de cet établissement était vicieux. Dans cet écrit il s’élevait contre l’éducation donnée à l’École, affirmant « que les élèves du roi, tous pauvres gentils hommes, n’y pouvaient puiser, au lieu des qualités du cœur, que l’amour de la gloriole, ou plutôt des sentiments de suffisance et de vanité tels, que, en regagnant leurs pénates, loin de partager avec plaisir la modique aisance de leur famille, ils rougiraient peut-être des auteurs de leurs jours et dédaigneraient leur modeste manoir. »
Le caractère de Bonaparte lui fit autant d’ennemis à l’école de Paris qu’à celle de Brienne ; en 1785 on se trouva heureux de l’éloigner de cet établissement en lui donnant une sous-lieutenance vacante dans le régiment d’artillerie de la Fère. Il reçut sa commission avec une joie indicible. En 1787, Bonaparte obtint le grade de lieutenant : il fut alors incorporé au régiment d’artillerie de Grenoble, et séjourna pendant plusieurs années à Valence.
On a dit que, dans ses moments de prédilection pour la cause de la Corse, il professait une grande admiration pour Paoli. Celui-ci lui rendait une partie de cette estime. Il est taillé à l’antique, disait-il en parlant de Napoléon ; je vois en lui un des grands hommes de Plutarque. » Tant que Paoli combattit contre la domination de la France, Bonaparte ne vit en lui qu’un héros ; quand plus tard le vieux général eut terni sa gloire en livrant la Corse à l’Angleterre, Bonaparte se mit au nombre de ses adversaires les plus ardents, et lutta énergiquement pour conserver sa patrie à la France. C’est de cette époque qu’on peut dire qu’il a adopté de cœur notre nationalité ; il en vint à aimer la France avec passion.
Mme Ducolombier, alors âgée de cinquante ans, mais qui, par son esprit et ses manières, était à la tête de la meilleure société de Valence, distingua sans peine le mérite du jeune Bonaparte parmi les personnes de toutes conditions qui se pressaient dans ses salons. La recommandation de cette dame ouvrit au lieutenant corse les meilleures maisons de la ville ; il y dépouilla peu à peu cette humeur farouche ou chagrine qui jusqu’alors l’avait réduit à l’isolement. La société eut de l’attrait pour lui ; il attirait d’ailleurs l’attention par sa conversation brève, saccadée, incorrecte, mais spirituelle et incisive. Cependant les heures de la garnison étaient longues. Bonaparte employait ses loisirs dans la boutique d’un libraire de Valence. Il étudiait l’histoire du Moyen Âge et des temps modernes, et y cherchait sans cesse, parmi les héros des siècles passés, des exemples ou des maîtres. L’Académie de Lyon ayant mis au concours cette question posée par l’abbé Raynal : Quels sont les principes et les institutions à inculquer aux hommes pour les rendre le plus heureux possible ? un sujet si bien choisi pour enflammer les imaginations aventureuses fut abordé par un très grand nombre d’écrivains. Bonaparte concourut et obtint le prix : c’est à dix-huit ans qu’il remportait ses premières palmes. Je me trompe : déjà, en 1783, le duc d’Orléans, étant venu présider à la distribution des prix de l’école de Brienne, avait posé sur la tête de Napoléon la couronne de chêne, que tant d’autres diadèmes plus lourds ne lui firent point oublier. Qui aurait dit alors que, vingt ans plus tard, celui que la main d’un Bourbon ceignait ainsi d’un feuillage académique chargerait son front de la couronne de Louis XIV et de la vieille couronne de fer des rois lombards ?
Cependant Bonaparte tint successivement garnison à Douai et à Auxonne ; il passait ses semestres à Paris, et l’abbé Raynal, qui l’avait pris en grande amitié, s’efforçait de l’initier aux désolants mystères de la philosophie encyclopédique. À cette époque, Napoléon était moins un officier qu’un jeune écrivain dont l’avenir littéraire laissait entrevoir des espérances. Le moment devait bientôt venir où l’histoire de son pays allait offrir un vaste aliment à son amour de la gloire et à son désir insatiable d’arriver à la postérité. La révolution française éclatait ; l’antique monarchie tombait en ruine.
Bonaparte, tout entier aux idées nouvelles qui réalisaient pour lui quelques-unes des rêveries auxquelles il s’était laissé aller en lisant Tite-Live et Plutarque, prit dès le premier jour parti pour la cause révolutionnaire. Il résista aux instances qui lui furent faites pour le déterminer à émigrer. Ce fut d’ailleurs chez lui un calcul. Des révolutions, disait-il, sont un bon temps pour les militaires qui ont de l’esprit et du courage ; si un maréchal de camp peut s’attacher au parti de la cour, un sous-lieutenant sans fortune doit se vouer à la révolution. » On doute qu’au temps où il essayait de relever les idées monarchiques il eût aimé dans ses lieutenants cette singulière théorie.
Il était en congé à Ajaccio lorsque parvint dans cette ville la nouvelle des évènements du 14 juillet 1789. La révolution française était populaire à Ajaccio, mais elle était assez froidement acceptée dans le reste de l’île. Napoléon, partisan exalté des idées nouvelles, n’épargnait rien pour exalter le peuple : de concert avec son frère Joseph, il rédigea et fit signer par les citoyens d’Ajaccio une adresse à l’Assemblée Constituante ayant pour but de réclamer que la Corse fût déclarée partie intégrante de la France. Peu de mois après, il vint de nouveau habiter Valence.
En 1790, le 25 juin, une émeute populaire éclata à Ajaccio : Napoléon, qui était de retour en Corse, fut mis à la tête du peuple, et réussit à maintenir un peu d’ordre. Le 14 juillet, Paoli débarqua à Maginajo, et fut accueilli avec enthousiasme par les habitants de l’île. Pendant les mouvements révolutionnaires qui agitèrent Ajaccio, Napoléon et son frère Joseph, signalés comme ardents démocrates, se virent un jour exposés à périr dans une émeute ; mais ils furent sauvés par un certain Trentacoste qui, au surplus, avait acquis dans l’île une triste célébrité. Plus tard, Napoléon fit de cet homme un inspecteur des eaux et forêts en disant : « La reconnaissance est une vertu qui oublie les mauvaises qualités pour ne tenir compte que des bonnes. »
Il se trouvait à Paris en 1792, et n’y tenait d’autre rang que celui d’un simple officier sans fortune ; chaque matin il inventait un projet pour améliorer sa position et se créer des ressources. Un jour, avec son camarade Bourrienne, il voulut spéculer sur la construction d’un nouveau quartier ; mais les propriétaires des terrains et des maisons firent des conditions trop dures : il ne s’agissait d’ailleurs que de louer plusieurs habitations de la rue Montholon, et de les sous-louer à des prix plus élevés. Pendant ce temps d’une vie vagabonde, Bonaparte fut témoin de la trop fameuse saturnale du 20 juin, journée pendant laquelle la populace des faubourgs, suscitée par la Gironde, avilit la royauté et plaça le bonnet rouge sur la tête de l’infortuné Louis XVI. Bonaparte, en voyant défiler les longues hordes de misérables déguenillés, armés burlesquement et vociférant des cris de mort, eut le pressentiment des instincts antirévolutionnaires qu’il devait plus tard manifester. Saisi d’un profond sentiment de mépris et d’indignation, il ne comprenait pas la résignation de Louis XVI, qui avait fait ouvrir ses appartements au peuple attroupé. « Eh ! comment, s’écria-t-il tout haut, a-t-on pu laisser entrer aux Tuileries cette canaille ? Il fallait en balayer quatre à cinq cents avec du canon, et le reste courrait encore. »
Bonaparte, ayant obtenu un nouveau congé, se rendit en Corse, auprès de sa famille. Deux partis s’étaient formés dans l’île : l’un tenait pour la France, l’autre, qui devait plus tard se rallier à l’Angleterre, affectait de ne vouloir que l’indépendance de la Corse. Ce dernier parti avait pour chef le vieux Paoli ; Bonaparte se rangea sous le drapeau français. On voit qu’il avait déjà laissé bien loin ses préoccupations de l’école de Brienne. Des troubles éclatèrent, et Bonaparte, à la tête d’un corps de volontaires corses, réussit à enlever Ajaccio, sa ville natale, aux partisans de Paoli. On lui fit néanmoins un crime de ce succès, et il fut rappelé à Paris pour se justifier.
De terribles évènements s’étaient accomplis au dedans et au dehors de la France. Les institutions monarchiques, battues en brèche depuis un demi-siècle, moralement désertées par ceux qui auraient dû les honorer ou les défendre, avaient été trouvées bien affaiblies par le jeune Louis XVI, le jour où il recueillit l’héritage dégradé de Louis XV. Le nouveau roi était dévoré de l’amour du peuple ; ses intentions étaient généreuses, son cœur droit, sa piété sincère. Ne faut-il pas que les victimes choisies pour être immolées en expiation des fautes des rois et des peuples soient innocentes et pures ?
Qu’est-il besoin de raconter par quelles tempêtes furent déracinées la royauté, la noblesse, la magistrature, l’Église de France ? Ces grandes calamités sont présentes à tous les souvenirs. Nous ne les mentionnerons en passant que lorsqu’elles se rattacheront directement à l’intelligence de ce livre, destiné à retracer la vie de Napoléon Bonaparte.
Paoli venait de livrer la Corse à l’Angleterre. Au milieu des troubles que ces évènements suscitèrent, la ville d’Ajaccio fut incendiée, et les flammes n’épargnèrent point la maison où Napoléon avait reçu le jour. Sa famille fut pour ainsi dire proscrite et réduite à chercher un refuge à Marseille : elle y trouva l’hospitalité, mais elle eut à subir de fort pénibles privations.
Dans les derniers jours du règne de Louis XVI, il avait eu beaucoup de peine à repousser les accusations qui pesaient sur lui, par suite des actes révolutionnaires commis en Corse par le bataillon des volontaires nationaux, excès qu’il n’avait pu empêcher, dans un pays où les passions sont si violentes. Il se lia avec les principaux Girondins, mais il prit en dégoût leurs ambitions et leurs intrigues. Le 2 septembre, saisi d’horreur à l’aspect des massacres, il quitta Paris, et conduisit en Corse sa sœur Marianne (Élisa). À Marseille, l’un et l’autre faillirent être massacrés comme aristocrates, parce que la jeune Élisa portait un chapeau garni de plumes. De retour en Corse, ainsi qu’on l’a dit plus haut, il se brouilla avec Paoli, qui avait conçu le projet de séparer la Corse de la France. Il reçut du ministre de la guerre l’ordre de se rendre à Saint-Florent et de lever les fortifications de cette place : arrivé à Corté, une dépêche de Paoli lui enjoignit de rétrograder et de prendre part à une expédition méditée contre la Sardaigne : cette expédition préparée à grands frais échoua, mais fournit au jeune Bonaparte plusieurs occasions de faire preuve d’intelligence et d’audace. Après avoir pris part à quelques luttes obscures, mais dangereuses, contre la faction de Paoli, qui persistait à séparer la Corse de la France, Napoléon, en butte aux persécutions de ses ennemis, prit le parti d’abandonner l’île et de venir, avec sa famille, chercher de nouvelles destinées sur le continent. On était en l’an II de la République (1793). Le jeune Bonaparte, protégé par quelques Corses assez influents, se fit admettre de nouveau dans l’armée active.
Les esprits se préoccupaient alors du siège de Toulon. Les ennemis de la république avaient livré cette ville aux Anglais ; une armée, envoyée par la Convention Nationale et commandée par le général Cartaux, reçut ordre de la reprendre. C’était une opération dans laquelle l’artillerie devait jouer le principal rôle. Bonaparte, à peine âgé de vingt-quatre ans, fut nommé chef d’escadron de cette arme, et désigné pour diriger, en second, les travaux du siège. Ici j’emprunte à Napoléon lui-même le récit des premières circonstances qui le mirent en évidence ; cette citation donnera une idée des choses et des hommes de ce temps :
Napoléon arrive au quartier général ; il aborde le général Cartaux, homme superbe, doré depuis les pieds jusqu’à la tête, qui lui demande ce qu’il y a pour son service. Le jeune officier présente modestement sa lettre qui le chargeait de venir, sous ses ordres, diriger les opérations de l’artillerie. « C’était bien inutile, dit le bel homme en caressant sa moustache ; nous n’avons plus besoin de rien pour reprendre Toulon. Cependant soyez le bienvenu, vous partagerez la gloire de le brûler demain, sans en avoir eu la fatigue. » Et il le fit rester à son souper.
On s’assied trente à table ; le général seul est servi en prince, tout le reste meurt de faim ; ce qui, en ces temps d’égalité, choqua étrangement le nouveau venu. Au point du jour, le général le prend dans son cabriolet pour aller admirer, disait-il, les dispositions offensives. À peine a-t-on dépassé la hauteur et découvert la rade, qu’on descend de voiture et qu’on se jette sur les côtés dans les vignes. Le commandant d’artillerie aperçoit alors quelques pièces de canon, quelque remuement de terre auxquels, à la lettre, il lui est impossible de rien comprendre. « Sont-ce là nos batteries ? dit fièrement le général, parlant à son aide de camp, son homme de confiance. – Oui, général. – Et notre parc ? – Là, à quatre pas. – Et nos boulets rouges ? – Dans les bastides voisines, où deux compagnies les chauffent depuis ce matin. – Mais comment porterons-nous ces boulets tout rouges ?… » Et ici les deux hommes de s’embarrasser et de demander à l’officier d’artillerie si par ses principes il ne saurait pas quelque remède à cela. Celui-ci, qui eût été tenté de prendre le tout pour une mystification, si les deux interlocuteurs y eussent mis moins de naturel (car on était au moins à une lieue et demie de l’objet à attaquer), employa toute la réserve, le ménagement, la gravité possibles, pour les persuader, avant de s’embarrasser de boulets rouges, d’essayer à froid pour bien s’assurer de la portée. Il eut bien de la peine à réussir, et encore ne fut-ce que pour avoir très heureusement employé l’expression technique de coup d’épreuve, qui frappa beaucoup, et les ramena à son avis. On tira donc ce coup d’épreuve ; mais il n’atteignit pas au tiers de la distance, et le général et son aide de camp de vociférer contre les Marseillais et les aristocrates, qui auront, malicieusement sans doute, gâté les poudres. Cependant arrive à cheval le représentant du peuple : c’était Gasparin, homme de sens, qui avait servi. Napoléon, jugeant dès cet instant toutes les circonstances environnantes, et prenant audacieusement son parti, se rehausse tout à coup de six pieds, interpelle le représentant, le somme de lui faire donner la direction absolue de sa besogne, démontre sans ménagement l’ignorance inouïe de tout ce qui l’entoure, et saisit dès cet instant la direction du siège, où dès lors il commande en maître. »
L’armée était absolument dépourvue du matériel et du personnel d’artillerie indispensables pour mener à terme le siège d’une ville inabordable du côté de la mer, et que protégeaient, sur le continent, une enceinte formidable et plusieurs forts établis sur les hauteurs. Toulon semblait défier pour toujours les armées de la république ; mais Bonaparte se mit à l’œuvre. En moins de six semaines, il eut créé les ressources qui lui manquaient, et rassemblé l’artillerie nécessaire. L’inepte Cartaux trouvait néanmoins que le siège allait en longueur. Pour y mettre fin, il prit un arrêté par lequel il était enjoint à Bonaparte de foudroyer la ville et de brûler la flotte ennemie, se chargeant lui-même de se rendre maître de Toulon, tout cela dans l’espace de trois jours. Le jeune commandant, qui savait qu’une place forte ne peut être enlevée que par les moyens ordinaires de la guerre, et non en vertu d’un morceau de papier ou d’un décret, ne tint nul compte de cet ordre absurde, et continua ses opérations. Par bonheur pour lui, Cartaux fut destitué, et la Convention mit à sa place le général Dugommier, militaire capable et intrépide ; celui-ci laissa le champ plus libre à Bonaparte. Le représentant du peuple Gasparin protégea d’ailleurs le jeune officier contre tous les obstacles qui lui furent suscités.
La ville et la plaine étaient commandés par le fort Mulgrave, citadelle réputée imprenable, et que les Anglais, qui s’étaient attachés à la rendre telle, avaient surnommée le Petit-Gibraltar. Bonaparte éleva contre elle une batterie destinée à la foudroyer : les Anglais, pour éteindre le feu de cette batterie, dirigèrent contre les artilleurs français une grêle incessante de boulets et de mitraille. Le poste était devenu si dangereux, que nul n’osait s’y tenir ; mais Bonaparte ordonna que cette batterie fût surnommée Batterie des hommes sans peur, et, la crainte d’être taxé de lâcheté surmontant toute autre crainte, le service des pièces ne fut point interrompu jusqu’à la prise du fort. Bonaparte, debout sur le parapet, encourageait lui-même les artilleurs et dirigeait leur tir. Il n’était pas seul à donner l’exemple de l’intrépidité. Un jour qu’il avait à transmettre un ordre, il demanda quelqu’un de bonne volonté pour écrire sous sa dictée. Un jeune sergent se présente. Comme ce dernier écrivait, un boulet lancé par les batteries anglaises le couvre de terre, lui et son papier. Le sergent se borne à dire en riant : « C’est bon, je n’aurai pas besoin de sable. » Un tel sang-froid annonçait une âme fortement trempée ; Bonaparte le comprit et fit la fortune militaire du jeune sergent. Le nom de ce dernier était Junot.
Le Petit-Gibraltar était pris. Bonaparte jugea que la position était bonne pour foudroyer la flotte ; mais les vaisseaux anglais se hâtèrent de gagner le large ; l’ennemi, dans sa fuite, incendia tous les navires français qu’il ne put emmener. L’armée française entra alors dans Toulon, et les représentants du peuple Fréron, Barras, Salicetti, Ricord et Robespierre le jeune, commissaires envoyés par la Convention, exercèrent les plus épouvantables représailles dans cette malheureuse ville. On comprit dans les vengeances de la république les innocents et les traîtres, et l’échafaud ayant paru trop lent pour les détruire, on y suppléa par la mitraille. On fit plus : on ordonna que le nom même de Toulon cesserait d’exister, et la malheureuse ville fut appelée Port de la Montagne. Bonaparte ne prit aucune part à ces mesures sinistres ; il n’était que soldat, et laissait à d’autres le rôle de juge. On sait, au contraire, qu’il profita de l’ascendant que ses services lui avaient acquis pour sauver un certain nombre de malheureux émigrés, parmi lesquels se trouva la famille de Chabrillant. Il faut dire néanmoins que, dès cette époque, il s’était concilié l’estime de Fréron et de Robespierre le jeune, et qu’il affichait hautement des opinions favorables au Comité de Salut Public. Vers ce temps-là il publia un petit opuscule intitulé Le souper de Beaucaire. C’est un dialogue entre un militaire, un Nimois, un Marseillais et un fabricant de Montpellier. Il est entièrement rédigé dans le sens du gouvernement de la Convention Nationale, contre les partisans de la Gironde, les aristocrates et les fédéralistes ; à son premier avènement au pouvoir, Bonaparte fit acheter par la police et détruire soigneusement les exemplaires de cet écrit qu’on parvint à saisir.
Dugommier, dans ses rapports au Comité de Salut Public, rendit justice aux talents qu’avait déployés Bonaparte devant Toulon : le grade de général de brigade, commandant l’artillerie de l’armée d’Italie, fut donné au jeune officier. Il s’en montra digne par de nouveaux services. Cependant les évènements du 9 thermidor avaient enlevé la puissance et la vie à Robespierre et aux autres chefs de la Montagne : cette journée amena dans les comités de la Convention divers changements qui influèrent sur l’avancement de Bonaparte. Il fut arrêté par ordre des représentants du peuple Albitte et Salicetti, auprès desquels il avait été calomnié ; mais sur les représentations énergiques qu’il leur adressa, sa conduite fut examinée de près, et il fut remis en liberté. Quelques jours après, le gouvernement, à l’instigation du représentant Aubry, voulut l’envoyer dans la Vendée comme général de brigade et d’infanterie ; il s’y refusa obstinément, et fut destitué par le Comité de Salut Public le 29 fructidor an II (15 septembre 1794.). Frappé de ce coup, auquel il ne s’attendait pas, Bonaparte rentra dans la vie privée, et se trouva réduit à une inaction intolérable pour l’ardeur de son caractère.
D’abord il se lia avec quelques mécontents, parmi lesquels se trouvait Salicetti, l’un des auteurs de la journée révolutionnaire du 1er prairial, pendant laquelle le peuple des faubourgs envahit la Convention Nationale et fit des victimes. Néanmoins les relations de Bonaparte avec les Montagnards ne furent jamais poussées au point de le compromettre : ce n’était pas par cette voie qu’il voulait parvenir. Cependant le temps se passait sans qu’il pût obtenir du service ; on n’écoutait aucune de ses demandes ; l’injustice aigrit son esprit. Il était tourmenté du besoin de faire quelque chose : rester dans la foule lui était insupportable. Il résolut de quitter la France, et l’idée favorite qui l’a toujours poursuivi depuis, que l’Orient est un beau champ pour la gloire, lui inspira le désir d’aller à Constantinople et de s’y vouer au service du Grand Seigneur : c’était un rêve qu’il ne réalisa pas plus que tant d’autres. Dans ces intervalles, Bonaparte fréquentait quelques salons, et entre autres ceux de Mme Tallien, si célèbre pour la part qu’elle avait prise à la chute de Robespierre, au renversement des échafauds et à la réaction qui s’opéra contre la Terreur. Les émigrés et les royalistes, dans leur reconnaissance, l’appelaient Notre-Dame de Thermidor. Bonaparte, introduit dans cette société, y rencontra souvent le représentant du peuple Barras ; mais le moment approchait où le jeune officier allait encore être tiré de l’oubli.
Depuis qu’un long cri d’épouvante avait répondu, dans le monde civilisé, au dernier soupir de Louis XVI, la guerre était devenue générale sur toutes les frontières de la république. Ce fut d’abord à la Prusse de faire franchir le Rhin aux vieilles légions du grand Frédéric, les plus redoutables de l’Europe par leur science et leur discipline. L’empereur d’Allemagne se joignit à cette puissance avec ses troupes et ses généraux, et tous les États de l’Italie se virent entraînés dans le même mouvement. La Hollande et l’Angleterre menaçaient la France au nord et sur toute la ligne de l’Océan ; l’Espagne lançait ses armées contre nous du haut des Pyrénées ; la Russie formait l’immense réserve de cette coalition continentale qui menaçait d’effacer la France du rang des peuples. L’avant-garde se composait des émigrés et des princes armés pour relever la monarchie et les droits que la révolution avait abolis. Telle était la tempête qui s’était formée au dehors.
Au-dedans, la situation était plus grave encore. Le crime du 21 janvier avait soulevé les provinces de l’ouest et les deux rives de la Loire Le Poitou, l’Anjou, la Bretagne et le Maine avaient été envahis par les armées royales de la Vendée, et sur tous les points, les troupes républicaines avaient dû céder au nombre ou à l’impétuosité de ces paysans, qui marchaient à la victoire en récitant les litanies et en invoquant le nom de ce Dieu dont l’impiété renversait partout les autels. La chute des Girondins retentit en Normandie, et y souleva une partie des populations. Les mêmes causes armèrent Lyon et créèrent des insurrections partielles depuis les Vosges jusqu’aux Bouches-du-Rhône. Partout la guerre civile, partout la famine, partout la mort. Pour résister à tant d’obstacles et combattre des ennemis si nombreux et si divers, la Convention Nationale n’avait sous ses ordres qu’un peuple ruiné par les assignats et déchiré par les querelles de partis. Elle-même perdait son temps à se décimer, et néanmoins elle ne recula point devant les extrémités de sa situation : le désespoir lui donna des forces.
Quatorze armées furent créées ; l’ennemi, vaincu à Jemmapes et à Valmy, mais plus heureux sur d’autres points, grâce à l’inexpérience des troupes et à de fausses combinaisons ordonnées par nos généraux, envahit plusieurs provinces du nord, de l’est et du midi. Il en fut chassé. La Belgique fut conquise et incorporée à la France ; déjà la Savoie avait eu le même sort ; il en advint autant de Nice, de son territoire et du Palatinat. Les batailles de Fleurus, de Wattignies, de Hondschoote, la reprise des lignes de Weissembourg, le siège de Mayence, et d’autres actions d’éclat, trop nombreuses pour qu’il soit possible de les énumérer ici, avaient contenu la coalition au nord et sur le Rhin ; au midi, on a déjà vu comment Toulon fut délivré des Anglais, le Piémont fut envahi ; les Espagnols furent battus et refoulés au-delà des Pyrénées. La Hollande fut conquise par Pichegru, et l’on vit une grande flotte, que retenaient les glaces, enlevée par la cavalerie française : cent mille hommes rassemblés autour de Lyon s’emparèrent de cette ville héroïque après un siège à jamais mémorable ; enfin la Vendée, aussi terrible à elle seule que tous les autres adversaires de la république, fut à son tour écrasée par les armées révolutionnaires et noyée dans le sang de ses enfants. À Paris, la lutte ne fut pas moins gigantesque. Les partis se faisaient la guerre la plus meurtrière dans les clubs et à la Convention, et chaque jour le tombereau de Fouquier-Tinville, l’accusateur public, portait à la guillotine les vaincus de la tribune et de la rue, les innocents et les coupables, les soldats et les chefs. La république, comme Saturne, et selon la prophétie de Vergniaud, dévorait ses propres enfants.
Lorsque Robespierre et ses complices eurent péri à la suite du 9 thermidor, la Convention Nationale mit à profit le calme que les victoires de nos armées avaient fait à la France, et travailla à une nouvelle constitution, dite de l’an III, dans laquelle se trouvaient résumés tous les principes révolutionnaires qui restaient encore debout sur le sol. Pour se soustraire à la réaction monarchique qui la menaçait de toutes parts, cette assemblée, à la veille de léguer ses pouvoirs législatifs aux Conseil des Anciens et des Cinq-Cents, imagina d’ordonner que les deux tiers de ces conseils seraient, dès le premier jour, composés de membres sortants de la Convention. Cette mesure souleva dans Paris une agitation universelle ; quarante-trois sections de cette grande capitale refusèrent de se soumettre aux décrets de la Convention, et s’insurgèrent contre cette assemblée. Ce fut le signal d’une nouvelle guerre civile. En quelques jours les royalistes se trouvèrent armés et disposés à renouveler contre le gouvernement républicain les scènes du 10 août et du 31 mai. Leur armée improvisée, mais pleine d’ardeur et d’enthousiasme, s’élevait à quarante mille hommes. La Convention pouvait à peine compter sur cinq mille défenseurs. La cause de cette assemblée fut encore compromise par la faiblesse du général Menou, chargé du commandement de Paris. Cet officier, au mépris de ses ordres, parlementa avec les insurgés de la section Lepelletier, et, par cette concession, donna aux royalistes une confiance et une audace qu’ils n’avaient point encore ressenties. Ils se préparèrent à attaquer le lendemain les Tuileries, où siégeait la Convention, et à se rendre maîtres du pouvoir. On était au 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).
La Convention Nationale avait compris le danger qui la menaçait. Elle ordonna l’arrestation du général Menou, et confia au représentant du peuple Barras le commandement des forces militaires de Paris. Barras, inhabile aux soins de la guerre, s’adjoignit le général Bonaparte, et lui prescrivit de prendre les dispositions que les circonstances réclamaient. Il était minuit.
Bonaparte, sans perdre un seul moment, ordonne au chef d’escadron Murat de s’assurer du parc d’artillerie établi dans la plaine des Sablons, aux abords de Paris ; Murat s’élance avec trois cents cavaliers, et ramène quelques heures après quarante pièces de canon, dont les royalistes n’ont point songé à se rendre maîtres, et que Bonaparte fait placer autour des Tuileries.
Les sections royalistes pouvaient disposer de quarante mille hommes. La Convention en comptait à peine huit mille réunis pour sa défense ; mais ceux-là étaient disciplinés et aguerris. Dans la matinée du 13 vendémiaire, la lutte devint imminente. En tête des royalistes marchaient les généraux Danican et Duboux. Le général Bonaparte avait établi sa première ligne de défense sur le côté gauche des Tuileries, le long de la rivière ; sur le côté droit, il avait fait occuper la rue Saint-Honoré, et toutes les rues qui y aboutissent. Ces dispositions avaient pour but d’isoler la Convention, de la protéger comme dans une citadelle, et de tenir tête aux insurgés.
À la fin, ceux-ci s’ébranlent par de grandes masses et débouchent à la fois par les deux quais, par le pont Royal et par la rue Saint-Honoré. Bonaparte dirige contre eux plusieurs pièces de canon chargées à mitraille, et les prend par le front et par le flanc ; les insurgés s’arrêtent et hésitent : ce moment est décisif. Les grenadiers républicains s’élancent en avant et achèvent l’œuvre de la mitraille. Vainement les royalistes se sont-ils retranchés à la butte Saint-Roch et sur le portail de l’église de ce nom ; ils sont foudroyés après une résistance meurtrière, et les débris de l’armée insurrectionnelle cherchent leur salut dans la fuite. Il était six heures : la Convention Nationale avait vaincu. Le nombre des morts s’élevait à près de quatre cents, la plupart tués dans les rangs de la population parisienne, sur laquelle, pendant le combat, Bonaparte avait fait tirer avec une impitoyable énergie. Quand les sections eurent été mises en fuite, on se contenta de charger les canons à poudre, afin d’effrayer ceux qui auraient été tentés de se rallier. Le lendemain on procéda au désarmement des sections ; mais la Convention, contre ses habitudes, usa avec modération de sa victoire. Pour en assurer les effets, le commandement de l’armée de l’intérieur fut confirmé à Barras, et le commandement en second à Bonaparte. Quelques jours après, le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795), la Convention Nationale abdiqua ses pouvoirs, et le gouvernement directorial fut installé
C’est peu de temps après la journée du 13 vendémiaire qu’eut lieu le mariage de Bonaparte avec Joséphine Tascher de la Pagerie, veuve du général Beauharnais, mort sur l’échafaud pendant la Terreur. Comme on venait de désarmer les sections, un jeune homme de quatorze ans se présente à Bonaparte et réclame l’épée de son père : c’était Eugène Beauharnais. Le général, charmé de cette démarche qui révélait de la part de son auteur un noble sentiment filial, ordonna que l’épée fût restituée à celui qui la revendiquait ainsi. Madame de Beauharnais vint remercier Bonaparte, et ce fut cette circonstance qui amena plus tard leur union. Outre son fils Eugène, madame de Beauharnais avait une fille nommée Hortense ; elle racontait souvent avec naïveté que, dans sa jeunesse, une prétendue magicienne lui avait annoncé qu’elle porterait un jour la couronne de France. Dans son élévation elle n’oublia point ses amis, et distribua beaucoup de bienfaits. Le peuple a conservé le nom de Joséphine comme un type de cette générosité gracieuse qui rehausse encore l’éclat du pouvoir.
Onze jours s’étaient à peine écoulés depuis le mariage de Bonaparte, que le jeune général reçut du Directoire l’ordre d’aller prendre le commandement de l’armée d’Italie (1796).
Bonaparte avait vingt-six ans, l’âge d’Annibal au début de la première guerre punique. Il remplaçait à l’armée d’Italie le général Schérer, homme de cœur, capable de vaincre, mais révoqué de son commandement pour n’avoir point su tirer parti de la victoire.
Bonaparte fut mal accueilli par les soldats et les officiers : les uns se défiaient de son inexpérience, les autres étaient jaloux de sa fortune. Tous lui reprochaient de n’avoir conquis son grade qu’en triomphant d’une révolte et en mitraillant le peuple de Paris. Qu’attendre d’ailleurs d’un homme si jeune, dont la taille était petite et grêle, et qui, sur ses joues creuses et livides, portait l’empreinte d’une fatigue prématurée ? Que ne s’essayait-il encore à combattre des bourgeois, au lieu de venir se mesurer contre l’élite des généraux et des troupes de l’Empire ? À quoi songeait le Directoire d’envoyer un tel capitaine à l’armée d’Italie ? N’était-ce pas la sacrifier avec un coupable dédain que de la confier à des mains si faibles, et de la faire servir à satisfaire l’ambition ou la vanité d’un courtisan de Barras ?
Mais ces inquiétudes s’évanouirent dès qu’on le vit parler et agir, et alors on reconnut en lui l’homme de génie qui a sa fortune à faire, mais dont la fortune se fera. Ayant rassemblé ses compagnons d’armes : « Soldats, » leur dit-il en montrant du haut des Alpes les fertiles plaines du Piémont et de la Lombardie, « vous êtes mal nourris, vous êtes nus : le gouvernement vous doit beaucoup, et ne peut rien pour vous. Votre patience, votre courage vous honorent, mais ne vous procurent ni avantage ni gloire. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde, vous y trouverez de grandes villes, de riches provinces ; vous y trouverez honneur, gloire et fortune. Soldats d’Italie, manqueriez-vous de courage ? » Et le frémissement qui agita ces vieux guerriers, et les acclamations qui montèrent jusqu’au ciel lui apprirent que désormais, soldats et général, tous les acteurs de cette grande scène avaient l’intelligence de leur propre valeur et de leur avenir : dès ce moment il pouvait tout oser.
Le quartier général était à Nice ; l’artillerie se trouvait dépourvue de chevaux pour les attelages, et le manque de fourrages avait forcé Schérer d’envoyer les chevaux de la cavalerie paître sur les bords du Rhône. Les principaux généraux que Bonaparte avait sous ses ordres étaient Masséna, né à Nice ; Augereau, ancien maître d’escrime ; Serrurier, ancien major ; Laharpe, Suisse expatrié ; Victor, soldat de fortune, et avec eux Joubert, Cervoni et quelques autres déjà renommés par de brillants faits d’armes. Les forces que ces chefs pouvaient mettre en ligne s’élevaient à trente mille hommes en deçà de l’Apennin ; il y avait, en outre, à Garessio, une division de six mille hommes commandée par Serrurier, et chargée de surveiller les Piémontais.
Deux armées, l’une piémontaise et commandée par Colli, l’autre autrichienne, sous les ordres de Beaulieu, général célèbre, débordaient les troupes françaises et leur opposaient environ quatre-vingt mille combattants bien disciplinés, bien pourvus de munitions et de vivres, deux cents pièces de canon et une forte cavalerie. Colli voulait couvrir le Piémont ; Beaulieu cherchait à se mettre en communication, du côté de la mer, avec la république de Gênes et la flotte anglaise.
Bonaparte jugea que son plan de campagne devait consister à séparer les deux armées ennemies, en pénétrant dans leur centre par le col le plus bas de l’Apennin. Beaulieu avait prévu ce système d’opérations ; mais les dispositions qu’il prit pour le contrarier tournèrent à la gloire de l’armée française. D’abord les Autrichiens réussirent à enlever quelques postes et à gagner du terrain ; mais ils ne purent parvenir à enlever la redoute de Montelegino, qui leur fermait la route de Montenotte. Cette position était défendue par le colonel Rampon, à la tête de douze cents hommes. Trois fois l’infanterie autrichienne, tout entière, s’élança pour s’en emparer ; trois fois cette poignée d’hommes réussit à la repousser avec perte. Au milieu du feu le plus meurtrier, Rampon fit prêter à ses soldats le serment de mourir dans la redoute ; ce sublime engagement fut suivi de prodiges de courage qui arrêtèrent l’armée autrichienne et permirent à l’armée française de prendre l’offensive (22 germinal. – 11 avril).
Bonaparte était à Savone. Il donne l’ordre à la division Laharpe de se replier sur la route de Montenotte, et à la division Augereau de soutenir ce mouvement. En même temps il envoie la division Masséna, par un chemin détourné, couper la retraite au corps d’armée que commande le général autrichien Argenteau. Le 23 germinal, le combat s’engage sur tous les points ; mais l’infanterie autrichienne, tournée dans ses positions, ne put que retarder sa défaite par une résistance inutile. Mise en déroute, elle s’enfuit sur Dego, laissant au pouvoir des Français plus de deux mille prisonniers et le champ de bataille couvert de morts. Telle fut la victoire de Montenotte : elle ouvrit à Bonaparte la route de l’Apennin.
Les Autrichiens s’étaient repliés sur Dego, gardant la route d’Acqui en Lombardie. Les Piémontais couvraient la route de Ceva et du Piémont. Bonaparte se trouvait dans la vallée de la Bormida, ayant les Autrichiens en face de lui et les Piémontais à sa gauche. Avec ses troupes fatiguées du glorieux combat de la veille, il lui fallait vaincre en même temps les deux armées coalisées. Il n’hésita point à ordonner une double attaque. Par l’effet de ses dispositions, Augereau aborda les Piémontais retranchés dans les profondes gorges de Millesimo, et les chassa de cette position formidable après quarante-huit heures d’une lutte à peine interrompue par la nuit ; en même temps Laharpe et Masséna se précipitèrent, avec des forces très inférieures, sur les Autrichiens rangés en bataille à Dego, et qui avaient reçu de nombreux renforts. Dego fut enlevé ; mais les Autrichiens le reprirent à la faveur de la nuit. Le lendemain, le combat recommença avec plus d’acharnement ; les Français, d’abord arrêtés par la résistance des grenadiers autrichiens, parurent hésiter ; mais enfin ils redoublèrent d’énergie et de dévouement, et la victoire récompensa leur audace : partout l’ennemi fuyait devant eux ; on s’était battu durant cinq jours.
Les victoires de Montenotte, de Dego et de Millesimo avaient coûté aux armées étrangères neuf mille prisonniers, trente-cinq pièces de canon, vingt drapeaux, un nombre très considérable de blessés et de morts. Elles avaient eu des résultats stratégiques d’une importance plus grande encore. Une fois les Piémontais et les Autrichiens battus et contraints de fuir par des routes opposées, Bonaparte se trouvait en mesure de pénétrer au-delà des monts et d’asseoir au cœur même de l’Italie la base de ses opérations militaires. Il avait conquis les chemins du Piémont et de la Lombardie, et, ce qui valait mieux peut-être, il était devenu en peu de jours l’objet de l’admiration commune des généraux et de l’armée. Quand ses troupes, des hauteurs de Monte-Zemoto, aperçurent derrière elles les Grandes Alpes couvertes de neige, elles comprirent le plan de leur jeune général ; Bonaparte lui-même s’écria avec enthousiasme : « Annibal avait franchi les Alpes ; nous les avons tournées. » Ce peu de mots résumait tout le secret de la campagne. Mais le jour devait venir où il ne laisserait à Annibal le privilège d’aucune gloire. Le général Colli, retranché à Ceva avec ses Piémontais, avait été chassé de cette position et s’était replié d’abord derrière la Cursaglia, puis sur Mondovi. Il y fut battu et abandonna le champ de bataille, après avoir perdu trois mille hommes tués ou prisonniers. La victoire de Mondovi livra aux Français la place de Cherasco.
Ils y étaient lorsque le roi de Sardaigne, épouvanté des succès rapides de Bonaparte, demanda un armistice : il ne l’obtint qu’en donnant pour garanties aux Français les places de Coni, de Tortone et d’Alexandrie, et en mettant à la disposition de nos troupes des magasins immenses. Dès lors, l’armée de Bonaparte n’avait plus à redouter la faim, le froid et les privations de toute espèce ; elle se trouvait abondamment pourvue de vivres et de vêtements, et pour comble d’avantages, ses opérations étaient protégées par les trois plus fortes places du Piémont. Cependant Bonaparte l’exhorta à de nouveaux travaux et à de nouvelles fatigues. En même temps il annonça à la France les succès rapides de son armée et fit porter au Directoire, par son aide de camp Murat, avec le récit de ses triomphes, vingt-un drapeaux pris à l’ennemi. Les conseils de la république décidèrent par trois fois que l’armée d’Italie avait bien mérité de la patrie, et comme tout, dans cet hommage, devait rappeler l’antiquité païenne, ils décrétèrent une fête à la Victoire.
Mais voilà que les plaines de la haute Italie sont ouvertes ; Bonaparte laisse derrière lui le Piémont ; il s’élance vers la Lombardie. Beaulieu, pour s’opposer à sa marche impétueuse, concentre ses forces entre la Sesia et le Tésin ; une manœuvre habile lui donne le change, et Bonaparte franchit le fleuve non loin de l’Adda. Il occupe sans coup férir Plaisance, Fombio, Casal. Restait à traverser l’Adda, l’un des affluents considérables qui, du haut des Alpes, descendent au Pô. Bonaparte ne recule point devant cet obstacle, il se dirige vers le pont de Lodi ; il atteint ce poste où doit s’opérer le passage de l’armée. L’armée autrichienne l’a devancé et couvre de ses nombreux bataillons la rivière, le pont, la ville. En quelques instants d’une attaque meurtrière, Bonaparte chasse l’ennemi de Lodi ; mais, sur l’autre rive, douze mille hommes d’infanterie, quatre mille cavaliers et vingt pièces de canon habilement dirigées faisaient du passage du pont une entreprise chimérique. Il fallait cependant le franchir ou se fermer les routes de la Lombardie. Bonaparte se porte sur les flancs du fleuve ; au milieu d’une grêle de balles et de mitraille, il arrête son plan d’attaque : par ses ordres, la cavalerie remonte l’Adda pour la passer à un gué, au-dessus de Lodi. En même temps six mille-grenadiers, l’élite de l’armée, commandés par Masséna, se forment en colonne, serrent leurs rangs et s’élancent sur le pont au pas de course. L’ennemi dirige contre ces braves un feu épouvantable qui les arrête ; mais leur hésitation est de peu de durée. Soutenus par la voix et par l’exemple de leurs généraux, ils reprennent leur élan, se précipitent en aveugles sur les batteries ennemies, massacrent les canonniers et écrasent à la baïonnette la vieille infanterie autrichienne. En ce moment la cavalerie, qui avait réussi à trouver un gué, débouche sur la rive gauche de l’Adda et complète la victoire (30 germinal).
La bataille de Lodi livrait aux Français Crémone et Pavie ; mais Bonaparte poursuivit sa route vers Milan. À son approche, l’archiduc abandonna cette capitale en versant d’impuissantes larmes ; le parti qui, d’accord avec l’armée française, travaillait à révolutionner l’Italie, devint dès lors maître de cette ville : au lieu de la disputer à Bonaparte, il se disposa à l’y recevoir en libérateur. Le 26 floréal (15 mai), un mois après l’ouverture de la campagne, Bonaparte fit son entrée à Milan, au milieu d’un peuple immense qui se livrait follement aux démonstrations de l’espérance et de la joie. On se pressait pour admirer, pour voir ce jeune capitaine, inconnu la veille, et qui, dès le début de sa carrière, avait grandi sa renommée à l’égal des hommes d’Homère. Bonaparte, à peine installé à Milan, organisa militairement le territoire conquis et le frappa d’une contribution de vingt millions de francs. Le duc de Modène fut trop heureux d’acheter un armistice ; le duc de Parme se soumit ; on espéra que Rome et Naples ne tarderaient pas à suivre son exemple. Alors, dans l’ivresse de ses succès, Bonaparte adressa à ses soldats une nouvelle proclamation qui se terminait ainsi : « Vos victoires feront époque dans la postérité ; vous aurez la gloire immortelle de changer la face de la plus belle partie de l’Europe. Le peuple français, libre, respecté du monde entier, donnera à l’Europe une paix glorieuse,… et, quand vous rentrerez dans vos foyers, vos concitoyens diront en vous montrant : Il était de l’armée d’Italie. »





























