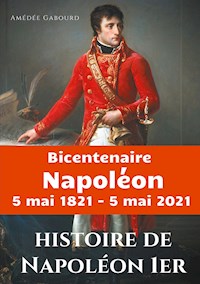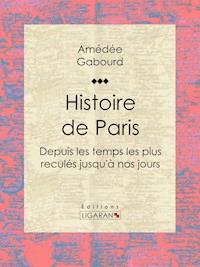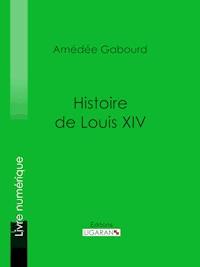
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : " Richelieu venait de mourir, et Louis XIII, le premier vassal de son ministre, n'avait pas tardé à le suivre dans le tombeau : la France, encore émue des souvenirs peu glorieux de la régence de Marie de Médicis et de Concini, se voyait avec inquiétude réservée la minorité d'un roi de cinq ans."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Résumer dans un tableau rapide les évènements et la pensée d’un grand règne ; retracer le mouvement social, les agitations et le repos d’un siècle qui occupe une large place dans l’histoire ; dire quelle fut alors la pente de l’opinion, quelle marche suivirent les idées, sous quelles inspirations fécondes l’art se manifesta ; faire apparaître au-dessus de ces glorieux éléments, comme on place un casque sur un trophée, la figure froide et majestueuse de Louis XIV, et ne laisser dans l’ombre rien de ce qui pourrait servir à caractériser ce roi et son époque, telle a été la tâche difficile que nous avons entreprise en écrivant ce livre.
Nous pouvons nous rendre ce témoignage, que, dégagé de toute préoccupation systématique, nous n’avons cherché que la vérité, veillant sur nous, afin de nous tenir en garde contre toute passion dans le blâme ou dans la louange. Au milieu des jugements multiples et contradictoires dont la personne, la vie et le gouvernement de Louis XIV ont été l’objet, nous nous sommes efforcé de démêler, par une étude sérieuse, ce qu’il faut croire ou rejeter dans les traditions vulgairement reçues. Et comme parmi les idées dont l’enchaînement et le tissu forment le fond de l’histoire, il en est qui de leur nature sont variables, qui se modifient, qui meurent, qui renaissent, d’autres qui ont pour elles les temps et les lieux, nous avons évité avec un soin scrupuleux de juger avec les idées contemporaines les hommes qui existèrent ou agirent sous l’empire des idées d’un autre siècle. On ne trouvera donc dans ce livre rien qui soit de l’essence du pamphlet ; on n’y verra aucune prétention d’accommoder le passé au service des opinions actuelles.
Nous appartenons à une école historique essentiellement opposée au fatalisme, et peu nous importe qu’une idée soit vaincue pour la défendre, si elle est vraie : nous ne connaissons aucune nécessité qui excuse le crime, aucun privilège qui rende le vice moins hideux. Surtout nous nous plaisons à remonter à la cause supérieure, à étudier avec respect l’accomplissement de cette pensée providentielle qui toujours se déploie, tantôt visible, tantôt inaperçue, au milieu de la confusion des choses humaines. Nous admettons fermement que la liberté humaine agit avec une indépendance pleine et entière, et concourt, néanmoins, à son insu, à établir cette sublime et consolante vérité “ que Dieu nous mène ” : merveilleux mystère que nous ne pouvons comprendre et qui nous éblouit de ses clartés.
Notre cadre a eu trop peu d’espace pour que nous ayons pu donner au récit des faits particuliers de la vie et du règne de Louis XIV un développement aussi étendu qu’on l’aurait peut-être désiré. Des évènements qui embrassent près d’un siècle et qui ont puissamment réagi sur l’esprit humain, ne sont point de ceux qu’on analyse suffisamment en quelques pages. Pour surmonter cet obstacle, nous ayons cru devoir insister particulièrement sur les détails et sur les actes qui ont exercé une influence durable et pesé de quelque poids dans la balance. On s’étonnera donc peu si nous avons résumé avec une extrême concision des faits militaires qui se ressemblent presque tous, des opérations de guerre toujours les mêmes, des plans stratégiques dont l’examen serait sans profit ; et si, d’autre part, nous nous sommes appliqué avec une certaine complaisance à mentionner tout ce qui pouvait se rattacher à l’histoire des mœurs, de la société, de la littérature et de la pensée : voilà ce qui demeure et ce qui surtout appelle la méditation.
Nous avons adopté la division par chapitres : cette méthode est indispensable à celui qui a besoin de parler dans un livre assez court d’une foule de choses qui se croisent sans cesse et dont la diversité tend à dérouter l’esprit. Lorsqu’on écrit une histoire générale avec ses vastes développements, l’ordre des dates est le seul qu’on doive choisir, parce que les faits, étant racontés avec étendue, conservent leur caractère distinct et ne sont point exposés à être tronqués ou perdus de vue ; mais, quand on entreprend une œuvre de moindre haleine, la clarté du récit conseille la marche que nous avons suivie ; elle s’accorde moins avec la chronologie, et davantage avec la nature ; elle seule enfin permet de comprendre et de retenir l’esprit de l’histoire.
Si dans ce livre, tel que nous l’offrons au public, on rencontre des choses bonnes et utiles, ce n’est pas à nous que l’éloge doit revenir, c’est à celui qui nous demandera un compte sévère du moindre don qu’il nous aura confié pour la gloire de son nom.
Paris, mai 1844.
A.G.
Richelieu venait de mourir, et Louis XIII, le premier vassal de son ministre, n’avait pas tardé à le suivre dans le tombeau : la France, encore émue des souvenirs peu glorieux de la régence de Marie de Médicis et de Concini, se voyait avec inquiétude réservée à la minorité d’un roi de cinq ans.
Les matériaux d’un grand règne étaient amassés, mais la main qui, plus tard, devait les mettre en œuvre ne se trouvait point encore assez forte pour s’en servir. La paix régnait au-dedans ; nos armes triomphaient au-dehors. L’autorité royale s’exerçait librement, mais cette prépondérance, péniblement conquise, grâce à la force et aux supplices, n’était encore entrée dans les mœurs du pays que par la crainte. Là où l’on avait comprimé les réclamations et les droits, on disait que l’ordre était établi : de longues années allaient s’écouler, de nouvelles agitations troubler la France avant l’heure où, la rébellion lassant le peuple, paralysant les intérêts, et favorisant les entreprises de l’étranger, la France irait d’elle-même au-devant du pouvoir absolu, la noblesse abdiquerait, toutes les forces sociales se confondraient dans le sceptre : période d’enivrement royal qui devait être consacrée par la gloire, fortifiée par l’opinion, et qui néanmoins, pour un petit nombre d’hommes (s’il en était) initiés aux secrets de l’avenir, renfermait déjà en son sein des germes de dépérissement et de ruine.
Richelieu, à son avènement aux affaires, avait trouvé la France dépourvue de grandeur et de sécurité : d’un côté, les princes du sang, les favoris, la reine mère, se disputaient l’influence ; de l’autre, les protestants, enhardis par les positions fortes que leur avait faites l’édit de Nantes, tenaient en échec les armées de Louis XIII et bravaient avec impunité les ordres du roi. Les guerres de religion avaient d’ailleurs donné à la noblesse de cour et de province un ascendant redoutable au pouvoir royal ; les intrigues de Marie de Médicis, les prétentions vaniteuses de Gaston d’Orléans, le scandale récent des fortunes du maréchal d’Ancre et de Luynes contribuaient encore à paralyser l’administration, à encourager les ambitieux, à livrer la chose publique au plus adroit. C’était avec de pareils éléments de décomposition qu’il fallait maintenir l’ordre à l’intérieur et étendre sur les champs de bataille et dans les congrès de l’Europe la prépondérance de la nation française.
Richelieu, loin de reculer devant cette œuvre, l’avait au-contraire dépassée, et d’abord il avait eu à vaincre la répugnance instinctive que sa domination inspirait au roi lui-même. Comme tous les hommes doués à un haut degré du savoir de parvenir, il s’était successivement rendu utile, nécessaire, indispensable ; arrivé à ce dernier degré, il s’y était maintenu en inspirant à son maître beaucoup de crainte et plus de confiance encore. Louis XIII le subissait avec déplaisir, mais avec sécurité, comme on se courbe sous un ascendant qui humilie et qui sauve. Rappeler tout ce que la mère et le frère du roi entreprirent pour ruiner l’influence du ministre et y substituer un joug plus commode, mais moins digne, ce serait entreprendre le récit d’une longue série de ruses toujours déjouées, de nombreuses faiblesses cruellement expiées. Ce qui est certain, c’est que la plus grande énergie de Richelieu fut consacrée à triompher de ces misérables luttes : il lui fallut perdre plus de talent à rompre, l’un après l’autre, les réseaux à peine visibles dont on cherchait à l’emprisonner, qu’il n’eut besoin d’en dépenser pour arriver à abattre l’influence européenne de la maison de Charles-Quint.
Les ennemis du cardinal n’étaient point tous à Paris ou à Saint-Germain ; il en comptait partout où se trouvait encore un seigneur poursuivant de ses regrets les souvenirs du régime féodal. Le pouvoir des grands, amoindri par la politique de Charles VII et les entreprises de Louis XI, contenu par la fermeté de madame de Beaujeu et la rivalité des parlements, relégué dans la révolte, comme dans une exception, en la personne du connétable de Bourbon, s’était peu à peu rétabli à la faveur des guerres religieuses et de la conjuration des Guise. Henri IV, gentilhomme de vieille souche avant d’être roi, et qui devait beaucoup à l’appui de la noblesse protestante, laissa volontiers les grands du royaume, ses anciens compagnons d’armes, ressaisir sinon leurs privilèges régaliens, du moins l’influence et la prépondérance que donnent la possession du sol et les souvenirs récents de la vertu militaire. En face de Concini et de Luynes, les représentants de l’ancienne féodalité se sentirent plus à l’aise : les uns intriguèrent à la cour, tantôt avec Marie de Médicis, tantôt avec Gaston d’Orléans, et se montrèrent fort peu soucieux de l’honneur ou des intérêts de la France dans les questions où leur amour-propre était engagé : c’était chose vulgaire, et dont leurs auteurs tiraient gloire, que de s’entendre avec les souverains d’Allemagne ou d’Espagne, de leur livrer des positions ou des places fortes, et de réclamer leur appui contre le cardinal ministre. Ainsi avait fait Cinq-Mars, qui paya de sa tête cette trahison et que la pitié du peuple a fait passer pour victime ; Montmorency, qui ne fut pas davantage épargné par le bourreau, s’était borné à participer à la guerre civile ; pour le duc de Bouillon, il s’était humilié et avait eu la vie sauve. Si ce fut un bonheur pour lui, ce n’en fut pas un moins grand pour Richelieu que de voir tant de hautes têtes courbées sous sa hache ou sous sa clémence plus dure encore.
L’exil et la mort avaient fait raison au ministre de la féodalité et des princes : la guerre ouverte lui permit d’abaisser l’orgueil des protestants. La Rochelle, qui servait de boulevard à l’hérésie, fut prise et démantelée après un long siège, et la république calviniste se vit ainsi étouffée à son berceau. Cette victoire remportée sur les rebelles du dedans avait permis au cardinal de tourner les forces de la France contre les ennemis extérieurs.
Il y eut alors de par le monde un grand scandale, celui de voir un cardinal, prince de la sainte Église romaine, prêter main-forte aux protestants d’Allemagne contre les armes du césar catholique. L’empereur Ferdinand ayant entrepris de s’opposer aux progrès de la réforme luthérienne, l’exécution de ce vaste projet avait suscité la fameuse guerre de Trente ans, guerre politique autant que religieuse. Richelieu se fit un mérite et un honneur de préférer l’intérêt temporel de la couronne de France aux intérêts immuables de la foi : ce fut lui qui attira en Allemagne Gustave-Adolphe, roi de Suède, et lui fournit les subsides nécessaires pour ébranler le trône impérial ; de son côté, il envoya un héraut à Bruxelles déclarer solennellement la guerre à l’Espagne, et, bien que ses premiers efforts n’eussent point été heureux, bien que l’armée ennemie eût un moment menacé nos places de la Somme, il n’en réussit pas moins plus tard à faire respecter la frontière et à séparer la Catalogne de la monarchie espagnole. Au moment où cet homme disparut de la scène du monde, l’œuvre qu’il avait commencée en Allemagne était à moitié accomplie ; les bases de la paix de Munster, si préjudiciable à la prépondérance de l’Église, étaient jetées et devaient être, à deux reprises, consolidées par la victoire. Ainsi croissait l’influence de la France, en même temps que s’amoindrissait la prépondérance de la maison d’Autriche : c’est à la faveur de ces circonstances que s’ouvrit le règne de Louis XIV.
Ce prince, né à Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638, était fils de Louis XIII et petit-fils de Henri le Grand ; sa mère, Anne d’Autriche, le mit au monde après vingt-deux ans de stérilité : il n’avait point encore atteint sa cinquième année lorsque la mort de son père, survenue le 14 mai 1643, le laissa roi de France et héritier des plans et de la politique de Richelieu. Aux termes du testament de Louis XIII, la régence allait appartenir à la reine mère ; mais l’exercice de l’autorité, déposée entre les mains d’Anne d’Autriche, devait être tempéré par un conseil dont le duc d’Orléans et le prince de Condé étaient les chefs désignés. Ce testament avait été écrit en défiance des intentions et de la capacité de la reine mère. Louis XIII, craignant pour son fils la tutelle d’un prince moins intéressé qu’Anne d’Autriche à écarter de cette royale tête les dangers qui la menaçaient, avait néanmoins voulu resserrer dans des limites étroites et soupçonneuses la prérogative de la régente : ces dispositions ne furent point respectées ; Anne d’Autriche en appela au parlement de Paris.
Cette cour de justice, comme tous les corps dont les pouvoirs ne reposent que sur des traditions et des faits naturellement mobiles, n’avait que des attributions mal définies. Dans l’origine elle avait été instituée pour appliquer et interpréter le droit civil et les coutumes ; elle suivait les rois dans leurs excursions, afin qu’il fût bien prouvé que la justice émanait du souverain et ne pouvait être distraite de son autorité : plus tard la nécessité des affaires introduisit des changements à cet état de choses ; le parlement fut autorisé à résider à Paris, et dès ce moment l’opinion publique commença à tenir compte de lui. On peut dire que les circonstances firent tour à tour sa force ou sa faiblesse. Quand l’autorité royale paraissait amoindrie ou contestée, quand la tranquillité publique était mise en question, le parlement s’érigeait en médiateur, il se constituait de lui-même assemblée politique, et, sous prétexte d’affermir le droit royal, il se posait en tuteur et en conseiller de la couronne. On l’avait vu régler la police, rendre des arrêts en matière de culte, mettre au ban du royaume les perturbateurs, condamner Charles VII au profit de l’Angleterre, intenter un procès criminel à Henri III, en un mot administrer et gouverner sous prétexte de jurisprudence. C’est dans ces intervalles d’exaltation qu’il affectait tous les dehors d’un corps de l’État, imposait silence à la noblesse d’épée et prescrivait aux gens de guerre de respecter la loi et la toge. Comme tout ce qui est justice ou même apparence de justice est de beaucoup préférable aux caprices des décisions arbitraires, les seigneurs, les grands du royaume, les princes du sang eux-mêmes avaient fortifié le pouvoir du parlement en y ayant recours dans leurs contestations et leurs querelles. Mais, quand les jours d’orage passaient, quand les rois ou leurs ministres avaient surmonté les obstacles les plus sérieux, ils considéraient avec inquiétude le terrain que le parlement avait conquis à la faveur des difficultés et des troubles ; c’était alors leur coutume de protester contre les usurpations de cette réunion de scribes et de légistes, sans titre et sans qualité pour s’immiscer dans les choses de l’État ; on rappelait au parlement son origine précaire et douteuse ; on lui démontrait, non sans raison, qu’il ne relevait que du roi et non du peuple, et que, n’ayant d’autre racine dans la monarchie que le bon plaisir du prince, il ne pouvait sans danger se poser comme un pouvoir politique prenant conseil de soi-même et se déterminant d’après un droit reconnu. Le parlement, selon le degré de son énergie, résistait plus ou moins à ces représentations ; il arguait de la prérogative de remontrance qu’un long usage lui avait acquise ; il opposait aux édits royaux une résistance d’inertie qu’on appelait refus d’enregistrer, et qui, au fond, paralysait souvent la volonté royale. Dans cette lutte, le plus fort finissait par l’emporter sur l’autre, et le plus fort était encore le roi, grâce à l’appui de la noblesse et de l’armée.
C’était dans cette dernière situation que Richelieu avait laissé les choses. Cet homme, si jaloux de son autorité que toute résistance lui semblait criminelle, avait contraint le parlement à se renfermer, une fois encore, dans l’examen des procès et dans l’étude des textes judiciaires, et les gens du roi et de la cour avaient repris le joug en le maudissant.
La minorité du jeune Louis XIV et les prochains embarras d’une régence leur présentaient une conjoncture heureuse pour ressaisir l’influence. Le parlement n’eut garde de la laisser échapper, et quand Anne d’Autriche, imitant l’exemple que lui avait donné la veuve de Henri IV, vint déférer à ses décisions le testament du dernier roi, il s’empressa de faire à la fois acte de courtisan et démonstration de puissance politique en émancipant de toute entrave l’autorité de la régente. Ajoutons que, si deux reines mères avaient ainsi consenti à réclamer du parlement de Paris la plénitude du droit de régence que leur attribuaient les précédents de la monarchie, elles ne l’avaient fait qu’en espérant que ce corps n’oserait refuser d’obtempérer à leurs demandes : l’ambition recherchait la complicité de la peur pour affaiblir le principe de la royauté au profit d’un avantage de circonstance.
Anne d’Autriche fut déclarée régente absolue ; le conseil qui devait limiter son pouvoir fut supprimé ; le prince de Condé, gagné par les promesses de la reine, ne fit aucune tentative pour soutenir ses prétentions ; Gaston d’Orléans, oncle de Louis XIV, prince sans énergie et sans autorité morale, se résigna à n’avoir dans le gouvernement d’autre part que le vain titre de lieutenant général du royaume sous la régente. En échange de l’arrêt du parlement qui consacrait cette situation nouvelle, la reine mère rappela de l’exil plusieurs membres de cette cour exilés sous le règne précédent par ordre du cardinal Richelieu, et ce ne furent pas les seuls proscrits qui rentrèrent en grâce.
À l’inflexible Richelieu avait succédé, en qualité de premier ministre, le cardinal Mazarin (Giulio Mazarini), homme souple et artificieux, mais non moins tenace, sous les apparences de la mollesse et du laisser-aller, que son implacable prédécesseur dans l’appareil de la force et de la puissance. L’un et l’autre marchaient à leur but, qui était de rendre la couronne royale indépendante de tout contrôle ; mais, chez Richelieu, cette conduite était le résultat d’une conviction énergique et la déduction naturelle d’un principe fort ; chez Mazarin, au contraire, s’il est possible d’en juger en connaissance de cause, l’amour du pouvoir n’eut trop souvent en vue que la satisfaction de l’orgueil et l’ambition du ministre. Richelieu voulait gouverner pour appliquer un système, Mazarin pour le plaisir d’être aux affaires, de dispenser la faveur et de s’enrichir sans oublier ses proches. Le premier donnait le pas aux intérêts du roi et de la gloire de la France ; l’autre, sans se montrer indifférent à ces grands motifs, ambitionnait surtout l’honneur d’associer sa fortune à celle de la cour ; l’un marchait à son but par la route droite, l’autre par la voie oblique, et tous deux arrivaient ; l’un était Français de cœur, de courage et de caractère, l’autre Italien par le sang et le génie ; le premier détesté et admiré, le dernier haï et méprisé jusqu’à l’injustice ; tous deux, enfin, destinés à se compléter l’un par l’autre.
Quand les ressorts d’un pouvoir ont été fortement tendus, il n’est pas inutile à la popularité de ceux qui en héritent de montrer un esprit de conciliation et de retour. Il y a, dans ce régime de concession, une mesure que la prudence conseille et que l’expérience limite. Surtout il est nécessaire que la réaction débonnaire soit et paraisse effectivement le résultat pur et gratuit de la clémence royale, du besoin que le souverain éprouve d’appeler à soi plus encore l’amour que la crainte du peuple ; tout est compromis si une faiblesse inopportune, si des retraites continues donnent un seul moment à penser que l’autorité fléchit parce qu’elle est moins forte ; alors, en effet, il ne manque pas de mains qui se croient faites pour se saisir des rênes du gouvernement et participer à la curée des choses publiques.
Pour le moment on respirait plus à l’aise, et c’était déjà beaucoup : les courtisans et les seigneurs que Richelieu avait disgraciés, emprisonnés ou bannis, commençaient peu à peu de reparaître à Saint-Germain. Parmi eux on remarquait le maréchal de Bassompierre, le représentant des idées féodales, et le maréchal de Vitry, dont la fortune n’avait eu d’autre source que le meurtre de Concini : c’était, pour cette époque, la nouvelle et l’ancienne noblesse, ou, pour mieux dire, la grandeur traditionnelle et historique associée à la fortune de fraîche date, et celle-ci ne pouvait guère se parer que de services de chambellan ou de sergent aux gardes : l’amnistie, sans être complète, avait suffi pour gagner les cœurs à la reine et rendre plus faciles les commencements du pouvoir de Mazarin. Celui-ci, qui d’ailleurs avait à se faire pardonner par la reine l’ancienne amitié de Richelieu, affecta de se montrer humble et modeste ; il allait dans un carrosse très simple, parfois à pied, toujours sans gardes et sans escorte, cherchant à s’effacer et à s’amincir de son mieux, affectant d’être las du fardeau des affaires et hâtant en apparence de ses vœux le moment où il plairait à la reine de le renvoyer en Italie. Ce serait bien peu connaître le caractère français que de croire qu’on se défiât de cette façon d’agir ; on s’y laissa prendre au contraire, et, avant les autres, la reine ; puis, quand chacun se vit dupe, il était trop tard pour déraciner l’influence du rusé cardinal.
Cependant il se forma à la cour un parti de tous les hommes que Richelieu avait persécutés. Récemment sortis de l’exil ou de la captivité, ils s’étaient trouvés naturellement réunis par une haine commune contre l’artisan de leurs disgrâces : l’instinct du ressentiment et de la vanité était le seul qu’ils prissent pour règle. Incapables qu’ils étaient de se rendre compte des besoins du gouvernement et des nécessités publiques, ils identifiaient l’intérêt de la France avec les soucis de leur amour-propre, ils ne portaient jamais leurs regards au-delà de Saint-Germain, où les grandes affaires étaient, pour eux, les présentations officielles et les tabourets reconquis. Sans autres titres que les déboires, souvent très mérités, que leur avait infligés Richelieu, ils se croyaient destinés à lui succéder et à gouverner le royaume. On les appela les importants : leur cabale ne tarda pas à s’étonner qu’on osât lui dénier le droit de mettre en tutelle la France et la régente. Si précaire que parût le pouvoir de Mazarin, comme il se prolongeait au-delà de toute prévision, les importants se plaignirent à la reine et demandèrent le renvoi du ministre ; Anne d’Autriche résista ; les ennemis du cardinal, grandement étonnés de ce refus, se jetèrent dans la voie des intrigues. Les duchesses de Montbazon et de Chevreuse, qui dirigeaient cette coterie, furent exilées de la cour ; le duc de Beaufort, petit-fils de Henri IV par son père, César de Vendôme, se crut assez haut placé pour s’emporter en reproches contre la reine, et en menaces contre le cardinal ; le 2 septembre 1643, il fut arrêté et enfermé au château de Vincennes. Augustin Potier, évêque de Beauvais, vieillard honnête, mais inintelligent, que les importants opposaient à Mazarin, fut obligé de se retirer dans son diocèse et de renoncer pour toujours aux affaires. Ce prélat, dont on faisait un chef de parti, avait été un moment ministre, et un seul acte de lui, au dire de ses ennemis, avait suffi pour donner la mesure de sa portée d’esprit : on assurait qu’à son avènement au pouvoir il avait signifié aux Hollandais « qu’ils eussent à rentrer dans le sein de l’Église catholique s’ils voulaient demeurer les alliés de la France. » Tel était l’homme qui se posait pour l’héritier des desseins de Richelieu et pour l’adversaire de Mazarin ; la mesure de rigueur prise contre lui déconcerta la cabale. Pour en finir avec cette coterie, nous mentionnerons le jugement que porta sur elle le cardinal de Retz : « c’était un parti composé de cinq ou six esprits mélancoliques, qui avaient la mine de penser creux, qui sont morts fous, et qui dès ce temps-là ne paraissaient guère sages. »
La duchesse de Chevreuse, exilée par Mazarin, avait été bannie pendant dix-huit ans par Richelieu, qui, sous le dernier règne, voulait la punir de sa trop grande participation aux intrigues d’Anne d’Autriche : comme elle disait avoir beaucoup souffert pour la reine, elle comptait sur une faveur égale à ses chagrins ; elle présuma trop, sans doute, de ses droits à la reconnaissance de la régente : élevée à la cour, elle aurait dû en connaître l’habitude. Quoi qu’il en soit, sa disgrâce et l’emprisonnement d’un petit-fils de Henri IV révélèrent tout l’ascendant qu’en moins de trois mois le cardinal Mazarin avait su prendre sur l’esprit de la reine. Le ministre avait été moins heureux dans ses tentatives pour complaire à la nation ; son avarice le discréditait, son ignorance de la langue française le rendait ridicule, sa qualité d’étranger le faisait haïr. Plus habile à nouer une intrigue et à négocier avec ses ennemis qu’à porter l’ordre dans l’administration et la régularité dans les finances, il avait laissé s’opérer d’intolérables dilapidations dont le public était victime. Comme il fallait des sommes considérables pour soutenir la guerre contre l’Espagne et l’Empereur, le gouvernement avait eu recours, pour se procurer des subsides, à des expédients sans dignité et sans loyauté : des mesures fiscales, mal concertées et justement odieuses, avaient indisposé le peuple de Paris et mécontenté le parlement ; en dépit des réclamations les plus sages, le gouvernement persévérait dans cette voie dangereuse, qui chaque jour alarmait l’opinion et aliénait les esprits les mieux disposés.
Cependant la cour et la France se laissaient encore distraire de ces préoccupations par les évènements de la guerre. Le nouveau règne s’était ouvert au bruit des victoires.
Le génie de Richelieu avait créé six armées : celle de Flandre était placée sous le commandement du duc d’Enghien, jeune homme de vingt-deux ans, fils aîné du prince de Condé. L’armée d’Allemagne, ayant à sa tête le maréchal de Guébriant et, après lui, Gassion et Turenne, avait, dès l’année précédente, franchi le Rhin à Wesel et soumis l’électorat de Cologne. L’armée des Pays-Ras était commandée par le duc d’Orléans, et celle d’Italie par les maréchaux de la Meilleraye et Duplessis Praslin ; le maréchal de la Mothe, à la tête d’une cinquième armée, qui, plus tard, fut mise sous le commandement de Schomberg, occupait le col de Balaguer et s’épuisait en Catalogne à des sièges et à des marches difficiles ; la flotte obéissait à l’amiral de Brézé. Grâce aux efforts de ces armées, la France se voyait maîtresse de l’Alsace, de la Lorraine, des passages des Alpes et du Roussillon ; elle triomphait en Italie, en Flandre, en Allemagne, en Catalogne ; et la maison d’Autriche, attaquée sur tous les points, voyait se développer autour d’elle les plans, la politique et les menaces de Richelieu.
L’avènement d’un roi de cinq ans et les embarras inséparables d’une régence ne tardèrent pas à relever les espérances de l’ennemi ; vingt-six mille Espagnols, sous la conduite de Francisco de Melos, envahirent les frontières de la Champagne ; ils se flattaient, à la faveur du nombre, de la discipline et de cette vieille renommée qui s’attachait aux armes de leur pays, de forcer en quelques jours les avenues de Paris et de prendre une éclatante revanche des succès de la France. Le duc d’Enghien n’avait à leur opposer que des troupes peu considérables, et comment un général adolescent pouvait-il lutter avec avantage contre l’expérience consommée de généraux habitués à la guerre ? Louis de Bourbon se montra digne de cette épreuve : à défaut de la science il avait l’instinct des grandes choses militaires. Les ordres de la cour lui prescrivaient en vain de ne point hasarder la bataille ; en vain le maréchal de l’Hospital lui conseillait de temporiser, le duc d’Enghien n’écouta que les illuminations de son génie. Le 18 mai, il se prépara à attaquer l’ennemi devant les murs de Rocroi ; le lendemain, pour emprunter le langage de Bossuet, il fallut réveiller d’un profond sommeil cet autre Alexandre. À la tête de sa cavalerie il enfonça l’infanterie espagnole, jusque alors réputée invincible ; le vieux comte de Fuentes, qui la commandait, tomba percé de coups ; mais le prince victorieux pardonna aux vaincus et suspendit le carnage. Cette célèbre journée apprit à l’Europe que désormais aucune armée n’était plus digne de respect que l’armée française : cependant le duc d’Enghien, que nous nommerons plus tard le grand Condé, mit à profit sa victoire. Après avoir passé à travers le pays ennemi et trompé la vigilance du général Beck, il prit Thionville, se rendit maître de Cirq et contraignit les Allemands de se rejeter à l’autre bord du Rhin ; s’étant mis à leur poursuite, il entra en Allemagne. Les armées françaises avaient subi des revers dans ce pays : la mort du maréchal de Guébriant et la blessure du maréchal Rantzau avaient fait perdre la bataille de Dutlingen et compromis le salut des débris de l’armée d’Allemagne. Louis de Bourbon, ayant sous ses ordres les maréchaux de Grammont et de Turenne, attaqua devant Fribourg le camp formidablement retranché des Impériaux. Merci, qui lui disputait la victoire, combattit pendant trois jours, et battit en retraite le quatrième. Cette bataille sanglante livra Philipsbourg et Mayence au duc d’Enghien (1644).
Ce prince vint à Paris jouir des acclamations du peuple et des enivrements de son triomphe. Turenne, qui commandait en son absence, s’empara de la Souabe et poussa l’ennemi jusqu’en Franconie ; mais, trompé par de faux avis, il fut battu à Mariendal : le duc d’Enghien s’empressa de reprendre la route des camps et eut le bonheur de réparer, par la glorieuse victoire de Norlingue (Nordlingen), la défaite subie par les armes de Turenne. Merci, l’orgueil de l’Empire, périt dans cette grande journée, et sur la tombe creusée pour lui sur le champ de bataille fut gravée cette épitaphe : « Arrête, voyageur, tu foules un héros. » Le nom du duc d’Enghien était dans toutes les bouches ; l’on admirait aussi la modestie de Turenne, qui, après avoir eu sa belle part dans le succès, en faisait hommage à son jeune chef (1645). L’armée ennemie se replia sur le Danube, et la frontière de Bavière fut ouverte. L’année suivante, le duc d’Enghien, qu’une grave maladie avait rappelé à Paris, assiégea Dunkerque à la vue d’une armée espagnole, et eut la gloire de rendre cette ville à la France (1647). Turenne et Wrangel obtinrent de nouveaux avantages en Allemagne.
Le duc d’Enghien, que nous appellerons désormais prince de Condé (son père venait de mourir), reçut de la cour l’ordre de commander l’armée de Catalogne : Mazarin se plut à tirer ce prince du théâtre de sa gloire pour l’exposer à des revers qui diminueraient sa popularité. Condé, avec des soldats mal payés et mal disciplinés, échoua devant Lérida (1647) : la cour s’applaudissait déjà d’un revers qui affaiblissait une trop grande renommée, lorsque l’apparition des Impériaux en Flandre et en Artois la contraignit de confier encore la défense du pays au capitaine dont la vertu précoce lui faisait ombrage. Condé accepta cette nouvelle mission et parut à l’armée du Nord. Les ennemis venaient de s’emparer de Lens, le prince marcha droit à eux, et pour toute harangue dit à ses troupes : « Amis, souvenez-vous de Rocroi, de Fribourg et de Nordlingue ! » La victoire de Lens inscrivit un nom de plus dans les fastes illustres du pays, elle hâta la conclusion de la paix qui se négociait à Munster et à Osnabruck. Il était temps pour l’Empire : déjà le duc d’Orléans avait pris Gravelines, Courtrai et Mardik ; Turenne s’était rendu maître de Landau, et, après avoir rétabli l’électeur de Trêves, avait gagné avec les Suédois les batailles de Lavingen et de Sommerhausen ; le comte d’Harcourt s’était emparé de Balaguier ; les Espagnols étaient vaincus en Italie, et les galères du roi avaient battu la flotte d’Espagne sur les côtes d’Italie ; enfin, pour comble d’avantages, la Lorraine était envahie par les armées françaises.
La paix de Munster, dont les préliminaires avaient été signés à Osnabruck, porte plus particulièrement dans l’histoire le nom de paix de Westphalie : c’est le plus grand évènement du dix-septième siècle et en quelque sorte le point de départ de l’ère moderne. Ce traité célèbre mit fin à la guerre de Trente-Ans.
La France obtint la renonciation de l’Empereur et de l’Empire, sauf la juridiction spirituelle de l’archevêque de Trêves, à tout droit sur les évêchés de Metz, Toul et Verdun, qu’elle possédait depuis près d’un siècle, ainsi qu’à toute suzeraineté sur la ville de Pignerol, autrefois cédée par le duc de Savoie ; elle eut de plus en partage les landgraviats de Haute et Basse-Alsace, le Sundgau, le Vieux-Brisach et son territoire, ainsi que la préfecture de Haguenau, formée de dix villes impériales libres, avec les mêmes droits de souveraineté que la maison d’Autriche et l’Empire y avaient précédemment exercés. Elle s’engagea à des indemnités et à la restitution des villes dont elle s’était emparée en Allemagne, et, par le consentement mutuel des puissances intéressées, la navigation du Rhin fut déclarée libre et le commerce rétabli sans entraves sur l’une et l’autre rive de ce fleuve.
D’autres dispositions déterminaient la constitution nouvelle de l’Empire, les conquêtes et les acquisitions de la Suède, et en même temps les parts de tout genre, soit en provinces, soit en indemnités, qui revenaient aux autres alliés de la France ou de la maison d’Autriche ; il serait sans nécessité de les énumérer ici. On se bornera à constater que ce fut seulement à dater de la paix de Westphalie que l’Empire consentit à reconnaître l’indépendance de la confédération suisse, soustraite de fait, depuis plus de trois siècles, à sa juridiction et à la communauté d’intérêts avec le corps germanique.
Des règlements d’une plus grande importance furent adoptés pour équilibrer la position et les droits des différents cultes. Et d’abord les réformés calvinistes obtinrent de participer à l’avenir aux concessions générales faites aux sectateurs de Luther.
L’état public de la religion fut remis, pour toute l’Allemagne, sur le même pied qu’au 1er janvier de l’année 1624, qui pour cela est appelée année décrétoire ou normale. Quelques exceptions furent faites à cette règle en faveur du Palatinat et des États du margrave de Bade et du duc de Wurtenberg. Tous les biens ecclésiastiques, soit médiats, soit immédiats, dont les protestants étaient en possession à l’époque de l’année décrétoire, durent rester entre leurs mains. La juridiction ecclésiastique, tant de la cour de Rome et d’État catholique à État protestant, que de protestant à protestant, fut suspendue, ainsi que le droit diocésain, jusqu’à la conclusion d’un arrangement définitif qu’on savait bien ne devoir pas avoir lieu : cette mesure était donc indirectement équivalente à l’abolition. À l’avenir, la chambre impériale devait être composée de vingt-quatre membres protestants et de vingt-six catholiques. Six membres protestants devaient entrer dans le conseil aulique de l’Empereur ; les députés protestants et les députés catholiques devaient être envoyés en nombre égal aux diètes ; mais, dans les causes extraordinaires qui intéressaient la religion, les protestants et les catholiques devaient être seuls appelés à régler les choses de leur culte.
Ainsi le protestantisme recevait titre de bourgeoisie en Europe : pour la première fois il entrait dans le droit public, comme un élément dont désormais il fallait tenir compte ; ainsi encore venait de s’éteindre ce grand principe historique du Moyen Âge, l’intervention légitime et nécessaire de l’Église dans les traités internationaux ; à cette hiérarchie, qui plaçait à la tête de la société chrétienne le césar spirituel et le césar temporel, le pape et l’Empereur, avait succédé le dogme politique de l’indifférence religieuse en matière de transactions européennes ; dès ce moment les sympathies et les croyances devaient céder le pas aux intérêts matériels, et comment comprendre autrement les relations des peuples, lorsque l’étranger avait pris place au banquet de l’ancienne famille catholique ?
Quoi qu’il en soit, la pacification ne fut point générale ; même après la paix de Westphalie, la France et l’Espagne ne posèrent point les armes. L’Espagne, qui avait réussi à séparer les Provinces-Unies de la France, comptait sur les troubles dont la minorité de Louis XIV était menacée, pour réparer ses pertes et recouvrer la Catalogne, le Roussillon et la partie des Pays-Bas dont les Français étaient en possession. D’un autre côté, Mazarin, inquiet de cet esprit d’agitation, de ces germes de révolte qui fermentaient au sein de la France, voulait donner à l’activité nationale assez d’occupations au-dehors pour qu’elle n’eût plus à réagir contre la couronne et le ministre. Ces divers motifs allaient prolonger de onze ans la guerre entre l’Espagne et la France.
L’Espagne était alors gouvernée par Philippe IV ; mais ce prince, faible et négligent comme son père, ne pouvait retarder la décadence de sa monarchie. Quels rois pour continuer l’œuvre de Charles-Quint et de Philippe II, que ces souverains incapables, livrés aux conseils de leurs favoris et relégués loin des affaires par des ministres plus intrigants qu’habiles ! Quels hommes que le duc de Lerme et Olivarès pour balancer le génie de Richelieu et la politique de Mazarin ! aussi la déchéance de l’Espagne fut-elle prompte. La guerre avait enlevé à ce pays les Provinces-Unies, le plus noble fleuron peut-être d’une royauté qui s’étendait jusque dans les deux Indes ; l’Artois éprouva le même sort ; la Catalogne, poussée à bout par de tyranniques exigences, s’était à son tour affranchie ; pour comble d’épreuves, le Portugal se détacha de la monarchie espagnole et la laissa ayant sa frontière maritime ouverte du côté de l’Angleterre.
L’Angleterre, pour le moment, était livrée à ses orages intérieurs, qui lui laissaient peu le temps d’intervenir dans les affaires de l’Europe. Le roi Charles Ier s’était engagé depuis plusieurs années dans la guerre civile qui devait lui faire perdre le trône et la vie ; là aussi s’accomplissait l’une des conséquences de la réforme, et la révolte inaugurée dans les questions religieuses se manifestait ouvertement dans le domaine des choses politiques. Ces rois d’Angleterre, qui avaient jadis usé de leur autorité pour séparer violemment leurs sujets de l’unité romaine, voyaient enfin se tourner contre eux l’esprit d’examen auquel ils avaient enlevé toutes ses digues ; et c’est pourquoi la hache de Henri VIII et de la sanglante Élisabeth, tant de fois abaissée sur la tête des martyrs catholiques, allait se relever pour frapper le front royal ; c’était là, s’il est permis de le dire, l’inexorable logique de la Providence, Au moment où la paix de Munster était signée en Allemagne, le parlement anglais, étranger à ce grand évènement, venait de s’emparer du pouvoir ; il avait sous ses ordres des généraux et des armées, et dans le pays une multitude qui battait des mains à ses triomphes. Le ministre Strafford venait d’être décapité, la reine fugitive avait cherché un asile en France, et sa fille, encore au berceau, celle qui devait plus tard épouser le frère de Louis XIV et obtenir, des sublimes regrets de Bossuet, une illustration plus grande encore, Henriette d’Angleterre, fille de Charles Stuart et petite-fille de Henri IV, souffrant alors les privations de la misère et de l’exil, allait bientôt se voir contrainte de garder le lit dans sa chambre du vieux Louvre, faute d’un peu de bois.
À une autre extrémité de l’Europe, sous un ciel moins brumeux et sur ce rivage volcanique où étincelle le Vésuve, une révolution populaire s’était opérée comme par enchantement. L’Europe avait appris, sans oser d’abord y ajouter foi, qu’un rassemblement de pêcheurs, une émeute de lazzaroni et de portefaix, avait un moment dépossédé la maison d’Autriche du trône de Naples ; qu’un homme du peuple, Tomaso Aniello, (Thomas l’Anier), élu chef des insurgés napolitains, avait, à leur tête, proclamé la république (7 juillet 1647). Ce mouvement, qui fut de si courte durée, frappa les esprits et fit naître d’étranges espérances.
La société française n’était point alors ce qu’on la suppose : depuis que des formules de liberté ou de privilèges populaires ont été écrites sur le papier, à l’usage des nations de notre temps, on s’imagine qu’autrefois le calme de la servitude était la seule constitution du pays, et qu’en dehors d’une poignée d’hommes trônant à la cour et dans les châteaux, le reste n’était qu’une foule de serfs dépourvus de garanties et d’instincts, étrangers à la vie politique. Il semble que la liberté soit jeune et que nous l’ayons vue naître, tant la forme nous préoccupe plus que le fond des choses, tant l’habitude de n’examiner les questions qu’à la surface nous empêche de les résoudre sainement.
La France, à l’avènement de Louis XIV, malgré la tentative de Richelieu, n’était pas ce qu’elle fut après le règne du grand roi : les traditions de son histoire vivaient encore, et, au besoin, se révélaient de nouveaux intérêts qui demandaient satisfaction. Le pouvoir royal, sorti vainqueur de sa lutte contre les grands et les princes, était réservé à de nouvelles épreuves de ce genre ; l’un et l’autre élément se trouvaient encore assez rapprochés du point de départ pour se rappeler le temps où le roi n’était que le premier entre les gentilshommes, et non un être en quelque sorte élevé au-dessus de la nature humaine, dont il fallait révérer les caprices et adorer la volonté : les guerres de religion étaient éteintes, mais elles avaient duré soixante ans, assez pour rendre à la féodalité les souvenirs et les regrets de son ancienne prépondérance. Si les attaques des seigneurs et des princes étaient dirigées contre le ministre, Richelieu ou Mazarin, n’importe ; si l’on reprochait au premier son inflexible rigueur, à l’autre ses détours et son origine étrangère, c’est que le principe ministériel, en d’autres termes le gouvernement absolu exercé par l’intermédiaire d’un ministre, était une nouveauté politique à laquelle tous les ordres de l’État refusaient de se prêter. Jusque alors le roi s’était montré en personne, soit en chevalier, comme François Ier et son fils ; soit le pourpoint troué au coude, et en soldat pauvre mais brave, comme au temps de Henri IV : c’était le roi qui régnait et gouvernait, lui que le peuple voyait passer dans la rue, que la noblesse suivait au camp, que le parlement abordait en face ; les ministres de ce roi n’étaient que des commis, des surintendants ou des légistes ; mais la politique et la marche des affaires remontaient à lui. Au lieu de ce régime, qui résultait des vœux de l’opinion et de la nature même des faits historiques, on avait d’abord imaginé de gouverner par les favoris, puis par les ministres. Les favoris firent des jaloux et vidèrent les coffres de l’État ; les ministres prirent pour eux l’effectif du pouvoir, et, pour se grandir, exaltèrent comme un dogme la royauté qui se manifestait parleur intermédiaire. Les états généraux cessèrent d’être convoqués dans les crises publiques ; la noblesse fut considérée comme un corps d’élite, chargé du seul droit de servir à la splendeur du trône ; on afficha la prétention de discipliner l’Église et de la faire entrer dans l’État comme un élément soumis à la hiérarchie commune ; on condamna le parlement et le tiers état au silence.
C’étaient là, ne cessons pas de le dire, autant d’innovations contraires au droit traditionnel de la France et que personne ne pouvait accepter volontairement. La noblesse, ayant pour chefs les princes du sang, membres naturels de cet ordre et ses représentants nécessaires, supportait impatiemment qu’on osât, sous prétexte de régularité et de service public, attenter à ses prérogatives ; le haut clergé, dans plus d’une assemblée, tenait en échec les prétentions de la cour et se montrait vigilant défenseur de ses immunités ; la bourgeoisie, sans se rendre très exactement compte des idées qui fermentaient en elle, voyait avec déplaisir les allures de l’autorité ministérielle et les agrandissements continus du pouvoir despotique. Sans chefs, sans base fixe, sans levier, elle n’entreprenait rien par elle-même ; mais on la trouvait toujours disposée à se rallier derrière quiconque avait le courage de protester, fût-il évêque, juge ou prince. D’ailleurs cette classe, toujours prête à blâmer et à critiquer, commençait avec raison à trouver bien lourd le chiffre des impôts et des charges qui pesaient sur le moindre habitant de la cité : son opposition, peu endurante, mais limitée dans sa hardiesse, trouvait matière à s’exercer sur les actes du pouvoir, que déjà les gazettes et les pamphlets portaient à la connaissance du public. Enrichie par le monopole du commerce et des trafics, elle se demandait à demi-voix comment il pouvait se faire que ses intérêts fussent si peu garantis ; au besoin, elle s’apprêtait à les faire respecter : n’avait-elle pas ses armes ? ne tenait-il pas à elle de tendre des chaînes dans les rues, comme aux jours des Guise, et d’ameuter contre l’autorité de la cour les métiers, les gens des halles, les populeuses confréries qui remplissaient la ville ? Tout cela formait comme l’arrière-garde ou la réserve de la bourgeoisie : ces gens de bas étage, ouvriers robustes, ces corporations aguerries de bouchers, de cordonniers, ce ramas formidable d’individus exposés aux incertitudes du salaire quotidien, ne pouvaient rien par eux-mêmes : mais que la bourgeoisie, avec laquelle ils avaient des contacts de tous les instants, éprouvât une espérance, un ressentiment, une rancune, leur multitude était toujours prête à changer le succès en triomphe, la bouderie en émeute, l’émeute en pillage. C’est ce qui retenait la bourgeoisie et l’empêchait d’aller trop avant dans ses colères : tout ce qui sentait de près ou de loin la guerre du pauvre contre le riche l’inquiétait outre mesure ; au lieu donc d’en appeler à la force, elle se rangeait derrière messieurs les échevins et messieurs du parlement.
Mais le corps qui, à cette époque, jouissait de la plus haute prépondérance et de l’influence la plus illimitée, était le clergé de second ordre. Il est certain que les curés de paroisses avaient en leurs mains la soumission ou la rébellion du peuple ; qu’habitués aux respects, aux épanchements, à la confiance de leur troupeau, ils pouvaient à volonté le diriger pour la paix ou pour la guerre. Pendant que beaucoup d’évêques ou d’archevêques, toujours choisis par le roi dans les rangs de la noblesse, se cantonnaient à la cour, affligeaient leurs ouailles par le spectacle de l’ambition ou du dérèglement des mœurs et se tenaient toujours placés en dehors du peuple, le clergé du second ordre, les curés, les moines, sortis des rangs de la bourgeoisie ou de la chaumière du pauvre, se rapprochaient plus étroitement que jamais des masses, et, par la communauté du sang, des sympathies et des traditions, constituaient sinon un grand ensemble, du moins les éléments propres à l’organisation d’un parti puissant.
Et combien le demi-siècle qui venait de s’écouler n’avait-il pas légué à cette société de principes mal compris, mais redoutables ! Les barricades de 1588 lui avaient montré par quel moyen on déclare la royauté en état de siège ; trois ans de résistance héroïque opposée aux armées d’un roi protestant, la famine endurée, la guerre conduite avec audace leur avaient laissé des traditions de lutte et de révolte dont on ne pouvait méconnaître la portée ; Concini mis en pièces et distribué sur la place publique avait entretenu dans les rangs infimes de la populace une certaine soif de meurtre et de sang ; Richelieu avait suscité bien des haines qui cherchaient un prétexte ; mais surtout ce qui se passait en Angleterre, aussi bien que l’échauffourée de Naples, réveillait dans les entrailles de la multitude et des bourgeois des émotions inconnues ; l’exemple des révolutions est contagieux ; l’insurrection, quand elle n’éclate pas en torrents de lave, n’en est pas moins un brasier mal couvert, dont l’odeur monte à la tête. Je ne sais quel esprit d’imitation se répandait en France et conseillait au peuple la conduite des pêcheurs de Mazaniello, au parlement de Paris les exemples du parlement de Cromwel. La cour seule se faisait illusion ; elle ne voyait en face d’elle que des bourgeois qui soldaient en lourds impôts le prix de leurs chansons contre Mazarin, qu’une poignée de mécontents vaniteux et de songe creux parlementaires ; l’orage qui se préparait de loin ne lui inspirait aucune crainte.
On sent quelquefois fermenter, au milieu des peuples, des passions ou des rancunes véhémentes, et toujours alors un désir de changement s’empare des esprits, une sorte de malaise général dispose la société aux maximes subversives de l’ordre ; mais, tant qu’un prétexte immédiat de rébellion n’est pas offert aux inquiétudes de la foule, le murmure n’empêche pas l’obéissance, l’amour des nouveautés ne détruit pas l’habitude de plier et de se soumettre. Le jour vient enfin où la circonstance qui doit déterminer l’explosion, se présente inattendue, et dès ce moment l’histoire marche vite en quelques heures, et l’on s’étonne de part et d’autre de l’espace qu’on a franchi. L’expérience nous prouve que ces occasions de crises sociales sont presque toujours hâtées ou déterminées par des questions d’argent.
Les nécessités de la guerre avaient épuisé le trésor, et l’on a vu que, pour faire face aux dépenses sans cesse renouvelées, le gouvernement de la régente avait cru devoir recourir à des ressources onéreuses pour le peuple. Mazarin usait largement de cette triste ressource, et, comme l’esprit d’économie lui manquait, il contribuait encore, par son imprévoyance, à aggraver le mauvais état des finances publiques. Le surintentant Emery, sa créature, ne cherchait que des noms nouveaux pour établir des taxes nouvelles. Au mois d’août 1647, il fit rendre un édit portant un impôt sur toutes les denrées qui entraient dans la ville de Paris. De nos jours, en dépit du progrès dont on se vante, ces choses-là s’opèrent sans conteste ; on a des corps municipaux pour voter, des citoyens pour payer. Mais, en ces temps qu’on appelle despotiques, les contribuables y mettaient moins de complaisance. Les esprits s’échauffèrent, le parlement éclata en plaintes ; la reine manda cette compagnie au Palais-Royal ; on ne put s’accommoder. Alors le conseil, craignant que le parlement ne donnât un arrêt de défense qui aurait infailliblement été exécuté par le peuple, envoya une déclaration pour supprimer le tarif, afin de sauver au moins l’apparence de l’autorité du roi. Ainsi commençait une lutte qui devait plus tard s’agrandir : cette attitude du parlement correspondait aux vues secrètes de la bourgeoisie, mais l’impatience de la multitude allait encore au-delà.
Le jeune roi, à peine entré dans sa dixième année, tint un lit de justice (janvier 1648) où il fit enregistrer un grand nombre d’édits, dont l’un portait création de douze nouvelles charges de maîtres des requêtes, et un autre la suppression de quatre années de gages des membres des cours souveraines. Le parlement était excepté de cette mesure sévère, mais il méprisa une grâce qui l’exposait au reproche de préférer son intérêt au bien public ; le 13 mai 1648, il donna un arrêt d’union avec le grand conseil, la cour des aides et la chambre des comptes de Paris. C’était méconnaître ouvertement la volonté royale. L’union ne s’en opéra pas moins, malgré les tentatives de la cour. Un comité, formé de députés des quatre compagnies souveraines, tint ses séances à la chambre de Saint-Louis ; on y discuta des intérêts dont le gouvernement revendiquait seul la surveillance, justice, finances, police, commerce ; ces envahissements dans le domaine du pouvoir s’accomplissaient aux applaudissements de la multitude. La cour, incertaine de la position qu’elle avait à prendre, craignant néanmoins d’user de rigueur et d’allumer sans nécessité, en France, un incendie pareil à celui qui dévorait l’Angleterre ; la cour résistait mollement ou cédait de mauvaise grâce : Mazarin crut faire beaucoup en sacrifiant le surintendant Emery, que ses exactions avaient rendu odieux : cette concession tardive ne concilia au ministre aucune reconnaissance ; on y vit seulement l’indice de la faiblesse du gouvernement, et la hardiesse des parlementaires en fut accrue.
Quelques méchants écoliers se livraient alors bataille avec des frondes dans les fossés de Paris ; pour parer aux accidents inévitables en pareil cas, la police envoyait des archers sur le théâtre de ces luttes, et bien souvent il arrivait que les gens du guet étaient eux-mêmes reçus à coups de pierres. Dans une ville où l’on parle de tout, cet incident sans portée avait fait un moment l’objet des conversations du peuple ; on s’intéressait aux démêlés de la garde et des petits rebelles. Sur ces entrefaites se manifestèrent les premiers efforts des magistrats du parlement contre Mazarin ; l’un des conseillers, dont l’avis était sans doute favorable à la cour, chercha un jour à ridiculiser les tentatives de l’opposition en les comparant aux mutineries des frondeurs du rempart : ce rapprochement parut bizarre ; il plut aux imaginations et demeura. Désormais la résistance avait un drapeau, le parlement ; un nom, la Fronde.
La reine crut faire beaucoup, pour apaiser la révolte, que de reconnaître l’arrêt d’union par lequel les cours souveraines s’arrogeaient le droit d’examiner les édits et de contrôler les actes du gouvernement ; le parlement ne se montra que plus hardi dans ses entreprises contre l’autorité royale. Sur ces entrefaites arriva à Paris la nouvelle de la victoire de Lens, et la cour reprit courage.
Le 26 août 1648, à l’issue d’un Te Deum chanté à Notre-Dame en mémoire de cette bataille, les rues étant bordées de troupes et de gardes, la cour fit enlever deux membres du parlement, les sieurs Broussel et Blancménil, qui, dans les dernières querelles, s’étaient montrés fort récalcitrants. Broussel était un vieillard très incapable, mais dont la réputation d’intégrité et plus encore les beaux cheveux blancs avaient séduit les sympathies de la multitude. Il eût été adroit de laisser cet homme en paix et de ne lui donner aucune importance politique : sa vertueuse nullité, aigrie par beaucoup de vanité et plus encore par l’oubli du pouvoir, ne pouvait créer de sérieux embarras, tandis que l’apparence d’une persécution dirigée contre lui paraissait insupportable. L’arrestation du bonhomme, ainsi le désignent les mémoires du temps, répandit dans le peuple une consternation générale. « La tristesse ou plutôt rabattement saisit jusqu’aux enfants. L’on se regardait et l’on ne disait rien. On éclata tout d’un coup, on s’émut, on courut, on cria et l’on ferma les boutiques. » Pour qui connaît l’énergie des impressions de la foule, la rapidité merveilleuse avec laquelle la même idée se communique à tous les membres de ce grand corps, la crédulité qui porte les masses à se faire des idoles d’un jour, oubliées en quelques heures, il ne sera pas difficile d’admettre qu’en peu d’instants, bourgeois, corporations, métiers, hommes et femmes, tout Paris, en un mot, avait pris les armes et réclamait à grands cris la liberté de Broussel, le protecteur, le père du peuple. C’est là ce qui avint, et peut-être l’insurrection abandonnée à elle-même fût-elle demeurée impuissante, si d’habiles meneurs ne se fussent attachés à la diriger et à lui donner plus de consistance.
Paul de Gondi, coadjuteur de Paris, et plus connu sous le nom de cardinal de Betz, attisait avec soin les préventions et les rancunes de la multitude. C’était un homme doué de rares talents, souple, vaniteux, habile à jouer tous les rôles qui convenaient à son ambition ; engagé dans les ordres, sans vocation, et malgré ses mauvaises mœurs, il n’avait pas cessé de rêver la mission de l’homme d’État et du profond politique. Il se proposait pour modèle le conspirateur Fiesque, dont il avait écrit l’histoire ; las de tout ce qui paraissait gêner ses plans de désordre, disposé à agiter à tout prix, fier de porter plutôt un poignard qu’un bréviaire, né avec plus d’intelligence qu’il n’en fallait pour gouverner un empire, et destiné, par l’impatience de son orgueil, à n’être qu’un intrigant et un brouillon, Paul de Gondi avait médité de supplanter Mazarin et de s’imposer à la reine, qui l’aimait peu et l’estimait moins encore. Les conjonctures lui semblaient favorables ; il aurait bien voulu aider la révolte d’une main et la contenir de l’autre, de telle sorte que le résultat de ce mouvement servît ses projets et ne les dépassât point. Au plus fort du tumulte il sortit dans la ville en habits pontificaux ; déjà quelques coups de fusil avaient été tirés, et le peuple gagnait du terrain sur la garde suisse : le coadjuteur commença par lui donner sa bénédiction ; un moment après, il écouta les plaintes de la foule, et consentit à se rendre auprès de la reine pour lui demander la mise en liberté de Broussel. Mais Anne d’Autriche ne comprenait rien au mouvement : elle disait avec gravité, ne voulant point admettre le danger, « qu’il y avait de la révolte à croire qu’on pouvait se révolter. » Elle ajoutait, en s’emportant comme une bourgeoise, « qu’au lieu de rendre Broussel, elle l’étranglerait plutôt de ses propres mains ; » cependant, intimidée par les remontrances de ceux qui osaient la conseiller, elle promit, pour gagner du temps, d’ordonner le lendemain la mise en liberté des prisonniers, se réservant d’ailleurs de n’en rien faire. Cet engagement ne calma point les inquiétudes du peuple ; de nouvelles collisions éclatèrent entre les insurgés et la troupe ; la nuit qui survint fut tout entière consacrée à la construction de barricades. Les Parisiens, habitués à cette guerre de rues, tendirent des chaînes et élevèrent aux principaux carrefours des remparts mobiles, formés de tonneaux pleins de terre. Au point du jour, la ville présentait le formidable aspect d’une place de guerre, peuplée d’une armée immense, également disposée à attaquer ou à se défendre.
La journée fut chaude et sérieuse ; les barricades, rapidement élevées au nombre de douze cents, furent poussées jusqu’à cent pas du Palais-Royal ; les forces militaires, placées sous les ordres du maréchal de la Meilleraye, résistaient à contrecœur, et cédaient le pied aux bourgeois ; le chancelier Séguier et sa fille, la duchesse de Sully, coururent les plus grands périls ; l’hôtel de Luyues, où ils se réfugièrent, fut pillé et dévasté ; on se battit aux abords du Pont-Neuf et de la porte de Nesle : quelques pas encore, et l’on allait voir se réaliser ces inquiétudes prophétiques de la reine d’Angleterre lorsqu’elle disait : « C’est ainsi que l’émeute commença à Londres, et vous savez ce qu’elle est devenue. »
Que faisait alors le parlement ? il reculait déjà devant son œuvre, et, dans son hypocrite douleur, il blâmait le peuple de sortir de la loi. On a vu de tout temps ces mauvais logiciens qui poussent de leur mieux à la révolte en affaiblissant l’autorité et en la déconsidérant dans l’esprit des masses, et qui, lorsque la révolte vient au bout de leurs phrases, la renient et la condamnent. Le parlement se trouvait placé dans cette position fausse ; il détestait la cour et avait peur de la rue. Cependant ne point agir au milieu des évènements dont Paris était le théâtre, eût été une lâcheté ou, pour mieux dire, une abdication. Le parlement se décida à se rendre auprès de la reine pour l’engager à céder au vœu du peuple. Le premier président, le célèbre Matthieu Molé, était un homme d’un esprit étroit et d’un cœur intrépide. Il marcha à la tête de la compagnie, au bruit des acclamations populaires, et à travers les barricades qu’on se hâtait d’abaisser sur son passage.
Le parlement, par l’organe de son chef, réclama la liberté des prisonniers. La reine, qui ne craignait rien, parce qu’elle connaissait peu, s’emporta et répondit : « Je sais bien qu’il y a du bruit dans la ville, mais vous m’en répondrez, Messieurs du parlement, vous, vos femmes et vos enfants. » En disant ces mots, elle rentra dans sa chambre et en ferma la porte avec colère.