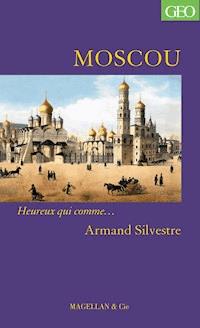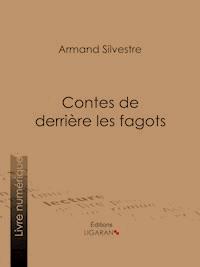Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Extrait : "Quel sacré gobe-mouche je suis ! J'en sais que l'institution des rosières fait rire aux larmes. Moi, je la prends fort au sérieux et j'y vois passer un souvenir troublant des vestales d'autrefois, je ne sais quelle apparition de candeur liliale. L'objet qu'on y honore a toujours été, au choix, pour moi, l'oiseau du Paradis ou le merle blanc. La timidité de mon caractère ne m'a jamais permis de m'adresser, en amour, qu'à des vertus éprouvées."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De mémoire de Culoméritain – ainsi se nomment, si j’en crois mon ami Paul Arène, les habitants de Coulommiers-en-Brie – l’hôtel de l’Ours, situé sur les bords du Morin, à l’entrée du pont, dans cette aimable et fromagère localité, n’avait été dans un pareil remue-ménage. C’était, des cuisines à la salle de festin, en traversant les salles communes, un cliquetis d’assiettes, un chassé-croisé de garçons, une envolée de serviettes sous les bras, une théorie de plats montés branlants sur leur base de nougat ou de biscuit, une dégringolade de fruits dans les escaliers, un parfum de ripailles congrues où se mêlait le dernier soupir attardé des bécasses rôties à l’haleine des viandes braisées, un orchestre d’harmonica fait par le choc des verres, un ouf ! innombrable de soulagement des bouteilles débouchées, comme on n’en avait vraiment jamais entendu. C’est que tous les jours le jeune Odysse Laroze, fils du plus grand fabricant de disques comestibles et odorants dont la renommée est celle même du pays, n’épousait pas mademoiselle Zélie Broquette, fille de rentiers aimables venus là pour y vivre en bons et béats provinciaux. Ce n’était pas seulement, je me hâte de le dire, un hymen où s’unissaient deux fortunes. Odysse aimait Zélie qui le payait de retour, comme disaient les romances du temps. Car il y a bien trente ans qu’eut lieu cette aventure. J’ai l’actualité paresseuse et je me souviens aujourd’hui plus souvent que je ne regarde autour de moi. C’est qu’il est lointain déjà le temps où je marchais au sourire des femmes comme jadis les bergers de Bethléem à la clarté des étoiles !
Charmants d’ailleurs, tous les deux, les nouveaux époux, à qui M. le curé et M. le maire venaient de délivrer l’exeat des légitimes félicités, pudiquement impatients de désir, lui ne tenant pas en place et elle rouge comme une pivoine tombée dans la floraison d’oranger vivante qu’elle était. Car elle était mignonne au possible dans l’effarouchement de symboliques candeurs qu’était son voile de neige tissée et sa robe aux cassures liliales de soie. Et, tout le long de ce mortel et bruyant dîner, où les vieux parents pleuraient dans leur godiveau, où les amis des familles disaient un tas de cochonneries, où les collégiens en sortie pinçaient, sous la table, les mollets des petites cousines, c’était une pitié de voir les regards brûlants qu’ils échangeaient, les sourires nerveux et aussi les frôlements de coudes remontant voluptueusement jusqu’aux épaules. Odysse était un gars à qui une merveilleuse santé tenait lieu de génie, et Zélie, une bonne petite poulinière à venir, bien râblée pour ce que le bon Rabelais appelait le jeu de serre-cropière. Ces martyrs de la gourmandise componctueuse de leurs invités faisaient peine à voir.
Cependant, au dehors, il faisait une belle nuit déjà, frileuse des premiers frissons d’automne et toute scintillante, avec un croissant railleur dans le ciel de lapis-lazuli. Mais Odysse n’était pas superstitieux. Enfin le signal du départ retentit dans un dernier toast, prétentieux et indécent à la fois. Ils allaient partir enfin, et partir seuls, faire d’un seul coup, jusqu’à Melun, la première étape de leur voyage à Paris. La voiture les attendait sans doute. Allons, bon ! la voiture commandée n’était pas venue. On ne peut compter sur rien dans ce monde. Remettre le voyage ? Odysse et Zélie en eussent été au désespoir. Ils avaient si grande hâte de se débarrasser de ces importuns ! Comment faire, cependant ? Tout à coup l’hôtelier de l’Ours entra se frappant le front. Il avait une idée ! Le soir même partait – et pour Melun précisément – le coucou qui transportait, tous les samedis, au chef-lieu du département et à destination de la recette générale, les fonds de la recette particulière. Il y avait un coupé à cette carriole où l’on pouvait très bien tenir deux. Les colis monétaires occupaient le fond. Un petit ennui. La voiture administrative était escortée, tout le long du chemin, de deux gendarmes et la mention : Envoi de fonds, était écrite, à la main, sur la caisse. Mais qu’est-ce que cela faisait à nos amoureux ! N’avaient-ils pas le droit de s’aimer tout à leur guise, même sous les regards de l’autorité ? La compagnie de cette escorte ne leur pouvait inspirer que les plus aimables rêveries. Le gouvernement lui-même voulait veiller sur leur bonheur. Il ne s’agissait que d’avoir le consentement du voiturier et des deux premiers gendarmes – car on en changeait en route, – et cela ne fit pas un pli. Odysse était fort estimé dans le pays et la beauté de Zélie y était sympathique partout.
Ils riaient comme des fous, en se hissant dans le coupé grinçant, Odysse prenant un plaisir extrême à pousser doucement Zélie la première, ce qui lui permettait d’explorer manuellement un paysage dont il allait être le touriste privilégié.
Rien de plus charmant, en effet, que le début du voyage. C’est un admirable coin de nature que celui-là, avec des bois profonds allongeant, jusqu’au bord même de la route, des presqu’îles d’ombre ; des caps de sombre frondaison, avec des cours d’eau qu’emplit d’un frisson d’argent le rayonnement nocturne, avec des visions de grands pâturages où surgissaient, en ce temps-là, les cabanes pointues des bergers, comme les clochers d’une ville de moutons agenouillés dans l’herbe et immobiles. De ce beau spectacle, à vrai dire, jouissaient-ils peu, ayant mieux à faire qu’à regarder par les portières. Captifs d’un voluptueux enlacement où se mêlaient leurs bras et leurs bouches, ils allaient sans savoir où oublieux du temps qui ne leur sonnait plus les heures, et de l’espace où, sous une cinglée de fouet, les emportaient deux apocalyptiques chevaux. Et, des deux côtés de leur chambre nuptiale roulante, à une distance décente toutefois, les deux bons gendarmes, rythmiquement secoués par leurs bêtes vigoureuses, dodelinant de la tête et, qui sait ? barytonnant d’ailleurs peut-être un épithalame, trottaient dans un petit nuage de poussière et dans une buée de naseaux.
Après deux heures de chemin, sans une halte même aux côtes, peu rapides d’ailleurs en cette région, on s’arrêta. Deux autres gendarmes attendaient sur la route, maussades et évidemment de mauvaise humeur, cette corvée nocturne n’étant pas de leur goût. Aussi n’échangèrent-ils aucune parole avec les camarades qu’ils allaient relayer, mais se mirent-ils, en grommelant, à leur place. Il y avait le brigadier surtout, le brigadier Belestron, qui faisait, dans sa moustache grise, une gueule de vieux chat dont on serre délicatement la queue dans une porte. Mais ce sont menus détails auxquels Odysse et Zélie ne prêtèrent aucune attention. Quand la voiture cependant se fut remise péniblement en marche – car on n’avait renouvelé que l’escorte, – ils s’aperçurent que leurs deux compagnons serraient de beaucoup plus près la portière que leurs devanciers, leur bouchant presque l’air et la lumière, et emplissant l’intérieur même du coupé d’ombres fantastiques, chaque fois qu’on passait devant une lumière, en traversant les bourgs. Odysse et Zélie commençaient à éprouver un certain malaise, ennui de se voir observés indiscrètement et aussi sentiment vague de nausée causé par l’oscillation des deux cavaliers sur leurs lourdes selles. Ils n’en continuaient pas moins à se couvrir de baisers. Tout à coup le brigadier Belestron vint littéralement coller contre la vitre son vieux visage ridé, ébouriffé, tomatiquement enluminé.
– Que vous allez vous tenir tranquilles, nom de Dieu ! hurla-t-il en posant la main au pommeau de son sabre.
– Ah ! mais il nous embête ! fit Odysse.
Et Zélie qui était espiègle tira la langue au militaire (la sienne, s’entend).
Mais le brigadier se contenta de hausser les épaules et d’aller dire un mot tout bas à son subordonné qui se colla, de plus en plus, à la voiture, de l’autre côté.
Pendant ce temps, Odysse passa la tête à la portière abandonnée, mais il fut violemment refoulé dans la voiture par le brigadier qui revenait par derrière.
– Ah ! mais, s’écria le jeune Laroze, j’en ai assez.
Et il intima au conducteur l’ordre d’arrêter.
Celui-ci allait obéir, mais le brigadier Belestron lui intima l’ordre supérieur de fouetter ses bêtes…
Odysse voulut reparlementer. Mais le brigadier le réintégra de nouveau, d’un demi-coup de poing, dans le fond du carrosse. Alors il voulut passer de l’autre côté ; mais l’autre gendarme, le saisissant délicatement par les épaules, le rassit sur son coussin à l’écraser.
– Madame a besoin de sortir ! s’écria Odysse. Animal ! imbécile !
Et, de fait, l’inquiétude donnait à Zélie une jolie pointe de colique.
– Connu ! fit le brigadier Belestron. Fichez-nous la paix.
Et lui-même, du bout de sa bride, sangla la croupe des chevaux.
Alors Odysse et Zélie commencèrent à s’exaspérer, à crier, à se démener dans le coupé comme des possédés.
Je crois qu’ils deviennent furieux ! fit sentencieusement le brigadier. Nous allons les ligoter.
Et, pour le coup, il fit arrêter la voiture et, les menottes à la main, il pénétra dans le coupé ! pendant que son camarade opérait, de même, de l’autre côté.
Les malheureux firent une résistance héroïque, mais force demeura, comme il convient, à l’autorité.
Voyez-vous ce voyage de noce qui se continue avec des chaînes au poignet ! Et jamais Zélie n’avait été plus charmante, plus touchante, ni tentante que dans son désespoir. Sa belle poitrine révoltée haletait. Sa croupe avait des ondulations de mer en furie. Ah ! ce que ses mains, ses mains captives ! démangeaient à l’infortuné Laroze.
Enfin, au petit jour, Melun apparut dans une buée rose, avec ses deux tours qui lui font une façon de Notre-Dame, au cœur d’une île ressemblant absolument à la Cité. Le clocher de Saint-Aspais plantait une flèche dans la nue légèrement cotonneuse, et les hauteurs du château de Vaux-le-Pénic s’étageaient dans une atmosphère mouillée où l’on devinait le chant des oiseaux, à leur réveil.
Odysse et Zélie, anéantis, étaient vaguement assoupis.
Quand on passa devant la gendarmerie départementale, l’adjudant descendit.
– Rien de nouveau ? fit-il en arrêtant la voiture.
– Ils sont un peu plus calmes nonobstant, mon lieutenant, fit le brigadier Belestron, depuis que Pétenouille et moi les avons enchaînés.
– Qui ça, enchaînés ? fit l’adjudant. Vous avez donc fait une capture en chemin ?
– Non, mon lieutenant. Mais les fous.
– Quels fous ?
– Lisez, mon lieutenant, reprit le brigadier en conduisant l’adjudant devant l’étiquette grossièrement tracée sur la caisse de la voiture.
– Eh bien ! envoi de fonds, lut l’adjudant. C’est l’argent de l’État qu’on apporte.
Pour le coup, le brigadier faillit avoir une attaque. Ses yeux lui sortaient du front ; ses joues flambaient ; il bavait.
– Lieut… lieutenant, fit-il en bégayant. Nous avions… vions lu : Envoi de fous. N’est-ce pas, Pétenouille ?
– Moi, j’avais très bien lu : Envoi de fonds, répondit tranquillement Pétenouille interpellé.
– Comment, malheureux ! Et tu ne m’as pas… ?
– Je respecte l’opinion de mes supérieurs ! fit sentencieusement Pétenouille.
Moitié colère nerveuse, moitié gaîté débordante, l’adjudant riait à se faire péter les côtes.
Il réveilla les amoureux que les émotions avaient brisés et leur fit des excuses. Délivrés de leurs chaînes, ils furent solennellement conduits à l’hôtel du Grand Monarque où ils purent reprendre l’entretien si malencontreusement interrompu.
Belestron fut cassé de ses galons dont hérita le malin Pétenouille.
Et, des tours de Notre-Dame de Melun à la flèche de Saint-Aspais, les corneilles se comptèrent la chose en de petits croassements ressemblant fort à des éclats de rire.
Qui s’appelait ainsi ? Une chatte tout simplement. Mais quelle chatte ! Une merveille qu’on eût justement adorée en Égypte, patrie des sages idolâtries. J’en avais trouvé une image avant la lettre et étrangement fidèle sur le sarcophage du célèbre Ptolémée Pétosiris. Encore cet icône n’avait-il qu’une partie des grâces vivantes de son modèle à venir. Même élégance des lignes, mais, à l’avantage de notre Mouzy, une admirable fourrure d’angora s’embroussaillant à l’échine, puis s’amincissant sur la tête qu’elle coiffait d’un double bandeau comme dans la coiffure dite « à la jolie femme ». Un nez rose, frémissant comme une fraise à peine mûre sous une ondée d’avril ; des yeux mystérieux et pleins d’or, deux larges gouttes du Pactole, avec, au fond, l’infini des gouffres où l’âme désespérée de Midas se lamente encore. C’est d’elle que Baudelaire eût dit :
Ce mysticisme du regard se féminisait d’ailleurs aussitôt que la gourmandise de Mouzy était sollicitée. C’était une bête difficile, gourmette plutôt que gourmande, adorablement égoïste d’ailleurs, avec des élans de tendresse quand elle pouvait être aimable sans que cela l’ennuyât en rien. Ai-je besoin de dire qu’elle était l’idole de sa maîtresse, la jolie comtesse de Moulin-Galant, qui l’avait eue toute petite et reportait sur elle tous les besoins de maternité dont le sort lui avait refusé de plus légitimes objets. Le comte, en effet, ne s’était pas reproduit dans l’orgueil de sa race. Les Moulin-Galant ont une légende héroïque aux environs de Corbeil. Ce fut un Gaspard de Moulin-Galant qui prit le premier la fuite à Bouvines. On montre encore son tombeau dans l’église Saint-Spire, avec un lévrier couché sous les pieds, pour ce que, de tous les chiens, celui-ci est celui qui court le plus vite. Vingt-cinq ans de plus que la comtesse, d’ailleurs, ce dernier des Moulin-Galant, aimable homme néanmoins et supportant la partialité dont sa femme fait preuve, en tous moments, quand un différend s’élève entre sa chatte et lui. C’est donc, au demeurant, la victime dans le ménage et une victime résignée. C’est Mouzy, et non lui, qui couche avec Madame. Elle tient, paraît-il, moins de place dans le lit. Madame est charmée quand Mouzy ronronne entre ses bras, tandis qu’elle peste dès qu’il y ronfle. Il n’est pas jusqu’à la propreté de Mouzy qu’on ne lui jette à la tête en de malhonnêtes comparaisons.
Le fait est que Mouzy est d’une propreté confinant à la monomanie. Il lui faut absolument des cendres pour ses épanchements – comme jadis Artémise, de poétique mémoire – et il est vrai d’ajouter que, partout où elle trouve des cendres, elle se croit invitée à leur confier quelque chose. Suivant sa maîtresse comme un caniche – ce qui est moins rare qu’on ne le croit chez un chat, – partout et même à l’église quand on est à la campagne où la comtesse se retire aussitôt le carnaval fini, Mouzy ne faillit-elle pas compromettre, une fois, l’auguste cérémonie qui signale le premier jour du Carême, le mercredi légendaire où le : Memento, homo, quia pulvis es ! est murmuré à l’oreille des chrétiens ! Une autre fois, Monsieur et Madame devisaient devant l’âtre où n’était plus qu’une tiède poussière de tison avec, çà et là, le crépitement mourant d’une étincelle. Ils avaient le dos voluptueusement renversé dans leur large fauteuil et les pieds tendus jusques aux chenets d’où montait encore une chaleur très douce. Tout à coup une pétarade suivie d’émissions dont on n’eût pas voulu même à la Bourse, où l’on n’est cependant pas difficile, éclata presque sous leurs semelles, cependant que leur montait aux narines un arome n’évoquant pas précisément l’image d’un jardin. C’était Mouzy qui avait attendu que la place se fût suffisamment rafraîchie.
– Pauvre petite bête ! murmura la jolie comtesse.
Et le comte, toujours débonnaire, se contenta de dire :
– Sapristi ! si j’en avais fait autant !…
– Vous êtes dégoûtant, mon cher, conclut Madame en s’éloignant de lui.
Cet homme de bien était-il au moins cocu, comme c’est l’ordinaire récompense de la destinée ? Pas encore, au moment où commence cette histoire, mais il n’était pas loin de le devenir. L’inflexible Fatum allait se présenter à lui, sous les traits du jeune Eusèbe de Pète-Lucette, dont le père avait été son ami d’enfance et que ledit père lui adressait, le médecin ayant impérieusement conseillé la campagne à cet Eusèbe que de longs voyages scientifiques avaient surmené. C’était un garçon, d’ailleurs, de grande distinction physique et morale, absolument érudit, passionné pour les choses de l’antiquité, et dont la conversation était autrement intéressante que celle de M. de Moulin-Galant, dont la grande occupation était la chasse, et qui ne trouvait, en lui, quelque imagination que pour mentir, comme c’est la coutume des chasseurs, qui ont toujours couru de grands dangers et failli tuer de merveilleux gibiers.
Il était donc tout naturel que, entre ce nouveau venu, tout à fait séduisant, et une jeune femme n’ayant au cœur que la tendresse que lui inspirait sa chatte, un courant de sympathie, plein de confiance, puis de mutuelle affection, s’établît. Eusèbe était vraiment fort éloquent quand il parlait de la Tauride et du Péloponèse, quand il décrivait l’Acropole et la sépulture des héros. Il avait veillé toute une nuit dans la vallée des Thermopyles et y avait senti frémir, dans je ne sais quel sursaut de la pierre, l’âme de Léonidas. De tous ces lieux sacrés il avait rapporté des reliques. Il possédait un des cailloux qui avaient délié la langue de Démosthène, la peau du renard qui avait dévoré le foie du petit Spartiate, un pied du plan de ciguë dont avait été préparé le dernier bouillon de Socrate, et plus de la moitié de la queue du chien d’Alcibiade, sans compter d’autres menus trésors archaïques qu’il n’eût pas cédés pour un lingot d’or ou même un lot de diamants de même poids.
De tout cela il avait fait un petit musée dans la chambre qu’il occupait au château de Moulin-Galant, tout près de Corbeil, chez l’ami de son père. Il n’y laissait entrer personne et demeurait sur place le temps qu’on y donnât un coup de balai. Les collectionneurs sont de merveilleux égoïstes. De cette rigueur à repousser toute visite, à repousser toute curiosité, il lui fallut bien cependant se démettre un peu quand la comtesse fut tout près de devenir sa bonne amie. C’était, en effet, l’endroit où ils pouvaient causer le plus en sûreté, pour ce qu’il était retiré et que tout le monde s’en éloignait, ayant toujours été mal reçu par le possesseur actuel. La jolie comtesse s’y plaisait, d’ailleurs, beaucoup, dans cette atmosphère de recueillement. Car le grand poète des Fleurs du Mal a encore très justement rapproché
Ce n’était pas d’ailleurs, par les banalités communes que s’affirmait la tendresse croissante d’Eusèbe. Il s’y mêlait une grande poésie faite de souvenirs revivifiés où les images des bien-aimées antiques, chastement adorées, faisaient comme un cortège au beau rêve qui s’allait faire chair, comme le Verbe. Toutes il les revoyait, dans une perfection détachée de leur être, revivantes dans une image qui les résumait toutes, où se confondaient toutes les splendeurs et toutes les grâces, où le beau soleil d’Ionie retrouvait cette caresse pour une contemporaine soudainement déifiée. Et madame de Moulin-Galant était intérieurement orgueilleuse d’être ainsi aimée, autrement que par un sot ou par un fat, comme le sont, le plus souvent, les bâtisseurs de cocus internationaux. Un à un Eusèbe lui révélait ses petits secrets ; il abjurait, pour elle, les jalousies de savant ; un prosélytisme généreux naissait de son amour et lui faisait souhaiter de partager, avec celle qu’il adorait, le meilleur de ses joies passées. Et c’était un sentiment absolument exquis dont la comtesse lui savait gré davantage encore.
Or, ce jour-là, il avait été plus confiant que jamais, ayant à demander davantage. Tout y semblait fait, en effet, pour la chute des derniers voiles dont s’entourent les pudiques amours. Un jour tiède de printemps avec des éclaircies ensoleillées, un grand réveil de chants d’oiseaux et de parfums de fleurs sauvages dans les haies, tout cela entrant par la fenêtre entrouverte et faisant passer comme d’aimables visions dans la transparence frémissante des rideaux. Pour plaire à la comtesse, Eusèbe avait descellé le couvercle d’une urne qu’il entourait d’un respect tout à fait religieux. D’après d’authentiques documents, cette argile contenait les cendres du vaillant Philopœmen, celui qui vainquit le tyran Machanidas à Mantinée et dont Plutarque a dit : « La Grèce l’aima simplement comme le dernier homme de vertu qu’elle eût porté dans sa vieillesse. » Et le jeune savant avait des larmes aux yeux en évoquant cet héroïque souvenir. Cet attendrissement ne nuisait pas d’ailleurs à ses affaires. De belles larmes montèrent aussi aux yeux de la comtesse, comme sympathiquement réveillées dans son cœur, et la conversation prit un tour plus languissant d’abord, puis, tout à coup, plus vif. Peu à peu, à tout petits pas serrés, on avait quitté l’autel où s’était chantée cette jolie messe païenne, et pour l’Ite, missa est on avait gagné un reposoir où s’allaient effeuiller toutes les roses d’une Fête-Dieu de l’amour. Les draps étaient tendus, non pas sur les murs, mais sur un bon lit, béant, ouvrant tout large son sourire de neige, son jardin de lys. Eusèbe y avait tout doucement poussé la comtesse, qui s’était laissée tomber avec des abandons voulus. Les cornes boutonnaient, sans doute, déjà, au front de l’absent. Le chapelet des baisers s’égrenait sous une double psalmodie. Tout à coup, un bruit étrange sur la table où étaient demeurées les reliques. Eusèbe bondit et aperçoit Mouzy, laquelle avait suivi sournoisement la comtesse, en train de « compisser fort aigrement » – pour employer le vocabulaire de Rabelais – les cendres du vertueux Philopœmen.
Le jeune savant faillit s’évanouir. L’amour s’était enfui de son âme. L’horreur du sacrilège clamait en lui, plus haut que la tendresse, et il repoussa le bras dont la comtesse, désespérée de le voir ainsi, le voulait enlacer.
– Philopœmen, pardon ! criait-il d’une voix suppliante. Pardon d’avoir arraché tes augustes restes à ta terre natale pour les livrer à cette profanation !
Sa chatte dans les bras, un peu vexée tout de même, furieuse au fond de ne pas même obtenir un adieu, la comtesse sortit.
À l’heure du dîner, Eusèbe descendit seulement en tenue de voyage. Il avait fait ses malles. Il allait partir le soir même. Il ne voulait pas abuser de l’hospitalité du comte. Pendant qu’il énumérait les motifs de son départ en n’oubliant, comme c’est la coutume, que le vrai, un domestique lui remit une lettre. Il demanda la permission de l’ouvrir et pâlit en commençant à la lire. Mais soudain la joie revint sur son visage, une joie qui l’hébétait, qui le rendait fou ! Un ami resté en Grèce ne le prévenait-il pas qu’il avait été victime d’un mystificateur et que les cendres de Philopœmen étaient simplement celles d’un bandit récemment brûlé après avoir été décapité ! Mouzy n’avait nullement profané la relique d’un héros, mais donné une légitime marque de mépris à la dépouille mortelle d’un gueux !
Inutile de dire qu’il renonça au retour précipité et que, le lendemain, par une journée pareille, avec des éclaircies ensoleillées, un grand réveil de chants d’oiseaux et de parfums de fleurs sauvages dans les haies, tout cela entrant par la fenêtre entrouverte et faisant passer comme d’aimables visions dans la transparence frémissante des rideaux, ils recommencèrent, nos amoureux, au point où ils l’avaient laissée, la lecture interrompue la veille, dans le livre que Roméo et Juliette avaient feuilleté avant eux.
Quel sacré gobe-mouches je suis ! J’en sais que l’institution des rosières fait rire aux larmes. Moi, je la prends fort au sérieux et j’y vois passer un souvenir troublant des vestales d’autrefois, je ne sais quelle apparition de candeur liliale. L’objet qu’on y honore a toujours été, au choix, pour moi, l’oiseau du Paradis ou le merle blanc. La timidité de mon caractère ne m’a jamais permis de m’adresser, en amour, qu’à des vertus éprouvées par d’antérieures chutes. Ajoutez à cela mon absence complète de goûts pédagogiques. Faire une éducation, bon Dieu ! J’y perdrais certainement autre chose que mon latin. Voilà un aveu dépouillé d’artifice, mes compères. Mais je me suis promis d’être toujours franc avec vous. Je n’ai pas le genre de vanité qui pousse un sot à se vanter d’avoir mis à mal beaucoup de pucelles. Ce sont bêtes mystérieuses pour moi, comme les animaux sacrés en Égypte, et c’est pour ce que les rosières sont censées de leur espèce, que les rosières m’inspirent un religieux effroi.
Quant à mon grand-oncle Thomas Pilevesse, il les tenait plus en honneur encore et ses fonctions de maire de Bouzinville lui semblaient surtout redoutables par le privilège qu’elles lui déléguaient de faire un choix pour la couronne virginale entre les jeunes filles du pays. Celles-ci étaient, sans doute, particulièrement hypocrites ; car aucune ne faisait jaser d’elle. Dans ce chapelet de perles, où trouver la perle la plus pure ? C’est alors que ma tante Agathe, sa femme, une femme de tête et qui avait rudement bossué jadis celle du doux Thomas, son mari, eut une idée géniale à vrai dire. Pourquoi ne pas soumettre toutes ces jeunes vertus au creuset d’une même tentation ? Nous avions, dans la famille, un très mauvais sujet, le cousin Marcel. On le fit venir de Paris et le colloque suivant s’engagea entre mon grand-oncle et ce sacripant.
– Vous vous demandez, monsieur, pourquoi je vous ai prié de venir passer quinze jours à la campagne, vous dont ordinairement les ménages tranquilles de notre lignée ne recherchent pas la société ?
– Mais, mon cher Pilevesse, sans doute parce qu’approchant de la soixantaine et n’ayant pas d’enfant…
– Par exemple ! Mais est-ce que vous croyez que votre cousine Agathe se prêterait !… Non, monsieur, je vous ai adressé cette invitation qui vous permettra de pêcher et de chasser, à vos moments perdus, suivant vos goûts carnassiers, parce que je suis accablé de besogne ici par mon devoir de maire.
– Trois cent cinquante-sept habitants ne doivent pas vous donner grand mal.
– Trois cent soixante-trois d’abord. Depuis la dernière statistique j’ai découvert huit nouveau-nés et deux décès. S’ils ne s’arrangent pas pour mieux équilibrer les naissances avec les morts, nous finirons par être encombrés et ce sera ici une véritable pétaudière. Mais je n’ai jamais vu une race plus désordonnée que celle de ce canton. Ils ne savent pas ce qu’ils font. On voit bien que ce n’est pas eux qui tiennent les registres de l’état civil ! Mais le point délicat, c’est le choix de la rosière. Ma femme a pensé à vous…
– Pour les essayer ?
– Non ! monsieur, pour les éprouver.
– Je ne saisis pas la nuance.
– Je vais vous la faire toucher du doigt.
– La rosière ?