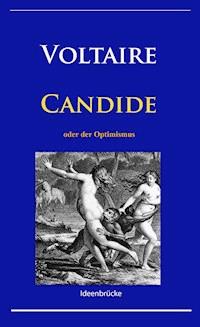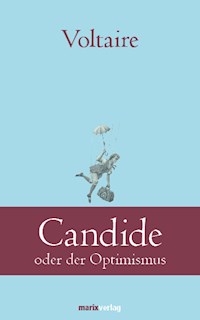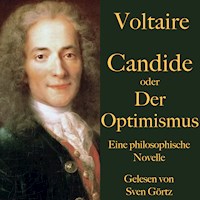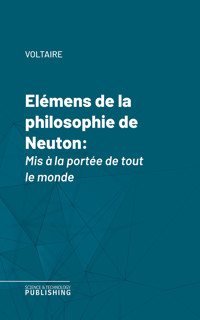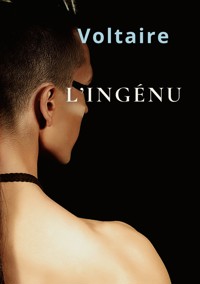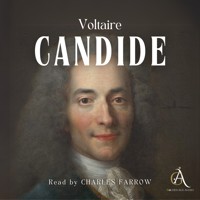Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "La Suède et la Finlande composent un royaume large d'environ deux cents de nos lieues, et long de trois cents. Il s'étend du midi au nord depuis le cinquante-cinquième degré; ou à peu près, jusqu'au soixante et dixième, sous un climat rigoureux, qui n'a presque ni printemps ni automne."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous avons donné en premier lieu les ouvrages de Voltaire concernant l’histoire générale, puis ceux plus spécialement consacrés à la France. Voici enfin ceux dont la matière a été fournie par les annales des peuples étrangers. Cette section ne comprend que deux ouvrages : l’Histoire de Charles XII et l’Histoire de Russie sous Pierre le Grand.
Si nous avions strictement suivi, dans la publication de la partie historique de l’œuvre de Voltaire, l’ordre chronologique, nous aurions dû commencer par l’Histoire de Charles XII, car c’est la première composition de ce genre que Voltaire publia. Elle suivit de très près la Henriade. « Il commença cette histoire, dit l’auteur du Tableau de la littérature française au XVIIIe siècle, à la fin de son voyage d’Angleterre, en relisant Quinte-Curce et on faisant causer le chevalier Désaleurs, qui avait longtemps suivi le service aventureux de Charles XII. L’Europe était encore pleine du bruit de ce roi. L’historien recueillit, en courant, des détails et des témoignages, et en écrivit le récit dans quelques mois de retraite profonde à Rouen, avec cette vitesse qui faisait partie de sa verve, et tout en composant à la fois Ériphyle et la Mort de César. »
Le premier volume avait été tiré à deux mille six cents exemplaires, l’approbation accordée au sceau, quand le ministre, se ravisant, fit saisir l’édition. Il paraît qu’on craignit que l’ouvrage ne fût désagréable au roi Auguste de Pologne, le rival de Stanislas. Voltaire s’arrangea pour donner une publicité clandestine au livre auquel on ne permettait pas de paraître au grand jour. Il comptait du reste sur une tolérance de l’autorité. Il s’adressa à Cideville pour qu’il lui ménageât la bienveillance du premier président de Normandie, M. de Pont-Carré, et lui cherchât un imprimeur rouennais. C’est à Rouen, en effet, qu’il rédigea la seconde partie de son ouvrage. Les deux premières éditions virent le jour sous la rubrique : « Basle, chez Christ. Revis 1731 ».
Neuf ans plus tard, en 1740, parut à Stockholm une histoire complète de Charles XII. L’auteur était le chapelain Nordberg, confesseur du roi de Suède, depuis 1703 aumônier de l’armée suédoise, qu’il suivit jusqu’à Pultava, où il fut fait prisonnier ; rendu à la liberté en 1715, il fut plus tard officiellement chargé d’écrire l’histoire du héros par sa sœur Ulrique-Éléonore ; il eut à sa disposition toutes les pièces authentiques, et son travail fut corrigé et approuvé par une commission royale.
Voltaire en eut immédiatement connaissance, comme on le voit par sa lettre au maréchal de Schulenbourg (15 septembre 1740). Il se défia tout d’abord de l’impartialité du chapelain : « J’ai peur, dit-il, que le chapelain n’ait quelquefois vu les choses avec d’autres yeux que les ministres qui m’ont fourni mes matériaux. » Il ajoutait en terminant sa lettre : « J’apprends qu’on imprime à la Haye la traduction française de l’Histoire de Charles XII, écrite en suédois par M. Nordberg ; ce sera pour moi une nouvelle palette dans laquelle je tremperai le pinceau dont il me faudra repeindre mon tableau. » Il écrivait au traducteur Warmholtz, le 12 mars 1741, pour le prier de noter les endroits où il s’était trompé ; il lui adressait encore deux lettres au mois de mai, et annonçait l’intention de corriger son livre, de se réformer sur ses mémoires. Cette traduction parut en quatre volumes qui portent la date de 1748, mais une partie était déjà imprimée dès 1742, et Voltaire, instruit de l’esprit et de la valeur de cette œuvre, crut pouvoir la juger en toute liberté. Il avait lu dans l’écrivain suédois ces paroles à son adresse : « La beauté et la vivacité du style méritent des louanges ; cependant un baron de Puffendorf ne traiterait M. de Voltaire que comme le premier traita Varillas, qu’il appela archimenteur. »
Voltaire n’était pas homme à laisser l’attaque sans riposte. De là la lettre à Nordberg, qu’on trouvera dans la correspondance à l’année 1744.
M. A. Geffroy juge ainsi l’ouvrage de Nordberg : « Sa lourde histoire de Charles XII en trois volumes in-4° et en suédois ne fut pas plus savante que celle de Voltaire, qu’il copia vers la fin, mais offrit un amas bizarre des plus niaises circonstances enchâssées dans les plus naïfs propos. Quoiqu’il ose à peine lever les yeux sur une tête couronnée, le bon chapelain se délecte à suivre dans son récit les progrès de la chevelure de Charles XII depuis son enfance jusqu’à sa mort, les variations de couleur que lui a fait subir l’âge ou la fortune, les différentes allures qu’elle a revêtues : « Il porta perruque pendant son enfance seulement, se fit ensuite couper les cheveux fort courts, et les redressait en se peignant, ce qui lui seyait admirablement bien, surtout quand son valet de chambre, en lui frottant la tête, mettait sur la serviette un peu de poudre. À la fleur de l’âge, ses cheveux, d’abord d’un brun foncé, devenaient tout gris, au point que, la dernière année de sa vie, ceux qui étaient des deux côtés de la tête, près des oreilles, avaient presque entièrement perdu leur couleur naturelle. » En septembre 1708, quand commence cette expédition de Russie dont le récit dans Voltaire est si entraînant et si rapide, Nordberg, saisi tout à coup de je ne sais quel amour des jardins et des fleurs, s’arrête et se met à décrire un aloès qui vient de fleurir sous le ciel de la Suède ! Que serait-ce si nous citions les détails beaucoup trop circonstanciés, que le chapelain a légués à la postérité, sur toutes les parties de l’habillement du fameux roi de Suède ? »
Le jugement de Voltaire, qu’on trouve ci-après dans la préface de l’édition de 1748, n’est donc pas trop rigoureux. « Charles XII serait ignoré, dit-il, s’il n’était connu que par Nordberg. » Il serait à coup sûr beaucoup moins populaire, et sa renommée aurait été probablement renfermée dans les bornes étroites de son pays.
L’appréciation qui a contribué le plus à faire considérer l’ouvrage de Voltaire comme peu solide, c’est celle de Napoléon Ier. On sait que Napoléon, dans sa campagne de 1812, rejetait le Charles XII, qu’il traitait de roman, pour lire et étudier l’exact mais ennuyeux ouvrage d’Adlerfelt. « On conçoit, en effet, dit M. Villemain, que les descriptions, devinées par l’historien d’après des cartes et des livres, n’aient pas satisfait la rigueur de la géographie militaire, la plus exacte de toutes par le but décisif qu’elle se propose. Voltaire cependant eut, un des premiers, l’art de mêler l’image des lieux à celle des évènements pour l’intelligence et l’effet du récit : témoin sa description si bien placée du climat de la Suède, sa vue des plaines de la Pologne et des forêts de l’Ukraine, sa route tracée vers Smolensk. Mais cette géographie de peintre avec ses brillantes perspectives ne suffit pas au général, qu’une erreur de quelques lieues peut fatalement tromper ; ce n’est pas là cette carte historique qui ressemble à un plan de bataille, cette topographie de conquérant que Napoléon voulait, et qu’il a jetée lui-même en tête du récit de sa campagne d’Italie comme le cercle magique où il enfermait sa proie. Un autre défaut de l’Histoire de Charles XII, lue surtout pendant la campagne de Russie, c’est que le récit, toujours si net et d’un coloris si pur, manque parfois de sérieux, et n’a jamais cette mâle tristesse et cette austérité qui point et fait sentir les grandes catastrophes, même sans les déplorer. »
Peut-être aussi, ajouterons-nous, Napoléon découvrait-il dans ce récit de Voltaire, qui fait bien ressortir les moyens de défense naturels de la Russie, des sujets d’inquiétude et de funestes présages.
Ce qu’il ne faut pas supposer, c’est que Voltaire n’ait pas fait d’actives recherches pour s’éclairer ; il s’était entouré de tous les renseignements, de tous les documents qui pouvaient lui faire connaître la vérité ; il s’était adressé à tous ceux qui avaient vécu avec Charles XII ou qui avaient été mêlés à quelques-uns des évènements de son histoire. Il avait écrit son livre, dit-il lui-même, sur les Mémoires de M. de Fabrice, qui avait été huit ans favori du roi de Suède ; sur les lettres de M. de Fierville, envoyé secret de France à Bender ; sur les rapports de M. de Croissy, ambassadeur de France. Il avait consulté M. Jeffreys, ministre d’Angleterre en Turquie, M. de Ferriol, notre ambassadeur à Constantinople, le maréchal de Saxe, fils du roi Auguste, lord Bolingbroke, le médecin Fonséca, M. Bru, drogman, le marquis de Brancas, ambassadeur en Suède, le baron de Görtz, etc.
« Il y a telle scène, nous dit M. A. Geffroy, pour laquelle il a été instruit de première main. C’est, par exemple, la duchesse de Marlborough qui lui a raconté les détails de l’entrevue entre le célèbre général anglais et le roi de Suède, et ces détails sont entièrement conformes à ce que nous donnent les dépêches du duc lui-même, qu’on peut lire dans sa correspondance, publiée par sir George Murray, à Londres, en 1845. C’est grâce à des informations si directes que Voltaire a fait de cette curieuse scène une courte, mais vive peinture que les écrivains modernes ont ensuite copiée. »
Voltaire cite parmi les ouvrages qu’il a eus sous les yeux l’Histoire ottomane du prince Cantemir, et l’Histoire militaire d’Adlerfell, qui donne exactement et jour par jour les marches de l’armée suédoise. Il a puisé dans l’ouvrage de Dalerac, Anecdotes de Pologne, et dans celui de Limiers, Histoire de la Suède pendant le règne de Charles XII. Mais il ne paraît pas s’être servi de l’Histoire de Charles XII, d’ailleurs fort superficielle, publiée en 1707, à Stockholm, par Grimaret.
On trouvera les preuves de l’enquête la plus opiniâtre dans le dossier qu’il déposa à la Bibliothèque du roi, et qui s’y trouve encore ; on y voit notamment sa correspondance avec Villelongue, qui avait été colonel au service du roi de Suède. On constate le soin, la prudence, avec lesquels il contrôle les témoignages qu’on lui donne. Ainsi Voltaire ne croit pas Villelongue, lorsque celui-ci lui affirme que le duc de Marlborough donna 400 000 écus au comte Piper pour détourner l’ardeur belliqueuse de Charles XII contre la Russie. Il n’admet la démarche bizarre et hardie de Villelongue auprès du sultan Achmet qu’après avoir interrogé M. de Fierville et un autre correspondant. Ces deux derniers confirment la première partie du récit de Villelongue, et nient l’entrevue de Villelongue avec le sultan.
« J’ai trouvé, dit Voltaire, de pareilles contrariétés dans les Mémoires que l’on m’a confiés. En ce cas, tout ce que doit faire un historien, c’est de conter ingénument le fait, sans vouloir pénétrer les motifs, et de se borner à dire précisément ce qu’il sait, au lieu de deviner ce qu’il ne sait pas. »
Les corrections nombreuses qu’il fit dans les éditions successives de son œuvre prouvent avec quel zèle il cherchait la vérité. Il lui en coûtait peu de rectifier une erreur ; on en a un remarquable exemple dans la Lettre aux auteurs de la Bibliothèque raisonnée, sur l’incendie de la ville d’Altena, qu’on trouvera dans les Mélanges.
Nous reproduisons d’autre part le bulletin bibliographique dressé par M. A. Geffroy, dans son édition classique de l’Histoire de Charles XII. Nous devons aussi mentionner parmi les éditions consultées par nous avec fruit celle donnée à la librairie Belin par M. L. Grégoire, professeur d’histoire au lycée Condorcet et au collège Chaptal.
L.M.
Les Anecdotes de Pologne, ou Mémoires secrets du règne de Jean Sobieski, IIIe du nom, par DALERAC, 2 vol. in-12. Paris, 1699.
Les Campagnes de Charles XII, roi de Suède, par GRIMARET 1707. 2 vol. in-18.
Mémoires pour servir à l’Histoire de Charles XII, imprimés par le secrétaire hollandais THEYLS, Leyde, 1722, in-12.
Remarques historiques et critiques sur l’Histoire de Charles XII, par M. DE LA MOTRAYE 1732, in-12.
Remarques sur l’Histoire de Charles XII, de Voltaire, par N.M. (NEMEITZ), Francfort, 1738, in-8°.
Histoire de Suède sous le règne de Charles XII, par LIMIERS, 6 vol. in-12. La Haye 1740. La première édition est de 1720.
Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède, depuis l’an 1700 jusqu’à la bataille de Pultava en 1709, écrite par ordre exprès de Sa Majesté par M. GUSTAVE ADLERFELT, chambellan du roi. On y a joint une Relation exacte de la bataille de Pultava, avec un journal de la retraite du roi à Bender. Amsterdam, MDCCXL.4 vol. in-12.
Histoire de Charles XII, roi de Suède, par M. J.-A. NORDBERG. Stockholm, 1740, 2 vol. in-fol. (en suédois).
Remarques d’un seigneur polonais (PONIATOWSKI) sur l’Histoire de Charles XII, par M. de Voltaire, in-8° 1741.
Histoire de Charles XII, de M. Nordberg, traduite du suédois par WARMHOLTZ. La Haye, 1742. 3 vol. in-4°.
Anecdotes du séjour du roi de Suède à Bender, ou Lettres de M. le baron de Fabrice, pour servir d’éclaircissement à l’Histoire de Charles XII. Hambourg, chez Chrétien Herold 1760.
Réflexions sur les talents militaires et sur le caractère de Charles XII, par le roi FRÉDÉRIC II. Berlin, 1786.
Voyage de deux Français en Allemagne, Danemark, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-92, par M. FORTIA DE PILES.5 vol. in-8°. Paris, Desenne, 1796.
Ouvrage à consulter sur la mort de Charles XII.
Mémoires concernant l’histoire de Charles XII, publiés par GUST. FLODERUS. in-8°. I-IV vol. Stockholm, 1819-26.
Ce sont : 1° des notes très nombreuses et fort minutieuses recueillies d’après son valet de chambre Hultmann. L’original est à la bibliothèque d’Upsal. Celles de ces notes qui concernent la bataille de Pultava sont curieuses ; 2° des lettres et autres documents.
Histoire moderne des États européens, par SCHŒLL, 46 vol. in-8°. Paris, 1830-34.
Histoire de la Régence, par LÉMONTEY. Paris, 1837.
Les notes de la fin sont très curieuses à consulter sur les dernières années de Charles XII.
Mémoires de J.-Chr. Pask au temps des rois Jean-Casimir, Michel Corybute et Jean III, publiés sur le manuscrit par E. RACZYNSKI, 3e édition. Posen 1840, in-8° (en polonais).
Ouvrage important à consulter sur l’histoire de Mazeppa.
Histoire de la Suède, par GEYER.1 vol. grand in-8°. Paris, 1843.
Fragments tirés des chroniques moldaves et valaques, pour servir à l’histoire de Pierre le Grand, Charles XII, Stanislas Lecszynski, Démètre Cantimir et Constantin Brançovan, par le major M. KOGALNICEAN.2 parties en 2 vol. in-8°. Jassi, 1845.
Carl XII’s brefvexling… Correspondance de Charles XII, principalement avec sa sœur la princesse Ulrique-Éléonore, de 1698 à 1709, par P.-A. WALLMARK 1830, in-8°, en suédois.
Carl XII’s död. Mort de Charles XII, par C. PALUDAN-MÜLLER. Traduit du danois en suédois, par SVEDERUS. Stockholm, 1846, in-8°.
Quœ a Carolo XII post pugnam Pultavensem de pace acta sint et quœ fuerint consilia Goerzii. Dissertatio academica, auctore F.-F. CARLSON. Upsalia, 1848, in-8°.
Berattelser… Récits de l’histoire de Suède, par FRYXEL, en suédois.
Lettres inédites du roi Charles XII, texte suédois, traduction française, avec introduction, notes et fac-similé, publiés par M. A. GEFFROY. Paris, Imprimerie impériale, 1853, in-8°.
L’Histoire de Charles XII, écrite en 1727 et 1728, fut imprimée pour la première fois en 1731, deux volumes in-12. L’auteur la retoucha à différentes époques, comme il le dit dans la Préface et dans sa note.
Dans la première édition, Voltaire accusait les Hambourgeois d’avoir acheté à prix d’argent la perte d’Altena, et d’avoir refusé asile à ses malheureux habitants. Un anonyme combattit cette opinion dans le tome IX de la Bibliothèque raisonnée. Voltaire n’eut que longtemps après connaissance de cet article. Convaincu par les raisons que donnait l’anonyme, il se rétracta. Cette rétractation est le sujet de la Lettre sur l’incendie d’Altena, imprimée dans les Mélanges à la date de 1732.
La Motraye qui, pendant le séjour à Bender, avait été attaché à Charles XII, publia, sous la forme d’une lettre à M. de Voltaire, des Remarques historiques et critiques sur l’Histoire de Charles XII, 1732, in-12. Voltaire, l’année suivante, fit imprimer les Remarques à la suite d’une nouvelle édition de son ouvrage, et les accompagna de notes qui jusqu’à ce jour n’ont été données dans aucune édition des Œuvres de Voltaire. On trouvera ces notes, au nombre de soixante-six, à la fin du présent ouvrage, précédées, chacune, du passage de La Motraye nécessaire pour son intelligence.
Les Remarques d’un seigneur polonais sur l’Histoire de Charles XII par M. de Voltaire parurent en 1741, un volume petit in-8°. Voltaire en parle, dans sa préface et dans une note. Il avait fait son profit de celles qu’il croyait justes et importantes. J’ai l’apporté une partie des autres en notes dans le courant du volume.
Les Réflexions sur les talents militaires et sur le caractère de Charles XII, roi de Suède, par Frédéric II, roi de Prusse, imprimées en 1760 à douze exemplaires, et faisant partie du tome IV des Œuvres du monarque prussien, n’ont aucun trait à l’ouvrage de Voltaire, qui n’y est pas nommé une seule fois.
Le P. Barre, chanoine de Sainte-Geneviève, est fréquemment cité dans les notes des deux premiers livres. Quoique Voltaire s’explique clairement cet égard dans l’Autre Avis, page 144, et encore dans la XIXe des Honnêtetéslittéraires (voyez les Mélanges, année 1767), on ne saurait trop répéter que le génovéfain ne publia qu’en 1748 son Histoire de l’empire d’Allemagne en onze volumes in-4°, dans lesquels il reproduisit, textuellement et sans citation, plusieurs passages de l’Histoire de Charles XII, publiée dès 1731, et que ce fut Voltaire qui fut traité de plagiaire.
Je possède un exemplaire des Œuvres de Voltaire (Dresde, 1748-54) qui paraît avoir été destiné à une réimpression, puisque plusieurs volumes contiennent des corrections de la main de Longchamp, valet de chambre et secrétaire de Voltaire, que je n’ai trouvées que dans l’édition de 1751 ; encore y en avait-il une qui avait été omise ; mais, quoique admises dans l’édition de 1751, ces corrections n’ont point passé dans les éditions suivantes. Cependant elles étaient toutes justes, et quelques-unes très importantes. Aussi n’ai-je pas hésité à les admettre. Leur authenticité m’a paru suffisamment établie par la copie que j’en possède de la main de Longchamp, et par leur existence dans l’édition de 1751.
Je n’en puis dire autant pour les deux corrections que je me suis permis de faire aux pages 151 et 244, n’ayant l’autorité d’aucune édition ni d’aucun manuscrit ; j’ai donné en note mes raisons, qu’on rejettera si on ne les trouve pas fondées.
J’étais fort embarrassé sur la manière d’écrire les noms propres. Il n’est pas toujours possible de concilier l’exactitude avec le système de Voltaire, qu’il me fallait respecter. J’ai eu recours à l’obligeance de M. Eyriès, à qui les langues et l’histoire du Nord sont familières. C’est d’après ses avis que j’ai écrit Dahlberg, Rebnsköld, etc., au lieu de d’Alberg, Renschild, etc. Mais quelque bons que fussent ses conseils, je ne les ai pas toujours suivis. Voltaire s’est prononcé trop formellement contre l’emploi des W en français pour qu’il me fût possible d’écrire Lewenhaupt et Wallenstein. J’ai donc laissé Levenhaupt et Valstein. Ce dernier mot, au reste, est admis par d’autres écrivains français. Voltaire toutefois a écrit, ou du moins laissé imprimer Wratislau et Alexiowitz.
Quant à Sheremetof, voyez, sur les différentes manières d’écrire ce nom, la note de Voltaire au chapitre VIII de la première partie de son Histoire de Russie.
Malgré tout mon désir, je ne me dissimule pas l’impossibilité, dans l’impression d’un auteur tel que Voltaire, d’écrire toujours le même nom de la même manière.
Voltaire avait publié, en 1744, une Lettre à M. Nordberg, in-8° de 16 pages. En 1750 il fit imprimer, dans le même volume qu’Oreste, une Lettre au maréchal de Schulenbourg, datée du 15 septembre 1740. Ce n’est qu’en 1752 que ces deux lettres ont été imprimées avec l’Histoire de Charles XII, et on les y a toujours laissées depuis lors. Aucune des éditions des Œuvres de Voltaire, données de son vivant, ne contenant sa correspondance, on pouvait placer à peu près où l’on voulait le petit nombre de ses lettres qu’on imprimait. Mais en donnant sa correspondance il fallait y rassembler autant que possible toutes ses lettres. C’est ce que j’ai fait pour les deux dont je viens de parler, ainsi que pour beaucoup d’autres, qui seront mises à leurs dates dans la Correspondance.
Les notes signées d’un P sont du comte Poniatowski, auteur des Remarques d’un seigneur polonais, publiées en 1741.
Paris, 1er décembre 1829.
B.
L’incrédulité, souvenons-nous-en, est le fondement de toute sagesse, selon Aristote. Cette maxime est fort bonne pour qui lit l’histoire, et surtout l’histoire ancienne.
Que de faits absurdes, quel amas de fables qui choquent le sens commun ! Eh bien, n’en croyez rien.
Il y a eu des rois à Rome, des consuls, des décemvirs. Le peuple romain a détruit Carthage ; César a vaincu Pompée : tout cela est vrai ; mais quand on vous dit que Castor et Pollux ont combattu pour ce peuple ; qu’une vestale avec sa ceinture a mis à flot un vaisseau engravé ; qu’un gouffre s’est refermé quand Curtius s’y est jeté : n’en croyez rien. Vous lisez partout des prodiges, des prédictions accomplies, des guérisons miraculeuses opérées dans les temples d’Esculape : n’en croyez rien ; mais cent témoins ont signé le procès-verbal de ces miracles sur des tables d’airain ; mais les temples étaient remplis d’ex-voto qui attestaient les guérisons : croyez qu’il y a eu des imbéciles et des fripons qui ont attesté ce qu’ils n’ont point vu. Croyez qu’il y a eu des dévots qui ont fait des présents aux prêtres d’Esculape quand leurs enfants ont été guéris d’un rhume ; mais pour les miracles d’Esculape, n’en croyez rien. Ils ne sont pas plus vrais que ceux du jésuite Xavier, à qui un cancre vint rapporter son crucifix du fond de la mer, et qui se trouva à la fois sur deux vaisseaux.
Mais les prêtres égyptiens étaient tous sorciers, et Hérodote admire la science profonde qu’ils avaient de la diablerie : ne croyez pas tout ce que vous dit Hérodote.
Je me défierai de tout ce qui est prodige ; mais dois-je porter l’incrédulité jusqu’aux faits qui, étant dans l’ordre ordinaire des choses humaines, manquent pourtant d’une vraisemblance morale ?
Par exemple, Plutarque assure que César tout armé se jeta dans la mer d’Alexandrie, tenant d’une main en l’air des papiers qu’il ne voulait pas mouiller, et nageant de l’autre main. Ne croyez pas un mot de ce conte que vous fait Plutarque : croyez plutôt César, qui n’en dit mot dans ses Commentaires, et soyez bien sûr que quand on se jette dans la mer, et qu’on tient des papiers à la main, on les mouille.
Vous trouverez dans Quinte-Curce qu’Alexandre et ses généraux furent tout étonnés quand ils virent le flux et le reflux de l’Océan, auquel ils ne s’attendaient pas : n’en croyez rien.
Il est bien vraisemblable qu’Alexandre, étant ivre, ait tué Clitus ; qu’il ait aimé Éphestion comme Socrate aimait Alcibiade ; mais il ne l’est point du tout que le disciple d’Aristote ignorât le flux et le reflux de l’Océan. Il y avait des philosophes dans son armée : c’était assez d’avoir été sur l’Euphrate, qui a des marées à son embouchure, pour être instruit de ce phénomène. Alexandre avait voyagé en Afrique, dont les côtes sont baignées par l’Océan. Son amiral Néarque pouvait-il être assez ignorant pour ne pas savoir ce que savaient tous les enfants sur le rivage du fleuve Indus ? De pareilles sottises, répétées dans tant d’auteurs, décréditent trop les historiens.
Le P. Maimbourg vous redit, après cent autres, que deux juifs promirent l’empire à Léon l’Isaurien, à condition que quand il serait empereur il abattrait les images. Quel intérêt, je vous prie, avaient ces deux juifs à empêcher que les chrétiens eussent des tableaux ? comment ces deux misérables pouvaient-ils promettre l’empire ? N’est-ce pas insulter à son lecteur que de lui présenter de telles fables ?
Il faut avouer que Mézerai, dans son style dur, bas, inégal, mêle aux faits mal digérés qu’il rapporte bien des absurdités pareilles : tantôt c’est Henri V, roi d’Angleterre, couronné roi de France à Paris, qui meurt des hémorroïdes pour s’être, dit-il, assis sur le trône de nos rois ; tantôt c’est saint Michel qui apparaît à Jeanne d’Arc.
Je ne crois pas même les témoins oculaires, quand ils me disent des choses que le sens commun désavoue. Le sire de Joinville, ou plutôt celui qui a traduit son histoire gauloise en ancien français, a beau m’assurer que les émirs d’Égypte, après avoir assassiné leur soudan, offrirent la couronne à saint Louis leur prisonnier : j’aimerais autant qu’on me dît que nous avons offert la couronne de France à un Turc. Quelle apparence que des mahométans aient pensé à faire leur souverain d’un homme qu’ils ne pouvaient regarder que comme un chef de barbares, qu’ils avaient pris dans une bataille, qui ne connaissait ni leurs lois ni leur langue, qui était l’ennemi capital de leur religion.
Je n’ai pas plus de foi au sire de Joinville, quand il me fait ce conte, que quand il me dit que le Nil se déborde à la Saint-Remi, au commencement d’octobre. Je révoquerai aussi hardiment en doute l’histoire du Vieux de la Montagne, qui, sur le bruit de la croisade de saint Louis, dépêche deux assassins à Paris pour le tuer, et, sur le bruit de sa vertu, fait partir le lendemain deux courriers pour contremander les autres. Ce trait a trop l’air d’un conte arabe.
Je dirai hardiment à Mézerai, au P. Daniel, et à tous les historiens, que je ne crois point qu’un orage de pluie et de grêle ait fait rentrer Édouard III en lui-même, et ait procuré la paix à Philippe de Valois. Les conquérants ne sont pas si dévots, et ne font point la paix pour de la pluie.
Rien n’est assurément plus vraisemblable que les crimes ; mais il faut du moins qu’ils soient constatés. Vous voyez chez Mézerai plus de soixante princes à qui on a donné le boucon ; mais il le dit sans preuve, et un bruit populaire ne doit se rapporter que comme un bruit.
Je ne croirai pas même Tite-Live, quand il me dit que le médecin de Pyrrhus offrit aux Romains d’empoisonner son maître moyennant une récompense. À peine les Romains avaient-ils alors de l’argent monnayé, et Pyrrhus avait de quoi acheter la république si elle avait voulu se vendre ; la place de premier médecin de Pyrrhus était plus lucrative probablement que celle de consul. Je n’ajouterai foi à un tel conte que quand on me prouvera que quelque premier médecin d’un de nos rois aura proposé à un canton suisse de le payer pour empoisonner son malade.
Défions-nous aussi de tout ce qui paraît exagéré. Une armée innombrable de Perses arrêtée par trois cents Spartiates au passage des Thermopyles ne me révolte point : l’assiette du terrain rend l’aventure croyable. Charles XII, avec huit mille hommes aguerris, défait à Narva environ quatre-vingt mille paysans moscovites mal armés ; je l’admire, et je le crois. Mais quand je lis que Simon de Montfort battit cent mille hommes avec neuf cents soldats divisés en trois corps, je répète alors : Je n’en crois rien. On me dit que c’est un miracle ; mais est-il bien vrai que Dieu ait fait ce miracle pour Simon de Montfort ?
Je révoquerais en doute le combat de Charles XII à Bender s’il ne m’avait été attesté par plusieurs témoins oculaires, et si le caractère de Charles XII ne rendait vraisemblable cette héroïque extravagance. Cette défiance qu’il faut avoir sur les faits particuliers, ayons-la encore sur les mœurs des peuples étrangers ; refusons notre créance à tout historien ancien et moderne qui nous rapporte des choses contraires à la nature et à la trempe du cœur humain.
Toutes les premières relations de l’Amérique ne parlaient que d’anthropophages ; il semblait, à les entendre, que les Américains mangeassent des hommes aussi communément que nous mangeons des moutons. Le fait, mieux éclairci, se réduit à un petit nombre de prisonniers qui ont été mangés par leurs vainqueurs, au lieu d’être mangés des vers.
Le nouveau Puffendorf, aussi fautif que l’ancien, dit qu’en l’an 1589 un Anglais et quatre femmes, échappés d’un naufrage sur la route de Madagascar, abordèrent une île déserte, et que l’Anglais travailla si bien, qu’en l’an 1667 on trouva cette île, nommée Pines, peuplée de douze mille beaux protestants anglais.
Les anciens et leurs innombrables et crédules compilateurs nous répètent sans cesse qu’à Babylone, la ville de l’univers la mieux policée, toutes les femmes et les filles se prostituaient dans le temple de Vénus une fois l’an. Je n’ai pas de peine à penser qu’à Babylone, comme ailleurs, on avait quelquefois du plaisir pour de l’argent ; mais je ne me persuaderai jamais que dans la ville la mieux policée qui fût alors dans l’univers, tous les pères et tous les maris envoyassent leurs filles et leurs femmes à un marché de prostitution publique, et que les législateurs ordonnassent ce beau trafic. On imprime tous les jours cent sottises semblables sur les coutumes des Orientaux ; et pour un voyageur comme Chardin, que de voyageurs comme Paul Lucas, et comme Jean Struys, et comme le jésuite Avril, qui baptisait mille personnes par jour chez les Persans, dont il n’entendait pas la langue, et qui vous dit que les caravanes russes allaient à la Chine et revenaient en trois mois !
Un moine grec, un moine latin, écrivent que Mahomet II a livré toute la ville de Constantinople au pillage ; qu’il a brisé lui-même les images de Jésus-Christ, et qu’il a changé toutes les églises en mosquées. Ils ajoutent, pour rendre ce conquérant plus odieux, qu’il a coupé la tête à sa maîtresse pour plaire à ses janissaires, qu’il a fait éventrer quatorze de ses pages pour savoir qui d’eux avait mangé un melon. Cent historiens copient ces misérables fables ; les dictionnaires de l’Europe les répètent. Consultez les véritables annales turques, recueillies par le prince Cantemir, vous verrez combien tous ces mensonges sont ridicules. Vous apprendrez que le grand Mahomet II ayant pris d’assaut la moitié de la ville de Constantinople daigna capituler avec l’autre, et conserva toutes les églises ; qu’il créa un patriarche grec, auquel il rendit plus d’honneurs que les empereurs grecs n’en avaient jamais rendu aux prédécesseurs de cet évêque. Enfin consultez le sens commun, vous jugerez combien il est ridicule de supposer qu’un grand monarque, savant et même poli, tel qu’était Mahomet II, ait fait éventrer quatorze pages pour un melon ; et pour peu que vous soyez instruit des mœurs des Turcs, vous verrez à quel point il est extravagant d’imaginer que les soldats se mêlent de ce qui se passe entre le sultan et ses femmes, et qu’un empereur coupe la tête à sa favorite pour leur plaire. C’est ainsi pourtant que la plupart des histoires sont écrites.
Il n’en est pas ainsi de l’Histoire de Charles XII. Je peux assurer que si jamais histoire a mérité la créance du lecteur, c’est celle-ci. Je la composai d’abord, comme on sait, sur les mémoires de M. Fabrice, de MM. de Villelongue et de Fierville, et sur le rapport de beaucoup de témoins oculaires ; mais comme les témoins ne voient pas tout, et qu’ils voient quelquefois mal, je tombai dans plus d’une erreur, non sur les faits essentiels, mais sur quelques anecdotes qui sont assez indifférentes en elles-mêmes, et sur lesquelles les petits critiques triomphent.
J’ai depuis réformé cette histoire sur le journal militaire de M. Adlerfelt, qui est très exact, et qui a servi à rectifier quelques faits et quelques dates.
J’ai même fait usage de l’histoire écrite par Nordberg, chapelain et confesseur de Charles XII. Il est vrai que c’est un ouvrage bien mal digéré et bien mal écrit, dans lequel on trouve trop de petits faits étrangers à son sujet, et où les grands évènements deviennent petits, tant ils sont mal rapportés. C’est un tissu de rescrits, de déclarations, de publications, qui se font d’ordinaire au nom des rois quand ils sont en guerre. Elles ne servent jamais à faire connaître le fond des évènements ; elles sont inutiles au militaire et au politique, et sont ennuyeuses pour le lecteur : un écrivain peut seulement les consulter quelquefois dans le besoin, pour en tirer quelque lumière, ainsi qu’un architecte emploie des décombres dans un édifice.
Parmi les pièces publiques dont Nordberg a surchargé sa malheureuse histoire, il s’en trouve même de fausses et d’absurdes, comme la lettre d’Achmet, empereur des Turcs, que cet historien appelle sultan bassa par la grâce de Dieu.
Ce même Nordberg fait dire au roi de Suède ce que ce monarque n’a jamais dit ni pu dire au sujet du roi Stanislas. Il prétend que Charles XII, en répondant aux objections du primat, lui dit que Stanislas avait acquis beaucoup d’amis dans son voyage d’Italie. Cependant il est très certain que jamais Stanislas n’a été en Italie, ainsi que ce monarque me l’a confirmé lui-même. Qu’importe, après tout, qu’un Polonais, dans le XVIIIe siècle, ait voyagé ou non en Italie pour son plaisir ? Que de faits inutiles il faut retrancher de l’histoire ! et que je me sais bon gré d’avoir resserré celle de Charles XII !
Nordberg n’avait ni lumières, ni esprit, ni connaissance des affaires du monde ; et c’est peut-être ce qui détermina Charles XII à le choisir pour son confesseur : je ne sais s’il a fait de ce prince un bon chrétien ; mais assurément il n’en a pas fait un héros, et Charles XII serait ignoré s’il n’était connu que par Nordberg.
Il est bon d’avertir ici que l’on a imprimé, il y a quelques années, une petite brochure intitulée Remarques historiques et critiques sur l’histoire de Charles XII par M. de Voltaire. Ce petit ouvrage est du comte Poniatowski : ce sont des réponses qu’il avait faites à de nouvelles questions de ma part dans son dernier voyage à Paris ; mais, son secrétaire en ayant fait une double copie, elle tomba entre les mains d’un libraire, qui ne manqua pas de l’imprimer ; et un correcteur d’imprimerie de Hollande intitula Critique cette instruction de M. Poniatowski, pour la mieux débiter. C’est un des moindres brigandages qui s’exercent dans la librairie.
La Motraye, domestique de M. Fabrice, avait aussi imprimé quelques remarques sur cette histoire. Parmi les erreurs et les petitesses dont cette critique de La Motraye est remplie, il ne laisse pas de se trouver quelque chose de vrai et d’utile ; et j’ai eu soin d’en faire usage dans les dernières éditions, et surtout dans celle de 1739 : car, en fait d’histoire, rien n’est à négliger ; et il faut consulter, si l’on peut, les rois et les valets de chambre.
Il y a bien peu de souverains dont on dût écrire une histoire particulière. En vain la malignité ou la flatterie s’est exercée sur presque tous les princes : il n’y en a qu’un très petit nombre dont la mémoire se conserve ; et ce nombre serait encore plus petit si l’on ne se souvenait que de ceux qui ont été justes.
Les princes qui ont le plus de droit à l’immortalité sont ceux qui ont fait quelque bien aux hommes. Ainsi, tant que la France subsistera, on s’y souviendra de la tendresse que Louis XII avait pour son peuple ; on excusera les grandes fautes de François Ier en faveur des arts et des sciences dont il a été le père ; on bénira la mémoire de Henri IV, qui conquit son héritage à force de vaincre et de pardonner ; on louera la magnificence de Louis XIV, qui a protégé les arts, que François Ier avait fait naître.
Par une raison contraire, on garde le souvenir des mauvais princes, comme on se souvient des inondations, des incendies et des pestes.
Entre les tyrans et les bons rois sont les conquérants, mais plus approchants des premiers : ceux-ci ont une réputation éclatante, on est avide de connaître les moindres particularités de leur vie. Telle est la misérable faiblesse des hommes, qu’ils regardent avec admiration ceux qui ont fait du mal d’une manière brillante, et qu’ils parleront souvent plus volontiers du destructeur d’un empire que de celui qui l’a fondé.
Pour tous les autres princes, qui n’ont été illustres ni en paix ni en guerre, et qui n’ont été connus ni par de grands vices, ni par de grandes vertus, comme leur vie ne fournit aucun exemple ni à imiter ni à fuir, elle n’est pas digne qu’on s’en souvienne. De tant d’empereurs de Rome, d’Allemagne, de Moscovie, de tant de sultans, de califes, de papes, de rois, combien y en a-t-il dont le nom ne mérite de se trouver ailleurs que dans les tables chronologiques, où ils ne sont que pour servir d’époques ?
Il y a un vulgaire parmi les princes comme parmi les autres hommes ; cependant la fureur d’écrire est venue au point qu’à peine un souverain cesse de vivre que le public est inondé de volumes sous le nom de mémoires, d’histoire de sa vie, d’anecdotes de sa cour. Par là les livres se multiplient de telle sorte qu’un homme qui vivrait cent ans, et qui les emploierait à lire, n’aurait pas le temps de parcourir ce qui s’est imprimé sur l’histoire seule, depuis deux siècles, en Europe.
Cette démangeaison de transmettre à la postérité des détails inutiles, et d’arrêter les yeux des siècles à venir sur des évènements communs, vient d’une faiblesse très ordinaire à ceux qui ont vécu dans quelque cour, et qui ont eu le malheur d’avoir quelque part aux affaires publiques. Ils regardent la cour où ils ont vécu comme la plus belle qui ait jamais été ; le roi qu’ils ont vu, comme le plus grand monarque ; les affaires dont ils se sont mêlés, comme ce qui a jamais été de plus important dans le monde. Ils s’imaginent que la postérité verra tout cela avec les mêmes yeux.
Qu’un prince entreprenne une guerre, que sa cour soit troublée d’intrigues, qu’il achète l’amitié d’un de ses voisins, et qu’il vende la sienne à un autre ; qu’il fasse enfin la paix avec ses ennemis après quelques victoires et quelques défaites ; ses sujets, échauffés par la vivacité de ces évènements présents, pensent être dans l’époque la plus singulière depuis la création. Qu’arrive-t-il ? ce prince meurt ; on prend après lui des mesures toutes différentes ; on oublie, et les intrigues de sa cour, et ses maîtresses, et ses ministres, et ses généraux, et ses guerres, et lui-même.
Depuis le temps que les princes chrétiens tâchent de se tromper les uns les autres, et font des guerres et des alliances, on a signé des milliers de traités et donné autant de batailles ; les belles ou infâmes actions sont innombrables. Quand toute cette foule d’évènements et de détails se présente devant la postérité, ils sont presque tous anéantis les uns par les autres ; les seuls qui restent sont ceux qui ont produit de grandes révolutions, ou ceux qui, ayant été décrits par quelque écrivain excellent, se sauvent de la foule, comme des portraits d’hommes obscurs peints par de grands maîtres.
On se serait donc donné bien de garde d’ajouter cette histoire particulière de Charles XII, roi de Suède, à la multitude des livres dont le public est accablé, si ce prince et son rival, Pierre Alexiowitz, beaucoup plus grand homme que lui, n’avaient été, du consentement de toute la terre, les personnages les plus singuliers qui eussent paru depuis plus de vingt siècles. Mais on n’a pas été déterminé seulement à donner cette vie par la petite satisfaction d’écrire des faits extraordinaires ; on a pensé que cette lecture pourrait être utile à quelques princes, si ce livre leur tombe par hasard entre les mains. Certainement il n’y a point de souverain qui, en lisant la vie de Charles XII, ne doive être guéri de la folie des conquêtes. Car, où est le souverain qui pût dire : J’ai plus de courage et de vertus, une âme plus forte, un corps plus robuste ; j’entends mieux la guerre, j’ai de meilleures troupes que Charles XII ? Que si, avec tous ces avantages, et après tant de victoires, ce roi a été si malheureux, que devraient espérer les autres princes qui auraient la même ambition, avec moins de talents et de ressources ?
On a composé cette histoire sur des récits de personnes connues, qui ont passé plusieurs années auprès de Charles XII et de Pierre le Grand, empereur de Moscovie, et qui, s’étant retirées dans un pays libre, longtemps après la mort de ces princes, n’avaient aucun intérêt de déguiser la vérité. M. Fabrice, qui a vécu sept années dans la familiarité de Charles XII ; M. de Fierville, envoyé de France ; M. de Villelongue, colonel au service de Suède ; M. Poniatowski même, ont fourni les mémoires.
On n’a pas avancé un seul fait sur lequel on n’ait consulté des témoins oculaires et irréprochables. C’est pourquoi on trouvera cette histoire fort différente des gazettes qui ont paru jusqu’ici sous le nom de la Vie de Charles XII. Si l’on a omis plusieurs petits combats donnés entre les officiers suédois et moscovites, c’est qu’on n’a point prétendu écrire l’histoire de ces officiers, mais seulement celle du roi de Suède ; même, parmi les évènements de sa vie, on n’a choisi que les plus intéressants. On est persuadé que l’histoire d’un prince n’est pas tout ce qu’il a fait, mais ce qu’il a fait de digne d’être transmis à la postérité.
On est obligé d’avertir que plusieurs choses, qui étaient vraies lorsqu’on écrivit cette histoire en 1728, cessent déjà de l’être aujourd’hui en 1739. Le commerce commence, par exemple, à être moins négligé en Suède. L’infanterie polonaise est mieux disciplinée, et a des habits d’ordonnance qu’elle n’avait pas alors. Il faut toujours, lorsqu’on lit une histoire, songer au temps où l’auteur a écrit. Un homme qui ne lirait que le cardinal de Retz prendrait les Français pour des forcenés qui ne respirent que la guerre civile, la faction, et la folie. Celui qui ne lirait que l’histoire des belles années de Louis XIV dirait : Les Français sont nés pour obéir, pour vaincre, et pour cultiver les arts. Un autre qui verrait les mémoires des premières années de Louis XV ne remarquerait dans notre nation que de la mollesse, une avidité extrême de s’enrichir, et trop d’indifférence pour tout le reste. Les Espagnols d’aujourd’hui ne sont plus les Espagnols de Charles-Quint, et peuvent l’être dans quelques années. Les Anglais ne ressemblent pas plus aux fanatiques de Cromwell que les moines et les monsignori dont Rome est peuplée ne ressemblent aux Scipions. Je ne sais si les Suédois pourraient avoir tout d’un coup des troupes aussi formidables que celles de Charles XII. On dit d’un homme : Il était brave un tel jour ; il faudrait dire, en parlant d’une nation : Elle paraissait telle sous un tel gouvernement, et en telle année.
Si quelque prince et quelque ministre trouvaient dans cet ouvrage des vérités désagréables, qu’ils se souviennent qu’étant hommes publics ils doivent compte au public de leurs actions ; que c’est à ce prix qu’ils achètent leur grandeur ; que l’histoire est un témoin et non un flatteur ; et que le seul moyen d’obliger les hommes à dire du bien de nous, c’est d’en faire.
SUR L’HISTOIRE
Ne cessera-t-on jamais de nous tromper sur l’avenir, le présent, et le passé ? Il faut que l’homme soit bien né pour l’erreur, puisque dans ce siècle éclairé on prend tant de plaisir à nous débiter les fables d’Hérodote, et des fables encore qu’Hérodote n’aurait jamais osé conter même à des Grecs.
Que gagne-t-on à nous redire que Ménès était petit-fils de Noé ? et par quel excès d’injustice peut-on se moquer des généalogies de Moréri, quand on en fabrique de pareilles ? Certes Noé envoya sa famille voyager loin : son petit-fils Ménès, en Égypte ; son autre petit-fils, à la Chine ; je ne sais quel autre petit-fils, en Suède, et un cadet, en Espagne. Les voyages alors formaient les jeunes gens bien mieux qu’aujourd’hui : il a fallu chez nos nations modernes des dix ou douze siècles pour s’instruire un peu de la géométrie ; mais ces voyageurs dont on parle étaient à peine arrivés dans des pays incultes qu’on y prédisait les éclipses. On ne peut douter au moins que l’histoire authentique de la Chine ne rapporte des éclipses calculées il y a environ quatre mille ans. Confucius en cite trente-six, dont les missionnaires mathématiciens ont vérifié trente-deux. Mais ces faits n’embarrassent point ceux qui ont fait Noé grand-père de Fo-hi : car rien ne les embarrasse.
D’autres adorateurs de l’antiquité nous font regarder les Égyptiens comme le peuple le plus sage de la terre, parce que, dit-on, les prêtres avaient chez eux beaucoup d’autorité ; et il se trouve que ces prêtres si sages, ces législateurs d’un peuple sage, adoraient des singes, des chats, et des oignons. On a beau se récrier sur la beauté des anciens ouvrages égyptiens, ceux qui nous sont restés sont des masses informes ; la plus belle statue de l’ancienne Égypte n’approche pas de celle du plus médiocre de nos ouvriers. Il a fallu que les Grecs enseignassent aux Égyptiens la sculpture ; il n’y a jamais eu en Égypte aucun bon ouvrage que de la main des Grecs. Quelle prodigieuse connaissance, nous dit-on, les Égyptiens avaient de l’astronomie ! les quatre côtés d’une grande pyramide sont exposés aux quatre régions du monde ; ne voilà-t-il pas un grand effort d’astronomie ? Ces Égyptiens étaient-ils autant de Cassini, de Halley, de Kepler, de Ticho-Brahé ? Ces bonnes gens racontaient froidement à Hérodote que le soleil, en onze mille ans, s’était couché deux fois où il se lève : c’était là leur astronomie.
Il en coûtait, répète M. Rollin, cinquante mille écus pour ouvrir et fermer les écluses du lac Mœris. M. Rollin est cher en écluses, et se mécompte en arithmétique. Il n’y a point d’écluse qui ne doive s’ouvrir et se fermer pour un écu, à moins qu’elle ne soit très mal faite. Il en coûtait, dit-il, cinquante talents pour ouvrir et fermer ces écluses. Il faut savoir qu’on évalua le talent du temps de Colbert à trois mille livres de France. Rollin ne songe pas que depuis ce temps la valeur numéraire de nos espèces est augmentée presque du double, et qu’ainsi la peine d’ouvrir les écluses du lac Mœris aurait dû coûter, selon lui, environ trois cent mille francs, ce qui est à peu près deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept livres plus qu’il ne faut. Tous les calculs de ses treize tomes se ressentent de cette inattention. Il répète encore après Hérodote qu’on entretenait d’ordinaire en Égypte, c’est-à-dire dans un pays beaucoup moins grand que la France, quatre cent mille soldats ; qu’on donnait à chacun cinq livres de pain par jour et deux livres de viande. C’est donc huit cent mille livres de viande par jour pour les seuls soldats, dans un pays où l’on n’en mangeait presque point. D’ailleurs à qui appartenaient ces quatre cent mille soldats, quand l’Égypte était divisée en plusieurs petites principautés ? On ajoute que chaque soldat avait six arpents francs de contributions ; voilà donc deux millions quatre cent mille arpents qui ne payent rien à l’État. C’est cependant ce petit État qui entretenait plus de soldats que n’en a aujourd’hui le Grand Seigneur, maître de l’Égypte et de dix fois plus de pays que l’Égypte n’en contient. Louis XIV a eu quatre cent mille hommes sous les armes pendant quelques années ; mais c’était un effort, et cet effort a ruiné la France.
Si on voulait faire usage de sa raison au lieu de sa mémoire, et examiner plus que transcrire, on ne multiplierait pas à l’infini les livres et les erreurs ; il faudrait n’écrire que des choses neuves et vraies. Ce qui manque d’ordinaire à ceux qui compilent l’histoire, c’est l’esprit philosophique : la plupart, au lieu de discuter des faits avec des hommes, font des contes à des enfants. Faut-il qu’au siècle où nous vivons on imprime encore le conte des Oreilles de Smerdis, et de Darius, qui fut déclaré roi par son cheval, lequel hennit le premier ; et de Sanacharib, ou Sennakérib, ou Sennacabon, dont l’armée fut détruite miraculeusement par des rats ! Quand on veut répéter ces contes, il faut du moins les donner pour ce qu’ils sont.
Est-il permis à un homme de bon sens, né dans le XVIIIe siècle, de nous parler sérieusement des oracles de Delphes ? tantôt de nous répéter que cet oracle devina que Crésus faisait cuire une tortue et du mouton dans une tourtière ; tantôt de nous dire que des batailles furent gagnées suivant la prédiction d’Apollon, et d’en donner pour raison le pouvoir du diable ? M. Rollin, dans sa compilation de l’histoire ancienne, prend le parti des oracles contre MM. Van Dale, Fontenelle, et Basnage. « Pour M. de Fontenelle, dit-il, il ne faut regarder que comme un ouvrage de jeunesse son livre contre les oracles, tiré de Van Dale. » J’ai bien peur que cet arrêt de la vieillesse de Rollin contre la jeunesse de Fontenelle ne soit cassé au tribunal de la raison ; les rhéteurs n’y gagnent guère leurs causes contre les philosophes. Il n’y a qu’à voir ce que dit Rollin dans son dixième tome, où il veut parler de physique : il prétend qu’Archimède, voulant faire voir à son bon ami le roi de Syracuse la puissance des mécaniques, fit mettre à terre une galère, la fit charger doublement, et la remit doucement à flot en remuant un doigt, sans sortir de dessus sa chaise. On sent bien que c’est là le rhéteur qui parle : s’il avait été un peu philosophe, il aurait vu l’absurdité de ce qu’il avance.
Il me semble que si l’on voulait mettre à profit le temps présent, on ne passerait point sa vie à s’infatuer des fables anciennes. Je conseillerais à un jeune homme d’avoir une légère teinture de ces temps reculés ; mais je voudrais qu’on commençât une étude sérieuse de l’histoire au temps où elle devient véritablement intéressante pour nous : il me semble que c’est vers la fin du XVe siècle. L’imprimerie, qu’on inventa en ce temps-là, commence à la rendre moins incertaine. L’Europe change de face ; les Turcs, qui s’y répandent, chassent les belles-lettres de Constantinople : elles fleurissent en Italie ; elles s’établissent en France ; elles vont polir l’Angleterre, l’Allemagne, et le Septentrion. Une nouvelle religion sépare la moitié de l’Europe de l’obédience du pape. Un nouveau système de politique s’établit ; on fait, avec le secours de la boussole, le tour de l’Afrique, et on commerce avec la Chine plus aisément que de Paris à Madrid. L’Amérique est découverte ; on subjugue un nouveau monde, et le nôtre est presque tout changé ; l’Europe chrétienne devient une espèce de république immense, où la balance du pouvoir est établie mieux qu’elle ne le fut en Grèce. Une correspondance perpétuelle en lie toutes les parties, malgré les guerres que l’ambition des rois suscite, et même malgré les guerres de religion, encore plus destructives. Les arts, qui font la gloire des États, sont portés à un point que la Grèce et Rome ne connurent jamais. Voilà l’histoire qu’il faut que tout homme sache ; c’est là qu’on ne trouve ni prédictions chimériques, ni oracles menteurs, ni faux miracles, ni fables insensées : tout y est vrai, aux petits détails près, dont il n’y a que les petits esprits qui se soucient beaucoup. Tout nous regarde, tout est fait pour nous ; l’argent sur lequel nous prenons nos repas, nos meubles, nos besoins, nos plaisirs nouveaux ; tout nous fait souvenir chaque jour que l’Amérique et les Grandes-Indes, et par conséquent toutes les parties du monde entier, sont réunies depuis environ deux siècles et demi par l’industrie de nos pères. Nous ne pouvons faire un pas qui ne nous avertisse du changement qui s’est opéré depuis dans le monde. Ici ce sont cent villes qui obéissaient au pape, et qui sont devenues libres. Là on a fixé pour un temps les privilèges de toute l’Allemagne. Ici se forme la plus belle des républiques dans un terrain que la mer menace chaque jour d’engloutir. L’Angleterre a réuni la vraie liberté avec la royauté ; la Suède l’imite, et le Danemark n’imite point la Suède. Que je voyage en Allemagne, en France, en Espagne, partout je trouve les traces de cette longue querelle qui a subsisté entre les maisons d’Autriche et de Bourbon, unies par tant de traités, qui ont tous produit des guerres funestes. Il n’y a point de particulier en Europe sur la fortune duquel tous ces changements n’aient influé. Il sied bien, après cela, de s’occuper de Salmanasar et de Mardokempad, et de rechercher les anecdotes du Persan Cayamarrat et de Sabaco Métophis ! Un homme mûr, qui a des affaires sérieuses, ne répète point les contes de sa nourrice.
SUR L’HISTOIRE
Peut-être arrivera-t-il bientôt dans la manière d’écrire l’histoire ce qui est arrivé dans la physique. Les nouvelles découvertes ont fait proscrire les anciens systèmes. On voudra connaître le genre humain dans ce détail intéressant qui fait aujourd’hui la base de la philosophie naturelle.
On commence à respecter très peu l’aventure de Curtius, qui referma un gouffre en se précipitant au fond, lui et son cheval. On se moque des boucliers descendus du ciel, et de tous les beaux talismans dont les dieux faisaient présent si libéralement aux hommes, et des vestales qui mettaient un vaisseau à flot avec leur ceinture, et de toute cette foule de sottises célèbres dont les anciens historiens regorgent. On n’est guère plus content que, dans son histoire ancienne, M. Rollin nous parle sérieusement du roi Nabis, qui faisait embrasser sa femme par ceux qui lui apportaient de l’argent, et qui mettait ceux qui lui en refusaient dans les bras d’une belle poupée toute semblable à la reine, et armée de pointes de fer sous son corps de jupe. On rit quand on voit tant d’auteurs répéter, les uns après les autres, que le fameux Othon, archevêque de Mayence, fut assiégé et mangé par une armée de rats, en 698 ; que des pluies de sang inondèrent la Gascogne en 1017 ; que deux armées de serpents se battirent près de Tournai en 1059. Les prodiges, les prédictions, les épreuves par le feu, etc., sont à présent dans le même rang que les contes d’Hérodote.
Je veux parler ici de l’histoire moderne, dans laquelle on ne trouve ni poupées qui embrassent les courtisans, ni évêques mangés par les rats.
On a grand soin de dire quel jour s’est donnée une bataille, et on a raison. On imprime les traités, on décrit la pompe d’un couronnement, la cérémonie de la réception d’une barrette, et même l’entrée d’un ambassadeur dans laquelle on n’oublie ni son suisse ni ses laquais. Il est bon qu’il y ait des archives de tout, afin qu’on puisse les consulter dans le besoin ; et je regarde à présent tous les gros livres comme des dictionnaires. Mais, après avoir lu trois ou quatre mille descriptions de batailles, et la teneur de quelques centaines de traités, j’ai trouvé que je n’étais guère plus instruit au fond. Je n’apprenais là que des évènements. Je ne connais pas plus les Français et les Sarrasins par la bataille de Charles Martel, que je ne connais les Tartares et les Turcs par la victoire que Tamerlan remporta sur Bajazet. J’avoue que quand j’ai lu les mémoires du cardinal de Retz et de Mme de Motteville, je sais ce que la reine mère a dit mot pour mot à M. de Jersai ; j’apprends comment le coadjuteur a contribué aux barricades ; je peux me faire un précis des longs discours qu’il tenait à Mme