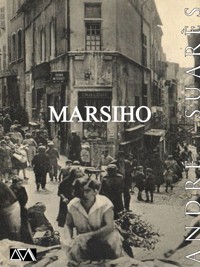Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Ibsen » par André Suarès est une étude approfondie et érudite de l'oeuvre et de la vie du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Publié en 1908, cet ouvrage offre une analyse pénétrante de l'un des pères du théâtre moderne. Suarès explore avec finesse les thèmes récurrents dans l'oeuvre d'Ibsen : la quête de vérité, la critique sociale, l'émancipation féminine et les conflits entre l'individu et la société. L'auteur examine en détail les pièces majeures telles que « Une Maison de poupée », « Les Revenants », et « Hedda Gabler », mettant en lumière leur portée révolutionnaire et leur impact sur le théâtre contemporain. L'ouvrage ne se contente pas d'une simple analyse littéraire ; Suarès replace Ibsen dans son contexte historique et culturel, explorant l'influence de la société norvégienne et du romantisme scandinave sur son oeuvre. Il établit des parallèles éclairants entre la vie personnelle d'Ibsen et ses créations dramatiques, révélant la profonde introspection qui caractérise son écriture. Suarès adopte un style à la fois érudit et accessible, alternant entre analyses détaillées et réflexions philosophiques. Il met en évidence la modernité d'Ibsen, soulignant comment ses pièces anticipent les préoccupations du XXe siècle. Cette étude offre non seulement un portrait vivant d'Ibsen en tant qu'artiste, mais aussi une réflexion plus large sur le rôle de l'art dans la société. Suarès examine comment Ibsen, à travers son théâtre, a remis en question les conventions sociales et morales de son époque, ouvrant la voie à une nouvelle forme d'expression dramatique. « Ibsen » de Suarès reste une référence incontournable pour comprendre l'héritage durable du dramaturge norvégien et son influence sur le théâtre mondial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
I. La Morale de l’anarchie
II. Sur les Glaciers de l’intelligence
IBSEN
I
MORALE DE L’ANARCHIE[1]
I. — LE GÉNIE DU NORD
La Norvège, navire de fer et de granit, gréé de pluie, de forêts et de brumes, est mouillée dans le Nord entre la frégate de l’Angleterre, les quais de l’Océan glacial, et la berge infinie de l’Orient qui semble sans limites. La proue est tournée vers le Sud ; peu s’en faut que le taille-mer n’entre comme un éperon au défaut de la plaine germanique et des marais bataves. À l’avant, la Norvège est sculptée, en poulaine, de golfes et de rochers : tout l’arrière est assis, large et massif, dans la neige et les longues ténèbres. Les morsures éternelles de la vague non moins que ses caresses ont cisaillé tout le bord, en dents de scie. Entre les deux mers, la tempête d’automne affourche les ancres du bateau, et croise les câbles du vent et de la pluie. L’hiver, il fait nuit à trois heures ; dans le nord, le jour ne se lève même pas. On vit sous la lampe, dans une ombre silencieuse où les formes furtives ont le pas des fantômes. La neige est partout : elle comble les mille vallées creusées dans la puissante échine des montagnes, comme la moelle dans les vertèbres. Le schiste noir, l’eau fauve qui a pris la couleur de la rouille sur les terrains du fer, les noires forêts de sapins ajoutent au grand deuil de la terre. Là, pendant des mois, le soleil est voilé ; ou bien d’argent, ce n’est plus que la lune douloureuse de midi. Au couchant rouge encore, sanglant et sans ardeur, ce globe hagard descend sur l’horizon humide, pareil au cyclope dont l’œil rond se cache dans l’eau verte et pâle. Les cygnes de la mer, les blancs eiders, hantent les vagues grises. Dans les villes de bois, les maisons sont rouges sous le ciel incertain du bleu mourant des colchiques. Les rues sont muettes, et les places sont vides. Les hommes sont sur la mer. Et, comme des corps morts, la foule des îles flotte le long du ponton rocheux et des quais granitiques.
Une âme vaporeuse, un ennui doux, enveloppent de chastes vies ; elles gardent leur fraîcheur, dans l’air humide et presque toujours frais, qui détend les désirs. Mais, comme ce pays, d’un seul coup, passe de l’hiver à l’été brûlant, la chair ici se jette dans l’ardeur brutale, dès qu’elle n’est plus indifférente. Ces enfans aux cheveux de lin blanc, sont gais et brusques ; les femmes, dont les yeux verts ont pris de sa mobile rêverie à l’inquiétude des flots, sont singulières et se plaisent à l’être ; les hommes robustes, durs, silencieux et rudes, semblent taillés pour parcourir une voie droite, sans jamais jeter un regard derrière eux. Tout ce peuple n’a de passions que par accès. Il est exact, et plein de scrupules. Il n’a toute sa fantaisie que dans l’ivresse ; elle est lourde et triste ; la chair et l’âme sensuelle de l’amour y ont moins de part qu’un appétit épais et court, qui a honte de se satisfaire. Rien de léger dans l’esprit ; une inclination pédante aux cas de conscience ; l’intelligence peu rapide, et presque toujours doctorale ; une commune envie d’être sincère et de se montrer original, et la bizarre vanité de croire qu’on est plus vrai, à mesure qu’on se range avec plus d’ostentation contre l’avis commun ; enfin, cette maladie de la religion propre à quelques églises réformées, qui consiste à faire de la morale comme on fait du trapèze, et à s’assurer que l’on en fait d’autant mieux qu’on saute plus haut, quitte dans la chute à se casser la tête ou à la rompre aux autres.
C’est le pays de l’hiver dur et de la neige : sous le ciel jaune qui s’affaisse, l’homme de génie vit dans la cellule de ses rêves ; et, s’il en sort, il tombe mort entre deux ombres glaciales[2]. Le pays de l’été étouffant, où les navires des nations lointaines viennent porter, en glissant au fond des fjords, toute sorte d’étranges promesses, des appels au réveil, les nouvelles d’une contrée houleuse, la chimère du soleil d’or et de la mer libre[3]. Le pays de la nuit polaire et du jour crépusculaire de minuit[4] ; la terre de la pluie, de la pluie éternelle, où l’homme est malade d’attendre la lumière, et où sa folie lui fait réclamer le soleil[5]. Le pays des golfes endormis, où la mer pénètre au cœur des montagnes, s’y frayant un chemin de ruisseau : comme une langue de chimère, comme une flamme liquide et bleue, le fjord dort entre les monts à pic, tel un long lac tortueux ; il est mystérieux et profond ; au bas des moraines énormes, ce filet de mer rêve dans le berceau du ravin, pareil à ce peu de ciel qu’on voit couler, entre les toits des maisons, dans les rues des vieilles villes. Partout la mer, ou la réclusion dans les vallées étroites, derrière les portes de la glace et les grilles de la forêt. La mer fait l’horizon de cette vie ; elle en baigne les bords ; elle en est l’espoir et le fossé ; elle en forme l’atmosphère ; et, là où elle n’est point, on en reçoit les brouillards, et on l’entend qui gronde.
C’est le pays d’Ibsen, où il veut mourir, puisqu’il y est né.
La mer est un élément capital pour la connaissance des peuples. La mer modèle les mœurs, comme elle fait les rivages. Tous les peuples marins ont du caprice, sinon de la folie, dans l’âme. Au soleil, le coup de vent les visite et balaie les nuages ; la brume, dans le Nord, prolonge le délire. Le risque de la mer et le paysage marin agissent puissamment sur les nerfs de la nation ; et par la langue, sur l’esprit. La Norvège parle une langue brève, sèche, cassante ; beaucoup moins sourde que le suédois, moins lourde et moins dure que l’allemand, il me semble ; d’un ton moyen entre l’allemand et l’anglais. Il est curieux que l’accent du breton, en Basse-Bretagne, soit assez semblable à celui du norvégien ; mais le norvégien n’a pas la cadence du breton, et ne chante pas.
L’imagination, presque partout, réfléchit les formes et la couleur des crépuscules. Sur le bord de la mer, au soleil couchant, l’homme qui regarde ses mains les élève et doute d’être soi ; mais, dans l’orage et le brouillard, le marin doit se résoudre, agir sur-le-champ, décider pour tout l’équipage et faire route. Même s’ils ne savent pas où ils vont, les marins calculent où ils sont avec une attention patiente : de nature, ils ont les meilleurs yeux du monde ; et le métier rend leur vue plus perçante. Un peuple de pêcheurs, de matelots et de petits fermiers, qui dépendent de quelques gros marchands. En Norvège, point de noblesse : un petit nombre de parens riches, et une foule de cousins en médiocrité. De la brusquerie ; peu de tendresse. De gros os et des muscles à toute épreuve, métal de gabier qui n’a pas de paille ; beaucoup de froideur et d’obstination ; de la constance ; des cœurs fidèles, enfin les vertus de la solidité, mais rien de puissant ni de chaud, qui jaillisse de l’âme. Hommes taciturnes le plus souvent, avec les éclats violens d’une joie brusque ; un long silence et, quand il est rompu, beaucoup de bruit. Un quant à soi qui touche à la grossièreté, et qui serait offensant pour le voisin, s’il n’en rendait pas l’offense. Les femmes n’en sont pas exemptes ; de là, cet air de raideur et de tourner le dos aux gens, qu’elles ont volontiers. Comme tout le monde sait lire et signer son nom au bas des comptes qu’il sait dresser, un caractère de ce peuple est un certain air de savant qui n’ignore pas, par exemple, que la terre tourne, et qui s’imagine savoir comment. Cette sorte de triomphe dans les matières de l’école primaire donne à beaucoup de Scandinaves une assurance ingénue, une haute mine de gens à qui l’on n’en fait pas accroire ; les femmes y excellent. La suffisance de l’esprit, la plus piteuse de toutes, est la plus sans pitié. Il n’est pas croyable ce que la femme qui sait lire s’estime au prix de l’homme qui ne sait qu’épeler. Voilà où se réduit, le plus souvent, la supériorité intellectuelle. Elle est la meilleure école de l’amour-propre.
Pendant dix siècles, ce pays fut à peine moins étranger à l’Europe que la Laponie ou l’Islande. Les mœurs y furent celles des clans, jaloux les uns des autres ; nulle unité ; ni le sens de l’État, ni l’audace d’une pensée originale ; point d’art : car la Cité est le premier étage du bel ordre où l’église de l’art se fonde. Et, malgré tout, une manière de génie moral : ces villages lisaient la Bible ; l’on y était théologien, raffiné en règles de conduite, comme à Athènes ou en France on put l’être en beau langage. L’inclination naturelle des Normands aux cas de conscience, en pays réformés, de tous les laïcs a fait des docteurs en théologie. Le goût des procès est la forme goguenarde, le goût de la procédure morale et de la casuistique la forme grave du même tempérament. Le drame où les idées plaident les unes contre les autres, où les grands partis de la conscience sont aux prises, devait bien tenir son poète de cette race disputeuse, et qui n’aime pas les idées pour elles-mêmes, mais par les voies où elles font entrer les lois et la conduite. Corneille aussi a mis les débats de la politique sur le théâtre. Depuis, et même sur la scène française, on trouve partout plus d’avocats que de héros ; mais dans Ibsen seulement les causes sont vivantes.
Solitude. — Ibsen est né ardent, violent, sensuel et passionné. C’est la force des grands artistes, dans le Nord, que violence, ardeur, passion, ils ne peuvent s’y livrer. À tous les torrens de l’âme, les mœurs opposent une digue rigide. Le flot se creuse un lit ; presque toujours l’eau croupit ; ce n’est plus qu’une mare. Mais, parfois, un large fleuve s’amasse ; il sait se donner cours, et la puissante inondation se prépare.
L’ardeur de l’homme dort et se concentre. Le silence est la matrice où la passion prend forme. L’avortement est innombrable ; mais, quand la gestation heureuse arrive au terme, il en sort une créature vraiment grande. Les peuples qui jouissent de la vie en dilapident la joie : c’est un or qu’ils prodiguent. Les gestes et les paroles de la foule épuisent le fonds commun : il n’est plus réservé, par droit d’aînesse, à la fortune de quelques maîtres. Le peuple du Nord, qui se tait et fait son épargne pendant mille ans, la lègue à un seul homme. Quel réveil et quelle action ! Quelle solitude, aussi ! Qui comprendra cet homme ? Dans le Midi, les peuples valent mieux que leurs héros, peut-être ; ces foules sont belles, éloquentes, héroïques. Ils sont plus avancés dans le bonheur et la perfection, qui pour l’usage commun ont nom : médiocrité. Dans le Nord, un seul homme, de temps en temps, confisque le trésor et vit pour tous les autres : Humanum paucis vivit genus.
Combien cet homme est seul, et qu’il doit m’être cher, par là, dès que je l’ai connu ! Ibsen a longtemps erré en exil, comme Dante ; mais, l’un ou l’autre, qu’auraient-ils fait dans leur pays ? Ils étaient bannis de naissance. Et Ibsen un peu plus encore, homme à se bannir. Ses livres mêmes ne le rapatrient pas. La langue littéraire de la Norvège diffère beaucoup de la langue parlée : le norvégien d’Ibsen n’est que le pur danois. Sa langue passe pour la plus belle de la littérature Scandinave ; elle est brève, forte, précise ; tendue à l’excès, et d’une trempe métallique ; elle abonde en ellipses, en raccourcis rapides ; mais elle est aussi claire et aussi harmonieuse que le danois puisse l’être. Si loin que soit l’Italie de la Norvège, le style d’Ibsen me rappelle celui de Dante ; ce n’est qu’une impression ; et je sens assez tout ce qu’on y pourrait opposer. Mais, dans les deux poètes, que d’ailleurs tant de traits séparent, il y a la même volonté de tout dire en peu de mots ; le même ton âpre, la même violence à bafouer ; la même force à tirer des vengeances éternelles. Dante, toutefois, sculpte dans le bronze ; et Ibsen, dans la glace. La forme de Dante est la plus ardente et la plus belle, ailée de feu et de passions ; la forme d’Ibsen, bien plus roide, est la plus lourde d’idées et qui va le plus loin dans la caverne où nos pensées s’enveloppent d’ombre. La solitude d’Ibsen s’en accroît : l’artiste, en Norvège comme en France, est un homme qui ne parle jamais que pour le petit nombre : c’est l’effet d’une langue littéraire, quand l’utile le cède à la beauté.
Il n’y a de société sincère qu’entre ceux qui parlent également mal leur langue. Quant aux autres, chacun ne la parle bien que pour soi. Il n’est pas de beau style commun à deux hommes ; comme la grandeur même, le style fait la prison[6].
Rhétorique du Nord. — Il y a quelquefois dans Ibsen un rhéteur, qu’on s’étonne d’y voir.
Par tout le Nord, il règne une rhétorique d’esprit, qui répond à la rhétorique de mots en faveur au Midi. Celle-ci se moque de celle-là ; mais l’une vaut bien l’autre. On est rhéteur d’idées comme on est rhéteur de phrases ; comme on bâtit sur de grands mots vides, on fait sur de hautes pensées ; mais la fabrique, ici et là, n’est pas moins vaine. Les personnages d’Ibsen s’enivrent de principes, comme ceux de Hugo d’antithèses. Si Ibsen n’était pas un grand peintre de portraits, il semblerait bien faux ; on ne croirait pas à la vérité de la peinture, si l’on n’y sentait la vie des modèles. Les rhéteurs de morale sont les pires de tous ; car ils sont crus. C’est pourquoi la sincérité dont le Nord se vante est souvent si fausse. Là-haut, ils se font un intérêt de l’intelligence ou de la morale, et c’est ce qu’ils appellent l’idéal. Ces hommes et ces femmes, à tout propos, revendiquent le droit de vivre, d’être libre, de savoir et d’agir : c’est, dans l’ordre de l’intelligence, la même rhétorique que celle des démagogues dans l’ordre de la politique. Au soleil, ces révoltes de la neige passent pour ridicules et sans raison. Et, sous la neige, c’est l’éloquence du soleil qui passe pour inféconde et très creuse. Il faut toujours qu’un bord du monde tourne le dos à l’autre, pour se croire seul du bon côté, et qu’une partie de la terre se rie de l’autre partie, pour se prendre elle-même au sérieux. Chacun s’estime davantage de ce qu’il mésestime.
L’abus de la conscience et du libre esprit n’est qu’une rhétorique. Toute éloquence qui se prend elle-même pour une fin n’a ni force ni preuve.
La vie n’a pas plus de temps à perdre aux bons mots qui ne finissent pas, qu’aux actes désordonnés d’une conscience qui prétend à la nouveauté, et se révéler nouvelle à soi-même tous les matins.
Excès de conscience, manque de conscience. À force de scrupules, on agit aussi mal que faute de scrupules. Quant à celui qui agit pour agir, il ne se distingue en rien de celui qui ne parle que pour parler. Les gens du Nord, s’ils le savaient, s’en feraient peut-être plus modestes.
Ni la conscience, ni l’action, ni le discours ne sont des panacées à tous les maux humains : car là, comme ailleurs, c’est le sens propre, presque toujours, qui seul s’exerce. J’entends que l’égoïsme ait de bonnes raisons pour lui-même, et lui seulement. Mais il ne faut pas que l’égoïste se prenne pour un principe, et se donne pour un exemple.
Qu’on rejette tout l’ordre de la Cité, soit ; mais, le faisant, qu’on ne s’imagine pas d’être le bon citoyen ni l’espoir de la Cité nouvelle. C’est mal se connaître ; c’est être dupe ; et bien pis que de duper. Les plus grands rebelles, qui font dans l’État la meilleure des révolutions, ne doivent point prétendre à fonder le nouvel ordre sur les bases du bien et de la vérité. Ou, s’ils l’osent, et même sans parler de vérité absolue, il y a de quoi sourire.
Il n’est pas sûr que la meilleure révolution ne soit pas aussi la pire. Elle est nouvelle, c’est ce qu’elle a de bon. Mais les héros de morale ne l’entendent pas ainsi. Ils sont sûrs d’avoir raison, jusqu’au délire.
On parle magnifiquement de la conscience, et on oublie de se dire qu’on ne pense peut-être qu’à soi. Il y a pis : on l’ignore. La jeune Norah, pour donner une leçon de respect à son mari, se rend à peu près trois fois infanticide. La rhétorique de Médée n’enseigne pas, du moins, la morale aux femmes mécontentes. Voilà bien les rhéteurs d’idées : à les en croire, ils ne visent que le droit de tous les hommes, la vie, l’honneur, le droit des femmes, le droit de la conscience. Et, au bout du compte, c’est un homme qui a mal au foie, ou qui a été trompé dans son ménage ; une femme qui s’ennuie à la maison, et qui veut voir du pays.
Quelle rage de s’en prendre aux lois et aux idées ? Elles ne sont que la forme de la vie. Dans le fond, il n’y a que des passions. Mais personne n’ose le dire, ni surtout qu’on les veut sans frein. Ibsen a eu cette audace, à la fin, lui pourtant qui n’avait reçu de son temps et de son pays qu’une foule insupportable de masques, de principes, de passions voilées, méconnaissables à elles-mêmes.
Les formes et les lois ne sont que les freins, mis aux passions d’un seul par l’intérêt de tous les autres. Quelle folie de tant prêter d’importance aux modes changeans de la vie humaine, et si peu à la nature et aux appétits incoercibles des hommes ! On bavarde à l’infini là-dessus dans le Nord, — et bien trop gravement. On ne vous y tue pas un homme pour une pomme, — mais pour un principe.
II. — IMAGE D’IBSEN
On doit rendre à Ibsen l’hommage de sa solitude. Qu’il soit unique, puisqu’il est seul.
Il est bien vrai : rien ne nous importe que ce qu’il y a de plus grand. Ibsen compte seul à nos yeux, de tous les Scandinaves. Il n’y a pas de place pour nous en France, disait l’un d’eux[7]. Mais il n’y a pas eu place pour Ibsen en Norvège, ni ailleurs. On lui donne parfois un rival : il ne peut l’être qu’à Berlin[8].
Ibsen s’étonne de ceux qui le font d’une école. S’il est réaliste, il leur montre Solness, ce rêve de la pensée enfoncée en soi-même. S’il est mystique, il leur fait voir Maison de Poupée ou l’Ennemi du peuple, ces peintures cruelles de la vie. Il y a deux hommes en lui, qui sont les deux termes du long débat entre le moi et le monde : un créateur et un critique. Tout ce qu’il voit de solide autour de lui, de bâti par les siècles, il le renverse. Tout ce qu’il élève lui-même, il le détruit. Son art oscille entre les deux pôles de la nature et du rêve. Nul poète, par-là, n’est plus de ce siècle : il crée en dépit de tout, — et seulement en vertu de lui-même.
Ibsen, qui sait le bonheur de créer, peut à la rigueur montrer le mépris de penser. La vie implique infiniment plus d’idées que tous les esprits ensemble. La vie a des pensées que la pensée n’a pas. Les idées du grand poète tendent de plus en plus à prendre la qualité d’êtres vivans. Le symbole est une idée qui a reçu le souffle divin ; elle est rachetée de sa condition inférieure ; elle a fait le grand pas ; elle a pris l’être. C’est dans Ibsen que je dis ; car, dans les poètes sans force, il est constant que c’est tout le contraire. Ils humilient la vie jusqu’à la mort ; ils ravalent un être vivant à une idée générale : comme si un mot valait jamais un homme.
Entre tous les poètes, Ibsen est le seul Rêveur, depuis Shakspeare. Tous les poètes tragiques sont réalistes, sous