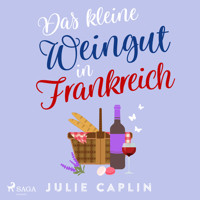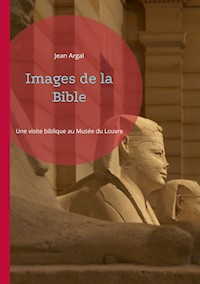
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Französisch
La Bible est un texte antique. Elle plonge ses racines dans les cultures orientales, dans la géographie levantine.... et donc dans un monde éloigné du nôtre. En cela, sa compréhension pour nous peut être difficile puisque nous n'en possédons pas toujours les codes et les images. Or, le musée du Louvre est un lieu qui permet de voyager au Proche-Orient, il y a 2000 ans. Ce musée nous montre des oeuvres provenant de cette région et qui rentrent en résonance avec le texte biblique. Ce livre est donc une invitation au voyage dans les temps bibliques à la rencontre d'objets similaires à ceux présents dans la Bible. Hors de toute approche polémique ou religieuse, cherchant à prouver une "exactitude" de la Bible, cet ouvrage se veut une sorte d'imagier de l'antiquité biblique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
LE DEPARTEMENT DES ANTIQUITES EGYPTIENNES (PARCOURS THEMATIQUE)
LE DEPARTEMENT DES ANTIQUITES EGYPTIENNES (PARCOURS CHRONOLOGIQUE)
LE DEPARTEMENT DES ANTIQUITES ORIENTALES
LE DEPARTEMENT DES ANTIQUITES GRECQUES, ETRUSQUES ET ROMAINES
ARTS DU PROCHE-ORIENT ET DE L’ÉGYPTE
BIBLIOGRAPHIE DE BASE
« En ces heures de travail austère et exaltant, emportés par les vestiges des siècles engloutis, le désert de Tello, pour nous, cessait d’être triste et désolé. Il redevenait ce pays de Schinear, »André Parrot
INTRODUCTION
Le christianisme possède la particularité d’être une religion donnant une grande importance à son contexte de naissance. Il plonge ses racines dans le judaïsme antique, dans les cultures orientales, dans la géographie levantine.... En cela, la compréhension de son texte sacré principal, la Bible, peut être difficile. « La Bible n’est‐elle pas avant tout un texte religieux intemporel ? » pensent certains. Et le lecteur, croyant ou non, peut hésiter, dans sa lecture, entre les multiples facettes de ce texte et les interprétations parfois si variées.
Pourtant, la Bible est avant tout un texte antique et il est important pour l’étudier de prendre cet aspect en compte, de comprendre les genres littéraires de l’Antiquité et les modes de vie des auteurs. La Bible, si elle est un texte historique, antique, n’est pas pour autant un manuel d’histoire. Les premières mises à l’écrit des textes bibliques, qui descendent de traditions orales, datent au plus tôt du VIIe siècle avant J‐C et racontent des événements plus anciens.
Les auteurs bibliques appartiennent à des cultures de l’Orient antique qui se caractérisent par une absence de méthode ou de pensée historique au sens moderne et occidental du terme. Celles‐ci se développeront dans le monde grec et nous considérons généralement Hérodote et Thucydide comme à l’origine de la théorisation de cette science. A l’inverse, l’écriture des faits historiques prend dans les cultures orientales des formes différentes qui peuvent nous paraitre symboliques ou déformées. Ces auteurs percevaient et écrivaient simplement la réalité d’une manière autre, qui nous est difficile à appréhender et à concevoir.
***
Le musée est un lieu qui présente une collection, c'est‐à‐dire un ensemble d’objets vrais porteurs d’informations. Ceux‐ci sont organisés par les conservateurs de manière à donner un sens particulier à l’exposition. Ainsi, les départements du Musée du Louvre sont, pour la plupart, organisés de manière chronologique, afin de donner au visiteur une vision globale de l’évolution de ces cultures. Ceci permet de rapprocher le visiteur du monde qui a créé ces objets, de le lui présenter et de le lui faire découvrir. Le musée est ainsi un véritable lieu pour remonter dans le temps et voyager dans des régions lointaines.
C’est un tel voyage que ce livre vous propose d’effectuer, un voyage de plus de deux milles ans dans le temps vers le Proche‐ Orient biblique. La Bible est un livre complexe pour un européen contemporain puisqu’il présente des récits de cultures semi‐nomades ou liés au monde agricole dans une région de climat et de géographie si différentes de l’Europe. Le but de ce livre est ainsi d’illustrer la Bible grâce à des objets des départements d’antiquités du Musée du Louvre. Cette confrontation entre des objets anciens et les extraits bibliques permet d’éclaircir certains passages, d’élargir la connaissance de personnages évoqués ou, tout simplement, d’illustrer et de découvrir des objets similaires à ceux qui sont cités dans la Bible.
L’honnêteté intellectuelle oblige à préciser « similaire ». Si l’exportation et le commerce à longue distance existaient, il est important de se souvenir que les objets présenté dans ce livre ne proviennent, pour la plupart, pas du Levant et encore moins de Palestine. Néanmoins, il a été choisi de présenter des œuvres qui dans leur forme ou dans leurs caractéristiques peuvent être comparables à ceux présents à l’esprit de ceux qui ont écrit la Bible malgré des particularités stylistiques ou matérielles différentes. Afin de conserver une logique d’ensemble, nous nous limiterons aux départements traitant de l’antiquité, c'est‐à‐ dire le Département des Antiquités Egyptiennes (DAE), le Département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romains (AGER), le Département des Antiquités Orientales (DAO) et dans la section Arts du Proche-Orient et de l’Egypte.
Hors de toute approche polémique ou religieuse cherchant à prouver une « exactitude » du texte biblique, cet ouvrage se veut donc être une sorte d’imagier de l’antiquité biblique.
***
Rares sont les musées dont le programme scientifique vise explicitement le Proche Orient sous l’angle de Bible. Nous pouvons citer, en France, le musée « Bible et Terre Sainte », fondé en 1957 qui prend place au sein de l’Institut Catholique de Paris. D’autres existent à l’étranger, le musée « Bible + Orient » à Fribourg, le Bijbelsmuseum d’Amsterdam, le musée biblique de Budapest et, bien entendu, le « Bible Lands Museum » de Jérusalem.
La recherche archéologique et historique sur les régions de la Bible est ancienne et la France a eu un rôle tout particulier dans la naissance de celle‐ci. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, presqu’un tiers des pèlerins de Terre Sainte sont français, ce qui permet un enseignement précoce de l’hébreu en France, l’importation de manuscrits et la publication d’ouvrages comme la Description et chute de la Terre Sainte de l’abbé Postel (avant 1553). L’idée de confronter la réalité du terrain aux textes bibliques se retrouve dans les textes des premiers exégètes. Cependant, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour observer, à travers une multitude de publications (V. Guerin, Clermont‐ Ganneau…) et la fondation du « Palestine Exploration Fund » puis l’« Ecole Pratique d’Etudes Bibliques » au sein du couvent dominicain de Jérusalem, une véritable volonté de recherches archéologiques. Cette dernière sera reconnue en 1920 par l’Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres (Paris) comme l’ « École archéologique française de Jérusalem ». La première approche de ses chercheurs était de prouver la concordance exacte des textes bibliques et la réalité historique par des fouilles archéologiques. Cependant, des réflexions sur les cultures orientales et le développement des études sur les écrits antiques ont permit à cette discipline d’acquérir depuis une véritable méthodologie scientifique.
Construit comme un guide de visite, ce livre ne cherche pas à être une étude complète des faits présentés succinctement. Pour approfondir les domaines et les thèmes abordés, nous ne pouvons que vous conseiller de vous renseigner sur les visites‐ guidées du Musée du Louvre, les conférences de l’Auditorium, les cours d’Histoire de l’Art (Cours du soir de Ecole du Louvre, par exemple) ou la lecture des ouvrages présentés dans la courte bibliographie.
NOTE AUX LECTEURS :
Ce livre présente des extraits de la traduction biblique par le Chanoine Crampon, corrigée par les jésuites professeurs de Saint‐Sulpice (édition de 1923). Cette traduction a été effectuée à partir des textes anciens hébreux, araméens et grecs. Elle permet une proximité lexicale et stylistique avec les textes originaux toute en conservant une beauté littéraire du français. Néanmoins, dans certains cas et après vérification du texte grec de la Septante ou du Nouveau Testament, nous avons préféré la traduction de la Bible de Jérusalem (BJ).
La présentation des collections du Musée du Louvre varie en fonction des expositions, des restaurations ou des études menées sur les objets. La muséographie générale des départements n’est, par définition, pas pérenne. Lors de la rédaction de cet ouvrage, nous avons pris le parti d’inclure des œuvres absentes des salles. Nous avons conscience que ce livre présente un état des collections qui est appelé à disparaitre à plus ou moins long terme. En cas de mouvement, la présence des numéros d’inventaire vous permettra de vérifier le lieu d’exposition grâce à la base de données en ligne du Musée du Louvre.
LE DEPARTEMENT DES ANTIQUITES EGYPTIENNES ( PARCOURS THEMATIQUE )
Ce département regroupe des objets créés sur les bords du Nil entre 4500av. J.‐C et le IVe siècle ap. J.C. Cette collection riche et variée, composée de statue en pierre, de papyrus, de sarcophages ou d’objets de la vie quotidienne, permet d’illustrer la vie d’une civilisation agraire comparable par certains traits à celle de Palestine antique.
Historique de la collection :
Le Département égyptien du Musée du Louvre est fondé en 1826 par une ordonnance royale qui nomme Jean‐François Champollion directeur. L’inauguration de celui‐ci a lieu le 15 décembre 1827. Le goût pour l’Egypte ancienne n’est pourtant pas une nouveauté du XIXe siècle mais apparait dès le XVIe siècle comme l’attestent les représentations de sphinx de cette époque. La Campagne d’Egypte et, tout particulièrement, la publication de Vivant Denon en 1802, Voyage dans la Haute et la Basse Egypte, et, entre 1810 et 1830, des volumes de la Description de l'Egypte, par les membres scientifiques de l'expédition, est pourtant le catalyseur d’une égyptomanie nouvelle.
Champollion est un égyptologue ayant reçu une formation de linguiste. Encouragé par son précepteur et par son frère, inspiré par les essais de traduction d’A. Lenoir, il étudie le système hiéroglyphique et écrit le 27 septembre 1822, la lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques dans laquelle il en annonce le déchiffrement de celui‐ci. Lors de sa nomination à la tête du département égyptien, celui‐ci ne possède encore que peu de pièces (comme les statues de Sekhmet A 2 à A 11). Champollion obtient de Charles X l'achat de la collection Durand, la seconde collection Salt, consul britannique, et de la seconde collection Drovetti, consul français d’origine italienne. En 1932, à sa mort, le département possède environ 9000 pièces.
Entre 1852 et 1868, d’autres ensembles, tout particulièrement ceux formés par le docteur Clot, médecin de Méhémet‐Ali, le comte polonais Tyszkiewicz ou le consul Delaporte renforce la collection du département. D’autres objets, comme ceux trouvés par A. Mariette au Sérapéum de Memphis, rentrent dans les collections grâce à des partages de fouille. Suite à découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, cette source d’entrée se tarit.
Au cours du XXe siècle, des dons, des transferts et des achats, dont certains par la Société des Amis du Louvre, ont permis l’arrivée d’œuvres comme le groupe Curtis représentant Akhénaton et Néfertiti, la statue de la Reine Ouret ou le Zodiaque de Dendérah
SALLE 338 : LE SPHINX
Grand sphinx (A23) : trouvé dans le site de l’ancienne Tanis (Basse Egypte) en 1825, granite
Le sphinx est un être composite possédant un corps de lion et une tête humaine royale. Celui‐ci porte les noms royaux d’Amenemhat II (12e dynastie), de Mérenptah (19e dynastie) et de Sheshonq Ier (22e dynastie). Il est néanmoins possible que cette œuvre remonte à l’Ancien Empire.
Le saviez-vous ?
Les statues égyptiennes étaient « réactualisées » par les rois. Ils faisaient effacer le nom des rois précédents pour le remplacer par le leurs. Cette pratique met en valeur la continuité du principe monarchique.
Cette œuvre possède un double intérêt. Elle provient d’un site identifié et porte le nom d’un roi cité dans la Bible.
Ville de Tanis
Psaumes 78, 2 : 12 Devant leurs pères, il avait fait des prodiges, au pays de l'Egypte, dans les campagnes de Tanis.
Ezéchiel 30, 14 : Je désolerai Pathros, je mettrai le feu à Tsoan, j'exercerai des jugements sur No.
Le terme grec utilisé par la Septante pour le nom de Tanis est Τάνιν. Dans cet extrait, la ville de Tanis porte le nom de Çoân/Tsoan. Ce nom provient du terme hébreu original. Il a été traduit par saint Jérôme, Taphnis
Psaumes 78, 43‐44 : où il montra ses prodiges en Egypte, ses actions merveilleuses dans les campagnes de Tanis, Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent boire à leurs ruisseaux.
Selon l’auteur des Psaumes, Moïse effectue des miracles
Isaïe 19, 11‐13 : Les princes de Tanis ne sont que des insensés; des sages conseillers de Pharaon les conseils sont stupides. Comment osez-vous dire à Pharaon: "Je suis fils des sages, fils des rois antiques ?" Où sont-ils, tes sages? Qu'ils t'annoncent donc, qu'ils devinent ce que Yahweh des armées a décrété contre l'Égypte! Les princes de Tanis ont perdu le sens, les princes de Memphis sont dans l'illusion ; ils égarent l'Egypte, eux, la pierre angulaire de ses castes.
Dans cet extrait, Isaïe critique les princes de Tanis, leurs prétentions de sagesse et leur mauvaise politique.
Le nom de Sheshonq Ier
1 Rois 11, 40 : Salomon chercha à faire mourir Jéroboam; mais Jéroboam se leva et s'enfuit en Egypte, auprès de Sésac, roi d'Egypte; il fut en Egypte jusqu'à la mort de Salomon.
2 Chroniques 12, 1‐9 : Lorsque Roboam eut affermi son royaume et acquis de la force, il abandonna la loi de Yahweh, et tout Israël avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Sésac, roi d'Egypte, monta contre Jérusalem, -- parce qu'ils avaient péché contre Yahweh, […] Sésac, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem; il prit les trésors de la maison de Yahweh et les trésors de la maison du roi : il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits.
Le pharaon Sésac/Sheshonq Ier est connu par sa politique d’expansion et sa campagne en Palestine. Si cette campagne est évoquée sur le mur du temple de Karnak, l’une des principales sources est l’Ancien Testament. Sheshonq prend des villes du centre de la Palestine, dont Megiddo, du Néguev et de la côte dans la région de Gaza. Dans le texte de Karnak, la ville de Jérusalem n’est pas nommée ce qui est contraire au texte biblique.
Le nom grec de ce roi dans la Septante est Σουσακιμ (Susacim) alors que son nom hébreu est Shishak. Grace aux tests Carbone 14 menés sur des restes de destructions dans ces villes, cette campagne est datée de 925 av. J.‐C. Selon le texte biblique, cette campagne eut lieu la cinquième année du roi Roboam (1 Rois 14, 25).
SALLE 336 : LE NIL
Le Nil est un fleuve qui traverse l’Egypte et qui est à l’origine de sa civilisation. « L’Egypte est un don du Nil » selon Hérodote. Permettant l’irrigation des champs, le transport des personnes et des biens, le Nil conditionne la vie des égyptiens de l’antiquité et possède un rôle primordial dans la pensée, tout particulièrement religieuse, de l’Egypte. Pour cette raison, il n’est guère étonnant que plusieurs plaies d’Egypte ou prophéties bibliques ‐ le fleuve tarira et se desséchera (Isaïe 19, 5)‐ touchent la caractéristiques essentielle du Nil, qui est d’être un fleuve nourricier et bienfaiteur.
Poisson du Nil Lepidotos (N 4014) : Bronze
Exode 7, 20‐21 : Moïse et Aaron firent ce que Yahweh avait ordonné. Aaron, levant le bâton, frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect, les Egyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Egypte.
Grenouille (AF 8557) : Stéatite glaçurée
Exode 7, 26‐28 : Yahweh dit à Moïse : "Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi dit Yahweh : Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici que je vais frapper du fléau des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles; elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, et au milieu de ton peuple.
Crocodile (E 22888) :
Ezéchiel 29, 2‐4 : "Fils de l'homme, tourne ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise sur lui et sur l'Égypte tout entière; parle et dis: Ainsi parle le Seigneur Yahweh: Voici que je viens à toi, Pharaon, roi d'Égypte, toi le grand crocodile, couché au milieu de tes fleuves, qui as dit: "Mon fleuve est à moi, et c'est moi qui me le suis fait." Je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je ferai s'attacher à tes écailles les poissons de tes fleuves; et je te ferai monter du milieu de tes fleuves, toi et tous les poissons de tes fleuves, attachés à tes écailles;
SALLE 333 : LES TRAVAUX DES CHAMPS
La chapelle d’Akhetetep (E 10958)
Cette chapelle liée à une tombe riche contient des représentations de chasse, de pèche, de navigation… Ces images illustrent un mode de vie agraire au Proche‐Orient pendant l’antiquité mais aussi, dans certaines régions, jusqu’à nos jours.
Le saviez-vous ?
L’Egypte est un pays de paysans et d’éleveur. Les travaux des champs tiennent une place importante dans les représentations picturales. Elles permettaient aux défunts d’obtenir, dans l’Au-delà, les biens que ces travaux procurent.
Isaïe 62, 9 : Mais ceux qui auront fait la moisson la mangeront; et ils loueront Yahweh ; et ceux qui auront fait la vendange la boiront, dans les parvis de mon sanctuaire.
Regardez à droite de la porte la scène de chasse aux oiseaux.
Psaumes 91, 3 : Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste.
Notez les antilopes escaladant les arbres, image bien connue de ceux qui visitent, aujourd’hui encore, les oasis du Néguev comme Ein Gadi.
Sur le mur de droite se trouve une scène musicale. On peut y voir des musiciens et des chanteurs. Ceux‐ci sont reconnaissables aux gestes qu’il effectue de leur main pour accompagner le chant. Cela s’appelle la chironomie et s’observe toujours chez les chanteurs coptes. Ces gestes sont évoqués dans le Talmud comme signe de hauteur de son.
Dans les deux extraits suivants, « les ordonnances de David » sont la traduction de « χειρὸς Δαυιδ », littéralement « les mains de David ».
2 Chroniques 23, 18 :