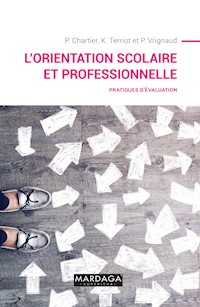Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Pourquoi tombons-nous malades ? Comment se prémunir des infections et protéger notre organisme ? Quels sont les enjeux réels autour de la vaccination ? Ce guide vous invite à explorer l’univers des micro-organismes, ces êtres invisibles responsables de maladies fréquentes telles que la grippe ou diverses infections. En dévoilant leur impact sur notre santé, il met en lumière les vérités scientifiques derrière les vaccins, ces outils essentiels mais souvent contestés, surtout dans le contexte post-pandémie. Abordant également les maladies infantiles et les stratégies de prévention, cet ouvrage offre une perspective claire et accessible pour mieux comprendre l’univers de l’infiniment petit, ses dangers, ses bienfaits, et les moyens d’adopter une hygiène de vie éclairée pour préserver notre santé et celle de nos proches.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fort d’études en biologie et d’une expérience en milieu hospitalier,
Philippe Chartier a occupé des postes à responsabilités dans l’industrie pharmaceutique. Cette carrière lui a permis de collaborer avec des médecins sur des stratégies thérapeutiques adaptées à diverses pathologies. Passionné par le domaine de la santé, il met son expertise au service de ses écrits, offrant une vision critique et éclairée des solutions médicales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Chartier
Infectiologie et vaccination
Essai
© Lys Bleu Éditions – Philippe Chartier
ISBN : 979-10-422-6225-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Bien vieillir, c’est un choix, Éditions Médicis Trédaniel
Guide pratique
Faire un choix, c’est savoir éliminer les situations non judicieuses, mais c’est aussi savoir retenir celles qui vous seront favorables pour, dans ce cas bien précis, pouvoir bien vieillir et profiter de la vie.
Ce manuel est conçu pour vous apporter les solutions qui vont vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté, afin d’aider votre organisme à continuer à sécréter les bonnes molécules de vie et conserver une enveloppe physique harmonieuse et fonctionnelle. Pour cela, il devient nécessaire d’avoir conscience que le vieillissement s’anticipe, car tous les excès ou les manquements finissent par se payer cash.
Alors, Bien vieillir, c’est votre choix vous renseigne sur les différents moyens à votre disposition, y compris les plus récents, tels que l’intelligence artificielle, l’épigénétique, l’exosquelette, qui constituent des solutions efficaces supplémentaires modernes pour suppléer aux effets du temps.
L’hygiène alimentaire, les supplémentations, la chasse au stress, les objectifs de vie, l’activité physique… l’appel à la nature font partie des solutions abordées qui permettront de rester optimiste quant à l’arrivée à l’âge d’or.
Conseils, solutions, techniques, stratégies viennent étayer tout l’intérêt de ce manuel afin que vieillissement puisse rimer avec plaisir de vivre, plaisir de voir ses enfants et petits-enfants évoluer et prendre racine dans la vie.
Le vieillissement est bien sûr multifactoriel, et ce manuel n’a pas la prétention de se subordonner à une consultation médicale. Cependant la prise en charge de la personne désireuse d’un mieux vivre sa vieillesse doit faire appel à la médecine anti-âge, qui associe la prévention, l’anticipation, la personnalisation et la participation, comme les aborde ce livre.
Alors, si ce manuel répond à vos questions, à vos soucis, j’aurai atteint mon objectif et je pourrai, moi aussi, gérer sereinement mon vieillissement, avec la certitude du devoir et du service rendu, accomplis.
Bien vieillir est un art,
Et l’art favorise le bien vieillir.
PH. Chartier
Covid-19 – Scandales d’État, Éditions Spinelle
Le moment vécu entre le 17 mars et le 11 mai 2020 va rester unique dans l’histoire de la France et du monde.
En effet, un virus d’une taille inférieure à 100 nm sème la panique sur l’ensemble des populations touchées sur les divers continents.
Ce livre va donc vous permettre de vous faire revivre, journée après journée, toute l’actualité sur cette pandémie de Covid-19, de la découverte de ce nouvel agresseur à la décision du gouvernement de confiner tout le monde à domicile.
Les analyses, questions, suggérées face à une telle pandémie, les raisons qui créent autant de victimes en France, cinquième puissance mondiale et incapable d’organiser une protection sanitaire digne de ce nom, sont abordées en tentant d’en montrer toutes les carences.
Cette pandémie a surpris beaucoup de monde en raison de sa dissimulation, de son ampleur, des vies emportées au sein de la population comme au sein des professionnels de santé, de la peur, de la panique engendrées dans la population.
Ce livre permet d’aborder les renseignements scientifiques sur le virus, tente d’en extraire son origine, son trajet, sa prise en charge controversée par des querelles d’ego de la part des médecins, des conflits d’intérêts de différents acteurs avec l’industrie pharmaceutique, abordant également les scandales d’État face à leur manque de discernement, à leur manque d’anticipation, à leurs mensonges.
Covid-19 vous fera toucher du doigt toutes les incohérences des décisions prises, en vous permettant de vous éclairer, de vous ouvrir les yeux sur les objectifs et les conséquences d’une telle pandémie.
L’après pandémie ne sera pas comme l’avant, « il faudra se réinventer », il vous suggérera quelques pistes de réflexion afin de tirer un enseignement positif et curatif de cette crise sans précédent, afin de pouvoir vivre plutôt que survivre.
Les fossoyeurs de la démocratie, Éditions Spinelle
Cet ouvrage, écrit en pleine crise sanitaire historique, fait l’alliance entre les données scientifiques sur un virus qui nous gâche la vie et la communication d’un gouvernement qui dirige la France et les Français en usant et en abusant d’une communication mensongère, visant à détruire la démocratie, les valeurs de la France, la liberté des citoyens.
Où sont passées nos libertés ?, Éditions Spinelle
La France dans l’enfer de la tyrannie, Éditions Spinelle.
Avertissement
Cet ouvrage vous permet de connaître un peu mieux un monde microscopique dont la connaissance, la maîtrise, est réservée aux spécialistes, techniciens et thérapeutes.
Vous trouverez dans cet essai un grand nombre de données sur la symptomatologie, les traitements médicamenteux à titre purement informatif.
Cet ouvrage, conformément à la législation en vigueur, ne saurait se substituer à une consultation et/ou à une prescription médicale.
En effet, les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques évoqués dans ce travail nécessitent un diagnostic médical précis et une prescription médicale adaptée.
Ne pas interrompre un traitement sans avis médical. Un arrêt de votre traitement sans en avoir la décision médicale risque de vous mettre en danger !
La réalisation de cet ouvrage nécessite parfois l’utilisation d’un jargon médical.
Les termes ou expressions médicaux bénéficient d’une définition en bas de page, et sont également repris dans le glossaire situé en fin d’ouvrage.
Vous disposez, dans cet ouvrage, du véritable nom scientifique des bactéries, des virus… Bonne rééducation de la mémoire pour les retenir tous sans exception !
Malgré le caractère scientifique des éléments présentés dans ce livre, la lecture et la compréhension de celui-ci sont accessibles à tous.
Note de l’auteur
J’ai mis en pratique pendant quelques années toutes mes connaissances acquises sur cette fabuleuse activité qu’est la microbiologie, en milieu hospitalier.
Puis de nombreuses années dans l’industrie pharmaceutique m’ont permis de peaufiner mes connaissances dans la lutte contre les agents infectieux en étudiant et en vantant les mérites de différents antibiotiques auprès du corps médical privé et hospitalier, et d’aborder avec eux les différentes pathologies concernées.
Cette connaissance des différentes disciplines, depuis le prélèvement du milieu infecté, l’isolement du germe responsable, le choix du traitement antibiotique, les résultats cliniques chez le patient, me permet de vous livrer tous les rouages d’une discipline parfois complexe, remise en question par les plus grands spécialistes et inconnue du grand public.
J’espère qu’au travers de cet ouvrage vous prendrez plaisir à découvrir ce que furent tant d’années de recherche afin d’apporter aujourd’hui des solutions à des problématiques médicales : ce monde de l’infiniment petit pouvant réduire encore aujourd’hui à néant, malgré les progrès de la recherche, de la médecine, mais face à des micro-organismes inconnus, une merveille de la nature qu’est le corps humain.
Alors, si tel est le cas, j’aurai atteint mon objectif !
Philippe Chartier
Infectiologie et vaccination
Bactéries, virus, champignons, parasites
Les maladies infectieuses courantes
Peut-on encore croire à la vaccination ?
Introduction
Les micro-organismes, ces bactéries, virus, champignons, levures, auxquels votre organisme et vous-même vous êtes sûrement déjà heurté dans votre vie, restent pour vous des « fantômes », tout simplement parce que vous ne les avez jamais vus et pour cause, ce sont des êtres de taille microscopique donc invisibles à l’œil nu.
La discipline biologique qui étudie ces micro-organismes est la microbiologie, ou bactériologie, et s’effectue au sein des laboratoires d’analyses médicales.
Ces micro-organismes sont présents partout, dans l’air, dans l’eau, dans le sol. Nous-mêmes véhiculons un nombre considérable de bactéries au sein de notre organisme, sur notre peau. Les bactéries sont donc utiles lorsque leur variété est équilibrée. Mais ces bactéries deviennent pathogènes, c’est-à-dire qu’elles engendrent la maladie, lorsque celles-ci sont en déséquilibre dans l’organisme (une catégorie vient supplanter les autres) ou se retrouvent dans un autre milieu ou ce sont tout simplement des bactéries ou des virus qui créent la maladie lorsque nous rentrons en contact avec (l’exemple du coronavirus qui crée une insuffisance respiratoire aiguë, ou le staphylocoque qui peut créer un furoncle, s’il infecte la peau par exemple, ou une infection urinaire s’il passe par ces voies).
Le pionnier de la bactériologie, c’est Louis Pasteur, aujourd’hui controversé par les travaux plus récents et par une théorie différente selon laquelle le « terrain » serait responsable de la survenue de la maladie et donc du déséquilibre bactérien.
En 1856, Pasteur montre que la production d’alcool est bien due à des micro-organismes très difficiles à voir au microscope.
En 1857, il publie deux mémoires, l’un sur la fermentation lactique, l’autre sur la fermentation alcoolique et montre que toutes les fermentations sont l’œuvre d’un micro-organisme vivant : le ferment.
Il montre aussi que certains ferments ont besoin d’oxygène pour se développer ; c’est la notion d’aérobiose et d’autres vivent sans oxygène : c’est l’anaérobiose.
Il montre également que les germes n’apparaissent pas spontanément dans les milieux fermentescibles, mais qu’ils proviennent du milieu environnant et ont besoin de conditions optimales pour se développer.
En 1859, le prix de physiologie expérimentale lui est décerné pour ses travaux sur les fermentations.
En 1861, Pasteur est convaincu que la génération spontanée n’existe pas. Il met donc en œuvre des expériences montrant que tout germe provient nécessairement d’un autre germe.
Il montre qu’il suffit de maintenir un milieu de culture à l’abri de l’air pour qu’il reste indéfiniment stérile : c’est la base de l’asepsie et de la grande révolution chirurgicale du XXe siècle.
Pasteur est à l’origine d’une technique permettant de réduire le niveau de contamination d’un milieu grâce au chauffage de quelques minutes entre 55 et 60 degrés en l’absence d’air, sans modifier le goût du vin, cette méthode appliquée à l’ensemble des liquides altérables est connue dans le monde entier sous le nom de PASTEURISATION.
Pasteur a la ferme conviction que la plupart des maladies de l’homme sont dues à des micro-organismes. Après de nombreuses constatations avec les chirurgiens, il apporte toutes les notions d’antisepsie avant, pendant et après les interventions chirurgicales (matériel stérilisé, eau « stérilisée, » lavage des mains, flambage des instruments afin d’éliminer les germes, stérilisation des pansements et objets de pansements). Ce fut une véritable révolution dans la pratique de la chirurgie et de l’obstétrique, révolution couronnée de succès en diminuant considérablement la mortalité.
Pasteur travailla ensuite sur la maladie du charbon qui touche les ruminants.
Il passa le reste de sa vie à identifier différents germes pathogènes tels :
Le vibrion ;
Le staphylocoque ;
Le streptocoque ;
Le pneumocoque ;
Le bacille du choléra.
Entre 1880 et 1885, Pasteur développe ses études et ses expériences sur la rage et finit par mettre au point la prophylaxie1 de la rage (vaccin et traitement de la maladie).
Pasteur a donc joué un rôle fondamental dans l’avancée des connaissances en bactériologie, dans les notions d’asepsie, d’antisepsie et dans la découverte du vaccin contre la rage.
La bactériologie, la virologie, la mycologie sont des sciences qui sont relativement récentes et ont vu leurs techniques de recherche évoluer, donner naissance à de nouvelles disciplines, essentielles pour nous tous, l’immunologie en particulier. Cette discipline, sur laquelle nous reviendrons, permet d’expliquer comment l’organisme parvient à se défendre.
Souvent seul face à un agresseur, l’organisme peut parfois être accompagné par des techniciens de laboratoire. Les techniques d’identification du micro-organisme responsable de l’infection font appel à la biochimie, à la réflexion, pour venir au secours de celui-ci, face à des corps étrangers virulents et parfois dangereux.
Ces données font appel à des connaissances physiologiques, biologiques, médicales, parfois complexes, que je vais tenter de simplifier afin que vous ayez une vision plus claire d’un monde jusqu’ici abstrait, mais dont les répercutions cliniques sont parfois importantes, inquiétantes.
Lorsque l’on parle de bactéries, virus, champignons, il faut également parler des conséquences sur l’organisme et donc des pathologies infectieuses. Je ne suis pas médecin, mais toutes les formations au cours de mes études en bactériologie et kiné, ma vie professionnelle dans l’industrie pharmaceutique en tant que cadre sup, responsable de la force de vente nationale, donné accès à l’ensemble des connaissances médicales relatives aux spécialités présentées au corps médical. Je possède donc des connaissances solides pour pouvoir vous les exposer.
Qui dit risque infectieux et contamination dit prévention des maladies infectieuses. Des conseils pour éviter la propagation des bactéries et virus, en particulier, seront abordés. La prévention sera d’autant plus importante en période d’épidémies, les pathologies infectieuses les plus fréquentes chaque année étant la grippe, la gastro-entérite, exception faite en 2020 et 2021, où ces pathologies auraient pratiquement disparu… « remplacées par Covid-19 ».
À cette notion de prévention vient se greffer la vaccination censée prévenir, anticiper la maladie et l’éviter.
Nous verrons que cette notion d’immunisation a pris du plomb dans l’aile depuis quelques épisodes maladroits et malheureux de nos communicants, de nos instances gouvernementales et scientifiques « la vaccination, ça ne se discute pas » et depuis cette pseudopandémie et sa polémique monstrueuse sur l’efficacité et les effets secondaires graves de la thérapie génique à ARNm.
Les vaccins obligatoires chez les enfants prennent une ampleur jamais connue avec, à ce jour, au moins 15 vaccins obligatoires, ne laissant donc aucune place à l’immunité naturelle. L’histoire de la vaccination en général vous laissera sans doute pantois et remettra en question vos croyances, jusque-là indéfectibles, aux multiples injections, soi-disant bénéfiques pour les enfants, pour les adultes fragilisés…
Bactéries
Virus
Champignons microscopiques
Parasites
Iris poussant en pleine nature dans la garrigue
Les bactéries se trouvent partout dans la nature, le sol étant un fantastique réservoir de bactéries, champignons microscopiques, et participent à la création des merveilles qui régalent nos yeux en permanence.
Un gramme de sol végétalisé contient environ un milliard de bactéries dont, pour certaines, des espèces encore inconnues.
Les bactéries telluriques jouent un rôle primordial dans les cycles du carbone, de l’azote et exercent des effets bénéfiques ou délétères sur la croissance et la santé des plantes. Outre l’être humain, la nature bénéficie aussi des avantages ou des inconvénients des micro-organismes.
Que la nature est belle !
Les micro-organismes chez les humains
Les micro-organismes sont des êtres ou des organismes vivants appelés communément microbes, de très petite taille puisqu’ils sont invisibles à l’œil nu et nécessitent donc un matériel bien particulier pour les étudier, outre le microscope.
Par micro-organismes, on sous-entend, bien sûr, des variétés diverses tels les bactéries ou microbes, les virus, de taille encore plus petite, les champignons, les levures.
Notons au passage que l’existence, la réalité du virus, est souvent remise en question. Référons-nous au virus ayant soi-disant provoqué la crise sanitaire de 2020-2022, qui n’a jamais été isolé. Seules les reconstitutions informatiques existent, il en est de même pour le virus du Sida et par extrapolation, l’ensemble des virus.
Nous aurons l’occasion de distinguer ces différents micro-organismes en leur consacrant un chapitre particulier et en passant en revue toutes leurs caractéristiques.
Les micro-organismes sont présents partout dans la nature, capables de s’adapter à des conditions de vie parfois extrêmes.
Le taux de micro-organismes dans l’air varie en fonction de l’humidité, de la température, de l’atmosphère. En effet, les rayons du soleil ont tendance à désinfecter l’air alors que l’humidité, les gouttelettes d’eau ont tendance à servir de support aux bactéries et virus.
Le froid sec aura tendance à stopper la croissance de la majorité des micro-organismes.
Les micro-organismes tels que les bactéries ont des rôles positifs importants dans l’organisme, en particulier dans nos intestins puisque nous avons une flore commensale2 : (flore intestinale), qui permet le bon fonctionnement de ceux-ci lorsqu’elle est en équilibre, en nombre et en variétés : par contre le déséquilibre de cette flore crée les désordres intestinaux avec souvent diarrhées et conséquences diverses sur l’organisme (notre deuxième cerveau).
Notre organisme vit grâce à une flore bactérienne présente à tous les niveaux, que ce soit en externe (sur la peau) ou en interne en particulier sur les différentes muqueuses, dans les intestins…
Il existe également les micro-organismes pathogènes 3à l’origine de maladies infectieuses bien précises (tuberculose, candidoses,4 grippe, sida5) selon qu’il s’agisse de bactéries, de virus, de champignons microscopiques, de levures.
Pour se nourrir, les micro-organismes ont besoin de substances leur apportant l’énergie dont ils ont besoin (glucides) en les utilisant de différentes façons en fonction des espèces, lipides pour un apport de carbone et d’énergie, protides pour l’apport de substances azotées.
« L’expérimentation se trouve sans cesse aux prises avec des faits qui ne se sont pas encore manifestés. L’inconnu dans le possible et aussi ce qui a été, voilà son domaine.
Le charme de nos études, l’enchantement de la science, consistent en ce que, partout et toujours, nous pouvons donner la justification de nos principes et la preuve de nos découvertes. »
Louis Pasteur
Pasteur est né à Dole en Franche-Comté le 27 décembre 1822. Il fréquente le collège d’Arbois, il ne fut tout d’abord qu’un élève moyen. Son application à l’étude ne se manifesta qu’à partir du moment où il aborda les sciences. Il poursuit ses études à Besançon puis à Dijon où il est reçu à son BAC ès sciences. Il revient ensuite à Paris où il assiste aux leçons du chimiste Dumas à la Sorbonne et entre enfin le quatrième à l’école normale dans la section des sciences.
À l’école normale, il s’adonna à la chimie, il eut les meilleurs professeurs et devint agrégé, réussit à rester à l’école comme préparateur en 1846 et obtint donc des facilités pour ses expériences et la préparation de ses thèses de doctorat.
« Il y a dix ans, écrivait Duclaux en 1886, malgré les travaux de Davaine sur le charbon, malgré les belles études de Pasteur sur le ver à soie, on pouvait se demander s’il y a des maladies dues à l’intoxication des microbes. Voilà qu’on est en droit de se demander s’il y a vraiment des maladies ou les microbes n’interviennent pas. »
C’est toute une science, toute une doctrine nouvelle que Pasteur avait élaborée :
La microbiologie
« On se laisse emporter par l’enthousiasme et on s’incline plein d’admiration et de respect devant le chimiste qui, pour ne pas être médecin, illumine la médecine et dissipe à la clarté des expériences, des obscurités qui étaient demeurées impénétrables. »
Savourons ces découvertes essentielles et ayons le plaisir de faire toute la lumière aujourd’hui, sur ce monde resté très longtemps inconnu et invisible ! et pour lequel encore aujourd’hui, les recherches continuent afin de pouvoir éradiquer germes, virus, parasites, champignons, qui viennent nous surprendre et parfois inquiéter notre pronostic vital.
Saluons également le travail acharné de nos chercheurs et des équipes médicales sur le terrain qui prennent parfois eux-mêmes des risques pour pouvoir apporter soins et réconforts à des populations en danger sanitaire.
Les bactéries
Bonnes connaissances, délicatesse, technicité, méthode, respect des règles d’hygiène et d’asepsie, telles sont les qualités nécessaires, qu’un bactériologiste doit posséder pour pouvoir exercer en toute sécurité, et pleine efficacité.
Les bactéries sont des micro-organismes que vous ne voyez pas à l’œil nu, qui nécessitent par conséquent un appareil grossissant pour les distinguer. En effet, leur taille est du niveau du micron soit 10-3 mm, le microscope optique s’impose donc.
Une bactérie, de quoi se compose-t-elle ?
Une bactérie est composée d’éléments constants :
Une paroi
qui protège la bactérie et dont la composition va déterminer la coloration au gram (voir plus loin). La paroi de la bactérie est recouverte d’antigènes (qui vont générer la sécrétion d’anticorps par l’organisme).
Une membrane cytoplasmique
qui constitue le lieu d’échanges avec le milieu extérieur, certaines protéines de la membrane sont des enzymes assurant différentes fonctions de la bactérie : respiration, échanges.
Le cytoplasme
dans lequel se trouvent
l’appareil nucléique
6
et les
ribosomes
7
.
Les éléments inconstants de la bactérie (que l’on ne retrouve pas systématiquement) :
La capsule :
ce sont en général des bactéries plus résistantes à la phagocytose
8
, empêchant aussi la pénétration des antibiotiques. Les bactéries encapsulées sont donc en général des bactéries plus méchantes : exemple : le pneumocoque peut être encapsulé et être à l’origine du décès du patient, en raison de sa virulence et de sa résistance aux antibiotiques.
Les flagelles
assurant la mobilité de la bactérie.
Les spores
pour résister aux agressions, certaines bactéries se mettent en veille et se réveillent lorsque les conditions deviennent favorables. Exemple : le bacille du tétanos (Clostridium Tétani).
Quelques noms vont vous orienter, car vous en avez déjà entendu parler, soit par votre médecin (colibacilles, staphylocoques, pour les plus connus) soit au travers des journaux télévisés et qui ont fait, à une période, la une de l’info (Escherichia coli).
On trouve ces bactéries un peu partout à l’état non pathogène (dans l’eau, le lait, l’air, le sol, sur la peau, les muqueuses…).
Les bactéries sont utiles, voire nécessaires, en effet sans flore intestinale, il n’y aurait pas de digestion par exemple (100 000 milliards de bactéries diverses en équilibre dans un rapport de 80 % de « bonnes » bactéries et 20 % de « mauvaises »).
La majorité des espèces bactériennes est inoffensive, certaines sont d’une très grande utilité en étant, par exemple, à l’origine du yaourt, du fromage, du pétrole !
Une bactérie saprophyte est une bactérie qui n’est pas pathogène, elle existe à l’état normal chez tout individu, l’homme n’est donc aseptique9 que pendant sa vie in utero10
Nous avons environ 500 sortes de bactéries dans notre corps.
Ces bactéries dites opportunistes peuvent devenir pathogènes si elles deviennent en surnombre ou dans un milieu inhabituel : une bactérie de l’intestin se retrouvant dans les urines par exemple.
Les bactéries peuvent être d’emblée pathogènes, c’est-à-dire être responsables de maladies, dans ce cas, mieux vaut les éviter SI POSSIBLE !
Nous rencontrons donc les bactéries dans les liquides biologiques, partout où il est nécessaire d’identifier la bactérie responsable de l’infection et/ou il faut intervenir pour aider l’organisme à se défendre. Le prélèvement s’effectuera donc au lieu même de l’infection présumée : il peut s’agir d’une plaie avec prélèvement des suppurations, prélèvement d’urine pour les infections urinaires, crachats, selles, peau, prélèvement vaginal…
Les prélèvements s’effectuent en général avec un écouvillon11 pour les plaies, les orifices, tandis que le recueil des milieux liquides (urines, crachats) se fait dans des pots stériles.
Pour les milieux biologiques tel le sang, un dispositif spécial est utilisé pour une mise en culture immédiate (flacon avec gélose intégrée et milieu nutritif).
Deux grandes sortes de bactéries nous habitent et circulent en nous et autour de nous :
Ce sont des bactéries de forme ronde (coques), isolées, regroupées par deux (diplocoques), en amas, en chaînes. La présentation de ces coques entre lame et lamelle ou sur frottis coloré, regardées au microscope, va déjà orienter l’identification.
Lorsque le prélèvement arrive au laboratoire, le microbiologiste va entamer plusieurs étapes afin d’identifier la bactérie responsable ;
Un examen macroscopique du prélèvement : couleur, aspect du liquide, odeur, consistance…
Un examen microscopique :
Le microbiologiste va prendre une partie infime du prélèvement qu’il va diluer dans une petite quantité d’eau stérile, il va en prélever une partie qu’il va déposer sur une lame et recouvrir d’une lamelle pour examen au microscope : le but est d’avoir déjà une idée sur les bactéries présentes, les cellules rencontrées (forme, disposition, quantité…).
Un frottis12 du prélèvement sur une lame est également effectué et coloré puis regardé au microscope : (non systématique dans ce premier temps).
Cette coloration va permettre de distinguer deux types de colorations :
La coloration rose des bactéries nous dirige vers des bactéries dites Gram négatif.
A contrario, la coloration violette de celles-ci nous oriente vers des bactéries « Gram positif ».
Nous aurons donc la possibilité de distinguer soit des coques « Gram négatif » soit des coques « Gram positif » et cette coloration va déjà orienter le bactériologiste dans l’identification et les examens complémentaires pour mettre un nom précis sur la bactérie.
Deuxième type de bactéries est représenté par « les bacilles » :
Ce sont bactéries de forme allongée (bâtonnets), dont la disposition va donner également des renseignements quant à leur identité potentielle.
De la même façon que pour les Cocci, nous aurons aussi des bacilles soit roses à la coloration : ce sont des bacilles » Gram négatif », et ce sont les plus courants, soit des bacilles violets et ils sont dits bacilles » Gram positif ».
Cette coloration n’est pas anodine puisque les classifications des bactéries vont, en particulier, reposer sur la celle-ci, dans un premier temps (forme et couleur).
Il existe donc plusieurs types de bactéries, le but n’est pas de faire un cours de bactériologie, mais de vous donner quelques idées sur la flore bactérienne existante et comment s’effectue l’identification en laboratoire.
C’est Leeuwenhoek en 1683 qui découvre les bactéries avec son « microscope13 » confectionné lui-même à partir d’une barre de verre dont il fait fondre l’extrémité. Il s’aperçoit que cette boule de verre fondu grossit énormément les objets. Grand bricoleur, il se fabrique alors un microscope et observe tout ce qu’il peut observer.
Alors qu’il pleut, il observe une goutte d’eau et s’aperçoit que cette goutte d’eau est « habitée » par des éléments vivants.
Il a ensuite l’idée de ne pas se laver les dents pendant quelques jours, et il prélève ensuite le dépôt dentaire qu’il dilue dans un peu d’eau et qu’il place sous son microscope.
Il découvre les premières bactéries qui pullulent dans ce milieu. (Cocci et bacilles), qu’il dessine ensuite sur des documents.
Leeuwenhoek est donc le premier homme au monde à avoir découvert les bactéries.
Depuis cette date, le microscope a évolué.
Le microscope optique est un instrument qui permet de grossir l’image placée sous l’objectif et invisible à l’œil nu. Il permet donc d’observer des éléments de très petite taille, de l’ordre du micron, il est utilisé en biologie, en minéralogie, en métallurgie pour inspecter la qualité d’un métal par exemple.
Pour ce qui nous concerne, il permet d’observer les bactéries, les parasites, les champignons microscopiques. Quant aux virus, leur taille étant encore plus petite, ils nécessiteront un matériel encore plus sophistiqué : le microscope électronique.
Qui a inventé le microscope optique ? On attribue à Antoni Leeuwenhoek (1632-1723), le fait d’avoir attiré l’attention des biologistes sur l’utilisation du microscope.
Il fallut encore au moins 150 ans pour que les optiques des microscopes soient mises au point.
Le microscope optique est composé de lentilles qui permettent le grossissement de l’objet à étudier, d’un miroir qui sert à réfléchir la lumière, d’une source de lumière pour éclairer l’objet à étudier, un diaphragme permettant d’augmenter ou diminuer la source de lumière, nécessaire en fonction du « matériel » à étudier, la platine porte échantillon : là ou est posée la lame sur laquelle figure l’échantillon à regarder.
Les objectifs qui permettent de grossir l’objet (choix de l’objectif en fonction de la taille souhaitée et de la taille initiale du micro-organisme à étudier) sont montés sur un barillet qui, en le tournant, « distribue » l’objectif de grossissement choisi.
Lorsque l’examen se fait entre lame et lamelle, une goutte d’huile est placée entre la lamelle et l’objectif pour améliorer la réfraction.
La mise au point de l’image se fait par l’intermédiaire d’une molette qui permet de faire monter ou descendre l’objectif, le but étant d’obtenir une image nette.
Les premiers microscopes étaient des microscopes mono oculaires, ensuite vinrent les binoculaires, ce sont ceux utilisés aujourd’hui et qui permettent même, en rajoutant un poste d’observation supplémentaire, à deux biologistes d’observer les mêmes images.
Le pouvoir grossissant du microscope optique est lié à l’utilisation de plusieurs lentilles. Depuis sa découverte le microscope a bénéficié de nombreuses améliorations passant d’une puissance de grossissement de 200 à 1500 fois, la plupart des observations se faisant entre 200 et 400 fois la taille de l’objet à observer.
L’oculaire peut être remplacé par un appareil photo ou une caméra vidéo permettant la lecture sur un moniteur vidéo.
Différents types de microscopes sophistiqués existent aujourd’hui afin d’améliorer toujours la qualité de l’image (microscopes en champ sombre pour améliorer le contraste d’échantillons transparents), illumination oblique (pour donner du volume à l’objet), en fluorescence (collecter la lumière émise), à contraste de phase.
Voici les différents aspects des bactéries vues au microscope, sans coloration :
Les cocci
Les bacilles
Les autres espèces plus rares
Après coloration de Gram
Voici un exemple de bactéries « Gram négatif », car de couleur rose.
La forme est en bâtonnet : ce sont donc des « bacilles Gram négatif ».
Bactéries en forme de coques et de couleur violette : ce sont donc des Cocci Gram positif.
La disposition est plutôt en amas, il s’agit donc probablement d’un staphylocoque.
Après examen microscopique, une infime partie de la solution constituée d’une partie du prélèvement mélangé à l’eau stérile sera utilisée pour ensemencer une gélose dans une boîte de pétri selon une technique bien précise pour pouvoir isoler ensuite les colonies entre elles s’il y a plusieurs souches bactériennes.
Cet ensemencement est placé ensuite 18 heures environ dans une étuve à 37° pour favoriser le développement bactérien.
Le développement bactérien fait apparaître des colonies sur la gélose (sortes de boules d’aspects et de couleur différents selon la nature du germe).
Pour information, les colonies peuvent apparaître :
Rondes, bombées ou plates de diamètre, environ 1 à 2 mm ;
À contour irrégulier ;
En étoile ;
Envahissantes, donnant l’aspect d’un voile, et caractéristiques de certaines bactéries.
L’odeur donnera une indication précise ainsi que la couleur de ces colonies.
Suite à cela, le bactériologiste va prélever une infime partie de colonie qu’il va diluer dans de l’eau stérile et procéder à :
– Un examen microscopique après coloration de gram.
– Selon la bactérie, il ensemencera une batterie de tests biologiques pour déterminer exactement le lendemain et après une incubation à 37°, le type de bactérie à laquelle il a à faire (exemple ensemencent de galeries API14 pour les Entérobactéries).
Il se peut que le prélèvement contienne plusieurs bactéries, il faudra donc procéder aux mêmes tests avec les différentes colonies cultivées si celles-ci sont bien isolées, sinon il faudra procéder à un isolement des bactéries.
Vous avez donc compris au travers de ces explications, peut-être pas faciles à visualiser pour un novice, que l’identification d’une bactérie est basée sur :
L’examen macroscopique du prélèvement (comment se présente-t-il ? Sa couleur, son aspect, son odeur…).
L’examen microscopique, forme des bactéries, en amas ou isolées…
La mise en culture et l’incubation à 37°.
Le lendemain :
L’examen macroscopique des colonies en tenant compte de la forme, des bords, de la couleur, de l’odeur…
L’examen microscopique des bactéries après coloration ;
L’ensemencement des tests biochimiques ;
La mise à l’étuve à 37°, afin de faire développer les colonies bactériennes.
Le lendemain encore :
La lecture des tests biochimiques permettant l’identification précise de la bactérie.
Dans le même temps, lors de l’ensemencement des tests biologiques, on ensemencera également une gélose du même bouillon de culture, de façon uniforme, sur laquelle on déposera des disques d’antibiotique afin d’obtenir en même temps que l’identification, l’antibiogramme15, c’est-à-dire les noms des antibiotiques qui seront efficaces chez le patient contre cette bactérie identifiée.
Théoriquement, à J+2, le médecin doit pouvoir être informé du nom de la bactérie responsable de l’infection chez le patient ainsi que les antibiotiques efficaces sur cette bactérie et qui peuvent donc permettre sa guérison.
Il arrive parfois que la bactérie responsable soit plus difficile à identifier, son identité sera donc révélée avec une journée ou deux de retard. Il est possible également que le pronostic vital du patient soit engagé (en cas d’hémoculture16 pour le diagnostic de septicémie ou LCR17 et diagnostic de méningite), dans ce cas, même sans identification, on tâchera de réaliser l’antibiogramme de façon à mettre l’antibiotique en place le plus rapidement possible.
Dans certains cas également, le médecin pratiquera une antibiothérapie probabiliste18.
Il est donc plus urgent de mettre en place l’antibiothérapie pour pouvoir guérir, soulager, voire sauver le patient, que d’avoir un nom précis de bactérie.
Mais l’identification de celle-ci reste malgré tout importante afin d’évaluer la virulence, le risque de contagion, d’épidémie potentielle.
Boites de pétri avec gélose permettant de cultiver les germes à 37°.
Voici une culture positive après incubation, les parties marrons étant les colonies de bactéries.
Colonies poussées sur gélose
Boite de pétri montrant des colonies bactériennes bien isolées, sur lesquelles il va être aisé de travailler pour le bactériologiste.
Le nom de la bactérie est parfois évocateur du nom donné à la maladie qui s’y rapporte, en effet par exemple le pneumocoque évoque la pneumonie, par contre si je vous dis Pseudomonas Aéruginosa, le rapport avec la maladie générée n’est pas évident !
Les bactéries ont donc un pouvoir pathogène, mais comment nous rendent-elles malades ?
Dans toute maladie bactérienne, un conflit entre la bactérie et l’organisme s’organise, la bactérie envahissant les tissus, l’organisme tentant de réagir pour lutter contre l’envahisseur.
L’envahissement va se dérouler en trois phases :
Les bactéries vont pénétrer au travers de la peau ou d’une muqueuse, soit naturellement soit par l’intermédiaire d’une porte d’entrée (plaie, blessures…).
Les bactéries vont franchir ensuite la barrière cutanéo-muqueuse
19
et atteindre les ganglions lymphatiques (c’est la raison pour laquelle nous avons lors d’une infection, une augmentation du volume de ces ganglions).
Les viscères seront ensuite atteints par propagation sanguine, il y aura alors simple passage de bactéries dans le sang (bactériémie) ou passage répété dans le sang, on parlera alors de septicémie.
Une arme redoutable des bactéries est la sécrétion de toxines, sorte de poison pour l’organisme contre lequel il va devoir se défendre.
Abordons enfin un sujet qui reste préoccupant et que nous reverrons dans le chapitre immunologie/antibiothérapie, c’est la résistance bactérienne.
Effectivement, à force de « bombarder » à outrance les bactéries d’antibiotiques, celles-ci ont fini par développer des résistances.
Qu’est-ce qu’une bactérie résistante ?
C’est une bactérie qui n’est plus sensible aux antibiotiques.
La bactérie, possédant du matériel génétique dans sa constitution, peut développer des résistances de différentes manières que je ne développerai pas ici en raison de mécanismes complexes.
Cette résistance bactérienne va poser de gros soucis en particulier en milieu hospitalier et plus particulièrement dans les services de réanimation pour la prise en charge des patients infectés et dont l’organisme est affaibli par la maladie ou les interventions chirurgicales.
Cette résistance est également potentialisée par le passage de germes, entre le personnel et les malades, une hygiène et une asepsie devront donc être rigoureuses.
La multiplication bactérienne
Tout comme les cellules, les bactéries se multiplient dans les milieux dans lesquels elles se trouvent.
En laboratoire, nous cultivons les bactéries sur des milieux gélosés contenant ou non un enrichissement en fonction des bactéries recherchées.
Par exemple, Haemophilus Influenzae est une entérobactérie qui aime le sang (d’où son nom), elle est donc cultivée en laboratoire sur des milieux enrichis au sang, et ce milieu enrichi permet également de déterminer dans certains cas, le type d’hémolyse produit par la bactérie (exemple du streptocoque bêta hémolytique du groupe A, qui lyse les hématies autour des colonies sur la gélose, formant un hâle clair plus ou moins important autour de celle-ci)). Cela permet ainsi de les identifier et de les classer selon l’importance de leur hémolyse.
Une bactérie, lorsqu’elle va se trouver dans un milieu nutritif favorable, va se diviser et former d’autres bactéries selon une courbe exponentielle, temp tant qu’elle aura de quoi se nourrir, c’est la phase de croissance de la bactérie. Cette phase se manifeste concrètement sur une gélose contenue dans la boîte de pétri, par la multiplication des colonies renfermant un nombre considérable de bactéries (boite de pétri maintenue dans des conditions favorables de culture).