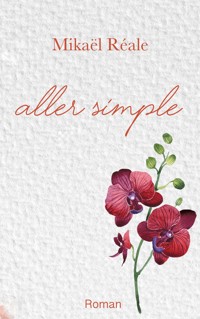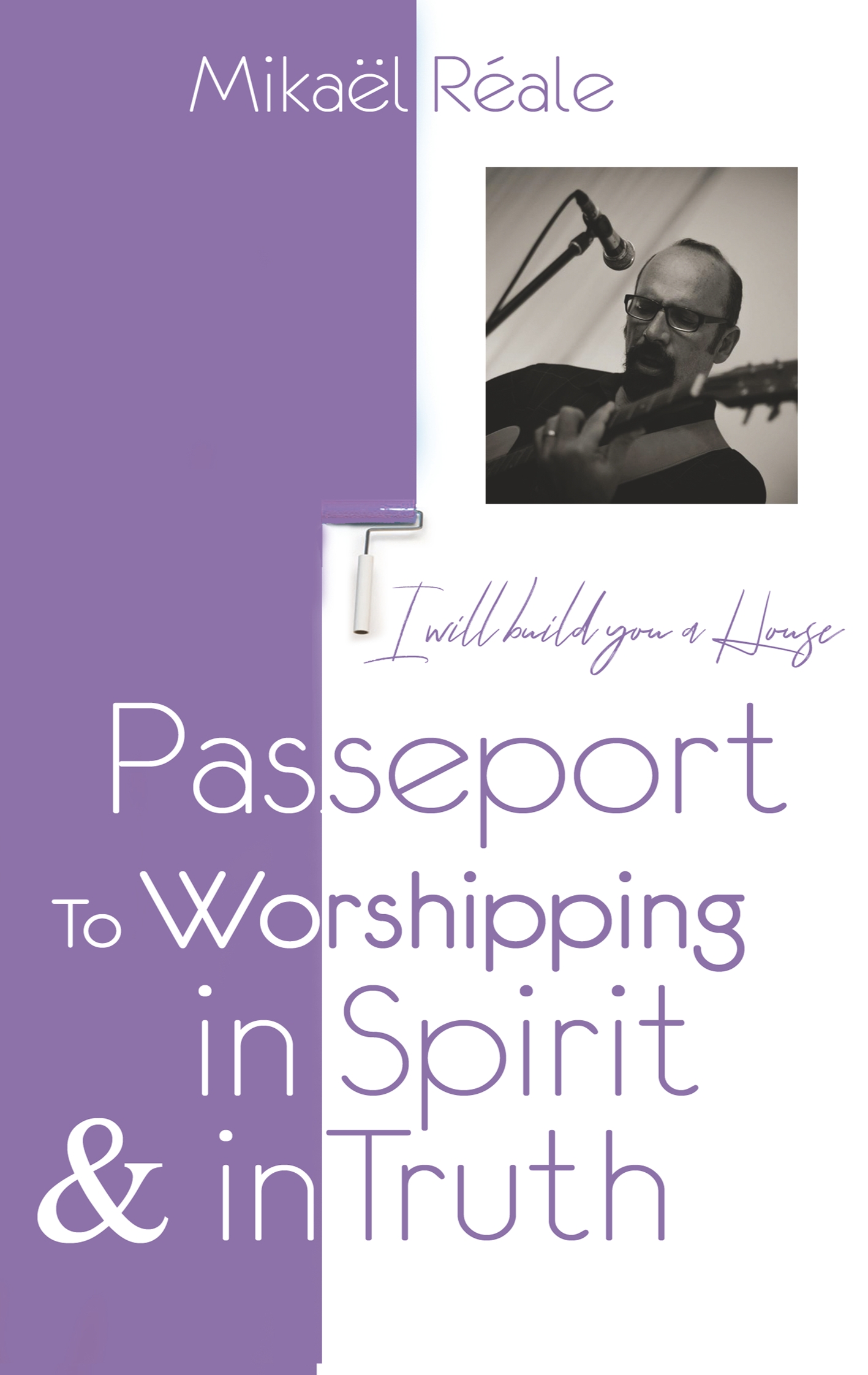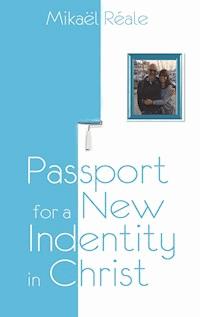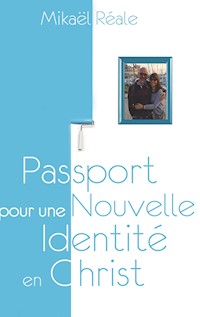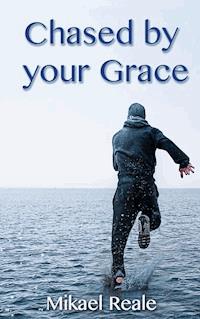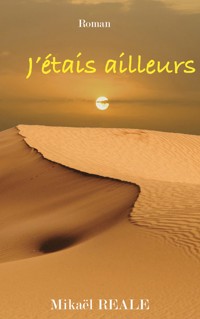
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alors qu'une jeune femme lutte contre la mort dans un coma profond, elle rencontre un monde "ailleurs". Ses parents, eux cherchent la justice, l'expiation, une explication qui ne vient pas. La quête de vengeance d'un père, celle d'absolu d'une mère, un frère qui s'enfonce ... Et pourtant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ; un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour abattre, et un temps pour bâtir ; un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ; un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ; un temps pour embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements ; un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour garder, et un temps pour jeter ; un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps pour parler ; un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix ».
L’Ecclésiaste chapitre III v 1-8
À tous ceux qui cherchent…
Sommaire
PREMIÈRE PARTIE : « Collision »
Chapitre I : « Il y a un temps pour tout, un temps pour rire… »
Thomas
Maëva
Martin Rodin
Jeanne Rodin
Chapitre II : « Il y a un temps pour tout, un temps pour déchirer… »
Jean-Luc Borelli
Fabien Muller
Thomas
Jeanne et Martin
Chapitre III : « Il y a un temps pour tout, un temps pour comprendre… »
Le Capitaine Bastogne
Jeanne
Chapitre IV : « Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer… »
Jean-Luc Borelli
Fabien
Jeanne et Martin
Fabien
Jean-Luc Borelli
Chapitre V : « Il y a un temps pour tout, un temps pour les pleurs… »
Fabien
Jeanne
Maître Guichard
DEUXIÈME PARTIE : « Il était une fois, la loi… Six mois plus tard »
Chapitre VI: « Il y a un temps pour tout, un temps pour la colère… »
Martin
Jeanne
Thomas
Martin
Fabien
Chapitre VII : « Il y a un temps pour tout, un temps pour la Loi… »
Maître Guichard
Jeanne
Thomas
Martin
Chapitre VIII : « Il y a un temps pour tout, un temps pour les questions… »
Jeanne
Fabien
Thomas
Martin
Chapitre IX : « Il y a un temps pour tout, un temps pour la Loi… »
Jean-Luc Borelli
Martin
Jeanne
Calculateur d’ascendant
Fabien
Thomas
Jeanne
Martin
TROISIÈME PARTIE : « Le piège de l’oiseleur »
Chapitre X : « Il y a un temps pour tout, un temps pour lancer des pierres Et un temps pour ramasser des pierres… »
Jean-Luc Borelli
Jeanne
Martin
Ailleurs
Chapitre XI : « Il y a un temps pour tout, un temps pour la colère »
Maître Guichard
Thomas
Martin
Jeanne
Fabien
Ailleurs
Chapitre XXII : « Il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre »
Jeanne
Jeanne hésita
Margareth
Martin
Fabien
Ailleurs
Chapitre XIII : « Il y a un temps pour tout, un temps pour tuer… Et un temps pour guérir »
Jeanne
Margareth
Martin
Thomas
Chapitre XIV : « Il y a un temps pour tout, un temps pour tuer… Et un temps pour guérir »
Martin
Margareth
Ailleurs
Fabien
Chapitre XV : « Il y a un temps pour tout, Un temps pour chercher, et un temps pour perdre
Jeanne
Thomas
Martin
Margareth
Chapitre XVI : « Il y avait un temps pour tout, Un temps pour se taire, et un temps pour parler »
Thomas
Martin
Jeanne
Margareth
Ailleurs
Chapitre XVII : « Il y avait un temps pour tout, Un temps pour la paix, et un temps pour la guerre »
Fabien
Martin
Jeanne
Thomas
Maître Guichard
Chapitre XVIII : « Il y a un temps pour tout, Un temps pour partir, et un temps pour revenir »
Ailleurs
Martin
Thomas et Fabien
Chapitre XIX : « Il y avait un temps pour tout, Un temps pour se venger, et un temps pour pardonner »
Capitaine Bastogne
Jeanne
Borelli
Martin
Chapitre XX : « Il y a un temps pour tout, Un temps pour se pleurer, et un temps pour rire »
Jeanne
Capitaine Bastogne
Martin
ÉPILOGUE : « Il était une fois, la justice… »
Chapitre XXI : « Il y a un temps pour tout, Un temps pour la justice »
Kevin
Jeanne
Borelli
Thomas
Margareth
Martin et Jeanne
Le Capitaine Bastogne
Maëva
PREMIÈRE PARTIE
« Collision »
Chapitre I
« Il y a un temps pour tout, un temps pour rire… »
Thomas
Dans le garage de la maison, Thomas était en train de vérifier leur équipement. Il avait toujours été perfectionniste et en matière de plongée sous-marine, c’était plutôt une qualité. Leur pneumatique Bombard, motorisé d’un 50 chevaux Yamaha, pouvait embarquer trois personnes avec tout leur matériel plus un pilote et une bouteille de sécurité. Cette fois-ci, ils ne seraient que lui et sa sœur Maëva.
Ils étaient, sa sœur et lui, niveau deux, et pouvaient pratiquer non accompagnés jusqu’à vingt mètres de profondeur. Ils avaient plus de cinquante plongées à leur actif et Martin les laissait seuls sans appréhension, du moment qu’il avait vérifié avec eux la préparation de leur expédition.
Thomas avait passé son permis bateau aux vacances de Noël et ils pouvaient maintenant partir sans leur père. Il contrôla une nouvelle fois la pression dans leur bloc de douze litres, les piles dans les lampes torches, les deux ordinateurs, chargea le tout dans le coffre de la voiture et y attela la remorque. Ils étaient fin prêts.
Du sommet de ses dix-neuf ans, Thomas pensait pouvoir décrocher la lune, ou tout du moins l’effleurer un jour. Il avait eu son bac et vivait la semaine en fac à Aix-en-Provence, où il préparait une licence d’histoire. Il avait toujours été passionné par l’Antiquité. Il s’était imaginé des centaines de fois dans la peau d’un Indiana Jones, à courir le monde comme son Martin l’avait fait dans sa jeunesse. De plus, depuis peu, il rêvait d’archéologie sous-marine.
La fac d’Aix proposait une telle option à ses élèves et il était décidé à passer son niveau trois cet été, afin de pouvoir s’y inscrire dès la rentrée. Son père l’y aiderait. Il s’entendait à merveille avec lui.
Dans deux semaines, ils partiraient tous à l’île de la Réunion où d’autres plongées les attendaient.
Oui, la vie était formidable quand on avait une famille comme la sienne et des projets plein la tête.
Il regarda sa montre et se dit qu’il fallait y aller s’ils voulaient être de retour avant la nuit pour rincer le matériel dans le jardin.
« Maëva, grouille-toi, tout est prêt » ! Décidément, les filles étaient toujours à la bourre. « Tu n’as pas besoin de te maquiller, les poissons s’en foutent ! »
Maëva
Maëva mit la touche finale à son look en criant à son frère : « J’arrive, une seconde ! »
En fait, elle aimait bien se faire attendre par Thomas. Elle était une princesse depuis le jour où elle était venue au monde : la princesse de son papa en particulier.
Le métissage lui avait donné cette beauté sauvage qui attirait les regards sur son passage. Ses yeux verts immenses illuminaient son visage d’une intensité particulière à laquelle son père n’avait jamais su résister. Petite, lorsqu’il la grondait, elle plantait son regard dans le sien et laissait échapper une grosse larme qui suivait le contour de sa joue avec une lenteur qui semblait calculée. La plupart du temps, quand celle-ci avait atteint le coin de la bouche de sa fille, Martin avait fini de fondre et la prenait dans ses bras. Plus tard, ayant grandi, elle avait continué ce petit jeu, consciente que son père n’en était plus dupe depuis longtemps. Et ils en riaient tous les deux.
Elle avait aujourd’hui dix-huit ans et parfois Martin regrettait le temps où elle était sa petite princesse à lui. Mais, la compétition était rude pour le cœur de la belle. Il se sentait désarmé devant la nuée d’adolescents montés sur leur scooter, qui semblaient faire le siège du portail de leur villa tous les mercredis. Jeanne se moquait gentiment de lui chaque fois qu’il regardait discrètement derrière les rideaux de la cuisine pour savoir avec qui elle allait partir.
Mais pour l’heure, il fallait vraiment se mettre en route. Elle avait attendu ce moment toute la semaine, dans ces classes du lycée Fénelon d’où elle voyait les plages du Mourillon. Une fois son bac en poche, elle comptait bien entrer en fac de bio. Elle rêvait de devenir océanographe : allier sa passion pour la nature avec celle pour la plongée. Depuis toute petite, elle avait toujours aimé l’eau et aujourd’hui plus encore que jamais.
Elle dévala les escaliers jusqu’au garage et jeta son sac sur la banquette arrière de la voiture. Thomas feignait l’agacement et se moqua d’elle en lui disant que les mérous seraient insensibles à son charme et qu’elle avait perdu bien trop de temps à se pomponner. Il démarra tranquillement et prit la direction du Pradet, où il allait mettre le bateau à l’eau.
Arrivés à destination, il ne leur fallut que vingt minutes pour être prêts et sortir du port. Vingt minutes encore et ils étaient au mouillage à l’abri de la presqu’île de Giens, à « l’anse au blé », et ils furent enfin dans le monde du silence.
Cette sensation d’apesanteur leur donnait à chaque fois un sentiment de liberté absolue, bien qu’ils soient tous les deux conscients des limites techniques de celle-ci.
Ils arrivaient sur un fond de dix-sept mètres, près d’une faille dans la paroi rocheuse, lorsqu’ils virent remontant du tombant une raie pastenague de presque un mètre de diamètre. Elle dansa quelques instants devant leurs yeux émerveillés par la grâce de l’animal qui ne semblait nullement impressionné par les plongeurs. Thomas fit signe à sa sœur de regarder vers le large d’où un escadron de bonites remontait le long du relief abyssal vers eux. Il aurait bien aimé les suivre un peu, mais, très vite effarouchées par les chapelets de bulles qui sortaient des détendeurs, celles-ci avaient commencé à sonder vers les eaux profondes.
Thomas savait que son père, comme à son habitude, vérifierait dans son ordinateur de plongée que ses deux enfants avaient bien respecté leurs prérogatives et n’avaient pas dépassé vingt mètres de profondeur. D’ailleurs, il était temps qu’ils fassent demi-tour. Son manomètre lui indiquait quatre-vingt-dix bars et cela aussi, son Martin ne manquerait pas de le contrôler. Sa sœur comme d’habitude en avait quarante de plus que lui et râlerait de ne pas aller plus loin. Mais la consigne était de sortir de l’eau avant d’être sur réserve.
Ils reprirent donc la direction du bateau et, après cinquante minutes de pur bonheur, étaient de nouveau à bord.
Dans trois semaines, ce serait les vacances de Pâques et ils s’envoleraient en famille pour l’île de la Réunion. Ils allaient être gâtés par leurs grands-parents et plongeraient presque tous les jours dans l’ouest de l’île. Même l’idée des examens à la fac dans quelques jours ne pouvait lui ravir ce sentiment de joie qui le submergeait alors qu’il attelait la remorque à sa voiture pour rentrer.
« Pendant que tu attelles, je vais acheter une pizza pour ce soir, les parents sortent. Tu me prends devant la pizzeria dans vingt minutes ! » lui dit Maëva.
Martin Rodin.
C’était le moment de la journée qu’il préférait. Depuis qu’ils avaient acheté cette maison sur les pentes du mont Faron, Martin aimait se prélasser le soir sur cette terrasse dont la vue imprenable sur la rade de Toulon lui rappelait sa carrière dans la marine nationale. Pendant quinze ans, il avait navigué sur les mers du globe à la poursuite du mythe utopique de la liberté qui avait suscité tant de vocations maritimes. Il avait dû très vite déchanter devant la réalité de la vie de matelot à bord du porte-avions Foch, alors qu’il n’était encore qu’un « appelé ». Mais à la fin de son service, son « bac moins deux » ne lui offrait guère de perspectives d’emploi dans cette « France chômage » des années quatre-vingt. Alors c’est tout naturellement qu’il s’était inscrit au cours des sous-officiers et que quelques mois plus tard, il s’était retrouvé dans une carrière militaire. Cela lui avait permis de voir du pays. Célibataire, il préférait être embarqué, approcher, et même vivre dans ces îles dont la plupart des gens ne faisaient que rêver : Tahiti, Nouméa, La Réunion… C’est là qu’il avait rencontré Jeanne et qu’il l’avait épousée.
En regardant les premières lumières de la rade s’éclairer, il ressentit un peu de vague à l’âme. Il repensait à ces années où sa seule responsabilité était d’être à bord à l’heure entre deux virées dans les bars des ports visités. Son mariage l’avait assagi. Après la naissance de leur premier enfant, Jeanne lui avait bien fait comprendre qu’elle n’accepterait pas longtemps de le voir voguer de par le monde pendant qu’elle élèverait leur fils Thomas. Pendant quelque temps, cela avait dégagé dans le couple une tension palpable qui les avait conduits au bord du divorce. Il avait alors demandé une affectation à terre et avait échoué à Toulon.
Mais la Marine n’avait plus guère de charme dans un bureau de l’Arsenal et après une année, Martin décida de prendre sa retraite partielle. Il ouvrit un cabinet immobilier qui lui rapportait aujourd’hui de quoi avoir un train de vie confortable. C’était loin de l’idéal dont il avait rêvé, mais enfin, il n’avait pas à se plaindre. Jeanne semblait heureuse, et à leur arrivée à Toulon lui avait annoncé la venue d’une petite sœur pour Thomas. Ils l’avaient appelée, de façon un peu nostalgique pour lui, Maëva. Elle avait maintenant dix-neuf ans et était la plus belle chose qu’il ait jamais faite. Il pouvait passer des heures à la contempler. Le métissage en avait fait une superbe jeune fille au teint mat que le soleil de Provence rendait caramel. Son visage avait de la peine à contenir ses immenses yeux d’un vert émeraude qui semblaient rire en permanence ; ses cheveux blonds ondulés descendaient en cascade sur ses épaules. Deux ans avant, durant l’été, il avait commencé à initier ses enfants à la plongée sous-marine. Plongeur expérimenté, il avait passé son brevet d’initiateur au club dont il était membre pour pouvoir lui-même les former. Tous les deux étaient aujourd’hui autonomes et c’était sa plus grande joie que de partir avec eux découvrir le tombant des « Fourmigues » au large de Carqueiranne. Ils prévoyaient tous ensemble de faire un voyage vers la Réunion pour plonger là où Martin avait découvert ce sport.
Oui, somme toute sa vie n’était pas si mal, et à quarantecinq ans, elle était encore devant lui, pensait-il, quand la sonnerie du téléphone l’extirpa de sa rêverie.
Jeanne Rodin
Assise devant sa coiffeuse, Jeanne regardait la femme qu’elle était devenue. Depuis son enfance à la Réunion, elle en avait fait du chemin !
Fille d’un coupeur de canne d’origine indo-mauricienne, d’une mère métisse malgache et sœur aînée de sept enfants, elle avait dû quitter l’école dès l’âge de douze ans. Bien sûr, l’assistante sociale était bien passée une ou deux fois chez eux, au milieu des champs de cannes à sucre des hauts de Sainte-Suzanne, mais cela n’avait jamais ramené personne sur les bancs de la classe. Son père considérait que seuls les fainéants poursuivaient des études après le certificat. Celui-ci était largement suffisant puisque lui avait su se débrouiller sans ne l’avoir jamais eu et qu’il vivait fort bien ainsi.
Ce n’était pas un mauvais bougre, comme disait sa mère. Contrairement à beaucoup de maris de son entourage, le sien ne buvait jamais la moitié de son salaire en « rhum Charrette » ni ne dilapidait le reste en combats de coqs. À force d’économies il avait réussi à acquérir le terrain sur lequel il avait bâti une « case bois sous tôle » qu’il avait agrandie au fil des naissances de ses enfants. Aujourd’hui, ils avaient une vraie maison, qui résistait aux cyclones ! Cela faisait leur fierté, alors que tant d’autres avaient fini dans les HLM de la ville au fur et à mesure que les champs de cannes avaient cédé la place aux lotissements pour fonctionnaires.
Comme il aimait à le dire :
« La Réunion longtemps permettait encore d’vivre dignement. Aujourd’hui, i reste que RMI pour bamna coupeurs de cannes. Mais moi, j’ai su gagner mon ti-case avant ! »
Jeanne avait toujours attendu autre chose de la vie. Elle voulait devenir quelqu’un ! Alors à dix-sept ans, elle était partie vivre vers Saint Paul, la partie touristique de l’île de la Réunion. Elle travaillait dans les restaurants et apprenait l’anglais avec les touristes. Le soir, elle lisait tout ce qu’elle pouvait, avide de savoir. À dix-neuf ans, elle réussit à entrer en formation de BEP d’hôtellerie, puis en bac pro. C’est à la soirée où elle fêtait sa réussite aux examens qu’elle fit la rencontre de Martin. Trois mois plus tard, ils se mariaient.
Aujourd’hui, elle travaillait avec Martin dans l’agence immobilière que son mari avait fondée avec Jean, son meilleur ami, quand ils avaient pris leur retraite de la Marine. Jean et Martin ne s’étaient pas quittés depuis l’année où ils s’étaient engagés dans la Marine et avaient réussi à se faire affecter sur les mêmes bateaux, ou dans les mêmes bases pendant près de quinze ans.
Était-ce à cause de l’amitié de ces deux-là, ou parce qu’elle et Martin passaient leur journée ensemble au bureau qu’ils avaient si peu à se dire le soir à la maison ? Jeanne ne le savait pas. Mais cela ne l’affectait pas tant que ça. Il y avait eu des temps plus difficiles dans leur couple et il semblait aujourd’hui qu’ils avaient trouvé un certain équilibre. Martin plongeait avec ses enfants et elle avait su tisser autour d’elle un cercle d’amies avec lequel elle passait la plus grande partie de son temps libre.
Elles avaient créé une association pour récolter des fonds pour les gamins des rues à Madagascar. Elles avaient déjà pu envoyer un conteneur de matériel scolaire et financer la construction d’une petite école primaire. Elle avait assisté à la première rentrée deux ans auparavant et cela avait été le plus beau jour de sa vie. Ce jour-là, elle avait été reçue par le ministre malgache de l’Éducation et elle s’était dit qu’elle avait fait du chemin depuis les champs de cannes de la Réunion. Elle était devenue quelqu’un !
Ce soir, Martin et elle sortaient en amoureux. Elle allait profiter de ce temps pour lui annoncer son désir de refaire un voyage sur Madagascar d’ici la fin de l’année, pour voir l’avancement des travaux de la nouvelle école à Antaratasy, au nord de Tamatave. Martin n’aimait pas trop la voir partir seule comme ça et il lui faudrait se montrer convaincante. Par ailleurs, il était tellement accaparé par l’agence qu’il avait tout juste accepté les deux semaines de vacances pour visiter ses parents à la Réunion.
Décidée à mettre tous les atouts de son côté, elle enfila cette petite robe qui plaisait tant à son mari, mit ce parfum qu’il lui avait offert à Noël et chaussa ses hauts talons qui lui faisaient des « gambettes de star ». Se regardant de plain-pied dans le grand miroir de leur chambre, elle pensa que pour son âge, elle était plutôt pas mal et que son charme agirait certainement pour tirer de Martin une approbation pour son voyage prochain.
Pour parfaire le tout, Jeanne jeta sur ses épaules un châle de soie, et descendit l’escalier pour rejoindre l’homme de sa vie sur la terrasse où il semblait rêvasser. Elle comptait bien l’éblouir au premier regard, mais au moment de faire son entrée, elle fut trahie par le téléphone qui se mit à sonner.
Chapitre II
« Il y a un temps pour tout, un temps pour déchirer… »
Jean-Luc Borelli
C’était la quatrième fois qu’il assistait à une réunion des alcooliques anonymes, et comme les trois premières fois, cela lui semblait être un cirque irréel. Si ce n’avait été l’obligation du juge de se faire suivre, il ne serait pas là. Il avait jusqu’à présent refusé de prendre la parole dans le groupe, car il ne se voyait pas commencer son « discours » par : « Bonjour, je m’appelle Jean-Luc, je suis alcoolique… Je suis sobre depuis… » Depuis quand en fait ?
Il avait bu une bière hier en rentrant et un verre de vin à table le soir. « Je ne suis pas un alcoolique », se répétait-il.
Une cuite de temps en temps ne faisait pas de lui un alcoolo. La psy de l’antenne locale lui avait bien expliqué que le déni faisait partie de l’arsenal défensif de tout alcoolique, et que la première étape de processus de sa guérison passait par vaincre ce déni. Mais lui ne se sentait nullement malade.
S’il n’y avait pas eu ce stupide contrôle routier, un aprèsmidi, à la sortie de Sanary où habitaient ses parents. Il avait mangé chez eux, car depuis que sa dernière compagne avait fait de lui un célibataire, il y passait tous les dimanches.
Un apéro, une bonne bouteille de Bandol rosé bien glacé à table, un petit digestif, une bière plus tard en jouant aux boules et le verdict était tombé : 0,9 gramme dans le sang. Il ne se sentait pourtant pas du tout en état d’ébriété, mais cela ne l’avait pas empêché de finir au poste.
Le gendarme lui expliqua à la fin de son audition que son véhicule était en fourrière et que Jean-Luc devait trouver quelqu’un pour aller le récupérer, car son permis lui était retiré. Il avait déjà perdu sept points pour des téléphones au volant et petits excès de vitesse et les six points qu’il venait de perdre avaient fini d’achever son droit à conduire.
De plus, il avait dû passer devant le juge qui l’avait condamné à une amende de trois mille euros et à suivre une thérapie pour son « problème » d’alcool.
Jean-Luc se retrouvait donc en scooter. Il ne s’était pas résolu à la voiture sans permis qui l’aurait définitivement catalogué comme chauffard ou paysan ! Il avait opté pour un deux-roues, prétextant à ses collègues de travail que cela était bien plus pratique dans les embouteillages de l’été. De plus, en tant que commercial, il avait une clause de son contrat qui stipulait qu’il devait avoir le permis de conduire pour aller en clientèle. Sa perte signifiait donc la perte de son emploi. Il avait décidé de ne rien dire. En plus, l’été arrivait et en novembre, cela serait terminé.
Après l’essai d’un cinquante cc, le seul accessible dans sa situation, il s’était laissé tenté par un cent vingt-cinq cc un peu plus « pêchu ». Bien sûr, il savait qu’il n’était pas censé le conduire, mais il devait aller travailler tous les jours à Hyères. Le deux-roues était donc assuré au nom de son frère, dont il avait une photocopie du permis dans son portefeuille en cas de contrôle. Encore quatre mois et il pourrait se présenter à l’examen du code, faire son bilan psy et récupérer sa voiture. D’ici là, il comptait sur sa chance pour ne pas se faire contrôler.
En attendant, en sortant de sa réunion de « poivrots » comme il l’appelait, il se dit que le samedi n’était pas un jour pour être sobre, mais pour faire la fête. Il fit un détour, plus par bravade que par envie, par le bar de l’Oasis, sur le port des Oursinières, pour prendre l’apéro avant de rentrer chez lui.
Il but une paire de Ricard en regardant les vieux joueurs de pétanque se disputer, le mètre à la main, devant les premiers touristes de la saison. Il s’était toujours dit que c’était du spectacle plus Pagnol que nature. L’accent poussé à l’extrême et le verbe haut, les « papés » semblaient sortir d’un film noir et blanc ! Ils s’apostrophaient sous le regard amusé de leurs épouses qui tricotaient pour leurs petits-enfants sous les derniers rayons de soleil de cet après-midi de printemps.
Jean-Luc avait toujours aimé cette ambiance et, lorsqu’il enfourcha son scooter pour rentrer chez lui, il se sentait serein.
La circulation commençait à être plus dense à l’approche de l’été, et le centre du Pradet, malgré ou à cause des travaux d’aménagement de la rue principale, était une fois de plus embouteillé. Il se dit que somme toute le deux-roues n’était pas si mal dans ces conditions et que peut-être il passerait un jour le permis moto.
La voiture qui le précédait semblait chercher sa route, pratiquement à l’arrêt. Il déboîta donc pour la dépasser et accéléra franchement, juste pour la sensation de liberté que cela lui procurait.
Le choc ne fut pas aussi violent qu’il l’aurait imaginé. Il avait senti qu’il perdait le contrôle comme s’il n’avait freiné que de l’avant. Puis il était passé par-dessus le guidon dans un vol plané disgracieux. À cet instant, il avait vu le bitume se rapprocher de lui comme au ralenti. Tout autour de lui, la vie semblait comme figée. Les gens ressemblaient à des statues de cire du musée Grévin, si réelles, mais immobiles. Son casque intégral heurta le trottoir et il fut surpris de ne ressentir ni peur ni douleur. Il glissa encore quelques mètres sur le ventre, puis s’immobilisa enfin.
Il prit alors la décision de ne pas bouger. C’est ce qui lui paraissait le plus approprié. S’il avait quelque chose au dos ou à la tête, c’était plus prudent. Il sentait, ou en tout cas c’était son impression, tous ses membres. Il ne pensait pas avoir perdu connaissance, ce qui était plutôt rassurant. À cause du choc, ou peut-être à cause du casque, tous les sons lui semblaient étouffés. Il avait le sentiment qu’une éternité était passée depuis sa chute quand il vit un visage au-dessus de lui.
« Monsieur, vous m’entendez ? Si vous m’entendez, serrez ma main ». Il s’exécuta. « Ne bougez pas, Monsieur, les pompiers arrivent ».
Fabien Muller
La sirène de l’ambulance hurlait pour s’ouvrir un passage dans les rues du Pradet. Ils avaient reçu l’appel du central, alors qu’ils revenaient d’une intervention bénigne qui n’aurait pas nécessité leur déplacement. Mais les pompiers répondaient toujours présents. Ils se rendaient maintenant sur un accident de la route.
Assis à l’arrière, Fabien était prêt. Il venait d’avoir vingt-quatre ans, et, le jour de son anniversaire, il avait reçu des mains du chef de caserne son diplôme de pompier-secouriste. Depuis qu’il était enfant, cela avait été son rêve.
Il faut dire que, dans sa famille, secourir les gens était une vocation. Ses parents avaient passé une grande partie de leur vie dans des œuvres missionnaires en Afrique. Sa mère était infirmière DE et son père technicien agronome. Deux ans après leur mariage, ils étaient partis dans le cadre de la coopération pour son service civil. Il trouvait cela plus intéressant que de jouer au petit soldat pendant onze mois. Cela avait été pour eux une révélation.
À la fin de ce temps, ils avaient rejoint une école de mission protestante et deux ans plus tard, ils étaient de retour en Afrique. Fabien était né là-bas et y avait vécu jusqu’à ses dix-sept ans. L’année de son bac, ses parents avaient décidé de rentrer pour s’occuper d’une paroisse dans l’arrière-pays varois et lui permettre de faire des études.
Il avait raté ce fameux sésame. Le choc culturel, pour l’Africain blanc qu’il était, avait été trop important. Il avait refusé de redoubler et avait décidé de prendre une année sabbatique. Ses parents n’avaient pas apprécié outre mesure, mais l’avaient laissé faire.
Fabien fit ensuite une école d’aide-soignant à La Garde et obtint son diplôme. Après une année dans le milieu hospitalier à pousser des brancards de service en service, il décida de quitter la sécurité de son poste en hôpital pour rentrer chez les pompiers. Aujourd’hui, il se sentait enfin à sa place et était particulièrement fier de son uniforme. Il vivait ce travail plus comme une vocation que comme un emploi.
Sa mère s’inquiétait parfois pour ce fils unique qui exerçait un métier si dangereux, et elle tremblait pour lui à chaque feu de forêt. Mais son mari et elle étaient particulièrement fiers que leur enfant ait choisi une activité au service de ses semblables.
En fait, il n’allait pas souvent au feu, car il était affecté à une ambulance et intervenait le plus souvent pour des urgences médicales.
Dès que le fourgon stoppa, il sauta à terre et commença à écarter les gens qui s’étaient massés sur les lieux. Son collègue se dirigea immédiatement vers le motard couché sur le trottoir. Quelqu’un l’avait mis en PLS et était en train de lui parler.
Une femme l’interpella et lui dit qu’un autre blessé avait besoin d’aide. Il la suivit jusqu’à un second attroupement à quelques mètres et ordonna avec autorité aux badauds de s’éloigner, car il avait du mal à accéder à la victime. Il dut bousculer les plus récalcitrants, outré du voyeurisme de ces gens. Il découvrit alors une jeune fille allongée sur le dos. Ses yeux étaient clos et un petit filet de sang coulait de son oreille, mais en dehors de ça, elle ne semblait pas avoir d’autre blessure. Il chercha la présence de signes vitaux, mais n’en trouva aucun. Immédiatement, il commença un massage cardiaque et une ventilation artificielle.
Le chauffeur de l’ambulance finit de disperser les gens qui s’étaient de nouveau approchés pour « voir » ce qui se passait. « Le SAMU est en route », dit-il.
La blessée ne semblait pas réagir et Fabien était au désespoir. Il n’avait encore perdu personne, même s’il savait que cela viendrait un jour ou l’autre. Mais pas maintenant, pas elle ! Elle est trop jeune se dit-il ! Il continuait avec acharnement son massage cardiaque alors que son collègue avait pris le relais de la ventilation. Il se surprit alors à prier, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années, depuis l’Afrique. Pas elle Seigneur, pas elle, c’est une enfant !
Il sentit soudain une présence à ses côtés. C’était le médecin du SAMU qui l’assistait. Après quelques instants, il déclara : « J’ai de nouveau un pouls, on l’évacue. »
« Bon boulot », dit-il à Fabien en repartant vers l’ambulance.
Fabien sentit des larmes remplir ses yeux. Il avait sauvé une vie. À moins que cela ne soit le résultat de sa prière ?
Thomas
Thomas n’arrivait pas à entrer dans le village tant la circulation était dense. Si c’est comme ça aujourd’hui, qu’est-ce que ce sera en pleine saison ? se dit-il. Le mieux à faire était de se garer et d’aller à pied jusqu’à la pizzeria pour récupérer sa sœur. Ensuite, il repartirait par une autre route sans passer par le centre-ville.
Il trouva à stationner sur une place de livraison et se hâta d’aller la chercher avant qu’on lui fasse déplacer la voiture. En arrivant devant le syndicat d’initiative, il vit un attroupement dû à un accident. Voilà pourquoi ça coinçait tant, pensa-t-il. Il avait pris la bonne décision en stationnant plus loin. Il devait retrouver sa Maëva et rentrer au plus vite ou les pizzas seraient froides.
Il traversa la rue pour rejoindre la pizzeria quand il vit le sac de sa sœur posé sur le capot d’une voiture en stationnement. Décidément, elle était championne ! Alors qu’il se saisissait du sac, un homme l’interpella violemment.
– Qu’est ce que tu crois faire là ?
– C’est le sac de ma sœur, je le reconnais !
– De ta sœur ? Tu en es sûr ?
– C’est moi qui le lui ai offert, et vous, de quoi vous mêlez-vous ?
– Elle est comment, ta frangine ?
Thomas commençait à s’énerver et il rentra dans la pizzeria où l’homme le suivit et le prit par le bras.
– Ce sac est à la victime de l’accident.
– Quoi ?
Il se rua à l’extérieur et, bousculant tout le monde, se précipita vers sa sœur que l’on venait de mettre sur un brancard. Il la reconnut immédiatement et rien ne semblait pouvoir l’arrêter jusqu’à ce qu’il se heurte à un pompier qui venait de se relever. Celui-ci lui bloquait l’accès à l’ambulance et Thomas comprit qu’il ne le laisserait pas passer. « C’est ma sœur, lui cria-t-il au visage, laissez-moi passer. » Le pompier le regarda fixement. C’était surprenant, on aurait dit qu’il avait pleuré. Soudain, l’angoisse serra la poitrine de Thomas. Si lui pleurait, c’est que Maëva était…
Il sentit ses jambes prêtes à se dérober sous lui et la nausée le submerger. Le secouriste lui dit :
– Elle est vivante, elle va s’en sortir. Comment t’appelles-tu ?
– Qu’est-ce qui s’est passé, laissez-moi la voir ?
– On l’amène à Sainte Musse à l’hôpital. Pour l’instant, tu ne pourras pas la voir. Essaie de te calmer et de me dire ton nom.
– Thomas, je m’appelle Thomas Rodin.
Il confia Thomas à un policier et sauta dans l’ambulance qui démarra au son de la sirène. Thomas était désemparé. Le gardien de la paix le conduisit jusqu’à un fourgon où il le fit asseoir. Il sortit un carnet à spirale et commença à lui poser des questions.
« Je dois appeler mes parents, lui répondit-il. Je dois appeler mes parents. »
Le policier lui dit qu’il le ferait plus tard, mais Thomas ne faisait que répéter la même chose. Thomas finit par se calmer et trouva le portable de Maëva dans son sac qu’il tenait encore dans ses bras.
Il appela à la maison et quand son père décrocha, il ne put dire que : « papa ». La voix se cassa et il se mit à sangloter dans le téléphone. Voyant qu’il ne retrouverait pas son calme de suite, le policier lui prit délicatement l’appareil des mains.
– Allô ! Monsieur, Police nationale, votre fille vient d’avoir un accident de la route. Je suis avec votre fils. Nous nous rendons aux urgences de Sainte Musse. Pourriez-vous nous y retrouver ? Les pompiers l’ont emmenée, je n’en sais pas plus… Non, votre fils n’a rien. Cela s’est passé au Pradet… Avec les médecins vous en saurez plus. Je prends votre fils avec moi, à tout de suite, oui.
Il raccrocha le téléphone et le rendit à Thomas qui avait cessé de pleurer.
« On va retrouver tes parents à l’hôpital lui dit-il. Ça va aller mon garçon, tu vas voir. Allons-y ».
Jeanne et Martin
Debout au milieu de la terrasse, Martin restait sans voix. Il n’arrivait pas à bouger. Il se tourna vers Jeanne qui venait de rentrer dans le salon. Elle était blême et il sut immédiatement qu’elle avait compris.
« On file aux urgences de Sainte Musse. Maëva a eu un accident de la route ». Il courut vers la table basse pour prendre ses clefs et allait sortir quand il réalisa que Jeanne n’avait pas bougé. Elle était comme tétanisée et ne réagissait pas, plantée là, debout au milieu du salon. Il s’approcha d’elle, la prit dans ses bras et lui dit doucement alors qu’elle commençait à sangloter : « Ça va aller, partons vite, Thomas nous attend là-bas ». Elle se ressaisit et attrapa son sac, sécha ses larmes et suivit son mari.
Dix minutes plus tard, ils étaient aux urgences de l’hôpital. Ils se renseignèrent au comptoir d’accueil, mais personne ne semblait au courant de l’arrivée de leur fille. Cet hôpital était flambant neuf, tout y était fonctionnel et performant. Les dernières technologies y avaient pris place… Mais les gens sont les gens et visiblement personne ne tenait compte de l’angoisse que pouvaient ressentir des parents en recherche d’informations sur leur fille blessée.
Après avoir attendu encore cinq minutes, Martin retourna au comptoir. La réceptionniste le regarda dans les yeux et lui dit : « Je vous ai dit que je n’en savais rien, et pas plus maintenant qu’il y a cinq minutes ».
Thomas, accompagné d’un policier entra à ce moment. Il n’avait, hélas, aucune réponse à leur donner. Il n’avait pas été témoin de l’accident. Il avait l’air désemparé et Martin préféra ne pas le noyer de questions inutiles. Sa mère le prit dans ses bras pour le réconforter.
Le gardien de la paix prit leurs identités qu’il nota dans son petit carnet, ainsi que leur adresse et téléphone. Il leur demanda de se présenter lundi matin au commissariat de Toulon. Martin le remercia de leur avoir ramené Thomas jusqu’à l’hôpital et vint s’asseoir auprès de sa femme et de son fils. C’est alors que Thomas aperçut le pompier qui s’était interposé sur le lieu de l’accident. Il se précipita vers lui, suivi de ses parents, pour avoir des nouvelles.
Fabien le reconnut tout de suite. Jeanne et Martin se présentèrent et le pressèrent de questions.
– Elle a été prise en charge il y a vingt minutes dans le service. À l’heure actuelle, elle doit être au bloc, leur dit-il.
– Mais comment va-t-elle ? demanda Jeanne.
– Je ne peux pas trop vous dire, elle était toujours inconsciente à notre arrivée. Elle souffre visiblement d’un traumatisme crânien. Le médecin du SAMU a prescrit un IRM immédiatement à notre arrivée et a fait réserver un bloc opératoire. Un neurochirurgien a aussi été appelé depuis l’ambulance. En dehors de ça, il semble qu’elle n’ait rien de cassé.
Martin expliqua que personne ne paraissait au courant de la situation à l’accueil et le jeune pompier alla voir la réceptionniste. Il lui parla quelques instants et elle hocha la tête en regardant les Rodin. Elle nota deux ou trois choses sur un calepin. Fabien revint vers eux et avant de prendre congé leur dit de faire enregistrer leurs coordonnées et d’inscrire Maëva à la réception. Ce serait plus facile de communiquer maintenant avec l’administration de l’hôpital. Il les salua et repartit vers l’entrée des urgences.
Martin retourna à l’accueil où il fit toutes les démarches d’admission pour Maëva. La réceptionniste s’était radoucie et elle lui sourit même avec un semblant de compassion. Elle lui proposa de s’asseoir et ajouta qu’elle le préviendrait si elle avait la moindre information.
Vers minuit, un médecin vint les voir. Il leur expliqua que Maëva était en salle de réveil suite à l’opération. Ils avaient résorbé un hématome intracrânien et Maëva ne souffrait d’aucune autre lésion importante. Ils pourraient la voir dès le lendemain en début d’après-midi. Ce soir, il n’y avait rien d’autre à faire que de rentrer et de prendre une nuit de sommeil. Il serait là encore demain toute la journée, car sa garde ne finissait que dimanche à vingt heures. Il les reverrait donc d’ici là.
Le jour suivant, après une nuit agitée pour tous, Martin alla de bonne heure récupérer la voiture et le bateau qui étaient restés au Pradet. Il ne put s’empêcher d’aller jusqu’au lieu de l’accident. La vie avait repris son cours. Les gens allaient et venaient, inconscients du drame qui s’était joué la veille, ou peut-être simplement oublieux. C’était impressionnant cette capacité qu’a le commun des mortels de passer si vite à autre chose.
Comment pouvait-il lui faire de même ? Sa fille était vivante, bien soignée, mais lui n’arriverait pas à passer à autre chose. Qu’était-il arrivé sur le passage piéton où Maëva avait été renversée ? Comment ? Qui ? Pourquoi ?
Il traversa jusqu’à la boulangerie et y acheta une baguette, plus pour poser des questions qu’autre chose ; mais la vendeuse n’avait rien vu de l’accident d’hier. Une cliente dit que c’était un scooter qui avait fauché une jeune fille, mais elle n’en savait pas plus. Cela ne mènerait à rien, se dit Martin et il rentra chez lui avec le bateau.
Vers treize heures, Jeanne et lui arrivèrent à l’hôpital. Ils demandèrent à l’accueil la chambre de leur fille. Après avoir pianoté sur son clavier, la réceptionniste leur dit que Maëva était toujours en réa. Il lui demanda où il pouvait voir le médecin qu’il avait vu la veille et elle passa un appel téléphonique pour prévenir celui-ci de leur arrivée.
Il arriva bientôt et les salua.
– Bonjour Docteur, comment va notre fille ?
– Son état est stable, répondit-il. Elle est en réanimation.
– Mais comment ça se fait ?
– Asseyez-vous, leur dit-il.
L’angoisse commença de nouveau à les saisir.
– Maëva ne s’est toujours pas réveillée. Elle va bien, mais elle ne reprend pas connaissance.
– Qu’est-ce que cela signifie, Docteur ? Pourquoi ne se réveille-t-elle pas ? demanda Jeanne au bord de l’affolement.
– Elle est dans le coma. Nous allons procéder à de nouveaux examens dans la journée et demain. Nous n’aurons pas de résultats avant l’après-midi. Le professeur Kaouri qui l’a opérée vous verra lundi à quinze heures, si c’est possible pour vous.
– Nous serons là, bien sûr. Merci Docteur.
Chapitre III
« Il y a un temps pour tout, un temps pour comprendre… »
Le Capitaine Bastogne
Le début du printemps avait amené de grosses chaleurs et l’air semblait irrespirable au Capitaine Bastogne, assis dans son bureau trop petit du commissariat de police de Toulon. Il essuyait sur son front les gouttes qui se faisaient la course jusque dans son col. À cinquante-deux ans, il avait eu une carrière, certes pas exemplaire, mais somme toute en accord avec sa philosophie de la vie. À l’inverse de son nom, celui de l’une des plus grandes batailles de la Libération en quarante-quatre, il avait toujours eu un caractère débonnaire. Cela lui avait permis de ne pas avoir à sortir son arme de service dont il n’avait jamais très bien su se servir de toute façon. Il faut dire que ce n’était pas la séance de tir annuelle que lui imposait la Police qui allait changer cela et son automatique ne quittait que rarement le tiroir de son bureau.
Aujourd’hui, il attendait une retraite qui lui semblait bien méritée, mais dans laquelle il n’arrivait pas à se projeter. Que pourrait-il bien faire de ses journées, seul ?
Une longue maladie avait fini par emporter sa femme un an plus tôt. Le terme de longue maladie l’avait surpris. C’est toujours trop rapide quand celle que vous aimez s’en va.
Il était passé à travers les quelques mois qu’avait duré le combat de sa femme contre le cancer comme si cela n’avait été qu’un instant. Il avait eu le sentiment qu’un jour elle était là, heureuse, aimante, vivante… et le lendemain, elle était partie à jamais. Il se reprochait de ne pas s’être assez battu, de ne pas lui avoir assez dit qu’il l’aimait. Il aurait dû passer plus de temps auprès d’elle dans cette chambre d’hôpital où il avait, lui aussi d’une certaine façon, fini ses jours au même rythme que son épouse.
Il aurait voulu mourir en même temps qu’elle, l’accompagner plus loin, faire encore un bout de chemin ensemble.
La longue maladie ; il avait le sentiment de la vivre aujourd’hui où le temps semblait se figer à chaque fois qu’il regardait sa montre. La longue maladie, c’était sa vie qui n’en finissait plus de s’écouler avec une lenteur désespérante. Et pourtant, la douleur depuis des mois s’était estompée. Seul demeurait l’ennui.
On frappa à la porte. C’était un gardien de la paix qui lui annonça que son rendez-vous de onze heures était arrivé. « Fais-le monter », lui dit Bastogne.
– Bonjour Monsieur, asseyez-vous s’il vous plaît. Je suis le capitaine Bastogne. Je suis chargé de cette affaire. Voudriez-vous un café ou un thé avant que nous ne commencions ?
– Merci, non, dit Martin. Je suis pressé de rejoindre mon épouse au chevet de notre fille. Et je n’ai pas grand-chose à vous dire en fait. Nous n’étions pas sur les lieux et nous ne savons pas ce qu’il s’est passé. Je ne peux pas vous aider.
– Je comprends, dit le Capitaine, je vais essayer de vous donner quelques informations telles que nous les avons reconstituées avec les témoignages recueillis juste après l’accident.
Votre fille a été renversée par un deux-roues sur le passage piéton. Un automobile a ralenti pour la laisser passer, c’est alors que le scooter l’a doublé et percutée votre enfant en pleine accélération pour finir sa course un peu plus loin. Le motard n’a pas été blessé, mais il a été conduit à l’hôpital pour y être examiné et surtout pour pratiquer une analyse sanguine.
Martin n’en revenait pas. Il n’avait pas réussi en allant sur place à définir les circonstances de l’accident. Mais maintenant qu’il les avait comprises, une colère sourde montait en lui.
– Mais c’est fou, sur le passage clouté, dans une zone à trente, mais qu’est-ce qui lui a pris à ce dingue ?
– Il semblerait, selon les premiers résultats de notre enquête, et d’après les analyses pratiquées à l’hôpital qu’il était alcoolisé, et que ce n’est pas la première fois. Il n’avait plus de permis et conduisait un scooter qui en nécessite un. C’est pourquoi il va être poursuivi. Vous devriez vous porter partie civile.