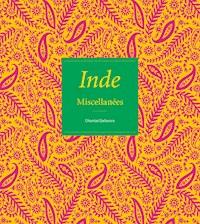Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Voici un livre qui ne se lit pas nécessairement du début à la fin, mais que l’on peut parcourir au hasard de ses deux cents petits textes, pour lever le voile sur une habitude, une croyance, un paysage, une mode, un objet, une personnalité, un art, une fête, une expression ou encore un proverbe, bref tout ce qui fait le quotidien et l’extraordinaire d’un pays : le Japon.
De courts textes qui étonnent et charment, mêlant le passé et le présent, l’intemporel et le très actuel, le visible et le caché, le signe et le sens, l’anecdote et le conte, la prouesse technologique et la poésie ancestrale…
Co-écrit par Chantal Deltenre et Maximilien Dauber, ce livre est pour les amoureux du Japon une façon d’être déjà là-bas sans encore avoir fait le voyage, de goûter son périple une fois sur place, et même de s’en souvenir avec émoi.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Romancière et ethnologue,
Chantal Deltenre est l’auteur de plusieurs romans et essais qui ont pour cadre sa région d’origine en Belgique ou les pays qu’elle a sillonnés : l’Égypte, la Roumanie ou encore le Japon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Romancière (Prix Rossel des Jeunes 2010), Chantal Deltenre a notamment publié La cérémonie des poupées qui se déroule au Japon. Également ethnologue, elle se consacre à l’éducation des jeunes à la diversité culturelle.
Cinéaste spécialisé dans le documentaire, Maximilien Dauber a réalisé de nombreux films sur l’Afrique, l’Égypte ou le Sahara, dont le récent portrait Théodore Monod, un destin nomade.
Japon. Miscellanées est un projet commun des deux auteurs, né de la plume de Chantal Deltenre et des images d’Un thé au Japon, le nouveau film de Maximilien Dauber.
Les astérisques renvoient aux sujets des textes ou aux principaux mots-clefs.
Nous avons pris le parti de garder l’accent circonflexe sur les mots japonais, de manière à indiquer les voyelles longues, et de ne pas accorder les pluriels de certains mots japonais importés, qui apparaissent dès lors en italiques.
Les illustrations des pages intérieures sont d’anciens sceaux de familles aristocratiques japonaises,
Il était une fois
Il était une fois un couple de dieux. On les appelle kami* au Japon. Elle avait pour nom Izanami et lui, Izanagi. En ce tempslà, raconte le Kojiki, la Chronique des choses anciennes, la terre était aussi vide et informe qu’une méduse au fond de l’océan.
Le couple de kami* décide de descendre du royaume céleste pour la peupler. Encore faut-il un coin de terre ferme. Ils plantent dans l’océan une lance qu’ils agitent en tous sens jusqu’à ce que les gouttes qui en retombent forment un chapelet d’îles. C’est ainsi, raconte la légende, que le Japon est né.
Tournant autour du pilier, Izanami et Izanagi tombent face à face. « Quel bel homme ! », s’exclame la déesse. Et les voilà unis. Hélas, comme elle a parlé la première, leur enfant, informe et gélatineux (il s’appelle Hiruko, « sangsue »), ne peut vivre et est abandonné aux flots.
Le couple reprend sa marche autour du pilier. Cette fois – un dieu averti en vaut deux ! – c’est Izanagi qui prend la parole : « Quelle belle femme ! ». Et leur premier enfant naît1 : c’est l’île d’Awaji.
Les deux kamis engendrent ainsi des centaines d’autres dieux qui peuplent petit à petit tout ce qui constitue la nature : les montagnes, les fleuves, les arbres, les pierres, etc.
Mais voilà qu’au moment d’accoucher du feu, la déesse, brûlée par ce rejeton dévastateur, perd la vie et se retire au royaume des morts.
Inconsolable, Izanagi part la chercher. Comme dans la légende d’Eurydice, le dieu nippon n’a pas le droit de se retourner sur sa belle avant de l’extraire du monde d’en-bas. Trop impatient, il n’y résiste pas et voyant sa chère épouse à demi décomposée et répandant une odeur putride, il prend aussitôt ses jambes à son cou.
Humiliée et furieuse, Izanami le poursuit et lui promet de se venger en tuant chaque jour au moins mille créations de son époux. Izanagi parvient à lui échapper en scellant d’une lourde pierre le royaume des morts et en lui lançant, juste avant la séparation définitive, qu’il créera tous les jours mille cinq cents nouvelles créatures, de manière à contrer sa malédiction. Le cycle de la vie et de la mort est né au royaume du Soleil-Levant.
Pour se purifier du contact avec la mort – chose encore indispensable au Japon d’aujourd’hui, comme on le note au moment des funérailles* –, Izanagi prend un bain primordial, ancêtre de tous les rites de purification.
De sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles et de ses plaies naissent des myriades de dieux dont le kami du soleil, la déesse mère du Japon, Amatérasu Ômikami, née de l’œil gauche d’Izanagi, ancêtre de la maison impériale.
Pour cette déesse au caractère bien trempé, il fallut rien moins qu’un strip-tease légendaire* pour la faire sortir de la grotte où elle s’était réfugiée après l’offense de son benêt de frère, le dieu du vent…
1. Nous ne ferons pas d’interprétation sexiste sur cette légende fondatrice de l’archipel…
Naissances
La septième nuit après la naissance d’un enfant est l’occasion d’une cérémonie familiale où le prénom* du nouveau-né est annoncé et calligraphié sur un bout de papier posé bien en évidence quelque part dans la maison.
Plus ou moins trente jours après sa naissance, l’enfant est porté au sanctuaire shintô* pour bénéficier de la protection des dieux. Parents et grands-parents sont présents. C’est traditionnellement la grand-mère paternelle qui porte l’enfant revêtu d’un mini-kimono, noir pour les garçons et coloré pour les filles.
Cette cérémonie qui n’est pas sans rappeler celle des baptêmes se déroule souvent à la chaîne car, comme pour les mariages*, les sanctuaires* sont pris d’assaut les jours dits « de chance »*. Il n’est pas rare de voir une dizaine de familles – et autant de bébés – être invités ensemble à se présenter devant le prêtre shintoïste.
Pendant la prière, le prêtre cite les noms des bébés, ceux des parents, les adresses des familles et les dates anniversaires des enfants. Les familles sont ensuite invitées une à une à déposer sur l’autel une offrande sous la forme d’un tamagushi (rien à voir avec les tamagotchi* qui ont inondé la planète il y a quelques années) : c’est une branche de sakaki, un arbre sacré japonais dont les feuilles sont éternellement vertes, entremêlée à des bandes de papier* de riz d’un blanc immaculé, soigneusement plié.
Le premier anniversaire sera pour le bambin le moment de la découverte des délicieux mochi, gâteaux de riz symboles d’abondance. Et les anniversaires n’en finiront plus jusqu’à l’année de la « renaissance », … celle de la soixantième année.
Poupées du 3 mars
La fête des poupées (hina matsuri) célèbre le 3 mars toutes les petites filles du Japon. C’est le pendant de la fête des carpes*, qui, tous les 5 mai, est dédiée aux petits garçons.
Au fil des jours qui précèdent le 3 mars, les petites filles exhument des cartons de délicates figurines représentant la Cour impériale de la période* de Heian (huitième – douzième siècle) qu’elles disposent sur de petites estrades. La coutume est très ancienne, et souvent aussi les poupées, transmises de génération en génération.
De la même façon que nous disposons nos santons, pas question de poser n’importe qui n’importe où :
Sur l’estrade la plus haute, on trouvera L’EMPEREUR ET L’IMPÉRATRICE,
juste en dessous, LES DAMES DE LA COUR,
plus bas, LES MUSICIENS,
et au ras des pâquerettes, LES DIVERS MINISTRES avec les petits gâteaux de riz gluant, les mochi, et de petites provisions de grains de riz soufflés sucrés.
Les poupées* disparaîtront aussi vite qu’elles sont apparues, le soir même du 3 mars, à défaut sinon de compromettre le mariage ultérieur des filles de la maison.
Écriture
Il y a trois systèmes d’écriture en Japonais : les kanji ou idéogrammes chinois et deux alphabets distincts, hiragana et katakana.
L’écriture japonaise a commencé avec les kanji, c’est-à-dire « lettres des Kan », nom donné par les Japonais à la dynastie Han chinoise. Ils sont utilisés dès le cinquième siècle. Jusque-là, la langue japonaise n’avait pas d’écriture.
Le kanbun, texte rédigé en chinois, a été la première écriture japonaise dès le cinquième siècle. Mais très vite, le kanbun s’est transformé au profit du manyôgana, qui consistait à utiliser des kanji non pas pour leur sens en chinois, mais pour leur valeur phonétique qui permettait de transcrire les sons de la langue japonaise.
En effet, les éminents linguistes de l’archipel s’étaient vite aperçus que quelque chose manquait : les kanji ne reflétaient pas les nuances de la langue. Aussi, ils se sont remis à l’ouvrage et ont inventé les deux systèmes syllabiques complémentaires, hiragana pour les éléments grammaticaux et katakana pour absorber les mots d’origine étrangère.
Dès le huitième siècle, les poétesses de la Cour de Heian (ancien nom de Kyôto) ont ensuite joué un rôle non négligeable dans la simplification des caractères manyôgana.
Pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure de l’apprentissage, il convient de faire preuve d’une infinie patience. Toutefois rien n’est perdu, et c’est plus facile aujourd’hui qu’hier. En effet, une personne cultivée connaissait plus de mille huit cents kanji avant-guerre. Elle se débrouille aujourd’hui avec huit cents.
Dès l’âge de sept ans, chaque écolier commence à inscrire les kanji dans les carreaux de grandes feuilles prévues à cet effet. Il convient de suivre attentivement les conseils du maître : ne pas déborder, toujours commencer par la gauche et respecter l’ordre des traits. Ici aussi, quelque chose se perd peu à peu : les pleins et les déliés des pages calligraphiées sont remplacés par les inscriptions anguleuses et standardisées des écrans.
Trois paysages d’exception
Il y a trois paysages considérés comme les plus beaux de l’archipel.
D’abord Ama-no-hashidate, le « pont du ciel », une longue dune serpentine de plus de trois kilomètres, couverte de sept mille pins et qui relie les deux bords opposés de la baie de Miyazu, au nord de la préfecture de Kyôto. Si l’on se baisse, dos à la dune, et qu’on la cherche des yeux en regardant entre ses jambes, on a l’impression qu’elle monte au ciel…
Ensuite l’île d’Itsukushima, aussi appelée Miyajima, dans la mer intérieure de Seto. C’est une île sacrée selon la croyance shintoïste. Elle foisonne de sanctuaires cachés dans son épaisse forêt d’érables. Il est interdit d’abattre un arbre sur cette île, et aussi d’y naître ou d’y mourir. Elle est plantée dans l’imaginaire du monde, cette île, grâce au torii* flottant de son principal sanctuaire.
Le troisième est Matsushima, littéralement « l’île pin », au nord-est de Sendai. Quand le moine-poète Bashô y est arrivé il y a trois cents ans, qu’il a vu cette baie sauvage et ses îlots épars sur le miroir de la mer, il a été saisi. Lui est alors venu ce haïku* :
Matsushima ah !
A-ah, Matsushima, ah !
Matsushima, ah !
Shintô
Le shintô ou kami-no-michi (la « voie des dieux ») est la religion primitive japonaise. Selon la mythologie, ce sont les dieux shintô (kami) qui ont créé les îles du Japon.
Le shintô comprend une myriade de divinités présentes partout dans la nature : les montagnes, les rivières, les arbres, les sources et les rochers. Le mont Fuji, par exemple, laisse chaque printemps s’échapper de son cratère la déesse-qui-faits’épanouir-les-fleurs. Les deux rochers liés d’une corde dans la baie d’Ise sont deux époux. Entre eux se lève le soleil. Le shintô exprime bien la croyance japonaise selon laquelle la nature est douée d’une âme.
Les origines du shintô sont aussi mystérieuses que les débuts de la civilisation japonaise. La Chronique des choses anciennes le présente, dès le huitième siècle, comme un ensemble de légendes sur l’origine divine des îles qui forment le Japon et de l’empereur, descendant du premier souverain, Jimmu-Tennô dont l’ancêtre est la déesse du soleil, Amatérasu Ômikami.
Le panthéon shintoïste contient huit cent millions de dieux, pratiquement tous des personnifications de la nature.
Les cultes les plus répandus du shintô sont ceux des dieux du vent, du feu, des épidémies et de la nourriture.
Le shintô est sans dogme ni théologie, fondé sur la croyance que la nature humaine est bonne et que l’au-delà n’est qu’un sommeil. Il réclame essentiellement des prières et de régulières purifications de l’âme et du corps par des ablutions, des abstinences diverses et parfois des pratiques d’exorcisme.
Les Japonais suivent aussi bien les rites du shintô ancestral que ceux du bouddhisme*, importé de Chine au sixième siècle.
Jours de fête
Le Japon se classe parmi les pays qui comptent le plus de jours de fête.
1er janvier : Jour de l’an
2e lundi de janvier : jour de l’accession à la majorité (20 ans)
11 février : anniversaire de la fondation du Japon
20 ou 21 mars : équinoxe de printemps
29 avril : anniversaire de l’empereur
3 mai : commémoration de la Constitution
4 mai : Fête de la nature
5 mai : Fête des enfants
3e lundi de juillet : Fête de la mer
3e lundi de septembre : Fête des personnes âgées
22 ou 23 septembre : équinoxe d’automne
2e lundi d’octobre : Fête des sports
3 novembre : Jour de la culture
23 novembre : Fête du travail
À cela s’ajoutent la golden week en mai (pont entre la date anniversaire de l’empereur et la fête du 5 mai) et la récente silver week en octobre.
École
N’y voir aucune farce ni brimade : la rentrée des classes a lieu au Japon le 1er avril, jour de hanami*, la fête des cerisiers en fleurs. Les enfants, en uniforme à partir du collège, se réunissent dans la cour de récréation pour écouter le discours de bienvenue du directeur.
L’uniforme est de couleur noire, avec une coupe assez militaire, pour les garçons ; ensemble bleu marine avec jupe plissée, pour les filles.
Des délégués de classe sont nommés dès le début de l’année. Ils seront notamment chargés d’organiser des fêtes culturelles (concerts, représentations de théâtre, etc.) ou des rencontres sportives.
Vu la fréquence des séismes* dans l’archipel, tous les écoliers sont entraînés dès leur plus jeune âge à réagir dans le plus grand calme aux secousses sismiques. Ils ont tous à portée de la main un casque pour se protéger en cas de danger.
Le déjeuner est souvent pris dans la classe. Les élèves apportent leur bentô* ou un plat est servi par un élève désigné.
L’année scolaire se termine fin mars et donne lieu à de multiples cérémonies de remises de dipômes. Ces rites de passage restent très marqués au Japon. Ainsi les élèves de sixième année à l’école primaire, de troisième année de collège et de troisième année de lycée reçoivent leur diplôme des mains du proviseur lors d’une cérémonie où sont conviés les parents.
Appelé naishinsho, le dossier scolaire de l’élève renseigne non seulement sur ses résultats, mais aussi sur ses activités sportives et culturelles et bien sûr sur sa conduite. Il est déterminant pour les entrées dans les écoles supérieures privées ou les prestigieuses universités, comme la célèbre Tôdai, abréviation de Tôkyô Daigaku, université de Tôkyô.
Le stress pour intégrer ces filières va de pair, dès le lycée, avec des cours privés parfois si lourds que les bacheliers sont nombreux à « péter un câble », comme les jeunes disent chez nous…
Origami
L’art du papier plié n’a rien à voir, du moins à ses débuts, avec le jeu des cocottes en papier tel que nous le connaissons.
Il consiste à décorer les autels des sanctuaires* shintô* avec des bandes de papier blanc délicatement coupées et pliées. Symbole de beauté et de pureté, ces bandelettes sont des offrandes aux dieux, les kami*.
L’origami a commencé à devenir un divertissement, d’abord pour les enfants, puis pour les adultes, après 1945, quand le maître Akira Yoshizawa a inventé des milliers de figures nouvelles.
Le principe du papier plié est simple : il faut réaliser un objet, un animal ou un masque avec une seule feuille de papier carrée, uniquement en la pliant avec les mains, sans colle ni ciseaux.
Les figures débutent toujours de la même manière, par une des quelque dix « bases » (« base oiseau », « base fleur », « base poisson », etc.) à partir desquelles on peut fabriquer une infinité de sujets.
La beauté de cet art est là : faire naître en quelques minutes à partir de ses mains et grâce à un matériau simple, un objet stylisé et parfait.
On trouve facilement au Japon des assortiments de feuilles de papier multicolores, spéciales pour l’origami. Minces, résistantes, elles gardent bien le pli.
Rien de tel pour exercer sa patience, son goût pour le travail minutieux et soigné, et son imagination.
Carpes du 5 mai
Le 5 mai, cinquième jour du cinquième mois, on célèbre la Fête des garçons. On l’appelle fête de tango. Et les bambins reçoivent traditionnellement ce jour-là une carpe en tissu et une figurine de guerrier.
Jadis elle célébrait les fils de samouraïs. Une fête initiatique où les descendants des preux guerriers ayant atteint l’âge de cinq ans recevaient leur premier sabre de bois, signe de leur adhésion aux valeurs féodales.
On leur racontait alors la légende d’une carpe qui, par son courage et sa ténacité, parvient à remonter le fort courant d’un fleuve. Parvenue au bout de sa course, elle se transforme en dragon. Morale de l’histoire : l’obstination a toujours sa juste récompense.
La carpe reste le principal symbole de cette fête et l’on voit ce jour-là chaque famille hisser sur un mât planté dans le jardin ou sur le balcon des bannières de carpes en papier (koi-nobori) d’un nombre égal à celui des membres de la famille. Chacune a sa couleur : en tête, la carpe du père, toute noire ou bleu nuit, puis l’exemplaire maternel, de couleur rouge, et enfin, dans un ordre décroissant, les carpes des enfants. Et chacune, sorte de manche à air, flotte au vent, rappelant la persévérance de la carpe légendaire.
Les petites filles ont elles aussi leur journée, célébrée le 3 mars, jour de la Fête des poupées*.
À noter enfin que la Fête des garçons coïncidait jadis avec celle des iris et que l’on suspendait alors aux avant-toits des maisons des couronnes d’herbes médicinales où étaient entremêlées feuilles et fleurs d’iris et d’armoise.
Lointain écho de cette tradition, il existe un saké aromatisé à l’iris que les enfants ont le droit de goûter, ce jour-là seulement.
Jours avec et jours sans
Pour la moindre décision, les Japonais tiennent compte des jours du calendrier. Celui-ci n’indique pas seulement les jours, mais il est divisé en cycles récurrents de six jours qui correspondent à des jours plus ou moins favorables. La symbolique des chiffres* y est pour quelque chose, mais pas seulement.
Les jours dits taian (grande sécurité) sont les meilleurs, ceux à choisir en priorité pour prendre une grande, voire même une petite décision, de la création d’une entreprise à l’achat d’un billet de loterie, en passant par le mariage.
Les jours dits tomokiki ou senshô sont de bons jours aussi, quoiqu’un peu moins auspicieux que les premiers.
Quant aux jours désignés comme senpu, chakko ou butsumetsu, ils sont à éviter. Surtout ne pas partir en voyage ces jourslà, encore moins pratiquer une activité à risque.
Voilà qui n’est pas sans effet sur l’existence. Ainsi les sanctuaires sont surchargés tous les jours dits taian (qui ne reviennent donc qu’une fois tous les six jours) et il faut réserver longtemps à l’avance pour se marier sous un bon augure.
Il faut aussi savoir qu’une croyance shintô dit qu’un homme ou une femme passe nécessairement par une année de malheur dite yaku-doshi.
C’est pourquoi les Japonais sont attentifs à conjurer ce sort en se rendant au sanctuaire lors de leurs vingt-cinquième, quarante-deuxième et soixante et unième années pour les hommes, dix-neuvième, trente-troisième et trente-septième années pour les femmes.
Nous n’avons pas réussi à savoir pourquoi et comment ces années-là avaient été désignées pour contrer une hypothétique année funeste.
Gens du dehors, gens du dedans
Le mot gaijin désigne les étrangers sans distinction. Littéralement, les « personnes hors du pays ». C’est l’abréviation du mot gaikokujin (littéralement, « personne de l’extérieur ») qui, à l’origine, était péjoratif, signe de ce puissant sentiment de l’île*, qui ménage une séparation étanche entre le dehors, désigné par le terme soto, que l’on oppose toujours à uchi, le dedans. Soto, c’est en quelque sorte tous ceux qui n’appartiennent pas au groupe dont on fait partie. Tels sont les gaijin.
Les premiers Européens à débarquer au Japon, navigateurs portugais du seizième siècle, étaient connus sous le nom de Nanbanjin, peuples barbares du Sud.
Le Japon ne s’étant vraiment ouvert que sous l’ère Meiji, à la fin du dix-neuvième siècle, peu d’étrangers y résidaient. Ils étaient perçus comme des curiosités.
Les termes gaijin ou hakujin sont généralement réservés aux Occidentaux, alors que gaikoku-jin englobe toutes les personnes qui ne seraient pas japonaises de souche, Chinois et Coréens notamment.
La plupart des Japonais utilisent aujourd’hui ce mot sans intention péjorative. Étrangement, ce sont les étrangers qui se sentent stigmatisés, voire offensés par ce terme. Il se décline sous différentes formes : gaijin san, gaijin sama ou gaikoku-jin (le même -jin utilisé pour les nationalités). Quel que soit son usage, ce terme continue de laisser planer ce soupçon que toute personne non-japonaise est en quelque sorte intruse.
Dans les grandes villes, les étrangers passent désormais quasi inaperçus. Mais c’est loin d’être le cas partout dans le pays.
Le Japon compte plus de deux millions d’étrangers vivant sur son sol. Ils viennent essentiellement de la Corée et de la Chine, du Pérou, du Brésil, des Philippines et des États-Unis.
Détail piquant : un enfant issu d’un couple mixte, né au Japon et possédant la nationalité japonaise, est désigné par le mot halfu (du terme anglais half, moitié), c’est-à-dire considéré comme à moitié japonais.
Principales villes
Les principales villes du Japon classées en ordre décroissant d’habitants sont :
Tôkyô : 12,7 millions2
Yokohama : 3,6 millions
Ôsaka : 2,6 millions
Nagoya : 2,2 millions
Sapporo : 1,9 million
Kôbé : 1,5 million
Kyôto : 1,5 million
Fukuoka : 1,4 million
Kawasaki : 1,3 million
Saitama : 1,2 million
Hiroshima : 1,1 million
Sendai : 1 million
L’agglomération de Tôkyô, englobant entre autres Yokohama, Kawasaki, Chiba et Saitama, est, avec plus de trente-trois millions d’habitants, la plus peuplée du monde (chiffres de 2005).
2. Tôkyô : 12,7 millions pour la préfecture, dont 8,3 millions pour les vingt-trois arrondissements spéciaux.
Aïnous
En langue aïnoue, aïnou veut dire : homme. On ne peut rêver plus simple… Les Aïnous sont les plus anciens habitants de l’archipel. C’est un peuple originaire d’Asie centrale qui s’installa dans l’île la plus septentrionale, Hokkaidô, bien avant que les éléments plus divers qui composent aujourd’hui le peuple japonais viennent s’y établir.
Chasseurs et pêcheurs, les Aïnous sont rapidement perçus par les autres Japonais avec une répulsion non dissimulée, prétendument due à leur importante pilosité et à leur faible penchant pour l’hygiène de base.
Ces clichés ont vite fait de nourrir le rejet de ce peuple désigné comme barbare, rustre, en un mot primitif.
Les Aïnous s’accrochent tant bien que mal à leur territoire, gardant jusqu’à l’époque de Nara la Grande Île au nord de la transversale Sendai-Niigata.
Mais les fines stratégies militaires des guerriers nippons ont tôt fait de les renvoyer de plus en plus vers le nord. Au dix-septième siècle, les forts japonais sont bien implantés dans tout le sud de Hokkaidô.
À l’instar des Peaux-Rouges chassés de leurs territoires, les Aïnous se contentent de dernières terres et voient peu à peu leur langue (véritable casse-tête des linguistes) et leur culture s’étioler.
Sous l’ère Meiji (1868 – 1912), leur situation empire et le peuple aïnou se voit définitivement relégué aux oubliettes de l’histoire d’un Japon de plus en plus conquérant.
De nos jours, il revendique avec force son identité, gardant la plus vive possible la flamme d’une culture essentiellement orale, qui s’exprime au cours de fêtes et de cérémonies liées au culte de l’ours et organisées dans ses rares villages recomposés.
Des musées locaux exposent cette culture, qui exprime en dialectes complexes de longs poèmes épiques et dans sa richesse artisanale les talents des « hommes poilus » comme les désignaient, non sans ironie et sarcasmes, les « autres » Japonais.
On ne résiste pas à citer ici, une fois encore, l’ethnologue Claude Lévi-Strauss, à propos de tous les peuples dont le monde a eu raison :
« Pauvre gibier pris au piège de la civilisation mécanique… Tendres et impuissantes victimes, je peux me résigner à comprendre le destin qui vous anéantit, mais non point être dupe de cette sorcellerie plus chétive que la vôtre, qui brandit devant des publics avides des albums en Kodachrome remplaçant vos masques détruits ».
Matsuri à ne pas rater
Les matsuri sont des fêtes* populaires organisées à l’occasion de célébrations religieuses shintô*. Des hommes, vêtus de sousvêtements traditionnels (assez élémentaires, il faut le dire, car ils laissent les fesses – rien de moins – à l’air !), portent en processions dansantes, dans les rues des villes ou sur les chemins de campagne, des mikoshi, autels portatifs consacrés aux divinités locales ou aux dieux et déesses shintô, en particulier Amatérasu*, la déesse-mère du soleil.
Il arrive que ces processions soient vraiment sportives comme lorsqu’il s’agit de gravir une montagne pour accéder au sanctuaire.
Se fondre dans la foule d’un matsuri est une expérience à ne rater sous aucun prétexte au fil d’un voyage au Japon. De même les feux d’artifice qui les clôturent.
Il existe des listes de matsuri dans les syndicats d’initiative de toutes les villes. Certains, où défilent des chars spectaculaires ou des personnages en costumes d’époque, attirent des voyageurs de tout l’archipel.
Voici quelques matsuri parmi les plus beaux :
Sannô matsuri : Takayama (avril)
Gion matsuri : Kyôto (juillet)
Danjiri matsuri : Kishiwada (septembre)
Kuruma-no-hi matsuri : Kuruma (octobre)
Kanamara matsuri : Kawasaki (avril)
Jidai matsuri : Kyôto (octobre)
Règles de politesse
Au Japon, les règles, degrés et nuances de la politesse se déclinent à l’infini. À commencer par le langage. Le simple fait d’accoler le préfixe o- ou go- à un nom commun, exprime le respect. Certains mots en sont devenus indissociables : o-kane (l’argent), o-mizu (l’eau), o-tearai (toilettes), o-tcha (thé). De même, ajouter le suffixe –san à un nom ou à un statut signale une déférence particulière. À utiliser avec prudence : ainsi on dira obâ pour parler à sa grand-mère, mais obâsan pour évoquer la grand-mère de quelqu’un d’autre.
Quant au savoir-vivre, voici cinq règles choisies au hasard parmi toutes celles à respecter :
Se déchausser avant d’entrer chez quelqu’un, mais aussi dans un
ryokan
(hôtel traditionnel), une cabine d’essayage, certains monuments ou restaurants, les toilettes parfois (des chaussons sont alors fournis). Attention : toujours poser ses chaussures côte à côte et les pointes vers la porte de manière à pouvoir les chausser facilement en sortant.
Ne jamais offrir à un Japonais un thé préparé la veille car, à l’époque féodale, on avait coutume de servir ce thé aux criminels sur le lieu d’exécution.
Ne jamais passer un aliment de baguette à baguette car c’est ainsi que les parents se repassent les débris d’os qu’on retire du four crématoire pour les placer dans une urne funéraire.
Éviter de serrer la main. Cet usage est encore peu répandu au Japon. Le salut japonais correct est fait les pieds joints, le haut du corps incliné à 45° environ et les mains à plat sur les cuisses, coudes au corps.
Devant une porte de toilettes fermée, deux coups légers peuvent n’être suivis d’aucun effet. Ou bien il y aura en retour un « toc-toc » intérieur signifiant que ce n’est pas la peine d’insister. En aucun cas, personne ne répondra « Occupé ! ».
Hello Kitty et Maneki-neko
Célèbre dans toute la planète, la petite chatte blanche à ruban rouge Kitty-chan (Hello Kitty ! Bonjour petit chat…) est née en 1974 dans un bureau de design de la société japonaise Sanrio, spécialiste des personnages mignons (kawai en japonais) reconnaissables à leurs grands yeux, leur nez mutin et leur petite bouche. Sauf Hello Kitty, bizarrement créée sans bouche.
La petite Kitty est le plus gros succès de la société. On la retrouve sur des milliers d’articles vendus partout dans le monde : vêtements, accessoires de mode, appareils électroniques et électroménagers, objets décoratifs d’intérieur, etc. Malgré son nom anglais tout droit sorti de De l’autre côté du miroir (Kitty est le nom d’un des chats gardés par Alice dans le roman de Lewis Carroll), la petite chatte s’inspire d’un personnage bien japonais : Maneki-neko, le chat porte-bonheur qui agite sa patte droite ou sa patte gauche à l’entrée des boutiques et restaurants.
Maneki-neko (littéralement, « le chat qui invite à venir avec sa patte ») est censé apporter la prospérité au commerce qu’il garde. Selon la croyance la plus répandue, celui qui lève la patte gauche attire les clients, et celui qui agite la droite apporte la fortune. Pour ce qui est d’Hello Kitty, elle a fait d’une pierre deux coups !
Kami
Il existe dans le shintô – croyance animiste oblige ! – une myriade de divinités vénérées sous des noms et des formes multiples. Toutes portent le nom de kami, les dieux shintô, tels qu’ils furent créés par le couple céleste primordial que formaient Izanagi et sa compagne Izanami.
Ainsi, en milieu rural, on trouvera les dieux des montagnes (yama no kami), de la rizière (ta no kami), de l’eau (suijin), du feu (hi no kami), des frontières (sai no kami) et dans les localités en bord de mer, les divinités de la mer (kaijin).
Tous ces dieux, par essence, n’ont pas de formes propres, mais ils peuvent s’incarner dans toutes sortes d’êtres, en particulier des animaux. C’est pourquoi la symbolique* des animaux est si riche au Japon. Le dieu de la montagne prendra tour à tour la forme d’un singe, d’une biche ou d’un sanglier. Le dieu de l’eau se manifestera sous la forme d’un serpent et celui de la mer sous celle d’un dragon.
Mais les dieux se manifestent aussi dans les pierres ou les arbres, si bien qu’il n’est pas rare, en se promenant en montagne, de voir au bord du chemin une pierre ornée d’une corde de chanvre tressée ou bien à l’orée d’une forêt, un petit autel orné de papiers* blancs découpés et où l’on a déposé quelques offrandes de fruits.
Il arrive souvent que les figures divines se superposent. Elles sont alors vénérées sous le nom d’une divinité reliée au bouddhisme*, culte importé de Chine et de Corée.
Certains dieux peuvent être sollicités à plusieurs titres. Ainsi le dieu Inari, particulièrement polymorphe, peut recevoir des dévotions en tant que dieu de la montagne, de la mer, de la rizière ou de la nourriture.
Dans les milieux urbains, on trouve surtout le culte des dieux de la prospérité et du bonheur* (fukujin) qui peuvent prendre tous les noms : Inari, Daikoku, Ebisu, etc.