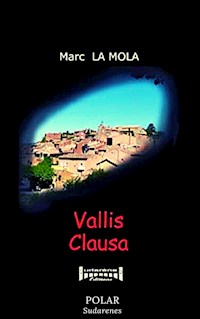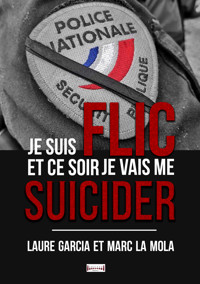
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sudarènes Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Chaque année ce sont soixante policiers qui mettent fin à leurs jours dans la quasi-indifférence du ministère de l’intérieur. Les maux qui ont contaminé la police sont nombreux et les raisons de ces s...uicides sont multifactorielles et difficiles à identifier. Peu de choses ont été mises en place par l’administration de tutelle et par les divers organismes impliqués. En effet rien ne semble prouver une quelconque efficacité. Marc La Mola a été flic durant plus de vingt années, lui-même a failli retourner son arme contre lui, de sa rencontre avec Laure GARCIA, flic en activité, ancienne syndicaliste et ancienne vice présidente nationale d’une association liée au ministère de l’Intérieur, est né cet ouvrage. Un livre puissant, un témoignage empreint de vérité et une mise au point sur le rôle parfois opaque d’une structure bénéficiant d’argent public. Ensemble ils nous livrent leur analyse en pointant les tenants et les aboutissants de ce qui peut conduire chaque flic à se mettre une balle dans la tête sans que sa famille ni son administration de tutelle ne comprennent pourquoi. Ils démontrent que les causes de cette litanie sont au- delà des seules conditions d’exercice de la fonction policière, ils mettent le doigt là où personne n’a encore osé le mettre en désignant les politiques du chiffre, le commandement et le management mais aussi les ambitions démesurées de quelques hiérarques aux dents longues et acérées pour lesquels la vie de ces flics semble ne pas compter. Mais les auteurs ne se contentent pas de dénoncer, ils apportent également leurs visions de ce que devrait être une vraie police républicaine et donnent leurs solutions pour tenter d’enrayer ce fléau au sein des effectifs de police. Les auteurs souhaitent que ce livre puisse aider les nombreux policiers en souffrance psychologique et qu’il éveille les consciences endormies
À PROPOS DES AUTEUR.RICE.S
"Vingt sept années à trainer dans des commissariats miteux et dans des voitures de patrouille déglinguées, je suis fatigué ...
En 2013 je rends mon arme et ma brème et me reconverti dans l'écriture. J'ai tant de choses à raconter." Marc La Mola
Laure Garcia est née le 06 Juin 1977 à l’Union (31). Dès l’âge de vingt ans elle intègre la police nationale et débute sa carrière en école de police dans les quartiers Nord de Marseille. Ensuite elle rejoint le commissariat de Saint-Denis (93) situé en zone difficile. C’est au cours de sa carrière qu’elle apprend le fonctionnement de l’institution policière et ses différentes affectations lui permettent de peaufiner son expérience de terrain. Toujours en prise directe avec la société et ses maux elle comprend qu’elle peut mettre sa passion pour les mots dans des textes qui deviendront des livres
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JE SUIS FLIC ET CE SOIR JE VAIS ME SUICIDER
MARC LA MOLA ET
LAURE GARCIA
À tous ces flics ayant décidé de partir trop tôt.
« Le suicide, mais c’est la force de ceux qui n’en ont plus. C’est l’espoir de ceux qui ne croient plus.
C’est le sublime courage des vaincus. » Guy de Maupassant
PREMIÈRE PARTIE LITANIE
Prologue
Lundi 24 janvier 2022, 16 h 38.
Seul chez moi je fais défiler le fil d’actualité de ce réseau social sur lequel je traîne trop, sur lequel j’erre depuis bien trop longtemps. Mon index est actif et je ne m’attarde pas sur les inepties qui défilent à la vitesse grand V. Je divague autant que mon esprit sur cette liste stupide d’informations personnelles sans aucun intérêt. À travers ma fenêtre un rayon de soleil réchauffe mes cuisses, pas un bruit n’émane de cette résidence du centre-ville de Marseille. Rien ni personne ne perturbe mon calme et ce silence se faisant lourd. Un tel a publié les photos de ses enfants, l’autre se lamente dans un texte trop long pour être lu alors qu’un troisième conteste la valeur du pass sanitaire en tentant de rallier à sa cause toute une bande de complotistes décérébrés.
Une liste d’idioties à laquelle je contribue, une liste de bêtises que j’alimente en la critiquant et me faisant la promesse de ne plus y retourner. Pourtant j’y suis encore et mon index redouble d’activité pour stopper brutalement sur une annonce d’une association policière. Une association qui pollue ma page depuis longtemps et que je m’étais encore promis de bloquer pour ne plus lire les lamentations de ces flics désabusés.
Flic je ne le suis plus depuis neuf années maintenant et celle qui fut ma seconde famille s’est éloignée lentement pour disparaître de mes souvenirs. Ne laissant que les bons pour occulter les mauvais. Pourtant, je reste flic, et si je souhaitais effacer mon passé je n’y parviendrais pas même en utilisant les pires détergents, les plus efficaces poudres à récurer. Non je le sais, flic je resterai…
Le texte publié par cette association m’interpelle, il me frappe le visage comme un lourd coup de poing qui viendrait écraser mon nez laissant s’échapper un ruisseau de sang rouge. Je lis, je relis mais je ne parviens pas à comprendre les informations que le texte diffuse. Il est court, à peine quelques lignes mais pourtant sa lecture m’épuise et me donne énormément de mal pour parvenir à la fin de ce maigre laïus.
Mon index a cessé de faire défiler le fil d’actualités, il est encore tendu vers le plafond comme si j’adressais à je ne sais qui un vulgaire doigt d’honneur, comme si j’étais en colère et que je souhaitais insulter cet interlocuteur imaginaire. Je suis seul face à cette information et mon doigt ne bouge toujours pas, seuls mes yeux se meuvent quelque peu pour peut être éviter de laisser couler abondamment des larmes. Je suis las de lire cela, je suis épuisé par cette litanie que personne ne semble vouloir enrayer, que l’administration policière feins d’ignorer et qu’une hiérarchie stupide provoque en se délestant de sa propre responsabilité.
Je ne me souviens plus de son prénom mais peu importe. Il pourrait s’appeler Julien ou elle pourrait porter le joli prénom de Maguy. Ce dont je me souviens c’est qu’il n’avait pas trente ans. Hier soir, après son service, il est rentré chez lui. Il était seul, esseulé et en tête-à-tête avec cette saleté d’arme, cette saleté de SIG-Sauer dont le chargeur était empli de quinze cartouches…
Le reste je l’ai imaginé et pour me donner le courage de l’écrire je l’ai hurlé en silence dans ma tête. Mes mots sont venus frapper mes os pariétaux comme pour s’en échapper, comme pour rompre une barrière osseuse obstruant leur liberté. Ces mots sont des mots simples et sans doute Julien ou Maguy les ont répétés avant de placer le canon froid de leur arme dans leur bouche.
Moi, pour ne pas les dire, j’ai préféré les écrire en pensant à lui, à elle et même en imaginant le projectile s’extraire de l’étui, passer dans le canon pour occasionner des dégâts irréversibles dans la jeune tête puis aller faire éclater le sommet du crâne en libérant sang et os émiettés sur un mur blanc immaculé. J’ai même pu entendre, à force de me concentrer, les bruits sordides de la déflagration et ceux de cette matière organique percée par une ogive de plomb de neuf millimètres.
Je ne sais pas encore pourquoi mais j’ai eu besoin d’imaginer cela pour pouvoir tirer un trait sur ce jeune visage que je n’avais d’ailleurs jamais croisé. J’ai eu envie de contempler cette scène affreuse et cette douleur libérée de ce jeune homme, de cette jeune femme à peine sorti de l’enfance. Par vocation, tous deux étaient devenus policiers. J’ai imaginé le corps sans vie devenu lourd s’écrouler au sol dans un mélange de craquements secs et furtifs. J’ai vu le sang couler et se répandre sur le carrelage froid, j’ai vu le cadavre là sous mes yeux.
Il était en ce début d’année le neuvième policier à se suicider dans l’indifférence d’une administration centrale égoïste et incapable de réagir.
J’ai continué à imaginer la suite et cette sonnerie stridente brisant le silence d’une petite chaumière bourgeoise égarée dans une banlieue de la deuxième ville de France. J’ai imaginé la maman accourir pour s’emparer du téléphone, elle était essoufflée et a posé ses gants et son sécateur sur la commode de la salle à manger pour prendre l’appel. J’ai imaginé ses yeux, j’ai entendu ses cris.
Par la suite, j’ai vu les simagrées des hiérarques et la mine de circonstance adoptée pour accompagner le mince cercueil vers un cimetière minuscule. J’ai entendu les clairons et les honneurs donnés ne parvenant pas à couvrir les hurlements d’une maman et d’un papa dévastés. J’ai imaginé les autres, les policiers qui n’ont rien compris de ce qu’il s’était déroulé, ceux qui n’ont rien perçu se tramer. En tendant l’oreille je les ai entendus dire qu’il était gentil et que jamais il ne se plaignait, j’ai même ouï-dire, par un vieux flic endimanché, qu’il avait des projets.
Parmi la foule réunie certains baissent les yeux pour ne pas croiser le regard de la famille, pour cacher leur honte d’avoir poussé cet homme à presser la détente. Qui sont-ils ceux-là, quel rôle ont-ils joué dans ce drame ?
Je m’interroge et pourtant je les connais et je sais ce qu’ils ont fait et, surtout, ce qu’ils n’ont pas fait. Mais eux le savent aussi. Et comme si je me tenais face à eux ils baisseraient les yeux pour ne pas voir ma haine et ma colère, pour ne pas être jugé par quelqu’un qui sait et quelqu’un qui veut dénoncer leurs excès. Alors, virtuellement, je me suis avancé vers eux et j’ai fendu la foule pour aller les rencontrer et pour qu’enfin leurs yeux croisent les miens. Je vais leur demander de s’expliquer, je vais même leur imposer de me supplier de ne pas donner leurs noms et de définir, pour démontrer au grand public, chacune de leurs responsabilités.
Mais la difficulté est que tous ne sont pas humain. Les responsables de la mort de ce policier sont parfois des regards dédaigneux, des ordres ridicules, une pression terrible, un management abominable et inhumain et, surtout, une politique des ressources humaines affreusement cruelle, voire barbare.
Tous ceux-là ont posé leur doigt sur la détente et ont largement contribué à libérer le chien allant frapper le culot de cette maudite cartouche de neuf millimètres. Tous ceux-là opèrent au quotidien pour pousser plus de quarante policiers chaque année à mettre fin à leurs jours sans que quiconque ne s’en émeuve et que ces drames ne parviennent à ébranler les piédestaux sur lesquels ils sont toutes et tous installés.
Moi, ces socles, je vais les ébranler.
ML
Prologue 2
Nous sommes lundi, je stationne mon véhicule dans cette grande rue qui mène au commissariat, à mon commissariat. Comme chaque matin, je vais retrouver mes collègues et croiser tous ceux qui fourmillent dans ce bâtiment que j’affectionne tant. Au loin, j’aperçois le drapeau tricolore, planté au sommet, il flotte au vent léger et rappelle qu’ici est érigée une bâtisse représentant notre pays, nos institutions, nos valeurs. J’ai toujours été fière de porter l’uniforme, d’avoir sur ma poitrine, côté cœur, ce petit bout de tissu bleu blanc rouge que j’arbore en gonflant mes poumons. Du plus loin que je me souvienne, être policier était une vocation mais aujourd’hui cette certitude s’est un peu effritée, comme ternie au fil des années, au fil des journées écoulées, que ce soit sur les sièges miteux des véhicules de police secours ou bien entre les murs ternes et délabrés d’un bureau de brigade de sûreté urbaine. Je survis et je tente d’y croire encore, de croire encore en ce métier et à ce que je peux apporter. Je m’accroche à un idéal qui n’est déjà peut-être plus.
Je sonne et fais un signe de la main, la lourde porte vitrée se débloque, la collègue se tenant derrière le comptoir me sourit et m’ouvre. Même les jours où je ne me sens pas bien, j’aime me retrouver ici, je me sens chez moi, c’est ma deuxième maison comme on dit entre nous mais cela fait bien longtemps que les choses ont changé, je le sais, je le ressens.
Je monte les quelques marches qui me conduisent à mon bureau, cela fait déjà 24 ans cette année que je suis rentrée dans cette famille, pas une journée je n’ai eu à regretter mon choix, mais j’avoue que depuis quelque temps je me sens lasse et je commence déjà à envisager un départ anticipé à la retraite. Je me sens fatiguée, plus psychologiquement que physiquement, je me sens tout simplement fatiguée.
Mon bureau est déjà bruyant, c’est l’heure du rituel du café. J’arrive toujours au moment où la cafetière a déjà délivré son nectar aux quelques collègues présents, le temps de déposer ma petite dernière à l’école maternelle, je prends le train en marche.
Ce matin, je ressens une drôle d’ambiance. Le visage de ma collègue me semble grave. Parmi les voix qui parlent de leur week-end écoulé, de leur repas dominical et de leur film de la veille, elle, elle me regarde et me dit d’une voix émue :
– « Tu as vu ce matin ? La Police Secours s’est déplacée au domicile d’un collègue qui s’est suicidé avec son arme de service. Un collègue de 22 ans, c’est le neuvième depuis le début de l’année ! »
L’annonce me glace le sang et un frisson parcourt ma colonne vertébrale, ça ne cessera donc jamais ! 22 ans ! Je n’ose imaginer, c’est trop jeune, bien trop jeune. Un sentiment de colère et de tristesse se germe en moi, j’ai envie de hurler. Je regarde mes collègues, ils n’ont pas l’air surpris, j’ai même l’impression qu’ils ne s’intéressent pas vraiment à cette annonce. C’est certain, nous ne le connaissions pas, mais pour moi c’est un des nôtres qui vient encore de tomber. Peu importe son nom, c’est un de plus qui vient de faire le choix de nous quitter de la manière la plus dramatique qu’il soit. Les mots me manquent, car il y a encore deux ans, j’ai été impliquée dans cette tentative de lutte contre ce fléau, contre ce malaise policier et chaque fois qu’une telle annonce voit le jour, c’est une part de moi qui s’enfonce un peu plus dans la nuit tant j’ai un sentiment d’échec, un goût amer dans la bouche. Pourtant j’ai essayé d’apporter des solutions, de tenter de poser une pierre à un édifice déjà bien construit, déjà bien en place depuis plus de 70 ans, mais les méandres de l’administration policière sont difficiles à contourner.
Je ne connais pas celui qui vient de faire ce choix ni les raisons qui l’ont poussé à le faire. Peut-être qu’elles sont d’ailleurs éloignées du monde de la police, mais peu importe, le fait que ce soit un des nôtres me ramène à tous ceux qui nous ont déjà quittés. Je ne le connaissais pas et pourtant il faisait partie de ma famille, celle de la maison police en qui je crois encore mais qui porte de moins en moins le nom de « famille ».
Durant prés de dix ans, j’ai été au cœur de cette problématique, j’ai tenté de porter des projets pour trouver des solutions mais sans y parvenir. J’ai eu des fonctions au sein d’une association reconnue d’utilité publique qui se bat contre le suicide, contre le burn out de mes collègues, qui tente d’apporter un soutien et une réponse à leur mal être, mais parfois, même souvent, nous nous sommes trouvés face à des murs infranchissables, des fossés incontournables et j’ai baissé les bras. Je n’ai plus eu la force de continuer ce combat, alors j’ai laissé mon bâton de pèlerin à d’autres, plus neufs, d’autres qui n’étaient pas encore abîmés par un sentiment de désespoir, d’impuissance. J’ai échoué et ce neuvième suicide me le prouve encore.
Je me prépare un café et je fixe longuement le nectar couler dans ma tasse. Je pense à ce jeune flic et j’avale ma salive pour ne pas hurler. La tasse est pleine, un jour elle va déborder.
LG
NEUF
Il est trois heures et je ne dors pas. Je viens de quitter mon lit en délaissant celle que j’aime, celle qui dort chaque nuit à mes côtés et que je regarde partir chaque matin en ne sachant pas si je la reverrais. Elle aussi est flic.
Elle est ce que la vie m’a donné de mieux, elle est aussi bien meilleure que moi et pourtant je sais ces difficultés rencontrées, je connais les tensions quotidiennes qu’elle doit administrer. Je fais mine de le gérer pour ne pas l’inquiéter, pour ne pas ajouter à son stress une autre pression qu’elle aurait du mal à anticiper.
Parfois j’imagine que je pourrais la perdre, qu’un rien pourrait me l’enlever et je suis pris d’un sentiment étrange fait de panique et de résignation. Je connais son métier et ses difficultés, je sais ses impératifs et j’ai même vu, plutôt aperçu, son pistolet posé sur sa hanche. Ce jour-là j’ai nié cet objet, cet instrument que je ne veux plus jamais porter, plus jamais posséder. Les armes, je les hais et pourtant j’ai fréquemment utilisé la mienne.
Mais il est trois heures et je ne dors pas, mon sommeil a été interrompu par l’annonce du décès brutal d’un jeune policier. Je ne saurais dire pourquoi, mais il me semble le connaître, il me semble l’avoir côtoyé même si j’ai, depuis de longues années, quitté le commissariat où il exerçait.
À cette époque il n’était pas policier, moi je traînais mes guêtres dans ces couloirs et dans ces bureaux bruyants sans savoir que neuf années plus tard un jeune homme aurait mis fin à ses jours après y avoir passé une seule journée.
Neuf années depuis que j’ai démissionné et ce matin ils sont neuf à avoir démissionné de la vie, sans avoir déposé leur rapport, leur carte barrée de tricolore mais en conservant leur pistolet encore quelques minutes avant de le laisser tomber sur le sol de leur appartement. Je ne parviens pas à comprendre comment un métier peut causer de tels dégâts et comment de si jeunes personnes peuvent en arriver à cette idée et, surtout parvenir à passer à l’acte. Je ne peux pas le comprendre, je ne peux surtout pas m’y résigner. Je ne veux pas m’y habituer.
Il avait vingt-deux ans, il était le neuvième à en finir. La plupart d’entre eux étaient jeunes, bien jeunes. Trop jeunes !
Je ne peux sortir de ma tête les images horribles de ces corps mutilés, de ces âmes meurtries et de ces familles anéanties. Mais pourquoi ne quittent-ils pas cette satanée police plutôt que de lui offrir leur vie, plutôt que de se mettre un pruneau dans la tête ? Pourquoi n’ont-ils pas ce courage et cette faculté de raisonner pour ne pas commettre le pire… ?
Ce matin, enfin cette nuit, ces questions me hantent. Elles m’obsèdent et j’ai encore du mal à ranger mes idées, à raisonner de manière cohérente pour parvenir à comprendre ce mécanisme. Je veux savoir pourquoi ils se sont tués !
Ce matin il me semble que le compte à rebours est commencé et que la grande horloge du temps va donner le tempo pour égrener les suicides de policiers. Le 25 janvier ils ont été neuf, il reste encore onze mois pour arriver à la fin de l’année et je fais un calcul simple qui m’amène au chiffre de 120 si le rythme est maintenu. Je compte sur mes doigts, je les regarde comme pour m’assurer que dix fois douze donne ce résultat, je préfère arrêter de compter.
Ce n’est pas un hommage que je souhaite rendre, ce n’est pas non plus une complainte inutile que je veux chanter. Ce que je veux c’est comprendre et aller au plus profond des cœurs des policiers pour les mettre en garde des risques de ce métier et leur dire que souvent, bien souvent, l’ennemi est à l’intérieur et qu’il est capable de les dévaster sans sourciller. Ce que je souhaite c’est avant tout comprendre le mécanisme intellectuel au travers des turpitudes de cette institution et lui faire prendre conscience qu’elle est – elle seule – le criminel pressant la queue de détente des armes qu’elle a elle-même confiées. Car c’est bien elle, cette personne morale, qui est à l’origine de l’hécatombe. C’est bien elle la responsable de tous nos morts.
Alors je sais que je vais me heurter au mutisme et à la puissance terrible d’une institution entière, d’un ministère impotent et d’une opinion publique parfois réfractaire à cette problématique pour ne pas la voir et ne pas en être contaminé. Après tout ce ne sont que des flics, diront certains sans voir qu’il s’agit avant tout de jeunes gens ayant donné leur vie à ce métier ingrat pour sauver une société malade de l’individualisme.
Mais ce combat, je vais le mener pour celle dont la respiration reste linéaire et apaisée. Dans quelques heures elle va quitter notre couche pour mettre l’uniforme et moi je patienterai là en espérant la retrouver. Mais ce combat, je dois le mener aussi pour ma propre liberté, ma
liberté intellectuelle et cette liberté que j’ai pu retrouver en démissionnant avant de commettre à mon tour aussi l’irréparable. Mes armes ne sont que des mots, ils peuvent paraître dérisoires, mais je n’ai que cela pour réveiller les consciences endormies sous des litres d’anesthésiants dans un bloc opératoire à la lumière blafarde. Un bloc où l’on n’opère pas mais où les médecins légistes découpent les corps des pauvres flics suicidés pour déterminer la trajectoire d’un projectile ou la prise de médicaments ayant précédé l’ultime phase. Mais avant tout pour couvrir une administration de sa responsabilité.
Une fois encore, je vois les scalpels et le sang couler, je vois les visages fermés et les organes placés sous scellés.
Il était policier, il n’est plus qu’un corps vidé de son contenu pour que des analyses soient effectuées et que l’on puisse enfin déclarer que sa mort n’a aucun lien avec son métier, qu’il traversait une période personnelle compliquée et que… etc. Que je hais cette maudite phrase !
Il est quatre heures et je n’ai toujours pas sommeil. Je viens d’écrire pour me soulager mais cela ne m’a pas apaisé. Je vais m’étendre à ses côtés en espérant que je retrouverais la paix. Je suis fatigué…
ML
JE N’AVAIS QUE 20 ANS
Je prends place derrière mon écran d’ordinateur, le bureau a retrouvé son calme. Nous ne sommes plus que trois et chacun pianote sur son clavier, le bruit régulier des touches enfoncées plus ou moins fort brise le silence qui s’est installé. Est-ce que mes deux collègues de bureau pensent la même chose que moi ? Ont-ils eux-mêmes des souvenirs qui leur reviennent, des images qui s’étaient terrées dans un coin de leur mémoire et qui attendaient bien sagement le moment de réapparaître ? Des images sordides, noires et dures, des images que chaque policier a en lui mais qu’il tente d’oublier, qu’il tente de masquer jusqu’au jour où… jusqu’au moment où… Et moi, à cet instant, j’ai une image qui me revient comme un boomerang, un visage qui se plante devant mes yeux et qui rend trouble ma vue, je ne peux plus travailler, je pense à lui…
William, il avait à peu près le même âge que celui qui vient de se suicider il y a quelques heures, il était jeune comme je l’étais moi-même à cette époque-là…
Saint-Denis, début des années 2000, le 9-3 comme disent les adolescents. Je venais de terminer mon école de Police à Marseille, douze mois de scolarité à profiter du soleil, logée, nourrie, presque blanchie par cette nouvelle mère qui venait de m’adopter en son sein. Douze mois à nous façonner, à nous modeler mais certainement pas à nous préparer à ce qui nous attendait. Douze mois bien assise au chaud devant un bureau d’écolier, face à un tableau blanc velleda que le formateur généraliste s’appliquait à noircir à grands coups d’articles du code de procédure pénale ou d’extrait de notre code de déontologie. Des mots et des phrases entières apprises par cœur pour des évaluations nécessaires à l’établissement d’un classement final, et qui, malgré ma position honorable, ne m’a permis qu’à éviter d’être plante verte devant le bâtiment du ministère de l’Intérieur.
J’avais donc choisi Saint-Denis car c’était la seule ville du 93 que je connaissais, la coupe du monde de football de 1998 que j’avais suivie cette année-là m’avait permis de la situer géographiquement sur le plan que l’on nous avait gracieusement distribué avant notre entrée dans l’amphithéâtre au moment du choix des postes.
J’avais donc quitté mes parents, la douce chaleur de mon foyer, mes trois frères et ma petite sœur. J’avais déserté ma chambre d’étudiante et je me retrouvais comme chacun des collègues de ma promotion dans une banlieue que je ne connaissais pas, que je n’avais même pas imaginée tant elle m’était étrangère, tant elle me semblait irréelle, comme venue d’une autre dimension. La douceur de ma campagne toulousaine me semblait si lointaine.
Je me retrouvais dans un 25 mètres carrés Porte de Clignancourt dans le XVIIIe arrondissement de Paris, prés de Saint-Ouen, le marché aux puces sur ma droite et le vacarme du périphérique sur ma gauche. Au sixième étage sans ascenseur, je n’avais pas trouvé mieux. À cette époque l’administration nous octroyait quinze jours pour trouver un logement avant de prendre nos fonctions dans notre première affectation… 15 jours pour ne pas se sentir
perdue, esseulée, à la rue. Certains n’ayant rien trouvé dormaient dans leur véhicule, ou bien passaient leurs premiers salaires dans des chambres d’hôtels miteux. Nous étions tous égarés, nous étions démunis, ceux qui avaient eu la chance de se voir proposer un appartement par la Préfecture de Police représentaient à peine dix pour cent des nouveaux affectés. Les autres, comme moi, c’était au petit bonheur la chance.
Mes six premiers mois, je les ai commencés en Police Secours à saint Denis, ce qui équivaut, j’en suis certaine, à deux ans en province. J’ai tout vu, j’ai tout enduré, à ce moment-là, j’encaisse, je me blinde comme on dit. On grandit vite, très vite et on apprend aussi très vite.
Six mois se sont écoulés ainsi. J’avais oublié les techniques de Gestes Techniques de Police en Intervention (GTPI) apprises sur le tatami de l’école, je ne gardai en tête que la parade croisillon parce qu’elle m’a toujours fait rire et qu’elle me fait rire encore aujourd’hui. Cette technique consiste à croiser ses bras en avant bien haut pour parer un coup de couteau venant de haut en bas. Je ne l’ai jamais mise en application, et je sais que si le cas devait se présenter ce n’est pas cette chorégraphie que je choisirais pour faire face à la situation. J’avais plutôt appris les techniques de terrain moins académiques mais bien plus efficaces à mon goût.
Au bout de six mois, je quittais la police secours pour intégrer un nouveau groupe qui allait voir le jour. Avec la création de la Police Urbaine de Proximité, c’était la tendance politique du moment, on voulait voir du bleu dans les quartiers dits difficiles, le groupe des Francs-Moisins, naissait.
Nous étions un petit groupe, tous jeunes, nous étions tous encore dans la vingtaine avec notre fougue et nos idéaux. Rien ne nous décourageait, même pas le fait
d’être jeté au milieu de la Cité des Francs-Moisins, quartier de cette ville de Saint-Denis dans le 93, sans véhicule, à pied, à peine équipés d’un casque bien souvent trop grand et d’un gilet pare-balles à dotation collective bien trop lourd pour nos épaules tout juste sorties de l’adolescence. Nous passions nos journées à déambuler dans cette citée comme des spectres, à longer les bâtiments lugubres et tagués de phrases agressives truffées de fautes d’orthographe, pour la plupart à notre intention, et à guetter les hauteurs pour éviter les divers objets qu’on nous envoyait des étages. Tout y passait, on en plaisantait parfois en hurlant « sauce tomate s’il vous plaît » à l’intention de ceux qui, terrés dans leur appartement, nous visaient avec tout ce qu’ils trouvaient, de la boite de conserve au four micro-ondes. C’était notre quotidien, mais on aimait ça. On se sentait fort et investis d’une mission, celle de reconquérir ce quartier qui était devenu le nôtre, on se l’était approprié. Pauvres fous que nous étions, tellement idéalistes et crédules en une mère qui nous lâchait ici avec pour seule arme notre jeunesse et notre naïveté.
Au bout de quelques mois, je n’étais déjà plus stagiaire, mais titulaire, ce qui confère un statut d’ancien dans ces commissariats qui voient défiler des générations entières de flics. Cela faisait donc un an que j’arpentais les rues sales et tristes de Saint-Denis où la misère humaine s’étalait au grand jour sans que cela ne me surprenne plus, j’y étais désormais habituée, la tendance s’était inversée. Tant et si bien que lorsque je revenais en province, dans mon foyer familial, je trouvais que le décalage était là-bas et non dans cette banlieue parisienne, deux mondes s’affrontaient à distances, mais je n’aurais jamais cru que ces mondes-là ne seraient un jour devenus qu’un et ce n’est pas celui de mon enfance qui a survécu. La gangrène de l’un avait gagné l’autre, un des deux mondes avait presque disparu, il s’était laissé étouffer.
William… Il faisait partie de ce nouveau groupe créé, nous n’étions qu’une dizaine, sous les ordres de notre Major, un golgoth, une armoire à glace, des mains immenses et fermes, un modèle pour nous tous.
Ce soir-là, le Major n’était pas présent, j’étais celle qui prenait les décisions en son absence. Nous venions d’avoir une journée normale. Nous avions parcouru de long en large la cité, nous avions essuyé quelques jets de projectiles, comme d’habitude, et dérangé quelques points de deals en jouant au chat et à la souris. Il nous restait une paire d’heure avant la fin de notre vacation, nous étions rentrés au service avec un interpellé, une mise à disposition, comme chaque jour. William m’a alors demandé un départ avancé. Je savais qu’il traversait une mauvaise période, il était en pleine séparation et cela le minait. Il n’était pas jovial ce jour-là, lui de nature si enthousiaste, il n’avait pas participé comme à son habitude à nos histoires drôles, et même le fait de rentrer avec un interpellé et de faire une belle affaire ne lui avait pas rendu son sourire. Je l’ai laissé partir en lui demandant de prendre soin de lui et de se reposer, je ne savais pas que c’était la dernière fois que je posais ma main sur son épaule. Je l’ai fait quelques jours plus tard, mais elle était devenue froide, pour toujours.
Je me souviendrai longtemps de cet appel. je rentrais chez moi, en voiture. C’était le début des téléphones portables, la fonction bluetooth n’existait pas, j’avais décroché et mis la conversation sur haut parleur, c’était mon Major. « William s’est tiré une balle, il y a moins d’une heure… » Je ne sais plus si c’est mon cri d’horreur qui a envahi l’habitacle, ou bien si c’est mon sanglot et mes paroles haletantes qui ont poussé à ce que la conversation soit coupée, mais je suis restée longtemps sur le bas-côté de la route. Dans le noir, les mains tremblantes, les yeux dans le vide. Incompréhensible, Inexplicable, je n’avais pas de mots assez forts, il n’existe d’ailleurs aucun mot assez fort pour exprimer ce que l’on ressent à cet instant.C’était la première fois que j’étais confrontée à ce mot « suicide » .William, sportif, n’ayant jamais bu une seule goutte d’alcool, s’était laissé tomber, il avait abandonné. Après avoir quitté le commissariat et nos yeux rieurs, après nous avoir laissé dans notre bureau de cinq mètres carrés au fond de ce bâtiment du 15 rue Jean Mermoz, cet édifice aux pierres rouges, vieillissant, lugubre, aux barreaux de fer tordus par le poids du plancher de béton du premier étage, après nous avoir fait un signe de la main, il s’était engouffré dans son véhicule, il avait fait des tours de périphérique, intérieur puis extérieur, avant de se résoudre à rentrer chez lui.
Là, attendant celle qu’il avait aimée mais qui maintenant le quittait, il avait vidé une bouteille entière de whisky, un liquide de 40 degrés d’alcool qui coulait dans ses veines, qui empoisonnait son sang et qui allait le conduire à presser la détente de son arme de service et à envoyer l’ogive brûlante sur sa tempe..
Il n’était plus, en une fraction de seconde, il n’était plus.
Alors aujourd’hui je pense à lui et son visage me revient en mémoire. Qu’aurais-je pu faire de plus ?
Ai-je manqué quelque chose ? Son visage est désormais dans ma mémoire, indélébile. J’ai oublié certains visages de mes collègues de cette époque, et parfois même leurs prénoms, mais William, lui, sera toujours là, comme si je l’avais quitté la veille.
Encore aujourd’hui je pense à lui, et je me pose toujours les mêmes questions, j’ai toujours les mêmes remords. Des questions que doivent très certainement se poser aujourd’hui les collègues de ce jeune de 22 ans venant lui aussi d’abandonner, venant lui aussi de nous quitter.
Adieu William…
LG
AU DÉBUT
Rien ne semblait pouvoir faire vaciller ces jeunes fonctionnaires de police. Dès leur entrée en école pour y recevoir leur formation initiale on les a vus pétillants et heureux d’intégrer l’institution. La plupart sont issus des couches populaires de notre société et bon nombre d’entre eux sont des enfants de policiers. Deux milieux dans lesquels jadis on ne se donnait pas la mort ou rarement car dans cette couche sociale, comme dans cette corporation, on vivait les pieds dans la merde et lorsque les effluves pestilentielles remontent jusqu’à vos narines on est souvent plus solide. Mais cela aussi semble avoir changé et la strate intermédiaire ayant quasiment disparu pour laisser la place à une catégorie de gens au faible pouvoir d’achat a vu se greffer à elle ceux qui auparavant vivaient plutôt bien. Dans la police, c’est un peu ce qu’il s’est passé aussi puisque à l’époque où cette corporation était reconnue, appréciée et surtout dirigée par de vrais flics on ne comptait pas autant de morts volontaires en ses rangs. La tendance est aujourd’hui tout autre.
Alors ces jeunes recrues ont-elles été les spectateurs de la lente paupérisation du métier et ont-elles assisté passivement à la diminution des motivations de leurs aînés, de leurs propres parents policiers ? Pourtant ce sont bien eux qui les ont motivés, pour peut-être éviter une situation économique compliquée, à embrasser une carrière qu’eux-mêmes souhaitaient quitter au plus vite. Mais peu importe puisque le constat est sans appel : elles seront une quarantaine chaque année à tomber sous leur propre balle !
Pourtant, au début de ma carrière dans la police, j’étais fringuant et motivé. L’immense tâche qui se présentait à moi ne m’effrayait pas et je me sentais armé pour l’affronter. Nous étions jeunes et larges d’épaule, comme le chante Bernard Lavilliers, nous étions jeunes et pleins d’idéaux surtout mais avec en plus de cela une étincelle au fond des yeux qui allait nous permettre de partir loin de chez nous pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Je savais que ce métier n’était pas simple et que mon parcours allait être jalonné d’obstacles sur lesquels j’allais trébucher. J’avais quelques pistes pour les éviter.
Au début, donc, j’étais fort et plein de motivations, j’étais surtout jeune et con, suffisamment con pour penser que je pouvais inverser une tendance, que mon action au sein de cette police pouvait contribuer à rendre le pays moins difficile, moins exposé à une vague de criminalité grandissante. Je me sentais capable d’aller au charbon avec le peu d’armes que mon administration de tutelle daignait mettre à ma disposition.
Pas ou peu de volonté politique courageuse, pas ou très peu de moyens matériels et techniques, des locaux insalubres et des véhicules hors d’âge stationnés devant mon commissariat menaçant parfois ruine : voilà ce dont je disposais pour affronter les délinquants sur-armés et sur-déterminés. Et pourtant j’y allais, nous y allions la fleur au fusil et nantis de cette certitude que notre mission était indispensable mais aussi qu’en cas de dérapages nous serions soutenus par notre hiérarchie et une justice pas encore faible et pas encore aveugle pour voir la bien triste réalité de sa propre chute dans les abysses de la misère.
Bref, nous étions motivés et moi le premier puisque animé par une vocation réelle pouvant paraître à ce jour dérisoire et même grotesque. Grotesque… Ce qui est grotesque c’est la mort récente de ce jeune collègue, ce décès que je ne parviens pas à extraire de mon crâne, ce départ qui m’a empêché de dormir cette nuit.
Nous étions plus flics que fonctionnaires de police et je donnais de mon temps et de mon intégrité physique sans que cela ne présente, à mes yeux comme à ceux des autres, une idée saugrenue ou une aberration. C’était normal de s’impliquer autant et même en délaissant mes propres enfants. J’étais flic et cela était important pour moi, parfois plus important que ma vie personnelle, familiale et sentimentale.
Je n’avais pourtant pas signé un quelconque contrat d’engagement, mais je me sentais engagé comme peuvent l’être les hommes de religion, ceux qui intègrent un monastère pour servir un Dieu dont on ignore encore son existence. Moi, de Dieu, je n’en avais qu’un, il s’appelait POLICE. Je le vénérais chaque jour et auquel je donnais tout ce que je pouvais lui offrir. Mais au-delà de la vénération que je pouvais éprouver il me semblait que j’appartenais à une famille, une autre famille que celle de mon sang. Ses membres étaient nombreux, plus de cent mille dans le pays, entre nous nous reconnaissions sans aucune difficulté et nous pouvions compter les uns sur les autres. J’étais fier d’être flic et rien ne pouvait m’empêcher de le clamer lors de repas improvisés durant lesquels j’allais me confronter à des gens hostiles et ignorants du fonctionnement de mon métier. Ma fonction, je la défendais bec et ongles, mes prises de décision je les assumais et ce putain de métier j’aurais pu devenir agressif pour l’expliquer. En d’autres termes je l’aimais et il faisait de moi un citoyen responsable et engagé.
Alors, pour éviter ces confrontations je passais le plus clair de mon temps avec d’autres policiers, ainsi les repas étaient moins agités et nul besoin de se disputer pour devenir pédagogue. C’est durant ces rencontres que je me sentais le mieux, nous étions tous flics et nous nous comprenions sans même nous parler, comme dans un vieux couple un seul regard même furtif suffisait.
Puis les années se sont écoulées. J’ai mûri, j’ai changé aussi mais c’est elle qui a le plus changé c’est bien elle, cette maîtresse que j’ai tant aimée : la police !
À coup de politiques inadaptées j’ai constaté, lentement mais sûrement, que la police vendait son âme au diable, à un diable devenu incontournable et qui la faisait ressembler de plus en plus à la société.
Je l’avais connue différente, j’avais rencontré une police à part, à part des autres, bien éloignée du reste de la société. En fait nous les policiers appartenions à une sorte de société parallèle, à une espèce de monde fait uniquement pour et par les flics et personne d’autre ne pouvaient y pénétrer. On y parlait le même langage, on y avait les mêmes visions de la société et nos aspirations pour elle comme pour nous étaient similaires. Le reste du monde ne pouvait pas nous comprendre, car nous évoluions dans un espace où le cynisme, le second degré et le pragmatisme régnaient en maîtres et régentaient les règles de vie. Nous nous moquions de tout et surtout du lendemain que l’on savait incertain pour être au quotidien plantés dans la réalité d’une violence et d’une misère omniprésentes.
Nous étions flics tout simplement et j’aimais tellement cela !
ML
PENSÉE NAPOLÉONIENNE
Il y a quelques jours je me suis rendue au Musée d’Orsay à Paris, et là, parmi les statues de marbre blanc au regard figé, je me suis attardée sur l’une d’entre elles. Pourtant elle n’était pas de marbre, elle détonnait et elle ne pouvait laisser personne indifférent. Je l’ai immédiatement reconnue au beau milieu de cette immense gare devenue un refuge pour des œuvres intemporelles. Il était dressé là, son code civil bien en évidence posé sur sa main droite tandis que sa main gauche tenait une lance semblant représenter la justice. Il portait une couronne de lauriers savamment déposée sur sa tête, représentant selon la mythologie grecque la sagesse et la gloire. Il regardait devant lui, avec assurance et conviction, vers un horizon imaginaire mais qui paraissait si clair à ses yeux, si évident à l’époque, une autre époque bien lointaine aujourd’hui. Napoléon Bonaparte, il était ainsi représenté avec le Code Civil où était mentionnée l’année 1804, mais on aurait également pû le représenter avec le Code Pénal qu’il rédigea six ans plus tard, en 1810. Devant cette statue de glaise plus que de marbre, à la couleur orangée tranchant avec la blancheur de ses voisines, je me suis égarée quelques minutes dans mes pensées… je me suis mise à réfléchir sur cette représentation de la justice si droite et juste.
Durant mon parcours professionnel, j’ai essuyé quelques déceptions à ce sujet. En effet, il est bien frustrant d’interpeller pour la dixième fois le même individu pour les mêmes faits (définition de la récidive il me semble…) et de le voir gambader à l’air libre, se pavanant sous les fenêtres sales de notre commissariat, quelques minutes après avoir été conduit dans nos locaux tandis que je n’avais même pas terminer de rédiger mon procès verbal. Comble du mépris, le petit malfrat en devenir le savait pertinemment et ne manquait de me le rappeler à chaque fois que le scénario se répétait, un petit sourire narquois au coin des lèvres. Mais je persévérais, espérant toujours une réponse pénale qui ne venait jamais. J’ai même vu certain signer leur énième rappel à la loi après avoir eu trente infractions listées sous leur identité… Un rappel à la loi au bout de trente infractions similaires !
Devant cette statue de Napoléon, je réfléchis : comment un policier peut garder sa motivation après avoir vécu la même expérience ? Comment peut-il croire en son métier lorsque lui-même est montré du doigt dès le premier fait ? Lorsqu’il est jeté en pâture devant une foule avide criant vengeance et punition à la moindre suspicion ? Faisant fi de la fameuse « présomption d’innocence » qui ne semble pas s’appliquer aux fonctionnaires de Police qui passent immédiatement par la case coupable, voire prison. Comment garder sa motivation lorsque des collègues sont ainsi jugés non pas devant des faits établis, entérinés par une décision de justice, mais dès le moindre doute, dès le premier soupçon, dès la première image détournée, tronquée, qui tournera en boucle sur les chaînes d’information continue et les réseaux sociaux.
Alors face à cette statue, je réfléchis. La justice doit prendre ses responsabilités mais pas pour sanctionner un seul côté de cette guerre non déclarée et pourtant omniprésente. Non, elle doit être équitable et si elle condamne aveuglement et dès le premier soupçon un policier supposé avoir fauté, de peur de déplaire à cette société en dérive, alors elle se doit également de condamner lorsque des faits sont réellement établis envers des petits délinquants qui nuisent plus que de raison au quotidien de nos concitoyens.
La police va mal, c’est un fait, et ce sentiment de mal être est également présent du fait que les policiers ne croient plus en leur justice. À quoi bon faire respecter des lois lorsque la sanction semble n’être prise qu’à l’encontre de ceux qui les défendent ?
Je regarde Napoléon et surtout son regard, il semble si sûr de lui ! Mais avait-il imaginé que l’on ferait ce constat deux siècles après lui ? Lui qui avait créé le ministère de la Police et le Préfet de Police de Paris ?
Je me retourne et regarde sur ma droite l’immense horloge qui trône au-dessus de l’entrée principale de ce musée. J’aurais aimé remonter le temps juste pour lui dresser le triste état des lieux que je fais aujourd’hui : les Policiers ne croient plus vraiment en leur Justice, je ne sais pas si la Justice croit en ses policiers d’ailleurs, mais parfois un divorce se décide par un seul membre du couple et là il semblerait que ce membre ce soit la Police et surtout ses Policiers qui se détachent petit à petit, lentement mais sûrement.
LG