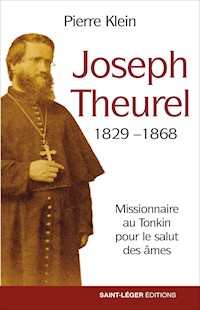
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Léger Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Joseph Theurel songe à devenir missionnaire dès l'âge de 10 ans. Ordonné prêtre, il est envoyé dans la région de
Hanoï en 1853. Les chrétiens y sont persécutés. Des persécutions de plus en plus atroces à mesure que les Français tentent de les arrêter par des interventions sporadiques et maladroites. Joseph, missionnaire énergique et exemplaire, sera obligé de fuir bien des fois. Sous cette pression, il voudra remettre en cause la pratique missionnaire. Mais, une fois la tolérance religieuse arrachée à l’empereur du Viêt Nam, Joseph, devenu évêque, maintiendra une organisation où les missionnaires verrouillent la hiérarchie. C’est pour lui le moyen le plus efficace de parvenir à son but impératif : sauver le plus d’âmes possible en les baptisant. Il meurt à 39 ans.
Suivre Joseph, c’est suivre l’aventure héroïque d’un missionnaire emblématique du XIXe siècle. Replacé dans son contexte, son itinéraire montre à quel point notre conception de Dieu, de l’Église et de ses sacrements est conditionnée par une époque.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né le 30 octobre 1956 à Missy-les-Pierrepont.
Ingénieur agronome de Rennes.
De 1981 à 2018 : Agriculteur dans une exploitation de grande culture spécialisée dans les productions légumières de plein champ.
De 1999 à 2017 : Président de Prim’allia, coopérative agricole de mise en marché de légumes regroupant 150 agriculteurs produisant 280 000 tonnes de légumes.
De 2014 à 2016 : DU « Culture et spiritualité d’Asie » à l’Institut de Science et de Théologie des Religions de l’Institut Catholique de Paris sous la direction d’Ysé Tardan Masquelier.
De 2018 à 2022 : DS Science et Théologie des religions à l’Institut Catholique de Paris sous la direction de Catherine Marin.
Mémoire : Joseph Theurel (1829 – 1868) Une vie dédiée au salut des âmes.
2020 : Publication de La pérégrination vers l’Occident, prix littéraire 2020 de l’Œuvre d’Orient.
2020 : Publication de Expandis, une dynamique agricole.
Marié depuis 1979, père de trois fils et aïeul de six petits-enfants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Klein
Joseph Theurel
(1829-1868)
Missionnaire au Tonkin pour le salut des âmes
Du même auteur
La pérégrination vers l’Occident. De Pékin à Paris, le voyage de deux moines nestoriens au temps de Marco Polo, Olizane, 2020. Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient. « C’est un vrai bonheur de lecture », Hélène Carrère d’Encausse.
Expandis, une dynamique agricole, Saint-Maur-des-Fossés, Jets d’Encre éditions, 2020.
Préface
En quittant Hanoï aujourd’hui pour rejoindre la ville de Phat Diem, siège épiscopal situé au sud-est de la capitale, la route traverse de magnifiques champs de rizières d’où parfois se profilent des clochers d’églises. Vision paisible d’un paysage où l’on aperçoit quelques chapeaux coniques de paysans penchés sur le sol, occupés à replanter le riz, un buffle tout près attend, un autre tire une charrue. Sur le chemin, la voiture double les innombrables motos sur lesquelles sont juchés des jeunes couples avec parfois un ou deux enfants accrochés au conducteur, ou transportant des charges improbables, machines, bouteilles de gaz, multiples cartons attachés on ne sait comment. On se salue, on se sourit. Cette terre aujourd’hui si hospitalière et accueillante, est celle de la mission de Joseph Theurel qui, de 1853 à sa mort survenue en 1868, a rempli sa charge d’ouvrier apostolique dans un contexte politique et religieux bien tourmenté.
En effet, la correspondance de ce jeune Franc-Comtois déterminé à rejoindre les missions d’Asie dès son plus jeune âge, offre un témoignage d’une grande importance sur les événements dramatiques, persécutions, déportations, que l’Église du Vietnam a endurés en cette période d’implantation des Français sur les côtes de Cochinchine, puis au Tonkin, dans la deuxième partie du xixe siècle.
Comme tous ceux de sa génération, Joseph Theurel avait emporté en mission à la fois les stigmates de la Révolution française, esprit de combat et de résistance si présent dans l’Église de France durant cette première partie du siècle, ainsi que les marques jansénistes reçues durant sa formation au séminaire. Aller porter en conquérant le salut aux âmes lointaines au risque de subir le martyr, telle avait été sa vocation missionnaire.
Cependant, la relecture de ses écrits finement menée par Pierre Klein dans cet ouvrage, met en relief combien la terrible volonté de l’empereur Tu Duc (1848-1883) d’éliminer l’Église catholique au Tonkin par tous les moyens, bouleverse le projet missionnaire pré-établi de celui qui devient évêque coadjuteur en 1859 puis vicaire apostolique du Tonkin occidental en 1866. Ces vagues de persécutions, l’insécurité permanente, le courage héroïque des confrères, des prêtres tonkinois, des chrétiens le plongent à la fois dans une profonde douleur mais aussi dans la fierté d’appartenir à cette Église si courageuse. De missionnaire, il devient membre à part entière de cette communauté cimentée par le sang des martyrs, « Quiconque en ce pays veut être chrétien doit être un héros »1 écrit-il. Le bilan est tristement lourd, des dizaines de milliers d’exécutions, de déportations. Des dix missionnaires du Tonkin occidental, trois seulement ont pu se soustraire à la mort, et parmi les martyrs son ami Théophane Vénard décapité en 1861.
Au début de l’année 1862, le jeune prélat rédige un appel adressé au Supérieur du Séminaire des Missions Étrangères de Paris, Mgr François Albrand (1804-1867), lui demandant d’accélérer la « vietnamisation » de l’Église, de nommer des évêques autochtones, de transférer les fonctions ecclésiales au clergé tonkinois. Ces tragédies ont démontré la force et l’enracinement du christianisme dans ce pays et le rôle du missionnaire est devenu celui du serviteur de ces témoins de la foi, et non plus du conquérant.
Cette réflexion se retrouve dans les correspondances de nombreux missionnaires aux prises aux mêmes tragédies s’abattant sur les chrétiens de Chine, Japon, Corée. Le temps est venu, selon eux, de doter ces communautés chrétiennes de guides issus de leur propre rang.
Il faudra attendre encore de nombreuses années avant que Rome ne se décide à nommer des évêques autochtones. Au début du xxe siècle, le pape Benoît XV (1914-1922) puis le pape Pie XI (1922-1939) répondent enfin à la demande de plus en plus pressante des missionnaires, tel le lazariste Vincent Lebbe (1877-1940), le Visiteur apostolique en Chine, Mgr Celso Costantini (1876-1958), Mgr de Guébriant (1860-1935), supérieur des Missions Étrangères de Paris, et bien d’autres. En 1926, six premiers évêques chinois sont consacrés à Rome par le pape Pie XI, et en 1933, est nommé le premier évêque vietnamien, Mgr Jean-Baptiste Nguyen Ba Ton (1868-1949).
Aujourd’hui, Phat Diem est le siège épiscopal suffragant de l’archidiocèse de Hanoï, englobant l’ancienne résidence des vicaires apostoliques du Tonkin occidental, Ke-Vinh. La cathédrale au style vietnamien se dresse fièrement, entourée de cinq chapelles construites pour exaucer un vœu du bâtisseur revenu vivant de camp de détention, sous le règne de Tu Duc. Le père Six, prêtre vietnamien appartenant au clergé de Mgr Theurel, a su accorder le style traditionnel de son pays au besoin d’espace et d’élévation du culte chrétien, mais surtout il a offert le repos éternel à plus de 2000 martyrs, dont les restes ont été ensevelis dans un cimetière clos de murs. Hélas, Joseph Theurel était mort de la dysenterie bien avant cet événement marquant le renouveau de cette Église du Tonkin qu’il a tant aimé.
Catherine Marin
Historienne des Missions
1. Mgr Armand OLICHON, Le Père Six, curé de Phat-Diem, Vice-Roi en Annam, Librairie Bloud et Gay, 1941, p. 65.
Beati mundo corde2
Pourquoi s’intéresser à Joseph Theurel ?
Joseph Theurel vécut de 1829 à 1868. Originaire de Franche-Comté il entre en 1849 au séminaire des Missions Étrangères, une association de prêtres français établie rue du Bac à Paris. Il est envoyé au Tonkin occidental, la région de Hanoï, qu’il atteint en 1853. Il y sera d’abord missionnaire puis vicaire apostolique, c’est-à-dire évêque, en 1866 mais il meurt de dysenterie en 1868. Pourquoi s’intéresser à lui ?
Il est courant de nos jours de faire l’amalgame entre la colonisation, vouée de manière indiscriminée aux gémonies, et l’évangélisation. Pourtant, au Viêt Nam, les missions catholiques débutent dès la première moitié du xviie siècle alors que les premiers accrochages entre Vietnamiens et Français datent seulement de 1847 et le début de la conquête proprement dite de 1860. Joseph a par conséquent vécu la période charnière au cours de laquelle les missionnaires, soumis à des persécutions intenses depuis 1820, doivent harmoniser leur patriotisme – au Tonkin occidental ils sont tous Français – et leur raison d’être : sauver les âmes des infidèles en formant un clergé indigène. Se pencher sur la vie de Joseph permet donc, en suivant un exemple biographique authentique, d’étudier cette période selon le point de vue de l’un de ses acteurs, sinon le plus célèbre, du moins l’un des plus actifs et des plus représentatifs.
L’essentiel des documents disponibles concernant Joseph sont des courriers. Par ailleurs, il existe une biographie composée en 1876 par l’abbé Morey3. Condisciple de son héros au séminaire de Besançon, il fournit un témoignage précieux sur les premières années de Joseph puis il le suit dans son aventure missionnaire. Il peint un portrait idéal, une incarnation de la perfection de la naissance à la mort. Bref, son livre est une hagiographie. À l’instar des Annales de la propagation de la foi, revue à grand succès qui exaltait l’action des missionnaires et dont le tirage dépassait dès 1830 les 40 000 exemplaires, cette biographie a plus pour objectif d’accroître le soutien des chrétiens de France aux missions lointaines que d’interroger la personnalité de Joseph et, à travers lui, l’aventure missionnaire au Viêt Nam à l’époque. Elle permet néanmoins de fixer des jalons fiables sur la jeunesse de Joseph.
L’objectif que se donne Joseph Theurel en partant en mission est clair : sauver les âmes des païens. Mais il est pris dans un maelström d’événements, proches et lointains, qui vont le ballotter et l’obliger à s’adapter, au premier rang desquels les errements de la politique française en Asie du Sud-Est et les réactions des empereurs du Viêt Nam. Si la biographie de Joseph permet de pénétrer l’histoire des missions de l’époque, ce sont les péripéties de l’Histoire qui expliquent ses positions et ses évolutions. Ces péripéties sont ici retracées pas à pas, chronologiquement puisque c’est la chronologie des événements, jamais prévisible, qui induit les cheminements des différents acteurs. Des questions apparaissent au fur et à mesure : quelle fut la formation de Joseph qui montre, à l’image de la plupart de ses confrères, une fermeté remarquable dans ses convictions et un réel intérêt intellectuel pour son pays d’accueil ? Pour quelles raisons, alors que l’objectif des Missions Étrangères consiste à créer un clergé indigène en dehors de toute interférence politique, la réalité, entre pragmatisme, a priori et routine, a-t-elle constamment repoussé sa réalisation ? Comment au cours du temps les relations entre les missions depuis longtemps établies et les Français conquérants nouvellement arrivés se sont-elles nouées ? Tout ceci en questionnant la correspondance de Joseph.
Le courage de Joseph, sa résilience face à des persécutions atroces quotidiennement renouvelées, face aux apostasies qui remettent en cause toute son application, face à la mort qui guette de mille façons, en font un admirable héros, mais surgit une autre interrogation : que fait-il au Tonkin ? Qu’apporte-t-il aux Tonkinois ? Dans les lettres à sa famille il décrit ses activités de missionnaire, la situation politique, les abominables persécutions dont les chrétiens sont les victimes, mais il le fait en bon petit soldat, sans manifester d’états d’âme ni de véritable originalité. Il semble se couler dans le moule proposé par Monseigneur Retord4, le modèle de sa jeunesse au séminaire de la rue du Bac, sans prendre de recul. Tant et si bien que la nomination de Joseph comme provicaire puis comme coadjuteur paraît un choix de continuité plus dicté par les circonstances tragiques que par ses qualités propres. Et puis quelle curieuse façon, vu de notre époque, de transmettre la Bonne Nouvelle !
D’ailleurs est-ce une si bonne nouvelle pour les néophytes annamites ? À côtoyer les écrits des missionnaires, il arrive, sans remettre en cause leur héroïsme, qu’on les comprenne de moins en moins. Comment expliquer qu’au sortir d’épouvantables persécutions, ils se rebellent contre leur évêque au prétexte, apparemment futile, qu’il a consacré une huile de mauvaise qualité ? Comment admettre l’augustinisme exacerbé d’un Monseigneur Retord qui croit si fort à la performativité des paroles sacramentelles qu’il fait du baptême des enfants à l’article de la mort, en l’absence de toute évangélisation des parents, un objectif en soi, allant jusqu’à infliger une amende à tout curé qui, dans sa paroisse, n’aura pas baptisé chaque année au moins 200 enfants d’infidèles ? Comment accepter que le martyre soit un horizon désiré non seulement pour les missionnaires, mais aussi pour leurs prosélytes ? Ne sont-ils venus de si loin que pour susciter le meurtre de leurs néophytes ? Leur foi ne propose-t-elle que de souffrir ?
Joseph, figure de son époque, est aussi un personnage figé dans ses certitudes, imbu de dogmatisme, certain de détenir l’absolue et unique vérité, y compris à propos des fins dernières, soumettant par exemple à ses parents, pour le salut de leur âme, les comptes d’apothicaire d’indulgences qui, si elles ne sont plus monétarisées comme à la Renaissance, marchandent la vie éternelle en Pater, en Ave et en soumission au pape ?
Mais il n’est pas que cela. Il est, comme tout humain, pétri de contradictions. Dans une lettre destinée au supérieur du séminaire des Missions Étrangères il fait preuve d’une véritable indépendance d’esprit, même s’il la modère d’une totale fidélité à Rome. Il s’y livre à une analyse très convaincante de l’histoire de la mission au Tonkin et de ses occasions manquées. Il s’y montre capable, même si c’est avec discrétion, de remettre en cause l’ordre établi de la mission et de critiquer la figure archétypique du parfait vicaire apostolique en la personne de Monseigneur Retord. Il s’autorise à penser que les Missions Étrangères sont passées à côté de leur vocation en ne proposant pas de fonder quand c’était possible une hiérarchie autochtone, à égratigner les positions du Vatican et même, avec passablement d’humour, à blâmer la hauteur avec laquelle les missionnaires considèrent les prêtres annamites.
Peu de temps après la rédaction de cette lettre le contexte politique de la mission du Tonkin s’améliore. L’évangélisation peut reprendre. C’est le moment de la rébellion de l’ensemble des missionnaires contre leur vicaire apostolique Monseigneur Jeantet. Les autres missionnaires prennent eux aussi une épaisseur humaine dans cette péripétie qui dure plus de deux ans. Joseph succède à Monseigneur Jeantet. Il a les coudées franches ou presque. Plus que ne les eurent aucun des vicaires apostoliques depuis la mort de Monseigneur Pigneaux de Béhaine 60 ans plus tôt. La nomination de Joseph était réclamée par tous les missionnaires. Dans quel but ? Ils ne l’expriment guère, si ce n’est pour dire qu’avec lui ils espèrent que les choses vont rentrer dans l’ordre, qu’après les errances de Monseigneur Jeantet la mission va retrouver son cours normal et que sa hiérarchie, avec des missionnaires nettement en surplomb du clergé annamite, sera à nouveau respectée.
Joseph sera-t-il fidèle aux analyses qu’il a élaborées au fond des antres où il se cachait ou bien répondra-t-il aux vœux des missionnaires ? La réponse est sans équivoque. Joseph se glisse délibérément sur les traces de Monseigneur Retord. Durant les deux brèves années de son vicariat, il pratique tout ce qu’il contestait il y a peu. Les prêtres annamites sont remis à leur place. C’est d’autant plus facile que les missionnaires sont plus nombreux. Les tournées pastorales reprennent selon la méthode Retord. La consécration de Monseigneur Puginier est l’occasion d’une fête grandiose, celle que Joseph, il le relève avec un certain dépit, n’a pas eue pour lui. Quelques semaines plus tard il décède, saintement, de la dysenterie qui le poursuivait depuis plus de 4 ans.
Ces choix de Joseph étaient-ils temporaires, nécessaires à la réorganisation de la mission ou correspondaient-ils à une adaptation plus définitive aux nouvelles circonstances ? On peut conjecturer que la seconde hypothèse est la bonne en observant la ligne de conduite de Monseigneur Puginier, le successeur de Joseph. Confronté au renouvellement des persécutions, conséquences des désastreuses expéditions Garnier et Rivière, il en appelle à un protectorat français sur le Tonkin. La conquête française assure effectivement à partir des années 1880 une paix civile inconnue depuis des décennies et les conversions sont nombreuses. Le salut de ces âmes est ainsi assuré dans le cadre d’une collaboration jugée fructueuse avec les autorités civiles qui de leur côté ouvrent le Viêt Nam à la modernité. Pour le meilleur et pour le pire les intérêts des missions et de l’administration s’amalgament. On oublie les Instructions de 1659 pourtant réaffirmées par Neminem Profecto en 1845. Mais c’est une autre histoire.
Cet ouvrage repose sur la partialité hasardeuse de la conservation des lettres de Joseph et sur Joseph. C’est dire qu’il est fragile. Qu’est-ce que Joseph a pu dire à des correspondants qui n’ont pas confié leurs missives à des archives ? Qu’a-t-on écrit sur Joseph qui est perdu ? Il faut nous contenter des documents finalement très fragmentaires dont nous disposons. La lettre très originale adressée au supérieur du séminaire, véritable remise en cause des pratiques mises en œuvre jusqu’alors, est unique et Joseph demandait explicitement qu’on la brûlât. Il est nécessaire de lire entre les lignes, de tirer sur des fils quelquefois très minces. C’est le sort de bien des travaux d’Histoire, tiraillés entre sources parcimonieuses et interprétation forcément subjective malgré tous les efforts.
Évoquer Joseph, c’est aussi se plonger dans une période de l’Église qui semble à bien des égards lointaine et révolue même si elle n’est pas très ancienne. On pénètre dans un monde où ceux qui ne sont pas catholiques sont des païens, où le bouddhisme est « un arbre gigantesque qui étend son ombre de mort sur une grande partie de l’Orient » et où les rituels populaires sont des diableries superstitieuses. Ceci alors qu’il apparaît à nos yeux d’aujourd’hui que c’est la manière dont les missionnaires administraient le baptême qui était, elle, naïvement superstitieuse, ce qui est confirmé par la façon dont certains Annamites le demandaient pour leurs enfants. Les pratiques sacramentelles de l’Église catholique idolâtraient les mots au point de commettre un péché contre l’esprit.
Il demeure la personnalité attachante de Joseph. Sa foi à déplacer les montagnes. Comment prétendre dénoncer les préjugés de son époque sans prendre la peine d’interroger les nôtres ? Côtoyer Joseph offre l’occasion de constater à quel point notre civilisation, notre bagage culturel, a changé en un peu plus d’un siècle. Nous utilisons les mêmes mots avec des acceptions bien différentes. Dieu le Père qui était à l’époque lointain, autoritaire et vengeur est devenu le Dieu d’amour. Au Jésus juge éternel, sévère et définitif nous avons substitué le Sauveur universel. Les sacrements mécaniquement opérationnels sont vus sous un angle bien plus symbolique, en tout cas par la majorité des chrétiens de nos pays. Cela nous parle des moments historiques traversés. À une période, celle de Joseph, marquée par les récents troubles de la Révolution et l’ébranlement des valeurs dans le cadre d’une rivalité européenne exacerbée, a fait place une autre, la nôtre, où l’hédonisme et l’ouverture au monde ne supporte plus les conflits devenus inacceptables, où la seule vraie peur partagée est la crainte que le ciel nous tombe sur la tête. Qu’en sera-t-il dans quelques décennies lorsque la globalisation heureuse des trente années qui viennent de s’écouler ne sera plus qu’un souvenir ?
Après tout, la méthode missionnaire de Joseph et de ses confrères s’est révélée efficace. L’Église vietnamienne est l’une des plus dynamiques d’Asie malgré l’autoritarisme soupçonneux du Parti communiste. Si l’on tente d’adopter le point de vue de Joseph, sa mission est, finalement, un succès au regard des hommes et, augurons-le, au regard de Dieu.
2. « Heureux les cœurs purs ». Mt 5,8. La devise épiscopale de Joseph Theurel.
3. Voir la bibliographie..
4. Les protagonistes et les mots techniques de cet ouvrage sont présentés dans le glossaire .
Dédicace
À ma grand-mère Marguerite qui m’a fait découvrir son grand-oncle Joseph.
Documentation
La biographie de l’abbé Morey est la seule source disponible pour ce qui concerne la jeunesse de Joseph. Elle apparaît fiable puisque Morey fut un condisciple de Joseph au séminaire de Besançon et qu’un courrier prouve qu’il s’est documenté auprès de la famille Theurel pour écrire son livre. En revanche il passe sous silence tout ce qui pourrait, de son point de vue, porter atteinte à la réputation de Joseph.
L’Institut de recherche France-Asie (IRFA) est en charge du très riche patrimoine historique des Missions Étrangères de Paris. Il regorge de courriers de missionnaires, certains particulièrement émouvants comme ceux de Théophane Vénard quelques jours avant son martyre. Ils sont ici transcrits en respectant évidemment leur forme. On y trouve les nombreuses lettres de Joseph à ses parents et à ses frères et sœurs, principalement à son frère Charles-François, curé de Theuley, et à sa sœur Séraphine. Quelques-unes sont adressées à plusieurs des membres de sa famille, y compris son frère Jean-Baptiste, chanoine de Reims. Malheureusement il fut impossible de trouver aucune de celles qu’il a probablement envoyées personnellement à celui-ci ni à sa sœur Onésime.
Les archives de l’IRFA conservent aussi des lettres de Joseph à ses supérieurs, à des confrères ou aux autorités françaises. Elles abritent également des courriers de missionnaires dans lesquels il est question de Joseph. On y trouve enfin quelques lettres entre missionnaires qui sont truffées de mots vietnamiens indéchiffrables.
Les Annales de la propagation de la foi ont publié de nombreuses lettres de Joseph ou à propos de Joseph. Presque tous les originaux se trouvent à l’IRFA.
Les archives de la Congrégation pour la propagation de la foi, à Rome, détiennent les rapports de la mission établis par les vicaires apostoliques successifs ainsi que les serments rejetant les rites chinois exigés des missionnaires et des prêtres indigènes. On y trouve aussi les lettres que les missionnaires du Tonkin occidental, y compris Joseph, lui ont envoyées pour protester contre les agissements de Monseigneur Jeantet. En revanche il n’y subsiste aucune trace écrite du passage de Joseph à Rome en 1865 alors que, selon Morey, il a été reçu par la Congrégation des rites, par celle de la Propagation de la foi et deux fois par Pie IX.
Orthographe et vocabulaire
L’orthographe des noms de personnes et de lieux n’est pas fixée dans les courriers des missionnaires. D’où parfois une incertitude sur la localisation ou l’individu évoqué.
Pour les noms propres, l’alphabet latin courant a été retenu. Dans quelques cas, on trouvera en note l’écriture du nom en chữ quốc ngữ, l’alphabet officiel du Viêt Nam.
Le mot Tonkin, la partie nord du Viêt Nam occupée par le delta du Fleuve Rouge et les montagnes alentour, est orthographié le plus souvent par Joseph Tonquin. Certains de ses confrères préfèrent Tong-King, avec ou sans tiret. Dans les citations de leurs missives, j’ai naturellement conservé la forme qu’ils ont choisie. Ailleurs j’ai adopté la graphie moderne Tonkin.
Dès l’époque de Gia Long, les habitants de son royaume sont officiellement appelés Vietnamiens. En revanche les missionnaires usent des vocables Annamites ou Tonkinois. Selon les contextes, on trouvera tel ou tel.
Quant aux mots Indigènes, Autochtones ou même Sauvages – celui-ci particulièrement adapté puisque signifiant littéralement ceux qui vivent dans la forêt –, ils n’ont, pour les missionnaires, aucune connotation péjorative. Je les ai utilisés ici dans le même esprit.
La vocation
« Besançon le 25 janvier 1849
Mes chers parents,
Hier, 24 janvier, s’est terminée pour moi une grande affaire, je veux dire l’affaire de ma vocation. Elle s’est terminée selon vos désirs et selon les miens : c’est-à-dire que vous me verrez la soutane et que moi je la porterai. Vous serez bien content de me la voir et moi bien content de vous la montrer. Cependant, si vous êtes tentés de vous livrer à une joie excessive, rappelez-vous qu’en entrant dans l’état ecclésiastique, j’embrasse une vie de renoncements et de sacrifices. C’est l’idée que j’en ai, et c’est l’idée que vous devez en avoir. Je vous invite donc moins à vous réjouir qu’à prier pour moi. »
Le garçon qui adresse cette lettre au ton ferme et décidé à ses parents n’a que dix-neuf ans. Il s’appelle Joseph Theurel, il est né le 27 octobre 1829 à La Rochelle, un village à mi-chemin entre Langres et Vesoul, et il est le douzième d’une famille de treize enfants dont neuf parviendront à l’âge adulte.
Joseph a raison d’inviter ses parents moins à se réjouir qu’à prier pour lui. Sa véritable vocation, il la connaît depuis sept ou huit ans, mais il ne veut pas les brusquer même si ses idées et ses projets sont déjà bien arrêtés. Il la leur avouera six mois plus tard, le 16 juillet 1849, quand il sera accepté au séminaire des Missions Étrangères de Paris. Dans l’esprit de tous les catholiques, y entrer est synonyme de grandes tribulations et de séparation définitive.
« Mes chers parents,
Je vous exhorte, avant de commencer la lecture de ma lettre, à réveiller votre foi et tous vos sentiments religieux. Souvenez-vous que les intérêts de la terre ne sont rien en comparaison des intérêts du ciel, que la vie n’est rien à côté de l’éternité, qu’une seule chose importe à l’homme ici-bas, de sauver son âme. Priez, en la présence de Dieu et, avec le secours de Marie, poursuivez avec une sainte insensibilité. D’ailleurs vous savez que la Sainte Écriture veut que nous nous réjouissions avec ceux qui sont dans la joie. Réjouissez-vous donc avec moi ; car je suis dans une grande joie d’être admis, pour le mois d’octobre prochain, au séminaire des Missions à Paris.
Je compte assez sur votre piété pour espérer que non seulement vous ne vous opposerez point à ce que je profite de la grande faveur que Dieu m’accorde, mais de plus que tous vous vous résignerez parfaitement. Du reste, en partant pour Paris, je ne vais pas directement dans les pays infidèles ; mais je vais y examiner plus à fond la vocation très belle que la Providence semble m’avoir donné. Oh ! C’est un ministère si beau ! N’allez pas entreprendre de me l’arracher. Que vous diraient, au jour du jugement, ces pauvres âmes auxquelles j’aurais dû annoncer l’Évangile et qui probablement auraient par là gagné le ciel, tandis que, par votre faute, elles auraient été privées de celui qui devait leur ouvrir la voie du salut, et se seraient damnées ? Que me diraient-elles à moi-même, si j’avais été assez lâche pour écouter une tendresse mal entendue, et trop maternelle, assez lâche pour préférer satisfaire cette fausse affection plutôt que d’obéir à la voix de Dieu ? Ah ! elles crieraient vers Dieu que nous ne méritons pas miséricorde, puisque nous n’avons pas eu pitié de leur triste état. Et certes leurs plaintes seraient trop justes pour ne pas trouver accès auprès de la souveraine justice. Que vous dirait Jésus Christ ? “Eh quoi ! j’étais mort pour vous, et vous avez refusé de faire pour mon amour, le sacrifice que je vous demandais !” Vous ne voulez point, mes chers Parents, vous attirer des reproches si accablants. Moi non plus je ne le veux pas. Obéissons donc les uns et les autres à l’ordre de la divine Providence et disons à Dieu de tout notre cœur : “Que votre volonté soit faite ; et non la nôtre.” »
Joseph sera bien missionnaire. Il partira de France, avant d’avoir 23 ans, pour le Tonkin occidental. Il en deviendra le vicaire apostolique, ferme dans sa foi malgré d’invraisemblables persécutions et très attaché à respecter dans tous leurs détails les rituels catholiques romains alors même qu’il témoigne d’une véritable indépendance d’esprit.
La famille de Joseph
Joseph, selon l’usage, est baptisé dès le lendemain de sa naissance. Son parrain est l’aîné de ses frères, Jean-Baptiste. Celui-ci aurait aimé que l’enfant se prénommât Simon ou Jude, les saints apôtres fêtés ce jour-là. Ses parents avaient choisi Joseph. On se mit d’accord pour Simon-Joseph, mais il fut toujours appelé Joseph.
Les Theurel sont installés à La Rochelle, le village de la famille de la mère de Joseph, Marguerite. Son père, prénommé Jean-Baptiste comme son fils aîné, est à la fois cultivateur et marchand de bestiaux. Les ressources du ménage sont très limitées alors qu’elles doivent subvenir aux besoins des nombreux enfants. Tout est calculé au plus juste. Ainsi Joseph, dès la lettre où il annonce sa volonté d’être prêtre, sollicite-t-il énergiquement son père, tout en gardant une espièglerie légèrement ironique qui sera la marque de son style épistolaire.
« On n’achète pas les soutanes pour des queues de poires. Vous voyez ce que cela signifie : c’est qu’il me faut de l’argent pour me procurer le costume ecclésiastique. Papa dira bien :“Oh ! Ses frères le lui achèteront.”Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Car vous savez, d’un côté que mon frère de Theuley ne peut rien ; et d’un autre côté mon frère de Rheims m’a écrit qu’il prenait sur lui ma pension, mais qu’il ne se mêlerait pas de la dépense qu’il s’agit de faire à présent.
Eh bien ! Puisque Papa est condamné à payer, je le prie de me suivre dans un petit détail de ce dont j’ai besoin…
Il me faut 2 soutanes 110 fr
une calotte 8 fr
un petit manteau 15 fr
un chapeau 18 fr
une barrette 4 fr
2 ceintures 12 fr
des petits-collets 3 fr
Maintenant, mon cher papa, si nous faisons l’addition, il se trouve que la somme à verser se monte à 170 fr5. Je vous entends dire que cela est plus aisé à demander qu’à donner, surtout quand on n’a pas d’argent. Mon Dieu ! Je me le figure comme cela. Mais que voulez-vous ? Je ne puis pas payer non plus, moi. Ainsi, dussiez-vous emprunter quelque chose, vous tâcherez de m’envoyer la somme ci-dessus pour le 20 février au plus tard6.Si vous êtes obligé de faire un grand sacrifice pour cela, aussi je serai plus particulièrement votre petit abbé, quand ce sera vous qui m’aurez habillé ! Pour le cas cependant où vous seriez absolument trop gênés pour m’envoyer 170 fr avant Pâques, vous pourriez à la rigueur vous contenter de m’envoyer 80 ou 100 francs alors je ferai crédit pour le drap de mes soutanes. Mais vous concevez que j’aimerais mieux payer comptant. »
Suivant l’impulsion de Marguerite, la mère de famille, les Theurel sont extrêmement fervents. Trois des garçons seront prêtres et l’une des filles religieuse.
Jean-Baptiste (1809-1869), l’aîné, a vingt ans de plus que Joseph. À la naissance de celui-ci, il est élève en théologie à Besançon. Il sera par la suite le secrétaire personnel du cardinal Gousset à Périgueux puis à Reims. Il est également chanoine de cette ville lorsque Joseph entre au séminaire des Missions Étrangères.
Anne-Marie, née en 1812, est devenue membre de la Congrégation de la Mère de Dieu à vingt-cinq ans sous le nom de sœur Onésime. Elle œuvre à Écouen, puis aux Loges à Saint-Germain-en-Laye, dans les maisons d’éducation de la Légion d’Honneur. En 1867 elle enseigne à l’école de filles nouvellement installée à Lambersart près de Lille. Elle fait partie des sept religieuses qui, le 13 décembre 1879, partent fonder un établissement sur le modèle de la Légion d’Honneur au Caire puis un autre à Alexandrie. Elle y mourra le 19 septembre 1884. Joseph aimait lui rendre souvent visite quand il était au séminaire de la rue du Bac. Éloignés de leur famille, ils s’entendaient à merveille et partageaient la même vision de l’Église. « Depuis cinq mois environ nous n’avons, je crois, reçu aucune nouvelle de la famille, nous nous dédommageons, nous deux la bonne religieuse, en parlant ensemble des bontés de Dieu, en lui offrant conjointement nos sacrifices et en nous excitant à marcher droit dans ses voies, les seules qui conduisent à un heureux terme. »
Charles-François (1814-1868) a quinze ans de plus que Joseph. Ordonné prêtre en 1842, il est nommé professeur au séminaire de Luxeuil. Il sera curé de Theuley, un village à une quinzaine de kilomètres de La Rochelle. Joseph et lui sont très proches de cœur tout au long de leur vie et échangent de nombreuses lettres. Il meurt quelques jours après Joseph.
Élisabeth (1821-1853) épouse un cultivateur de Cintrey, un village tout proche de La Rochelle. Elle meurt à trente-trois ans seulement. Élisabeth est la seule à demeurer dans l’agriculture, preuve de l’intense mobilité sociale dans la France de l’époque.
Pierre-François (1822-1890) est instituteur à Champvans, un village proche de Dole.
Claude-Gertrude (1825-1883), mais on ne l’appelle que Claude, est un soldat. Il a quatre ans de plus que Joseph. Quand celui-ci est à Paris, Claude fait partie du premier bataillon de voltigeurs installé à la caserne de l’Ourcine. Ils habitent donc à moins de trois kilomètres l’un de l’autre et se voient fréquemment. Une fois Joseph parti pour le Tonkin, ils continuent de s’écrire quelques rares fois. En 1853, Joseph recevra de lui une lettre en provenance d’Afrique, c’est-à-dire probablement de l’Algérie qui vient d’être conquise. Claude revient en France en 1855, il se marie et devient percepteur à Hautvillers dans la Marne.
Anne-Séraphine (1827-1893) est de deux ans l’aînée de Joseph. Elle sera un lien puissant de la famille, bien qu’elle habite loin, à Reims où son mari, Alexandre Limasset, est directeur du petit lycée. Trois de leurs enfants atteindront l’âge adulte dont Charles-Lucien, mon arrière-grand-père. Quand on écrit à Joseph que Lucien, à six ans, lui ressemble, il répond : « En ce cas, prenez garde : car si Lucien me ressemble beaucoup, il pourrait bien, d’après le Proverbe qui se ressemble s’assemble, venir un jour se réunir à son oncle du Tonquin » !
Marie-Thérèse (1833-1851), la dernière, est née quatre ans après Joseph. Très jeune, elle lui a confié son rêve d’une vie religieuse. Quelques années plus tard elle change d’avis et songe à se marier mais elle meurt de la variole à dix-huit ans. Joseph est alors séminariste aux Missions Étrangères. À l’annonce de la maladie de sa sœur, Joseph avait écrit à ses parents : « Pour ce qui est de Thérèse, il est inutile de l’inviter à profiter de sa maladie pour le ciel. Elle n’ignore pas qu’il importe peu d’être ou pas en bonne santé, pourvu que l’on ait la conscience en paix et que l’on aime beaucoup le Bon Dieu. Si l’on se trouve dans cette heureuse condition, il n’y a vraiment rien de plus avantageux que de passer de cette misérable vie au Paradis. Comme il n’est pas encore question pour elle d’effectuer ce passage, qu’elle offre du moins ses douleurs et ses ennuis à Dieu qui la visite par la maladie, et certainement pour son plus grand bien. Quant à moi, je n’ai rien de mieux à faire qu’à prier pour elle d’une façon toute particulière et elle sait que je le ferai. » Lorsqu’il apprend le décès de Thérèse il reprend : « Rappelons-nous que nous ne sommes pas faits pour la terre, que notre séjour n’y est autre que celui des voyageurs, que tous nous avons au ciel notre patrie et notre fin, que les plus heureux d’entre nous sont ceux qui arrivent au but les premiers, que leur sort mérite par conséquent plus de sainte envie que de larmes. Ainsi, un jour qui n’est pas éloigné, nous serons comme notre petite Marie-Thérèse dégagés de ce corps périssable et nous nous retrouverons avec elle dans le sein de Dieu. »
Joseph méprise si explicitement le monde d’ici-bas qu’il en vient à perdre de vue que l’homme est créé à l’image de Dieu7, que le Christ, s’il est véritablement Dieu, est aussi, selon le concile de Nicée, pleinement homme et que le credo catholique8 exhorte les fidèles à croire à la résurrection des corps. Il se place, avec ces propos, dans la perspective tracée par Saint Augustin. Celui-ci reste marqué de manière indélébile par sa période manichéenne. Pour Mani, l’esprit appartient à la Lumière et le corps aux Ténèbres, tout l’effort du fidèle consistant à se débarrasser du corps pour baigner dans la lumière. Saint Augustin a transplanté, au moins en partie, cette vision de l’univers à la théologie chrétienne. Nous retrouverons souvent chez Joseph un augustinisme rigoureux.
Il poursuit :« Que notre joie sera grande alors, n’est-ce pas ! Faisons donc tous de généreux efforts pour ne pas manquer à ce rendez-vous du ciel. Vivons tous dans la piété comme Marie-Thérèse, afin d’avoir tous comme elle une mort qui ne laisse pas de doute sur notre salut.Oserai-je vous dire quelle est la pensée qui domine depuis hier dans mon esprit ? Pourquoi pas, puisque vous êtes chrétiens ? Eh bien ! Je me dis que le bon Dieu a visiblement usé envers notre chère petite d’une très grande miséricorde. Marie-Thérèse, selon moi, ne pouvait mourir plus à propos. Je n’ai pas besoin de vous en dire les raisons; vous les connaissez mieux que moi. Aussi, lorsqu’elle m’a fait écrire le 3 mai qu’elle était malade, en priant pour que la volonté de Dieu s’accomplît en elle, j’avais une grande propension à demander à Notre-Seigneur qu’il la retirât à lui, afin qu’elle n’eût pas d’autre époux que son Dieu et son Sauveur, et qu’elle pût lui offrir l’âme d’une vierge. J’ai été exaucé, vous ne m’en voudrez pas. J’espère fermement que ces prières, jointes à celles de beaucoup d’autres personnes sans doute, auront bientôt tiré notre petit ange du Purgatoire, si elle a dû y passer pour purifier davantage sa robe d’innocence. Moi-même je ferai cette semaine 4 communions pour elle, 7 chemins de croix, je dirai 7 chapelets et j’offrirai dans le même but mon bréviaire et toutes mes actions. »
Joseph n’a pas encore vingt-deux ans. Il est déjà opiniâtrement convaincu que les douleurs d’ici-bas, si elles sont supportées saintement, sont l’un des plus sûrs moyens d’accéder à la vie éternelle. Opiniâtrement convaincu que la vie éternelle compte infiniment plus que la vie terrestre et qu’elle mérite tous les sacrifices. Y compris la mort de sa jeune sœur. Il laisse par conséquent paraître une insensibilité de façade qu’il explique être, tout au contraire, la preuve d’une affection supérieure.
5. De l’ordre de 510 €.
6. Les mots soulignés dans les lettres de Joseph le sont par lui.
7. Genèse 1, 27.
8. Symbole des apôtres 11.
Enfance
Morey décrit un enfant enjoué et malicieux tout en étant d’une piété remarquable. Ainsi quand il avait une dizaine d’années « chaque jour il disparaissait, au plus fort des récréations et des jeux, pour entrer dans l’église et y faire son chemin de la croix ». C’est loin d’être impossible, mais il se peut aussi que ses condisciples, qui rapportent ces faits trente-cinq ans plus tard, aient une propension spontanée à embellir l’enfance de Joseph, leur héros. Un héros qui, naturellement, ne saurait connaître des débuts banals.
Joseph est d’abord scolarisé à l’école paroissiale de Laître. Son curé propose qu’il effectue sa première communion deux ans avant l’âge habituel, preuve de son esprit éveillé et de sa ferveur. Son frère Charles-François part en novembre 1840 pour le séminaire de Besançon où il est externe. Situation quelque peu exceptionnelle. Besançon est en effet le dernier séminaire en France à accueillir des externes. Ceci permet à Charles-François, qui a vingt-six ans, de prendre avec lui Joseph, son jeune frère de onze ans, pour lui donner des leçons de latin. Joseph ne semble pas avoir eu d’autre maître à ce moment. Charles-François est ordonné prêtre en septembre 1842. Son séjour au séminaire n’aura donc duré que deux ans. C’est très bref. Il avait probablement suivi d’autres études auparavant puisqu’on entre plus souvent au grand séminaire vers l’âge de vingt ans. C’est d’autant plus probable qu’il est immédiatement nommé professeur au petit séminaire de Luxeuil. Joseph le suit et y devient tout naturellement élève.
Entrer dans un petit séminaire n’implique pas nécessairement une vocation sacerdotalemême si l’ordonnance du 5 octobre 1814 précise que la fonction unique des petits séminaires est de former des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires. Celle de juin 1828 rappelle cette stricte limite, mais elle n’est jamais effectivement appliquée. Fréquemment des élèves de petits séminaires se présentent au baccalauréat avec de faux certificats qui attestent qu’ils ont fait les études exigées dans la maison paternelle. Si Joseph suit des études, cela montre l’importance que ses parents accordent à l’éducation de leurs enfants à une époque où il n’en allait pas toujours ainsi dans les familles nombreuses et modestes de la France rurale. C’est d’autant plus méritoire qu’il semble que son père était analphabète. Quant au choix du petit séminaire plutôt que d’une autre école, il témoigne de leur grand attachement à l’Église.
Mais Joseph, lui, se sent déjà appelé. Selon le supérieur du petit séminaire, Joseph est un bon élève, même s’il est dissipé. La preuve, il obtient, en classe de rhétorique9, le premier prix des concours diocésains. Son style épistolaire, toujours plaisant et léger, même dans les moments les plus tragiques, démontre que ce prix n’est pas usurpé. Dans le domaine de l’instruction proprement dite, l’appareil scolaire dans les petits séminaires ne diffère guère de celui que l’on peut rencontrer dans les lycées ou collèges ordinaires. Joseph bénéficie donc de l’instruction classique de son époque avec probablement plus de latin et certainement beaucoup plus de célébrations religieuses.
Si tous les élèves du petit séminaire ne sont pas destinés à devenir prêtres, la Congrégation regroupe les plus fervents. Par une pédagogie appropriée, les plus âgés y font, vis-à-vis des plus jeunes, l’apprentissage de la direction spirituelle, sous la surveillance attentive d’un prêtre. La Congrégation joue pour eux le rôle de propédeutique au sacerdoce. Joseph en fait naturellement partie, mais ses facéties l’empêchent d’en devenir le préfet.
En 1846 Joseph entre au séminaire de Vesoul. Ce n’est plus un petit séminaire. Joseph a dix-sept ans, l’âge de la maturation.
9. La classe de première de nos jours.
Les séminaires entre gallicanisme et ultramontanisme
Pour cerner la formation dispensée dans les séminaires au milieu du xixe siècle, un détour historique s’impose.
Le message évangélique est apparemment clair : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu10. » Mais César et le représentant de Dieu n’ont jamais la même définition de leurs apanages respectifs. En tout temps chacun des deux cherche à accroître le sien au détriment de celui de l’autre. Un conflit qui sous-tend une bonne partie de l’histoire de l’Occident chrétien. Un conflit qui, traduit dans l’histoire de France depuis la Renaissance, oppose gallicanisme et ultramontanisme.
La Pragmatique Sanction de Bourges, ordonnance royale promulguée en 1438, est considérée comme l’acte fondateur du gallicanisme. Le clergé français, en présence du roi Charles VII, y avalise les conclusions du concile de Bâle qui place l’autorité de l’assemblée conciliaire au-dessus de celle du pape. L’ordonnance en profite pour établir un système de bénéfices au détriment de Rome et permet au roi d’intervenir dans la désignation des évêques. En 1516, dans la foulée de la victoire de Marignan, le concordat de Bologne renforce encore l’autonomie de l’Église de France. Il ignore délibérément la collégialité épiscopale et entérine l’abandon de toute procédure élective dans la désignation des évêques. Dorénavant c’est le roi qui les nomme. Ce n’est qu’ensuite, après examen, que le pape leur confère l’investiture canonique. Ils doivent alors jurer fidélité au roi qui leur donne, pour finir, l’investiture temporelle. Le clergé français s’en satisfait souvent. Ainsi en 1682 Bossuet prend le parti de Louis XIV contre Innocent XI et rédige la Déclaration des quatre articles qui donne aux libertés gallicanes une définition très large. Dorénavant pour les gallicans le pouvoir du pape est exclusivement spirituel, il est soumis aux canons de l’Église, aux usages de l’Église gallicane et il est inférieur à celui d’un concile œcuménique. De plus « son jugement n’est pas irréformable, à moins que le consentement de l’Église n’intervienne ». On est très loin d’une quelconque infaillibilité papale.
L’Église de France est ainsi, jusqu’à la Révolution, dans la dépendance du pouvoir royal. Se substituant au roi, la Constituante décide de la subordonner encore plus en imposant la Constitution civile au clergé. Une réorganisation en profondeur de l’Église sous l’égide de la seule nation. C’en est trop pour le pape qui dénonce un schisme. Le conflit se focalise sur le serment que les clercs doivent prêter : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (ou de la paroisse) qui m’est confié ; d’être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée et acceptée par le Roi. » Se rangeant derrière le pape, une majorité de prêtres, de religieuses et de religieux refusent de se soumettre à cette constitution et choisissent la clandestinité. Leurs souffrances, leur fidélité à leur foi, à leur conception de l’Église et à la personne du pape, leur courage extrême inspirera les générations suivantes.
Une fois la tourmente apaisée leur exemple, conjugué à la générosité et à la soif d’héroïsme de jeunes gens désireux d’égaler leurs aînés, va conduire ceux-ci vers les terres lointaines. Ils savent qu’ils y partent sans espoir de retour, qu’ils risquent de mourir très jeunes d’accident ou de maladie. Peu importe. Ils veulent prouver qu’ils sont prêts à témoigner, comme leurs prédécesseurs, de leur foi sans limite, y compris dans l’idéal affiché et partagé du martyre. Le succès de l’Œuvre de la propagation de la foi, fondée par Pauline Jaricot en 1822 à Lyon, et de sa revue des Annales ainsi que les nombreuses rééditions des Lettres édifiantes et curieuses des jésuites tout au long du xixe siècle montrent à quel point ces missionnaires représentent un idéal pour tous les catholiques de l’époque. Un enchaînement des causes et des effets qui évoque le départ d’ascètes et de moines vers le désert lorsque cessent les persécutions de l’empire romain.
Le concordat de 1801, voulu par Bonaparte, scelle la perte par l’Église de France de son statut de religion d’État. Le Premier consul, qui est en principe catholique, obtient de nommer les évêques qui doivent jurer fidélité à la constitution : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au Gouvernement ». Ce texte est bien plus compromettant vis-à-vis de l’État que le précédent mais il a, lui, reçu l’approbation de Rome. Curés et évêques deviennent des fonctionnaires. Cette situation perdure jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État en 1905 même si, en 1832, le Saint-Siège obtient d’être consulté avant la nomination des évêques, si bien qu’à partir de 1835 un nombre croissant est recruté parmi le clergé ultramontain. Elle prévaut donc à la période qui nous intéresse durant laquelle la controverse entre gallicans et ultramontains divise toujours l’Église de France.
Cette controverse va naturellement influer sur la formation des futurs prêtres. Ceux-ci sont formés dans des séminaires, instaurés par le concile de Trente (1545-1563) qui a redéfini la doctrine catholique en s’opposant au « serf arbitre » de Luther et en affirmant le « libre arbitre » de l’homme, lequel a naturellement besoin du soutien de la grâce divine pour affronter le péché et parvenir à sauver son âme. Cette grâce lui est procurée par les sacrements, sacrements qui réactualisent l’alliance de Dieu avec les hommes scellée par la mort et la résurrection du Christ, sacrements immanquablement efficaces à la stricte condition d’être correctement célébrés. L’Église a donc un besoin impérieux de prêtres parfaitement préparés à leur ministère, lequel ne se limite pas aux seules cérémonies. Pour que leurs ouailles s’engagent sur le chemin de la sainteté, il faut les enseigner, filles comme garçons, animer des œuvres de charité de toutes natures, guider des confréries de piété, etc. Pour disposer de ces prêtres de qualité, Trente veut que chaque diocèse dispose d’un séminaire, c’est-à-dire d’une pépinière de ministres pour le service de Dieu convenablement instruits par la lecture de l’Écriture Sainte et formés à la manière d’administrer les sacrements. L’installation de séminaires est ainsi la clef de la Contre-réforme. Elle induit aussi les prémices d’une harmonisation et d’une cohésion du clergé qui permettra à Rome d’affirmer progressivement son ascendant.
En France, plusieurs initiatives se développent au xviie siècle. Pierre de Bérulle fonde la Société de l’Oratoire de Jésus qui propose aux prêtres séculiers de vivre une véritable vie spirituelle et érige le premier séminaire de Paris. Les lazaristes de saint Vincent de Paul se consacrent à des missions itinérantes dans les campagnes et à la formation des prêtres diocésains. Saint Jean Eudes implante des séminaires en Normandie et en Bretagne. Mais ce n’est qu’en 1641 que Jean-Jacques Olier fonde le séminaire de Saint-Sulpice qui fera de nombreux émules et il faut attendre le xviiie siècle pour que chaque diocèse dispose enfin d’un séminaire, preuve de la résistance opposée par les gallicans.
L’Église de l’Ancien Régime cristallise les aversions des partisans des Lumières qui la prennent pour un anachronisme néfaste. Mais paradoxalement la Révolution française qui en est issue puis l’Empire vont provoquer sa profonde rénovation. Les victimes chrétiennes se multiplient. Les structures féodales de l’Église gallicane sont dynamitées. Pie VI puis Pie VII sont emprisonnés, d’où l’image romantique des papes martyrs, ce qui va, par réaction, accroître le rayonnement de la papauté et lui offrir, de façon inattendue, l’occasion de renforcer son autorité morale. Dès 1799, le futur pape Grégoire XVI publie un traité intitulé Triomphe du Saint-Siège et de l’Église ! Les ultramontains deviennent les chantres d’une Église régénérée par un retour aux sources de l’Évangile porté par l’Église clandestine. Un lien affectif se crée pour la première fois entre les fidèles français et le pape qui est bientôt considéré comme l’incarnation de l’Église. Enthousiaste, Lamennais écrit en 1826 : « Sans pape point d’Église ; sans Église point de christianisme ; sans christianisme, point de religion et point de société : de sorte que la vie des nations européennes a, comme nous l’avons dit, sa source, son unique source, dans le pouvoir pontifical. » La nouvelle légitimation du pape lui permet de concentrer de plus en plus le pouvoir entre ses mains, tant sur le plan spirituel que temporel, mouvement dont l’acmé sera la dogmatisation de l’infaillibilité papale proclamée le 18 juillet 1870 lors du concile de Vatican I sous le pontificat de Pie IX. La valorisation exaltée des nouveaux martyrs engendre un élan de dévotion qui passe entre autres par le culte du Sacré-Cœur de Jésus et celui de la Sainte Vierge. Joseph réclamera souvent qu’on lui envoie au Tonkin des images mariales. L’hyperdulie du concile de Trente n’est bientôt plus suffisante, si bien qu’en 1854 Pie IX promulgue le dogme de l’Immaculée Conception à l’instigation de nombreux évêques. Monseigneur Retord, le vicaire apostolique du Tonkin occidental, l’évêque de Joseph, en fait partie. L’enthousiasme sincère qui entoure cette proclamation semble avoir occulté aux yeux des fidèles, tout à leur ferveur, l’affadissement du « Fiat » de Marie, de son acceptation sans équivoque ni réserve du plan de Dieu, dès lors qu’elle est exempte de péché. Orthodoxes et protestants n’ont pas manqué de relever cette difficulté.
L’unité affichée, revendiquée par les ultramontains derrière le pape se traduit par un souci d’uniformité. Évidemment, la messe est partout célébrée en latin, latin d’autant plus indispensable que l’abbé Grégoire, emblématique évêque constitutionnel des républicains, s’est fait le promoteur zélé du français pour tous mais, à la fin de l’Empire, seuls vingt-deux diocèses suivent le rite romain, vingt le rite parisien et dix-huit des rites particuliers. Les différences entre ces rites peuvent sembler dérisoires. Il est question d’ornements d’autel, de succession de chants, de génuflexions, de salutations et de préséance lors des processions. Mais ce sont des symboles et l’on ne saurait transiger avec les symboles. Le rite sera le prétexte de l’affrontement entre gallicans et ultramontains jusqu’au concile Vatican I (1869-1870) comme le furent, en d’autres occasions, filioque ou Théotokos.
Les circonstances précises par lesquelles Jean-Baptiste Theurel est devenu secrétaire particulier de Monseigneur Gousset puis chanoine titulaire de la cathédrale de Reims ne sont pas documentées. Ils se sont probablement rencontrés à Besançon lorsque celui-ci y était professeur au séminaire. Monseigneur Gousset, d’origine paysanne modeste comme les Theurel, est devenu, en 1840, l’un des principaux porte-parole des ultramontains en France. Le premier, il organise un concile provincial, le concile de Soissons, sitôt que le gouvernement de la Deuxième République autorise en 1849 ces rencontres qui paraissaient si dangereuses aux ministères précédents. Paradoxalement c’est le pape lui-même qui préconise d’utiliser l’outil conciliaire afin de renforcer l’autorité du successeur de Pierre. En 1857 Monseigneur Gousset organise un concile provincial à Reims et c’est Jean-Baptiste qui en porte les décrets au pape Pie IX.
Quand en 1862 Jean-Baptiste accompagne Monseigneur Gousset à Rome pour la canonisation des martyrs japonais, les querelles à tous propos sont toujours vives entre ultramontains et gallicans. Faveur exceptionnelle, le pape nomme les secrétaires de Monseigneur Gousset, dont Jean-Baptiste, protonotaires apostoliques. Sans être évêque, il a donc le droit d’être appelé Monseigneur. Lors d’un entretien avec un proche collaborateur du pape, celui-ci lui demande s’il a pour habitude de porter le rabat, une pièce de tissu, blanc ou noir, en deux parties attachée sur le devant du col et longue d’une vingtaine de centimètres. Ce rabat est propre au clergé séculier français si bien que Rome cherche à imposer le col romain, plus simple. À la réponse négative de Jean-Baptiste, son interlocuteur ajoute « J’aime mieux qu’on ne le porte pas. En effet, le rabat est une défroque gallicane ; il doit disparaître avec l’erreur dont il est le symbole ! » Pendant ce temps Monseigneur Gousset, reçu par le pape, déclare : «





























