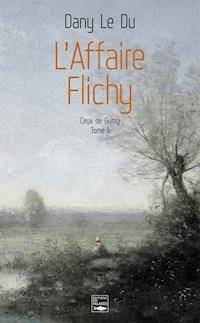
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions des Falaises
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ceux de Guitry
- Sprache: Französisch
Galerie de portraits en Normandie
La Révolution Française a profondément bousculé les relations entre les habitants de Guitry, petit village de Normandie. Denise et Nicolas Belhoste, la famille de Beauval et Jean Misère, les personnages principaux de l’Affaire Flichy, illustrent cette évolution radicale.
Fils de cultivateur devenu entrepreneur et maire de son village, Nicolas Belhoste est un homme orgueilleux, égoïste, manipulateur et opportuniste, porté par la volonté de laver une humiliation subie dans sa jeunesse. Le jour de son premier mariage, le destin de ces personnages se nouera pour plusieurs générations, en donnant à Nicolas Belhoste le moyen d’accomplir sa vengeance, cruelle, sournoise, implacable.
Le premier volet d'une fresque historique qui dépeint la vie provinciale du XIXe siècle !
EXTRAIT
La marquise de Beauval qui les accueille au bout de l’allée avec le sourire est une petite femme avenante aux formes généreuses. Elle protège son visage sous une ombrelle de dentelle, mais quelques gouttes de sueur perlent à la racine de ses cheveux blonds.
— Bonjour Belhoste, et merci à vous d’être venu si vite, dit-elle. Ce grand garçon, c’est votre fils ? Quel âge a-t-il ?
— Dix ans, répond l’homme.
— Comme Augustin, dit la marquise en se retournant vers le jeune paysan qui l’accompagne en poussant une brouette de branches cassées. Et comment s’appelle-t-il ?
— Nicolas Belhoste comme moi. C’est l’aîné de mes fils.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Dany Le Du, auteur de nouvelles et de guides pratiques, signe ici le premier tome d’une fresque historique passionnante peignant un visage inattendu de la vie en province tout au long du XIXe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liste des personnages
FAMILLE BELHOSTE
Nicolas Belhoste, le père
Marie-Anne Belhoste, épouse de Nicolas Belhoste, le père
Nicolas Belhoste, le fils
Paul Belhoste, frère de Nicolas
Louis Belhoste, fils de Paul et neveu de Nicolas Belhoste
Louis Belhoste, frère de Nicolas
Françoise Belhoste, sœur de Nicolas
Anne Belhoste, sœur de Nicolas, décédée
Julie, fille de Nicolas Belhoste et Clotilde
Hyppolite Belhoste, fils naturel de Denise Distot reconnu par Nicolas Belhoste
Philibert Belhoste, fils naturel de Denise Distot reconnu par Nicolas Belhoste
Célestine Belhoste, fille de Nicolas Belhoste et Denise
Pierre Belhoste, fils de Nicolas Belhoste et Denise
Simon Belhoste, cousin de Nicolas Belhoste
Anthoine Belhoste, cousin de Nicolas Belhoste
FAMILLE DISTOT
Denise Distot, deuxième épouse de Nicolas Belhoste
Adélaïde Distot, mère de Denise
FAMILLE GAVEL
Alexis Gavellele, ouvrier de Nicolas Belhoste
Clotilde Gavelle née Pezant, épouse d’Alexis Gavelle, puis de Nicolas Belhoste
Jacques Gavelle, fils de Clotilde et Alexis
Élisabeth Gavelle, fille de Clotilde et Alexis
Joséphine Gavelle, fille de Clotilde et Alexis
Désirée Gavelle, fille de Clotilde et Alexis
Marie Gavelle, fille de Clotilde et Alexis
FAMILLE FLICHY
Augustin Flichy, marchand de bois
Gaspard Flichy, frère d’Augustin
Mathieu Flichy, frère d’Augustin
FAMILLE MISÈRE
Jean Misère, le père, colporteur
Jean Misère, fils de Jean Misère
FAMILLE DE BEAUVAL
Madame de Beauval, la châtelaine, marraine d’Augustin Flichy
Anne de Beauval, sa fille
Philippe de Beauval, son fils
Barbe, femme de chambre de Madame de Beauval
Madame de Nanteuil, amie de madame de Beauval
Raoul de Nanteuil, le père
Raoul de nanteuil, le fils
Madame de la Haye, amie de madame de Beauval
Père Hallé, chanoine, ami de la famille de Beauval
Madame Blavier, nom d’emprunt de madame de Beauval
FRANCS-MAÇONS
Ricard, maire de Gamaches
Singeot, arpenteur
Pierre Foucard, élu de Guitry
Boullenger, lieutenant général du baillage de Rouen
Le Clerc, chirurgien
Cuisinier, juge de paix
Ymont, maçon
VILLAGEOIS
Maître Drevet, notaire
Madame Morel, dite la Grise, villageoise
Henri Morel, dit Grison, fils de la Grise
Le petit Grison, frère d’Henri Morel
La mère Gaudon, qui vit dans le marais
Père Duhamel, curé de Guitry
Marinier, aubergiste
Élisabeth Marinier, aubergiste, sœur de Clotilde Gavelle
Garnier, beau-frère de Nicolas
Garnier, procureur
Varin, beau-frère de Nicolas
Lainé, garde forestier
IColin-maillard
— Une bête de somme ! crie la mère, t’es rien qu’une bête de somme !
L’homme baisse la tête sans répondre tout en terminant de remplir la charrette qui déborde de foin. Il enroule plusieurs épaisseurs de chanvre aux bras de la carriole et les noue autour de ses épaules et de son torse. Puis il glisse quelques poignées de paille entre sa peau et ce harnais improvisé et, d’un mouvement de la tête, il fait signe à son fils et à sa femme de se placer à l’arrière. Saisissant les bras de la carriole, pliant les genoux, bandant ses muscles, il va chercher une respiration profonde au creux de sa poitrine et crie : « Poussez ! » Le chargement tremble sous la secousse. Les liens s’enfoncent dans ses côtes et au creux de ses épaules. La charrette s’ébranle. La mère se retire. L’homme, l’enfant, la carriole et le foin, enchaînés par l’effort, unis dans la recherche de l’équilibre, ne forment bientôt plus qu’un seul être hybride attentif à se garder des pierres et des nids-de-poules du chemin. La femme regarde le groupe s’éloigner en tanguant, et marmonne : « Même le colporteur, il est capable d’acheter un âne. Et moi qui trime tous les jours aux champs et le soir à rhabiller les nippes, qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour qu’il me donne cet incapable de mari ? »
***
C’est le petit matin. La chaleur qui a pesé toute la nuit sur le village laisse craindre que la canicule qui règne sur la Normandie en cette année 1770 ne dure encore une bonne partie de l’été. Depuis une semaine, alors que la moisson bat son plein, chacun craint que l’orage éclate avant que les récoltes n’aient été mises à l’abri. Mais le ciel n’a pas eu la patience d’attendre et, voici deux nuits, il s’est déchiré d’éclairs. Le tonnerre a roulé en vagues sombres et grondantes avant qu’une avalanche de grêlons ne s’abatte sur les champs, couchant et saccageant le blé, l’avoine, l’orge et le seigle. Ceux qui avaient moissonné à temps s’en félicitaient. Aux autres, il ne restait plus que leurs yeux pour pleurer. Transpirant, tirant et poussant la carriole, l’homme et l’enfant engagent leur équipage dans le long chemin qui relie Guitry à Guiseniers. Ici, c’est la plaine, et les haies qui délimitent les parcelles cultivées ne suffisent pas à leur procurer suffisamment d’ombre pour éviter que leurs bras ne cuisent de chaleur. L’odeur âcre et sucrée de leur sueur se fond avec les senteurs des fleurs d’aubépine et des blés coupés et, se mêlant à la poussière du chemin, monte vers le ciel comme aspirée par le soleil déjà brûlant.
Ils aperçoivent enfin les deux chênes centenaires qui marquent l’entrée du domaine. Empruntant l’allée ombragée, ils entendent au loin des rires et des cris d’enfants. « Si Madame reçoit, c’était peut-être pas le jour de venir », dit l’homme. « Elle s’ra ben contente que tu lui vendes ton foin, répond le jeune garçon, ‘cause que toutes ses récoltes sont abîmées ». Dans la fraîcheur des arbres, ce n’est qu’un concert de chants d’oiseaux dominé par le roucoulement des ramiers. En apercevant le colombier, le père soupire : « Si elles ont plus rien à manger ici, les maudites bêtes vont venir se servir sur nos terres. Ça sera ’core ça de moins pour nous. »
La marquise de Beauval qui les accueille au bout de l’allée avec le sourire est une petite femme avenante aux formes généreuses. Elle protège son visage sous une ombrelle de dentelle, mais quelques gouttes de sueur perlent à la racine de ses cheveux blonds.
— Bonjour Belhoste, et merci à vous d’être venu si vite, dit-elle. Ce grand garçon, c’est votre fils ? Quel âge a-t-il ?
— Dix ans, répond l’homme.
— Comme Augustin, dit la marquise en se retournant vers le jeune paysan qui l’accompagne en poussant une brouette de branches cassées. Et comment s’appelle-t-il ?
— Nicolas Belhoste comme moi. C’est l’aîné de mes fils.
— Augustin va vous aider à décharger. Mais venez d’abord vous rafraîchir à la cuisine.
De sa main elle désigne un petit groupe d’enfants près de la pièce d’eau.
— Et toi Nicolas, veux-tu aller jouer avec eux ?
— Non merci madame, répond le garçon, je préfère rester avec mon père.
Mais la marquise insiste. Craignant de la vexer, le père pousse son fils.
— Obéis à madame la Marquise. Je n’ai pas besoin de toi.
L’enfant ébauche un pas en direction du groupe, puis s’immobilise. Ils sont bien habillés. On dirait des grandes personnes, pense-t-il. Moi je suis qu’un paysan. Une fillette l’a aperçu et se dirige vers lui. Elle a des rubans dans les cheveux, porte une robe de princesse et ses pieds sont chaussés de souliers vernis, brillants de propreté.
— Tu veux des gâteaux ? demande-t-elle.
Nicolas baisse les yeux sur sa blouse, essuie ses mains moites de sueur et d’émotion sur son pantalon de grosse toile déjà trop court et regarde ses pieds chaussés de sabots poussiéreux.
— Non merci mademoiselle, répond-il.
— Tu viens jouer avec nous ?
— Non merci, faut que j’aille aider mon père.
Mais le père est déjà loin et malgré ses protestations, le jeune garçon se laisse entraîner vers les autres enfants qui, sous les arbres bordant le bassin, font une partie de colin-maillard. Pourvu qu’ils m’obligent pas à jouer, pense-t-il, et surtout qu’ils me mettent pas le bandeau.
Sous les arbres qui offrent un peu d’ombre, madame de Beauval et ses amis conversent paisiblement autour d’une table de jardin portant des rafraîchissements et des sucreries. Autour du père Hallé, qui dessert la paroisse d’Écouis, les dignes représentantes de l’aristocratie locale sont rassemblées. À côté de madame de Beauval, madame de Nanteuil, venue des Andelys, s’évente gracieusement, et la marquise de la Haye, qui règne sur le château de Cahaignes, essuie délicatement quelques gouttes de sueur derrière sa nuque. Leurs filles, tout en dentelles et ombrelles ouvragées, se tiennent bien droites sur les sièges de jardin, regardant avec un brin de nostalgie les enfants qui s’amusent près du bassin, comme elles étaient autorisées à le faire l’an passé avant d’être devenues des jeunes filles, comme disent pudiquement leurs mères. À quelques pas de la table, les fleurs des bosquets exhalent leurs senteurs d’été, et les papillons sont nombreux à voleter en couple autour d’elles, poursuivis par Philippe, le jeune fils de madame de Beauval, un filet à la main. Attirées par les arômes des fleurs et des sucreries, les abeilles bourdonnent autour de la table et par instant, un gros bourdon vrombit, rapidement chassé par un éventail agile.
— Quel bonheur de les voir jouer ainsi, dit la maîtresse de maison en regardant Anne sa fille, et Raoul le fils de madame de Nanteuil qui courent autour du jeune paysan.
— Peut-être aurai-je la joie, dans quelques années, de marier ces deux jeunes gens, plaisante le père Hallé.
Les deux mères acquiescent d’un sourire retenu car, en effet, elles s’interrogent déjà, en silence, sur l’opportunité de réunir un jour leur famille et leur patrimoine à travers ces deux enfants.
— Pourquoi pas, répond la marquise de Nanteuil. On pourrait voir plus mauvais arrangement.
— Je vais leur porter quelques fruits, ajoute madame de Beauval en rectifiant les plis de sa robe.
— Chère amie, intervient madame de la Haye, ne devriez-vous pas envoyer ce jeune paysan se rafraîchir à la cuisine ?
— Mais pourquoi donc ?
— Il n’est pas de notre race.
Ce n’est pas la première fois que madame de Beauval entend ce genre de remarque. Régulièrement, elle va visiter les familles qui vivent et travaillent sur ses terres, et tient à emmener ses enfants avec elle malgré leur jeune âge. Elle sait que ses amies désapprouvent la promiscuité qu’elle impose ainsi au futur marquis et à sa sœur, mais elle reste ferme sur ses principes.
— Un jour, mes enfants seront responsables du domaine et des fermiers qui entretiennent nos terres. Je veux qu’ils connaissent ces familles et qu’ils sachent dans quelles conditions souvent difficiles elles vivent. Ainsi, deviendront-ils des maîtres justes. C’est notre devoir, à nous qui sommes nantis, de nous préoccuper de ceux qui le sont moins.
— Moi, j’aurais peur qu’ils prennent de mauvaises manières et qu’ils attrapent des maladies, objecte madame de Nanteuil en agitant son éventail.
Madame de Beauval sourit :
— Voulez-vous encore une goutte de sirop d’orgeat, chère amie ?
***
Autour du bassin, la partie de colin-maillard bat son plein. Comme Nicolas le craignait, c’est bien lui qui est choisi pour porter le bandeau, et le voici entre les mains autoritaires d’un garçon qui lui couvre les yeux et le fait tourner sur lui-même. Nicolas vacille et se tord les pieds tandis que des mains légères lui effleurent les épaules, le dos, le visage. Il tente de s’en saisir, fait quelques pas et glisse sur l’herbe mouillée. Il tombe sur quelque chose de gras et d’humide, essaie de se relever, perd un sabot, puis l’autre. Ses mains ne trouvent aucune prise et en quelques instants il est dans l’eau jusqu’à la ceinture. Il cherche le bord mais celui-ci s’éloigne au fur et à mesure que ses pieds glissent sur les parois du bassin en forme de cône et enduites de vase. Battant des mains, suffoquant, il entend les éclats de rire des enfants au-dessus de lui. Enfin, il arrache le bandeau, parvient à s’agripper à quelques roseaux et rampe jusqu’à la terre, puant, couvert de boue, la bouche pleine d’une eau saumâtre qu’il tente de recracher en toussant. Les enfants s’écartent en riant et en se bouchant le nez.
Alertées par le bruit, madame de Beauval et ses amies se précipitent vers leur progéniture.
— Il n’y a rien de drôle, dit la marquise d’un air sévère. Cessez de rire immédiatement.
Et s’adressant à sa fille :
— Anne, mon enfant, allez chercher Barbe pour qu’elle s’occupe de ce jeune homme et qu’elle lui donne des vêtements secs. Et vous, Philippe, prêtez-lui votre mouchoir pour qu’il s’essuie le visage.
— Oh non, mère, pas mon mouchoir brodé ! proteste le garçonnet de sa petite voix pointue, en secouant ses longues boucles blondes.
— Faites ce que je vous dis, insiste sa mère en haussant le ton.
Le jeune garçon s’exécute à regrets, allongeant le bras le plus possible et tenant le mouchoir du bout des doigts pour éviter le moindre contact avec l’enfant couvert de boue.
En un instant, la femme de chambre est là, et elle entraîne Nicolas vers le château.
— Mon pauvre garçon, dit-elle en lui ôtant sa chemise devant la cheminée de la cuisine, te v’là bien, mais t’en fais pas, je vais te donner des habits propres. Enlève déjà ceux-là.
L’enfant proteste. Il ne veut pas se déshabiller. Il est très bien comme ça. Ça va sécher au soleil. C’est pas la peine. Mais Barbe ne s’en laisse pas conter et, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, le voici nu comme un ver, tandis que la servante sort pour chercher des vêtements.
C’est alors que, tournant les yeux vers la fenêtre, il aperçoit des petits nez collés aux carreaux, des yeux grands ouverts et des bouches ricanantes. Il cache son sexe d’une main, ses fesses de l’autre et se réfugie derrière la table. La honte, le chagrin, la révolte lui font monter le rouge au visage, venir les larmes au bord des yeux et étouffer bruyamment un sanglot qui noue sa gorge, tandis que derrière la vitre les enfants le montrent du doigt en riant à perdre haleine.
Je me vengerai, se jure-t-il, un jour je me vengerai.
IILa sorcière du marais
À Guitry, lorsque l’on quitte la place de l’Église en descendant vers Fontenay, on passe d’abord devant un grand pré de céréales : le pré sous Belhoste, et l’on aperçoit ensuite la maison de la famille du même nom. Entre les deux, une sente mène à des marais dont l’odeur pestilentielle flotte parfois, poussée par le vent, vers le village. L’eau croupie qui se répand entre les herbes dégage un brouillard malodorant et les parents interdisent cet endroit à leur progéniture car, dit-on, le marais avale les enfants désobéissants. Le conseil est d’autant mieux suivi que de l’autre côté de ce marécage vit la mère Gaudon dont la simple évocation suffit à faire fuir les plus aventureux.
Dans les jardins, on s’active à terminer les travaux extérieurs avant que vienne l’hiver. Nicolas, le fils aîné de la famille Belhoste, a été affecté à la réparation de la clôture entre le jardin et la sente du marais. À quinze ans, il est presque aussi fort qu’un homme et remplacer la totalité des piquets ne lui fait pas peur. Assis sur une grosse pierre, il taille les pieux en pointe pour qu’ils s’enfoncent facilement dans la terre ramollie par les pluies des jours précédents. Un peu plus loin, son frère Louis répare les clapiers et Paul, le plus jeune, achève de nettoyer le potager. Le village est calme, mais le petit trot d’un cheval vient troubler le silence en s’arrêtant à quelques mètres de la maison. Nicolas tourne la tête. Ce n’est pas une charrette mais une petite calèche et il reconnaît immédiatement l’attelage de la marquise de Beauval. Il fronce les sourcils. Que vient-elle faire là ? se demande-t-il. Puis, se souvenant que leur voisine est la couturière du château et qu’elle vient de se casser la jambe, il suppose que la dame s’est rendue chez elle pour un essayage. J’espère qu’elle n’est pas avec ses maudits gamins, pense-t-il. Mais ceux-ci descendent de la calèche à la suite de leur mère. Il reconnaît Anne, la fille aînée, et Philippe le fils avec ses boucles blondes. Cinq ans ont passé et la fillette est devenue une jolie jeune fille, mais le garçon est resté fluet et fragile. La mère et sa fille entrent dans le logis de la couturière et le jeune fils reste auprès de la calèche avec son chien, un élégant lévrier au corps souple et léger. Nicolas se lève et va à sa rencontre.
— Bonjour, lui dit-il. Il est beau ton chien. Comment s’appelle-t-il ?
— Elle s’appelle Isis, comme la déesse égyptienne, répond le garçon d’une petite voix pointue.
Bien sûr, ils peuvent pas appeler leurs chiens comme tout le monde, pense Nicolas. Ils se croient supérieurs parce qu’ils connaissent des noms bizarres.
— Je crois que tu aimes les papillons, dit Nicolas.
— Oui, les coléoptères sont un ordre d’insectes magnifiques. Je les collectionne.
— Il y en a encore quelques-uns dans le chemin. Ce sont les derniers de la saison, dit Nicolas en indiquant la sente qui longe le jardin. J’en ai vu un tout à l’heure, il était sur les canneberges. Tu vois là-bas, les jolies fleurs roses ?
— Il était de quelle couleur ? demande l’enfant.
— Bleu clair. Avec des ronds blancs. Magnifique. Bon je te laisse j’ai du travail.
Et Nicolas retourne vers la clôture pour se remettre à l’ouvrage. Ses pieux sont taillés, il peut maintenant les planter.
Le jeune Philippe est indécis. Un papillon bleu clair, ce peut être un Polyommatus icarus, pense-t-il. Pourtant cette espèce n’a pas de ronds blancs, juste une bordure blanche autour des ailes. Sa mère lui a recommandé de ne pas s’éloigner, mais une telle découverte mérite peut-être de désobéir un peu. Poussé par la curiosité, il fait quelques pas dans la sente. Nicolas, qui a enfoncé un premier pieu, lève son maillet en souriant à l’enfant et, d’un geste, lui indique le bout de la sente : « Oui, c’est par là, un peu plus loin. Je le vois. » L’enfant avance. Un pas, puis un autre. Un autre encore. Il ne voit toujours pas le papillon et il continue vers l’eau stagnante. Soudain ses pieds s’enfoncent dans la boue. Il cherche à les retirer mais chaque mouvement l’empêtre un peu plus et il a bientôt de la gadoue jusqu’aux chevilles. Il se met à pleurer et appelle sa mère mais le bruit du marteau de Nicolas couvre ses cris. Seul le chien est alerté et se met à aboyer en allant et venant dans la sente. Nicolas tape sur les pieux. L’enfant crie et cherche à extraire ses pieds aspirés par le marais. Il a maintenant de l’eau jusqu’aux genoux. Le chien court en aboyant de plus en plus fort. Il dessine des cercles autour de Nicolas qui ne tourne pas la tête et continue à ficher ses pieux en terre à grands coups de maillet sonores, couvrant les cris de l’enfant qui s’enfonce peu à peu.
Mais soudain, du fond du marais, dans la brume légère qui le recouvre, apparaît une grande silhouette noire. Elle semble marcher sur le marigot sans s’y enfoncer. En quelques enjambées, elle est auprès de l’enfant. Elle le saisit sous les bras, effectue quelques petits mouvements légers et le tire de la boue. Puis elle le sort du marécage et le pose sur le talus devant Nicolas, qui tourne alors la tête. Elle s’approche et se plante devant lui : « Chien, tu portes le mal en toi. Un jour j’ai maudit le village et je te maudis de la même manière. Comme moi tu verras mourir tes deux premiers fils ; et par tes mauvaises actions, tes enfants seront punis de la même manière. » Puis la vielle femme se retourne et disparaît comme elle était venue, semblant glisser sur le marais. Saisi d’un froid glacial, Nicolas tremble de tous ses membres et claque des dents. Puis il se reprend, franchit la clôture et s’approche du jeune garçon qui sanglote, affalé sur le talus.
— C’est rien, lui dit-il. Regarde, voilà ton chien. C’est lui qui a donné l’alerte. Je vais chercher ta mère.
En un instant, madame de Beauval, sa fille, la mère de Nicolas et ses frères sont autour de l’enfant.
— Merci Nicolas, dit la marquise les larmes aux yeux en prenant Nicolas dans ses bras. Merci, merci.
Un attroupement s’est formé dans la sente. Les voisins se sont approchés, étonnés de voir la marquise de Beauval se diriger en courant vers le marécage, sa robe traînant dans la boue. Ils l’entourent lorsqu’elle relève l’enfant et le serre contre elle.
— Dis merci à Nicolas.
— C’est la sorcière qui m’a sorti, murmure l’enfant.
— Les sorcières n’existent pas mon chéri. Remercie plutôt Nicolas.
Mais l’enfant persiste :
— C’est la sorcière !
La mère n’insiste pas et entraîne l’enfant vers le logis de la couturière pour qu’il soit lavé, changé et réconforté.
Le petit groupe de curieux ne se disperse pas et chacun cherche à comprendre, gourmand de détails concrets, voire surnaturels.
— Qu’est-ce qui s’est passé ? demande-t-on à la cantonade.
— C’est le p’tit marquis. Il a failli se noyer dans le marais.
— On leur dit pourtant bien aux gamins de pas aller par là. Que le marais il obéit à la mère Gaudon. Mais ça n’écoute rien à c’t’âge !
— P’tèt ben qu’ils n’y croient plus à cette histoire de sorcière. Depuis le temps.
— Oui, ben moi j’y crois, dit un vieil édenté appuyé sur son bâton. Un jour elle a maudit le village. Et vous verrez qu’un jour, l’église, elle s’écroulera comme elle a dit.
— C’est des foutaises, répond un homme, la mère Gaudon c’est juste une vieille folle dont personne ne veut ici.
— Et pourquoi qu’on n’en veut pas dans le village ? enchaîne une vieille femme. Y a bien une raison ! Moi je le sais. C’était une fille du diable. Le curé il avait pas voulu la baptiser cause que sa mère elle était une traînée et que la petite elle était née dans le marécage. Laide et pleine de boue qu’elle était sortie ! Moi aussi j’étais là quand le drame est arrivé, dit-elle en s’adressant au vieillard édenté. T’as pas la souvenance de pourquoi elle l’avait maudit, le village ?
Le vieux lève les yeux au ciel. Il semble avoir oublié.
— C’est loin tout ça. Je sais plus.
— Je te rafraîchis la mémoire, continue la vieille. Elle avait de bonnes raisons. Elle avait deux fils. Très laids. Autant qu’elle. Et vous les gamins du village vous les détestiez. Vous leur jetiez des pierres. Un jour ils ont couru pour vous échapper et ils se sont noyés dans le marais. T’en as toujours pas la souvenance ? T’y étais pas ?
— Non, j’y étais pas. J’étais aux champs ce jour-là.
— Alors elle a lancé sa malédiction et elle est venue vivre auprès de ses enfants morts. Depuis, plus personne ne veut s’approcher du marigot. Et c’est pas bon de vivre à côté, dit-elle en regardant le pré et la maison Belhoste. Y’a toute la mauvaiseté qui se promène ici.
Ce disant, elle se saisit de trois pierres du chemin qu’elle jette derrière son épaule gauche dans le marais en faisant le signe de croix de la main droite.
— En tout cas, heureusement qu’il était là le Nicolas pour sortir le petit, lance une femme. Sûr qu’il y serait passé.
— C’est pas ce qu’y dit le gamin. Y dit qu’c’est la sorcière qui l’a retiré du marais, reprend le vieux.
— T’y crois, toi ? demande la vieille femme.
— Ce que je crois, c’est qu’c’est sûrement pas l’Nicolas en tout cas.
— Et pourquoi ? demande-t-on.
— Il a pas de boue sur ses souliers, répond le vieillard. Il est tout propre. Et comment qu’il l’a tiré du marigot sans se salir ?
Et, de sa canne, il désigne Nicolas qui s’est accroupi et semble très occupé à consolider ses piquets. Tous les regards se tournent vers le jeune homme. Le vieil homme continue :
— M’est avis qu’y sort les marrons du feu pour se faire bien voir et que c’est bien plutôt la mère Gaudon qui lui a sauvé la vie au p’tiot. Et puis, va-t-en savoir si c’est pas l’Nicolas qui l’a attiré dans le marigot ?
Les uns et les autres se regardent, dubitatifs mais intéressés.
— Vous êtes tous des langues de vipère qu’avez mauvais fond, répond une ménagère en tournant le dos pour s’éloigner. Le petit il est sauvé. C’est ça qui compte.
Nicolas se relève et redouble d’énergie pour enfoncer les derniers piquets. Tous des abrutis arriérés, enrage-t-il en les regardant quitter les bords du marais.
***
Le père vient de rentrer pour sa collation du matin et sur le trajet il a déjà entendu parler de l’exploit de son fils.
— Alors, mon fils, dit-il en se taillant une tranche de pain, te voilà le héros du village. Je suis fier de toi.
— Tout le monde aurait fait la même chose, répond Nicolas.
— Peut-être pas, répond la mère. En tout cas les Beauval pourront t’en être reconnaissants toute leur vie.
— Je ne comprends pas, enchaîne le père, comment cet enfant si délicat a pu avoir l’idée d’aller se fourrer dans le marigot.
— C’est à cause du papillon, dit Louis.
Nicolas se retourne vivement vers son frère et lui jette un regard noir.
— Quel papillon ? demande le père.
— Le bleu avec des ronds blancs.
— Il n’y a jamais eu de papillons dans le marécage, ni dans la sente. Ça sent trop mauvais et il n’y a pas de fleurs, dit le père.
— Ben si, même que c’est Nicolas qui l’a vu, répond Louis.
Le père s’adresse à son fils aîné.
— Tu as vu un papillon bleu avec des ronds blancs ?
— Oui, père.
— Dans le marigot ?
— À côté, dans la sente, oui.
— Et tu l’as dit au gamin ?
— Ben oui, en bavardant. Pour être aimable.
— Tu lui as dit : y’a un papillon là-bas, va voir ?
— Pas vraiment, bafouille Nicolas. Je savais qu’il aimait chasser les papillons. Tu te souviens y’a longtemps quand on était allés livrer du foin au château, après la tempête…
Son père lève la voix et le coupe :
— Tu as dit au gamin : y’a un papillon là-bas ?
— Heu, oui, comme ça, pour bavarder.
— Et il y est allé ?
— Je sais pas j’ai pas fait attention après lui. Je faisais la clôture, je me suis remis à mon ouvrage. Et puis je l’ai entendu appeler, et le chien qui aboyait en me tournant autour. Alors je suis allé le tirer.
La mère intervient.
— Mais qu’est-ce que tu cherches là mon bonhomme, dit-elle en s’adressant à son mari. Il a sauvé l’enfant, les parents nous en sont reconnaissants, et tout le monde félicite ton fils. Tu devrais être content.
Le père se lève et jette son torchon par terre.
— Non, je ne suis pas content. Parce que si cet enfant a failli se noyer, c’est la faute de Nicolas qui l’a attiré vers le danger. Tu ne les aimes pas les Beauval, n’est-ce-pas ? dit-il en s’adressant à son fils.
Nicolas sent ses jambes se ramollir. Sa mère vient à son secours.
— Mon pauvre bonhomme t’as plus toute ta tête. Ton fils a sauvé la vie du gamin et maintenant tu l’accuses de lui avoir voulu du mal !
— Tais-toi, la femme. Et toi, dit-il à Nicolas en le saisissant par le col, tu vas venir immédiatement t’excuser d’avoir entraîné le garçon dans la sente.
La mère s’interpose.
— Lâche-le, dit-elle à son mari. Il va quand même pas s’humilier pour une faute qu’il n’a pas commise.
Mais le père ne l’écoute pas et en quelques instants Nicolas est hors du logis, traîné jusqu’à la petite calèche dans laquelle madame de Beauval et ses enfants s’apprêtent à monter.
— Pardon, madame la Marquise, mon fils a quelque chose à vous dire.
Nicolas reste muet. Son père le secoue. Il finit par murmurer :
— C’est ma faute si le petit il est allé dans le marais.
— Et pourquoi ? demande la marquise.
Nicolas se tait, la tête basse. Son père le secoue un peu plus. Un petit attroupement s’est formé autour d’eux.
— Je lui ai dit qu’il y avait des papillons.
Madame de Beauval le regarde un moment puis elle dit :
— C’est bien, Nicolas, de te sentir responsable, mais c’est Philippe le seul coupable. Il m’a désobéi. Et il a été puni. Mais grâce à toi la punition ne lui a pas coûté la vie.
Et s’adressant au père en pénétrant dans le petit carrosse :
— Ne soyez pas trop sévère avec lui.
Dans les bras de sa sœur, le jeune Philippe murmure à nouveau : « C’est la sorcière qui m’a sorti. » Sa sœur lui caresse les cheveux, la mère s’assied à côté de son fils et lui prend la main. Le cocher fouette les chevaux.
***
L’histoire fait rapidement le tour du village et devient polémique. Est-ce bien Nicolas, le fils Belhoste qui a sorti le petit marquis du marigot ? Et ne serait-ce pas lui qui l’y aurait attiré ? Les tenants du courage de Nicolas s’opposent à ceux qui doutent de son honnêteté et pendant plusieurs jours, le jeune homme évite de se montrer au village. Ça passera, pense-t-il, ils finiront par penser à autre chose. Mais ce qui ne passe pas, c’est la rage qu’il développe à l’égard de son père pour lui avoir fait honte ainsi devant la marquise et ses enfants, au vu et au su des voisins. Je venais de nous placer, la famille et moi, en héros devant tout le village, et mon père a osé me faire cet affront ! Jamais je ne lui pardonnerai, enrage-t-il.
***
Comme chaque samedi, les enfants du village ayant déjà fait leur première communion doivent se rendre à l’église pour y confesser leurs fautes, afin de recevoir le Saint-Sacrement de la messe dominicale. Et dans le confessionnal c’est chaque semaine la même litanie de petits péchés véniels, de fautes légères et de mauvaises pensées qui s’égrènent devant le père Duhamel, toujours indulgent, parfois amusé, devant ces confessions naïves auxquelles il donne volontiers l’absolution.
Nicolas ne manque jamais ce rituel et ce jour-là, son visage est sérieux. Ce qu’il vient avouer est grave. Mais il est déterminé et c’est le pas assuré qu’il pénètre dans le confessionnal et tire le rideau derrière lui.
— Pardonnez-moi mon père parce que j’ai péché.
— Je t’écoute mon fils, parle sans crainte.
— Mon père, si on est témoin d’une mauvaise action et qu’on ne dit rien, est-ce qu’on est coupable aussi ?
— En effet, mon fils. On devient complice.
Nicolas se tait un instant.
— Alors je m’accuse d’avoir volé de l’argent.
— Est-ce que tu as volé toi-même ou tu as vu quelqu’un voler ?
— J’ai vu quelqu’un voler et je n’ai rien dit.
— Et de qui s’agit-il ? demande le prêtre.
— Je ne peux pas le dire, murmure Nicolas.
— Tu dois soulager ta conscience pour que je te donne l’absolution. Tu sais que ce que tu me diras ne sortira pas d’ici. C’est le secret de le confession.
Nicolas ne répond pas.
— Parle sans crainte mon fils. Personne ne saura jamais ce que tu vas me confier. Raconte-moi ce qui s’est passé, ce que tu as vu. Ça se passait où ?
— Au château. Chez les Beauval. On était venus livrer du foin. C’était il y a longtemps.
— Avec ton père ?
— Oui.
— Et alors ?
— On était dans la cuisine du château. Il y avait des pièces sur la table et mon père les a prises.
— Ton père a volé de l’argent aux Beauval ?
— Oui, mon père. Et Nicolas met la tête dans ses mains.
Il a fallu du courage à ce jeune homme pour venir avouer la faute de son père, pense le prêtre.
— Tu n’es pas responsable, mon fils. C’est très difficile d’accuser son père et tu as fort bien fait de soulager ta conscience aujourd’hui. Je te donne volontiers l’absolution. Tu feras trois Notre Père. Va en paix mon fils.
Le lendemain, à la sortie de la messe, le père Duhamel fait un signe au père Belhoste.
— Je peux vous voir un instant, lui demande-t-il. Allons à la sacristie.
Belhoste le suit et le curé fait sortir les enfants de chœur qui achèvent de ranger les objets du culte.
— Mon fils, dit le prêtre, tu es un bon chrétien. Tu assistes à la messe chaque dimanche, tu te confesses régulièrement, tu communies et je te tiens pour un honnête homme. Mais es-tu sûr de ne rien me cacher ? Tu sais que Dieu voit et sait tout de nous.
— Oui, mon père. Que voulez-vous dire ?
— Je pense que tu as commis un mauvais geste voici des années et que tu n’as jamais osé en faire la confession.
— Un mauvais geste, s’étonne Belhoste. De quoi voulez-vous parler ?
— C’est à toi de me le dire, mon fils. Tu sais que Dieu pardonne.
— Je ne comprends rien à ce que vous me dites, mon père. Soyez plus précis.
— Il y a quelques années, tu es allé livrer du foin chez les Beauval. Il y avait des pièces sur la table. Ne les aurais-tu pas prises pour nourrir ta famille ? Les temps étaient durs à cette période.
— Moi, voler de l’argent ? Aux Beauval ? Mais vous n’y pensez pas mon père ! Jamais ! J’en suis bien incapable ! Vous me connaissez !
— Le Diable est partout, mon fils, et il attaque plus durement ceux qui sont les plus proches de Dieu. Si tu confesses ta faute, tu seras pardonné.
Belhoste devient rouge écarlate, puis blanc de colère et de rage.
— J’ai rien fait de ce que vous dites, mon père ! Rien ! Qui c’est qui vous a dit ça ?
— Je suis tenu par le secret de la confession mon fils. Je ne peux pas te le dire. Mais la personne en question t’a vu. Je peux t’entendre en confession maintenant. Je te donnerai l’absolution et tu pourras communier la semaine prochaine.
— Je ne confesserai pas quelque chose dont je suis innocent. Jamais, jamais. C’est un menteur celui qui vous a dit ça.
— Mais si tu ne te confesses pas, je ne pourrai plus te donner la communion.
— Et bien je m’en passerai de votre communion, lance Belhoste en claquant la porte de la sacristie.
***
Et en effet, le dimanche suivant, non seulement Belhoste ne se présente pas devant l’autel pour y recevoir l’hostie, mais il ne se rend même pas à la messe. La semaine suivante non plus et la semaine d’après encore moins. Désormais, chaque dimanche, il accompagne sa famille jusqu’au parvis puis entre dans le cabaret et attend la sortie de la messe devant un pichet de vin.
Au fil des mois, sa femme s’en étonne puis lui fait des reproches : « Alors non seulement tu ne vas plus à la messe, mais maintenant tu te mets à boire. » Et chaque soir lorsqu’il rentre de son travail elle lui demande s’il va enfin se décider à aller à confesse pour revenir à l’église le dimanche suivant. Il ne répond pas, se taille une tranche de pain et retourne à l’auberge d’où il rentre de plus en plus tard.
Car une question le taraude. Qui a pu raconter ces mensonges au père Duhamel ? Qui rencontrait-il lorsqu’il allait porter du foin au château ? Les Flichy, les fermiers du domaine, leurs trois fils, Barbe la femme de chambre de madame de Beauval, la marquise elle-même parfois, sa fille et son fils de temps en temps. Qui, parmi tous ces gens, peut lui en vouloir ? À moins que ce ne soit quelqu’un du village. Alors il se met à soupçonner tout le monde. Il devient sombre et silencieux. Perd ses amis et le goût de son travail. Et pendant les quatre années qui suivent, c’est dans le vin qu’il cherche la réponse et le réconfort.
Et un matin, alors qu’il avait beaucoup bu et quitté l’auberge tard dans la nuit, c’est au pied d’un pommier qu’on le retrouve rigide et froid, les yeux grands ouverts, continuant à lancer en vain vers le ciel cette interrogation : qui ?
IIIChangement de monde
En mourant, alors qu’il venait d’entrer dans sa soixante-troisième année, le père Belhoste laissait une veuve et six enfants : trois filles et trois garçons. Cet homme, qui était né quatre ans après la mort du Roi Soleil, qui avait connu la Régence et le règne de Louis XV, quittait ce monde alors que celui-ci s’apprêtait à entrer dans les temps modernes. Comme son père avant lui, et ses fils ensuite, il avait appris à lire et à écrire, et avait acquis peu à peu les quelques arpents de terre qui lui avaient permis de nourrir sa famille et de survivre aux famines des années vingt-cinq et cinquante. Mais, au grand dam de son épouse, il n’avait pu se hisser au-delà de sa condition de paysan.
À peine majeur, Nicolas enterra son père, très inquiet de la guerre contre les Anglais pour laquelle la France mobilisait ses jeunes recrues, en espérant que sa position de fils aîné et soutien de famille lui permettrait d’échapper à la conscription. Mais avant que l’État ne lui reconnaisse ce statut, c’est sa mère, Marie-Anne, qui le consacra chef de famille.
Du temps du père, les repas du laboureur se passaient de manière très informelle. La mère sortait le pain du four, le père y traçait une croix avec son couteau et découpait des tranches qu’il distribuait aux enfants. Puis sa femme versait dans les écuelles de bois une louche de la soupe, parfois agrémentée de viande, et chacun s’installait où il le pouvait. Le père prenait une chaise et posait son bol sur un tabouret recouvert d’un linge, les petits s’asseyaient au sol, les plus grands mettaient leur gamelle sur une chaise ou un trépied. Nicolas mangeait debout, près de sa mère, à côté de la fenêtre.
Dès que son mari fut porté en terre, la mère imposa d’autres habitudes. Son premier acte de modernité fut de faire fabriquer une grande table et des sièges en nombre suffisant. Le jour de la livraison, elle ordonna à ses enfants de s’asseoir sur les bancs et d’attendre que chacun soit servi pour commencer à manger. Quand elle enjoignit à son fils Nicolas de prendre place sur la chaise paillée au bout de la table, face à ses frères et sœurs, et qu’elle lui tendit le pain à trancher et le couteau de son père, il comprit qu’il devenait dépositaire du rôle de chef de famille et que désormais, c’était lui qui dicterait la loi. Il en fut reconnaissant à sa mère et se jura de rester digne du trône sur lequel elle venait de le couronner.
À partir de ce jour, il limita l’usage de son prénom à l’univers strictement familial et exigea que dans le village on le nommât désormais par son nom de famille : Belhoste.
Il reprit immédiatement l’exploitation des parcelles familiales, mais comprit très vite que la terre ne suffirait pas à faire évoluer son état, et il chercha d’autres opportunités. Le paysan normand est très attaché à sa maison et au fil des générations, il tient à apporter des améliorations au patrimoine transmis par ses parents. Le jeune homme sentit qu’il y avait de l’argent à faire dans ce secteur et, sans quitter la terre qui nourrit, il apprit à travailler celle qui protège. Trois ans plus tard, il était devenu maçon.
Au fil des années, il s’était forgé la conviction que le système seigneurial avait causé la ruine de ce pays, pourtant si fertile. En 1789, quand éclate la Révolution, il y voit l’occasion de prendre sa revanche en adoptant le parti de ceux qui veulent supprimer les privilèges de la noblesse. Confiant dans sa détermination, son énergie et son intelligence, il ne doute pas un instant de sa capacité à éviter les pièges de cette période troublée. C’est, pense-t-il, l’occasion inespérée de laver l’humiliation en devenant un notable et même, pourquoi pas, un bourgeois.
***
Belhoste n’est pas ce que l’on pourrait appeler un bel homme. Un peu plus petit que la moyenne, c’est toutefois un paysan vigoureux, dans la force de ses trente ans. Ses épaules légèrement tombantes dégagent un cou épais et son visage porte la malice finaude du paysan à travers des yeux vifs et brillants. Sa bouche et ses lèvres fines disparaissent sous une barbe et une moustache fournies qui couvrent le bas de son visage. Il porte les cheveux mi-longs et on a peine à l’imaginer coiffé de la petite perruque brune à cheveux courts qui caractérise les bourgeois de la ville. Hâbleur comme un vrai Normand, un peu couard et fanfaron, mais habile et prudent, il aime prendre son temps et ne se décide jamais avant d’avoir pesé et mesuré les avantages qu’il peut tirer de telle ou telle situation. Sa parole est retenue. Comme tous les Normands, ses phrases ondulent, bombées et allongées sur les voyelles comme pour donner le temps à l’interlocuteur de suivre la pensée. Lorsqu’il se déplace, c’est toujours d’un pas lent, les bras croisés derrière le dos, semblant dire aux importuns : ne me dérangez pas, je réfléchis. C’est donc de ce pas mesuré qu’il rejoint la foule qui envahit la place du village, en ce matin du mercredi 20 mars 1789.
Le dimanche précédent, en terminant son oraison, la voix pointue du père Duhamel s’était élevée de la chaire pour faire une importante déclaration à ses ouailles : « Tous les hommes âgés de vingt-cinq ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s’exprimer mercredi prochain, et à rédiger le cahier de doléances de notre village. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre Grand Roy la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. »
Et ce jour, tous les hommes de Guitry, suivis de leurs femmes et de leurs enfants, se pressent dans l’église pour faire entendre leur voix et espérer mettre fin à des siècles de misère et d’oppression. Le père Duhamel a bien tenté de faire sortir ceux et celles qui ne répondaient pas aux conditions requises pour cette consultation mais c’est tout le village qui envahit l’église, se pressant dans le vestibule, débordant bientôt la travée principale et se dispersant jusqu’au chœur entre les rangées de bancs. Le silence recueilli et l’odeur de l’encens, propres à ce lieu saint, sont bientôt remplacés par un brouhaha fiévreux aux senteurs de sueur, de paille et de fumier. Du haut de sa croix, le Christ ne lève pas un œil sur ses fidèles en passe de devenir des citoyens. Un peu plus loin Lazare, indifférent à l’agitation, continue à sortir de son tombeau, et une Vierge de pierre contemple inlassablement son bel enfant, tandis que la foule, oubliant le respect qu’elle doit à ce lieu sacré, s’agglutine bruyamment autour du greffier envoyé des Andelys pour la rédaction du document. Bien que les membres du clergé ne soient pas consultés, le père Duhamel assiste à l’événement, « pour des raisons de sécurité » a-t-il dit, mais il ne prend pas part aux débats et se tient à distance. Il monte dans sa chaire, s’assied, ne laissant voir que sa tête dépassant de ce qui est encore le symbole de son pouvoir spirituel.





























