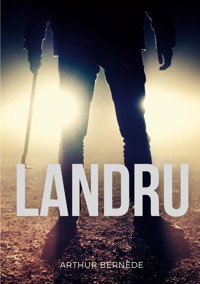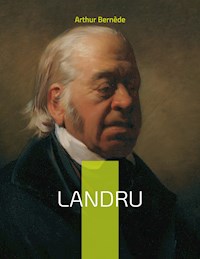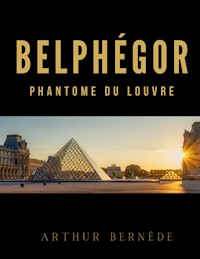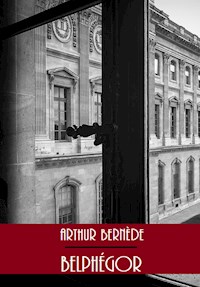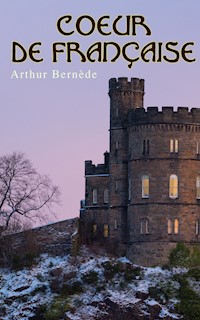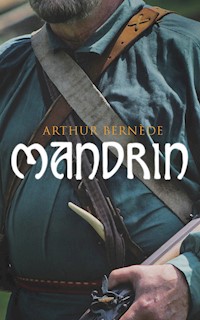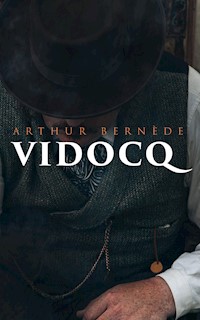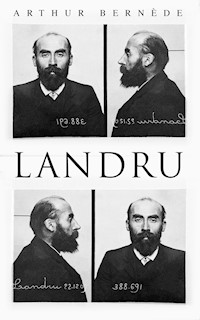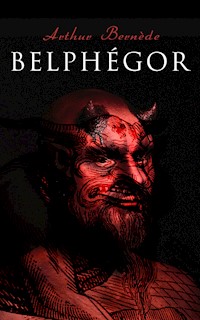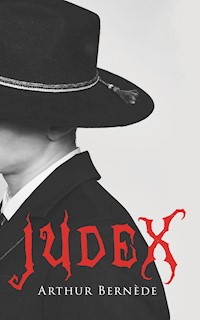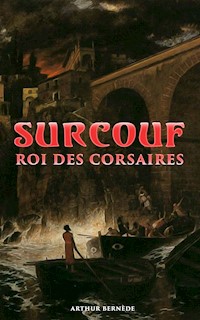0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le lecteur est irrésistiblement emporté par la plume jubilante de Bernède dans un véritable roman de cape et d'épée greffé sur l'épopée napoléonienne: Napoléon est maintenant empereur. Laurence, sa fille ignorée, est devenue auprès de ses parents adoptifs une farouche républicaine, une patriote fervente, membre du très secret club des Philadelphes qui veut la mort de l'empereur. Fidèle à la parole donnée à la comtesse, Malet n'a pas révélé ses origines à celle qui est devenue sa fille... Arthur Bernède (1871 - 1937), est un romancier populaire français. Auteur très prolixe, il a créé plusieurs centaines de personnages romanesques, dont certains, devenus très célèbres, tels que Belphégor, Judex et Mandrin, ont effacé leur créateur. Il a également mis en scène Vidocq, inspiré par les exploits de ce chef de la Sûreté haut en couleurs. Il est également connu sous les noms de plume de Jean de la Périgne et de Roland d'Albret.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
L’Aiglonne
Table des matières
I : L’homme au collet noir
Le 10 août 1792, le vent des grandes révolutions soufflait sur Paris.
Dès l’aube, descendant des faubourgs, précédés de tambours battant la « générale », des bandes d’hommes, la plupart en guenilles et bonnets rouges, armés de piques, de vieux mousquetons, de fusils rouillés, de coutelas, de haches et de gourdins, marchaient sur le château des Tuileries aux cris de « Vive la Nation ! A bas le roi ! »
Sur le quai des Galeries du Louvre, où le tumulte grandissait d’instant en instant, un jeune homme de taille moyenne sangle dans un uniforme sombre d’officier d’artillerie sur lequel tranchait l’or fané de ses épaulettes, chaussé de bottes aux talons éculés, coiffé d’un bicorne aux poils usés et jaunis par les intempéries, très maigre, le teint légèrement olivâtre, la mâchoire énergique et le regard fiévreux, martelait le pavé, indifférent, en apparence, à l’émeute ou plutôt à la Révolution qui grondait autour de lui.
C’est à peine si, de temps en temps, lorsque les hurlements redoublaient, un furtif sourire entrouvrait ses lèvres, en même temps que sa main étreignait nerveusement la poignée de son sabre.
Bientôt, happé par le remous, traîné par la marée humaine jusque dans les jardins des Tuileries, où nulle défense n’avait été préparée, l’officier d’artillerie murmura, en haussant dédaigneusement les épaules :
« Comment a-t-on pu laisser entrer cette “canaille” ? Il fallait en balayer quatre ou cinq cents avec du canon, et le reste courrait ! »
Tout en enveloppant d’un coup d’œil aigu, pénétrant, le spectacle qui s’offrait à lui, il tira de l’échancrure de son plastron un petit calepin relié en cuir vert et muni d’un porte-mine en argent. Le sourcil froncé, il commençait à griffonner d’une écriture illisible des mots qu’il se répétait à lui-même, lorsqu’une voix courtoise et presque familière s’éleva près de lui :
— Hé ! bonjour, lieutenant Bonaparte !
L’officier se retourna vivement et aperçut un homme d’une quarantaine d’années, coiffé d’un large tricorne et vêtu d’un manteau à collet noir, qui lui donnait une vague allure d’ecclésiastique.
Immédiatement, Bonaparte le fixa, cherchant à mettre un nom sur ce visage aux traits anguleux, aux yeux clignotants et à l’inquiétant sourire.
— Citoyen ! fit-il, après un bref examen, je n’ai pas l’avantage de vous connaître.
— Il se peut, riposta le survenant, en élargissant son sourire. Mais, moi, je vous connais très bien, lieutenant, et même mieux que vous ne le supposez…
— Vraiment ?
— Et je remercie le hasard qui me permet de saluer en vous un jeune et brillant officier dont le gouvernement agirait sagement en utilisant mieux les services…
— Comment… citoyen… vous savez ?…
— Je sais que vous vous êtes très brillamment conduit lors des troubles insurrectionnels qui ont agité cette île de Corse, d’où vous êtes originaire. Je sais aussi que pour défendre la France, votre nouvelle patrie, vous n’avez pas hésité à rompre avec le grand révolté Paoli, que vous aimiez comme un frère, et que, pour demeurer fidèle aux lois de l’Assemblée nationale, vous avez été jusqu’à refuser d’exécuter un ordre suspect de votre colonel.
— Mais, citoyen…
— Attendez !… Dénoncé et mandé à Paris, pour justifier votre conduite, vous n’avez eu aucune peine à convaincre de votre loyalisme le ministre de la Guerre… Enfin, je n’ignore point que, malgré cela, renvoyé de bureau en bureau, vous attendez toujours qu’on vous rétablisse dans vos droits et que l’on vous rende votre grade. Vous voyez donc, lieutenant, que je suis très exactement renseigné sur votre compte…
— Ah ça, citoyen, s’écria Bonaparte, qui avait écouté son étrange interlocuteur avec un étonnement croissant. Este que, par hasard, vous seriez de la police ?
— Non, lieutenant, s’écria l’homme au collet noir, je suis tout simplement professeur au collège de Nantes, en Bretagne. Féru des idées nouvelles, ennemi acharné du despotisme, j’ai profité des vacances pour venir assister à la chute de la monarchie.
Et, désignant les hordes qui s’apprêtaient à livrer au palais des rois un assaut suprême, il ajouta :
— Je crois bien que je suis arrivé au bon moment… C’est bien l’hallali de la royauté…
— Je partage votre avis, citoyen, reprit Bonaparte, qui n’avait cessé de considérer d’un regard soupçonneux son mystérieux interlocuteur. Mais tout cela ne me dit pas comment vous avez appris sur moi tant de choses.
— De la façon la plus simple au monde, lieutenant. Depuis quelques jours, je prends mes repas rue de Valois, chez le même traiteur que vous.
— Aux Trois Bornes ?
— Oui, lieutenant… Aux Trois Bornes… Vous ne m’avez pas remarqué… Rien d’étonnant à cela !… Mais, vous, vous avez une physionomie qui attire tout de suite l’attention… Aussi vous ai-je observé… et même écouté, lorsque vous faisiez, à très haute voix, vos confidences à l’un de vos amis, qui tient boutique de meubles, près de la place du Carrousel, à l’ancien hôtel Longueville…
— Fauvelet… murmura Bonaparte, de plus en plus stupéfait.
— C’est cela… Fauvelet… Ah ! combien je déplorais de vous entendre vous écrier d’un air découragé : « J’en ai assez ! Je vais donner ma démission !… » Et comme je maudissais tout bas cet ami, lorsque, au lieu de vous dissuader d’un pareil acte, il voulait vous persuader qu’en louant avec lui plusieurs maisons en construction, dans la rue Montholon, vous réaliseriez, en les sous-louant, d’importants bénéfices.
— Il faut bien vivre… souligna l’officier en disgrâce.
— Un soldat tel que vous a mieux à faire que de se lancer dans un aussi méchant négoce.
— A faire quoi ? citoyen… s’exclama nerveusement Bonaparte. Ah ! je ne m’illusionne ni sur les hommes, ni sur les choses… Depuis Louis XIV, notre pays a eu des maîtres, mais pas de chefs. En ce moment, ses fils, exaspérés par de longs siècles de servitude et indignes de voir ce fantôme de roi qu’est Louis XVI conspirer avec l’étranger pour rétablir son trône chancelant, cherchent à secouer le joug… et ils vont le briser… Et après ?… Quelle main sera assez forte, d’abord pour repousser l’invasion qui se prépare, puis pour canaliser le courant révolutionnaire et reconstruire une France nouvelle sur les ruines d’un régime déchu ?… Ceux qui sont au pouvoir sont de pauvres gens !… Chacun cherche son intérêt. On intrigue aujourd’hui plus vilainement que jamais… Tout cela détruit l’ambition… Vivre tranquille, jouir des affections de la famille et de soi-même, voilà citoyen, le parti que l’on doit prendre. Et c’est celui auquel je me suis arrêté.
— Venez avec moi, invitait le professeur, et je vais vous faire assister à un spectacle qui pourrait bien changer le cours de vos idées.
Bonaparte hésita un instant. De nouveau, il considérait son interlocuteur avec une curiosité dans laquelle il entrait encore quelque méfiance.
Ce n’était plus l’humble pédagogue provincial, au parler mielleux et aux gestes bénisseurs de clerc laïque qu’il avait devant lui.
L’homme au collet noir s’était entièrement transformé. Ses paupières, nettement soulevées, laissaient apercevoir un œil luisant d’intelligence et de ruse… Sa bouche ne souriait plus… mais elle semblait respirer une indomptable énergie. Sa voix s’était faite mieux que persuasive, entraînante, si bien que Bonaparte, plus fasciné que séduit, lança d’une voix brève et déjà impérieuse :
— Citoyen, je vous suis !…
Bonaparte et son guide se faufilèrent à travers les rangs des émeutiers qui, répandus parmi les parterres saccagés, n’avaient d’yeux que pour les Tuileries, dont ils convoitaient la prise.
Traversant le jardin dans toute sa largeur, ils parvinrent ainsi jusqu’à la terrasse des Feuillants, qui conduisait au manège, où l’Assemblée nationale siégeait en permanence.
S’arrêtant devant une grille, qui n’avait pas encore été forcée, l’homme au collet noir dit à Bonaparte :
— Restons ici. Nous serons très bien pour voir.
— Voir quoi ?
— Ce qui va se passer.
A peine achevait-il ces mots, qu’une immense clameur s’élevait dans les jardins :
— A bas le tyran !… A mort !… A mort !…
D’une petite porte du château, qui donnait directement sur la terrasse des Feuillants, un cortège venait de déboucher sous la protection ironique et mal assurée des gardes-françaises, que l’on devinait prêts à faire cause commune avec la Révolution.
En tête figurait Roederer, procureur général de la Commune de Paris, ceint de son écharpe et entouré de la plupart des directeurs du département. Louis XVI suivait, rouge, congestionné, la démarche lourde, hésitante.
A ses côtés, marchait Marie-Antoinette, qui, la tête haute et les traits courroucés, semblait n’avoir rien abdiqué de son orgueil et représentait vraiment, à elle seule, la royauté absolue.
Venaient ensuite, Madame Elisabeth, sœur du roi, au bras de laquelle se suspendait sa nièce, Madame Royale, âgée de treize ans, puis la marquise de Tourzel, gouvernante des Enfants de France, qui tenait par la main le petit Dauphin inconscient du danger et souriant presque à l’orage.
Enfin, quelques rares gentilshommes résolus à suivre jusqu’au bout leur maître infortuné.
Et la clameur se faisait toujours plus sinistre, plus violente :
—À mort !… À mort !…
Lorsque les portes de l’Assemblée nationale se furent refermées derrière le dernier serviteur de la royauté expirante, la foule, ivre de rage, se rua vers les portes des Tuileries, envahissant le palais, massacrant tout sur son passage.
Bonaparte, empoigné par la fièvre des batailles, se retourna vers son compagnon pour l’entraîner à son tour.
Mais une exclamation lui échappa.
L’homme au collet noir avait disparu.
II : La dame en robe blanche
Cette fois, Bonaparte n’avait pas hésité.
Mû par cet élan irrésistible qui précipite instantanément tout vrai soldat à l’endroit où l’on se bat, il avait atteint, en quelques rapides enjambées, l’entrée principale du palais.
De toutes parts, retentissaient le crépitement des fusils et le choc des armes…
Bonaparte, au milieu de la populace délirante, escaladant les marches du grand escalier, qui ruisselait du sang des gardes et des Suisses, va pénétrer, pour la première fois, dans le palais des rois.
Il arrive au vestibule du premier étage, où plusieurs vieux gentilshommes, armés de leurs frêles épées de cour, s’efforcent de défendre les appartements où sont réfugiées les dames d’honneur de la reine et de Madame Elisabeth.
En un clin d’œil, ils sont abattus : les massacreurs, brisant à coups de hache les portes aux moulures dorées, se précipitent dans les salles, semant partout la terreur.
Bonaparte, pâle, frémissant, tourmentant la poignée de son sabre, pénètre dans les appartements du roi…
Le voilà dans le cabinet de travail, dont le parquet est jonché de parchemins, de feuilles de papier, de livres écartelés sur lesquels dansent frénétiquement des énergumènes.
Il passe dans la chambre à coucher. Là, le pillage est à son paroxysme. Une pendule, renversée de son socle, gît devant la cheminée… Le buste de la reine est ignominieusement souillé… Le portrait de Louis XVI a les yeux crevés… Des forcenés démolissent, à coups de pics, un secrétaire, dont les tiroirs, qui renferment des rouleaux d’or, des brevets de l’ordre de Saint-Louis, des titres de noblesse, des lettres de cachet, sont immédiatement vidés.
Cette fois, c’en est trop !… Bonaparte, malgré son empire sur lui-même et sa volonté de rester impassible, sent une nausée de dégoût lui monter à la gorge.
Et il va s’éloigner, lorsque, soudain, un cri atroce le cloue sur place :
— Grâce !… Pitié… ! A moi !… A moi !
Poursuivie par une bande d’insurgés, une jeune femme, d’une radieuse beauté, toute vêtue de blanc, ses magnifiques cheveux dénoués sur ses épaules, en proie à une frayeur inexprimable, se précipite vers le jeune officier en implorant :
— Défendez-moi !… Sauvez-moi !…
En un geste d’instinctive protection, Bonaparte lui a ouvert tout grands ses bras où elle se jette, éperdue… Des massacreurs cherchent à lui arracher leur proie.
Mais à peine l’un d’entre eux, un colosse débraillé, au torse et aux bras nus, a-t-il posé sa main énorme sur l’épaule de l’infortunée, que Bonaparte, l’œil enflammé, s’écrie :
— Citoyen, je te défends de toucher à cette femme !
— D’abord, toi, qui es-tu ? grincent plusieurs voix courroucées.
— Je suis un soldat au service de la France, clame Bonaparte, d’une voix métallique, qui résonne comme un appel de trompette. Croyez-vous donc, poursuit-il, servir la cause de la liberté en assassinant des femmes ?… Etes-vous des hommes libres ou des bêtes féroces ?
Un silence profond accueille ces paroles.
Les fauves sont domptés… Bonaparte vient de remporter sa première victoire ! Mais, comprenant qu’il ne faut pas donner à la haine assoupie le temps de se réveiller, il souffle à l’oreille de la dame en robe blanche, qui semble prête à défaillir :
— Venez, citoyenne !
Et, ouvrant brusquement une petite porte pratiquée dans la boiserie, il entraîne la jeune femme qui s’est accrochée à son bras… Puis, poussant rapidement un verrou extérieur, il scande :
— Et maintenant, madame, remettez-vous et guidez-moi.
Tandis que, revenus de leur stupeur, les tigres se jettent sur la porte et cherchent à l’enfoncer, la jeune femme, stimulée encore plus par la voix de son sauveur que par les affres du danger, lui dit :
— Lieutenant, suivez-moi !…
Tous deux, après avoir longé l’étroit couloir de service qui dessert les appartements du roi, atteignent le palier d’un escalier qui conduit au rez-de-chaussée du palais.
Rapidement, ils descendent les marches et se trouvent en face d’un étroit boyau à peine éclairé par de minuscules ouvertures grillées.
La jeune femme, qui semble connaître à merveille tous les tours et les détours du château, s’y engage aussitôt… Mais, à mesure qu’ils s’avancent, une fumée âcre, irritante, les prend à la gorge.
Suffoquée, la malheureuse chancelle. Bonaparte, qui la soutient, va rebrousser chemin, lorsque des cris menaçants lui annoncent que les massacreurs ont retrouvé leur trace.
Bonaparte saisit sa protégée dans ses bras et, continuant à marcher à travers le nuage qui s’épaissit de plus en plus, il arrive jusqu’à l’intérieur d’un bâtiment où un violent incendie s’est déclaré.
A travers une fenêtre, il aperçoit une petite cour déserte, Où tombent de grosses flammèches.
Sans hésiter, Bonaparte s’y élance, aidant ensuite la dame du palais à le rejoindre… De là, ils gagnent en courant une porte qui donne sur la rue de 1’Echelle…
Avisant un cabriolet de place qui passe à vide, l’officier fait signe à l’automédon de s’arrêter… Puis, emportant dans ses bras la dame en robe blanche, qui s’est évanouie, il l’installe sur les coussins et lance au conducteur :
— A l’hôtel de Metz… et au galop !
III : A l’hôtel de Metz
Trois semaines après les événements que nous venons de décrire, vers huit heures du soir, un homme vêtu d’un long manteau à collet noir, coiffé d’un tricorne enfoncé jusqu’aux oreilles, suivait, en s’appuyant sur une canne à poignée en bec de corbin, la paisible rue du Mail.
Arrivé à la hauteur de l’hôtel de Metz, il s’arrêta et, soulevant légèrement ses « besicles », dont les verres sombres devaient gêner sa vue, il promena minutieusement son regard sur la façade de la maison.
Bientôt, il eut un léger tressaillement… L’une des fenêtres du troisième étage venait de s’ouvrir, laissant apparaître une jeune femme blonde au profil aristocratique et aux allures de grande dame.
« Elle doit être seule », murmura-t-il en la voyant se pencher sur la balustrade en fer ouvragé et interroger d’un air anxieux le carrefour de la rue de Cléry et de la rue Montmartre.
Vite, il traversa la chaussée et pénétra dans le corridor de l’hôtel.
— Holà ! quelqu’un ! fit-il d’une voix plaintive.
Emergeant d’une porte, qu’il remplissait à lui seul de sa puissante carrure, un grand et gros gaillard, à la face rubiconde de Bourguignon réjoui, coiffé du bonnet classique, le traditionnel couteau à manche de bois et à gaine de cuir passé à la ceinture, se dressa devant le visiteur : — Vous désirez souper… môssieu ?
— Non, merci, répliqua l’inconnu. Je suis très fatigué et je voudrais me reposer tout de suite… Auriez-vous une chambre à me donner ?
— Une chambre ! s’écria avec véhémence le sieur Maugeard, qui, depuis un quart de siècle, présidait aux destinées de l’hôtel de Metz. D’abord, le logement, ce n’est pas mon affaire. Moi, je ne m’occupe que de la table.
Et d’une voix qui fit trembler les carreaux de la porte d’entrée : — Grippe-Sols ! lança-t-il… Grippe-Sols… Il y a du monde !
À cet appel, un garçon d’une vingtaine d’années, preste, déluré, au sourire enjoué d’Ange Pitou, et au nez retroussé de Cadet Rousselle, s’empressa d’apparaître : — Voilà, patron, voilà !
— Occupe-toi de ce môssieu. Et, une autre fois, tâche d’être là pour recevoir la « pratique ». Car je n’ai pas envie de laisser brûler mon rôti et d’attacher mes pâtisseries !
Tout en bougonnant, le sieur Maugeard regagna ses fourneaux.
— Alors, citoyen, reprit aimablement Grippe-Sols, que les menaces de son patron ne semblaient nullement intimider, c’est pour une chambre ?
— Oui, mon ami.
— J’en ai plusieurs à vous offrir, au premier, au deuxième…
— Non, merci… Ce serait trop cher pour ma maigre bourse… Je me contenterai d’un simple cabinet, voire d’une mansarde.
— Comme il vous plaira, citoyen… Si vous voulez bien monter ?
— Je vous suis.
Grippe-Sols prit sur une étagère un bougeoir en étain dont il alluma la chandelle à moitié consumée. Puis, il commença l’ascension de l’escalier étroit et obscur qui desservait tous les étages.
Arrivé au quatrième, l’homme au collet noir posa familièrement la main sur l’épaule de Grippe-Sols… et, sur un ton plein de bienveillance, attaqua : — Il n’a pas l’air très endurant, le sieur Maugeard.
— Lui ! s’esclaffa le jeune commis… Mais il ne serait pas capable de faire du mal à une mouche !
— En tout cas, tu -ne dois pas toucher gros, à son service ?
— Pas trop, en effet. Heureusement qu’il y a des voyageurs qui, de temps en temps, m’offrent la pièce.
— Veux-tu gagner un écu… là… tout de suite ?
— Un écu ? répliqua Grippe-Sols avec scepticisme.
Et, d’un ton gouailleur, il ajouta :
— Vous êtes donc un richard ?
— Peut-être.
— Vous qui me disiez tout à l’heure que votre escarcelle était aux trois quarts vide !
— Ne suis-je pas libre de dépenser mon argent à ma guise ?
— C’est vrai, citoyen.
— Donc, il y a un écu pour toi, si tu réponds nettement aux questions que je vais te poser.
— Donnez d’abord… je parlerai après.
— Tu es un madré compère… Tiens, voilà ton écu…
— A vos ordres, citoyen.
— C’est bien ici, n’est-ce pas, qu’habite le lieutenant Bonaparte ?
— Parfaitement, citoyen, à l’étage en dessus, au n° 141.
— N’a-t-il pas une compagne ?
— Oui… une belle dame, ma foi, qu’il a amenée avec lui, le jour où le peuple a pris d’assaut le château du tyran.
— Comment s’appelle-t-elle ?
— Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais si vous vouliez m’allonger un second écu, peut-être pourrais-je vous apporter demain le nom de la particulière.
— Je n’en ai pas besoin.
— Tant pis !
— Tu ne perdras pas au change, car, au lieu d’un écu, je puis t’en faire gagner trois.
— Pas possible !
— Tu n’as qu’à me donner la mansarde qui se trouve juste au-dessus de la chambre du lieutenant… Comment l’appelles-tu, déjà ?…
— Bonaparte.
— C’est cela, Bonaparte.
Donne-moi la mansarde et je te ferai cadeau d’un beau louis d’or avec lequel tu pourras offrir quelques gentils colifichets à ta bonne amie.
— Ah ça ! vous êtes donc un grand seigneur ?
— Hélas ! non.
— En tout cas, vous êtes digne de le devenir.
— Alors, j’ai ma mansarde ?
— Vous l’avez !
Ouvrant d’un air comiquement cérémonieux une porte placée au centre du couloir, Grippe-Sols fit pénétrer l’homme au collet noir dans une pièce carrelée et sommairement meublée d’un lit en bois, d’une commode et de deux chaises de paille.
— Citoyen, fit-il, vous êtes chez vous. Attendez-moi un instant, je vous apporte des draps blancs…
— Ce n’est pas la peine… Je m’étendrai tout habillé ; car, demain, il faut que je sois debout à la première heure.
— Devrai-je vous réveiller ?
C’est inutile.
Et, glissant le louis promis dans la main que Grippe-Sols lui tendait, le voyageur lança avec cordialité : Bonsoir, mon garçon !
Bonsoir, citoyen !
Grippe-Sols, sans insister, se retira en grommelant : « Drôle de bonhomme ! C’est égal, je ne demanderais pas mieux qu’il m’en tombe un comme ça tous les soirs, à l’hôtel de Metz ! »
Aussitôt Grippe-Sols éclipsé, l’homme aux besicles s’enferma à clef. Après avoir constaté que la mansarde n’avait pas d’autre issue qu’une fenêtre à tabatière qui donnait sur les toits, il enleva son tricorne et son manteau, qu’il déposa sur le lit ; et, plaçant à terre le bougeoir que lui avait laissé le garçon du sieur Maugeard, il tira de la poche de son habit un « eustache » à manche de corne, dont il arma la lame fraîchement aiguisée. Puis, s’agenouillant, il introduisit la pointe de son couteau dans la rainure d’un des carreaux en tuile qui recouvraient le sol.
Presque aussitôt, sous la pression, la plaque d’argile se soulevait, découvrant une ouverture contre laquelle notre homme immédiatement colla son oreille.
Bientôt, un sourire de satisfaction donnait à sa figure une expression de méchanceté sournoise et de ruse satisfaite. En bas, une porte venait de claquer, tandis que montait une voix de femme harmonieuse et tendre : — Vous… Vous, enfin !
L’homme au collet noir se prit à murmurer :
— Et maintenant, à nous deux, madame la marquise !
IV : La belle Toinon
Laissons notre mystérieux personnage à son poste d’écoute, descendons à l’étage inférieur et pénétrons au n° 14, ce qui va nous permettre d’être les témoins de ce qui va s’y passer.
Au milieu d’une pièce à l’ameublement suranné et au confort relatif, qu’égayaient quelques jolies roses émergeant d’un vase en tôle grossièrement peinte, la jolie personne que nous avons vue quelques instants auparavant se pencher à la fenêtre entourait de ses bras un jeune officier d’artillerie.
Tout en laissant retomber sa tête sur son épaule, elle murmurait d’une voix que le frisson de l’inquiétude faisait trembler :
— Que je suis heureuse de vous revoir ! J’avais si peur qu’il ne vous fût arrivé une fâcheuse aventure !
— A moi… ! fit Bonaparte.
— Dans les temps troubles que nous traversons, nul n’est à l’abri des coups de l’infortune. Aussi tremblais-je que vous n’eussiez été dénoncé et accusé de donner asile à une aristocrate.
Dénoncé ?… Par qui ?… Puisque personne ici… personne ; pas même moi, ne connaît votre nom ?
— Est-ce un reproche ? reprit la jeune femme, avec un peu d’amertume…
— Pourquoi, en effet ? s’écria Bonaparte avec vivacité. Oui, pourquoi vous obstiner à ne pas me dire qui vous êtes ? N’auriez-vous pas confiance en moi ?
— Je vous en prie, mon ami, chassez de vous cette mauvaise pensée… Après l’héroïsme que vous avez déployé pour m’arracher à mes bourreaux, et plus encore peut-être devant cette affection toute dévouée que vous me témoignez, je serais la plus ingrate des créatures, si je ne vous accordais pas une foi absolue, en même temps qu’une reconnaissance infinie. Tout de suite, au contraire, je me suis sentie si puissamment attirée vers vous, qu’à peine ce seuil franchi, je vous appartenais déjà toute, et lorsque vous m’avez dit de votre voix si persuasive, si pénétrante : « Restez, je vous en prie ! », j’étais tellement troublée que mes lèvres n’ont trouvé pour vous répondre qu’un baiser qui vous a livré toute mon âme.
— Et qui fait de moi l’amant le plus heureux de la terre ! s’écria Bonaparte, en étreignant sa compagne.
Doucement, celle-ci se dégagea : et, prenant les mains de son sauveur, elle fit, tout en l’enveloppant de son regard dont l’éclat s’atténuait d’une touchante tristesse :
— Cela aura été un beau rêve, mais rien qu’un rêve…
— Pourquoi ? sourit Bonaparte.
— Ne sommes-nous pas appelés tous deux à une destinée trop différente pour que nous ayons la folie de songer qu’il peut devenir réalité ?… Bientôt, vous allez reprendre la carrière des armes…
Elle s’arrêta, la gorge serrée… puis, après un effort, elle reprit :
— Nous devrons bientôt nous séparer, pour longtemps, pour toujours peut-être. Eh bien ! mon ami, si je n’ai pas été forte pour résister à l’élan qui m’a jetée dans vos bras, consentez à ma pudeur de femme le sacrifice que je demande à votre délicatesse… Ne cherchez pas à découvrir mon secret… et votre généreuse discrétion, en me permettant de penser sans rougir aux heures vécues ensemble, fera que vous resterez le plus cher souvenir de ma vie.
— Eh bien ! soit ! ma Toinon, acquiesçait Bonaparte, touché par cette prière qui révélait un cœur à la fois si humain et si fier.
— Alors… c’est juré ?
— C’est juré !
— Oh ! merci ! s’écria la jeune femme, qui, aussitôt, ajouta avec un adorable sourire : Grâce à vous, je vais pouvoir vivre sans remords les instants qui nous restent.
— Instants bien courts, hélas ! reprit Bonaparte avec mélancolie. Ainsi que je vous l’avais dit, je me suis rendu cet après-midi au ministère de la Guerre. L’ordre de rejoindre sans délai mon commandement en Corse m’y attendait.
Et tendrement, mais avec un accent de fermeté décisive, il martela :
— Il faut nous dire adieu… Mais ne croyez pas que je vous abandonne… Mon premier souci a été d’assurer votre sécurité.
Et, tirant de son portefeuille une lettre cachetée qu’il tendit à sa compagne, Bonaparte continua :
— Dès que je serai parti, au nom de votre salut, quittez aussitôt cet hôtel… N’attendez pas le jour pour vous rendre à l’adresse indiquée sur cette enveloppe. Elle est celle d’un homme que je connais personnellement et qui est en relations suivies avec une agence d’émigration. Cet individu, dont je réponds, vous fournira le passeport et le déguisement nécessaires pour gagner l’Angleterre.
Puis, maîtrisant son émotion, il commença à ranger ses rares effets, ses menus objets de toilette et quelques livres dans une petite valise en peau de buffle qui était tout son équipage.
Tout à coup, elle aperçut, entrouvert sur la cheminée, un volume à reliure usée et dont les pages avaient dû souvent être lues et relues, tournées et retournées.
Au moment où elle s’en emparait, Bonaparte releva le front.
— Mon théâtre de Corneille, mon livre préféré que j’oubliais ! s’écria-t-il.
La belle Toinon tendit aussitôt le volume à Bonaparte, qui lui dit :
— Gardez-le, mon amie, ce volume qui m’a suivi partout : à Brienne, à l’école du Champ-de-Mars, à Valence, à Auxonne, dans toutes les villes de garnison ! oui, gardez le, ce cher livre de chevet, où j’ai puisé tout l’amour qu’il y a en moi pour ce qui est sublime…
— Merci ! fit la belle inconnue, en portant le volume à ses lèvres.
— Et moi, reprit Bonaparte, n’emporterai-je pas de vous un souvenir qui, au cours de mes veilles, remplacera le vieux compagnon dont pour vous je me sépare ?
— Si, mon ami.
Détachant un médaillon qu’elle portait au cou, attaché à une chaîne d’or, la jeune femme l’ouvrit et le tendit à Bonaparte.
Le médaillon contenait, en effet, une miniature splendide, chef-d’œuvre de Mme Vigée-Lebrun, peintre favori de la reine Marie-Antoinette.
— Votre portrait ! murmura Bonaparte.
— IL est à vous ! offrait la belle Toinon, mais à la condition que vous vous engagiez sur l’honneur à ne jamais vous en servir pour connaître mon vrai nom…
Une dernière fois, sur le palier de l’escalier où elle l’avait accompagné, Bonaparte étreignit longuement la belle Toinon.
D’un pas rapide, il gagna le vestibule où Grippe-Sols l’attendait, une note à la main.
Posant à terre sa valise, le jeune officier saisit le papier et lut :
Vingt-sept jours de pension double à six livres : trois cent vingt-quatre livres ; frais divers : quatorze livres et six sols ; autres frais divers : neuf livres onze sols. Total, trois cent quarante-sept livres dix-sept sols.
Bonaparte tira de sa poche une bourse dont il versa le contenu sur la table.
— Il me manque trente livres, fit-il, avec une légère grimace. Voulez-vous m’accorder quelque temps de crédit ?
— Impossible… môssieu… intervenait Maugeard, qui était accouru.
— Il faut que je regagne mon poste.
— Si on ne paie pas, môssieu, on ne passe pas !
Alors, Bonaparte, en un geste de colère, s’empara de sa cantine, la lança à Maugeard, en disant :
— Eh bien ! gardez cela en gage !
Sous le choc, le patron de l’hôtel de Metz chancela sur ses robustes assises.
Et tandis que Bonaparte disparaissait dans la rue, Grippe-Sols, envoyant un pied-de-nez à son maître, murmura :
« Attrape, vieux grigou, ça t’apprendra à être moins ladre ! »
Quant à la belle Toinon, elle avait regagné sa chambre. Donnant libre cours à sa douleur, elle s’en fut tomber sur une chaise, en sanglotant.
« Ah ! pourquoi n’ai-je pas pu le suivre ?… Pourquoi n’ai je pas le droit d’être à lui pour toujours ? »
Et elle demeura prostrée pendant de longues minutes… Mais, tout à coup, elle se releva… IL lui semblait qu’on grattait discrètement à la porte.
— Qui est là ? interrogea-t-elle… subitement angoissée.
— Un ami… répondit une voix pleine de discrète onction, qui ajouta aussitôt : Ouvrez… ouvrez vite… Il s’agit de votre vie et de celle de l’homme qui vient de vous quitter.
Cette fois, la jeune femme n’hésita plus.
S’emparant de la lampe, elle s’en fut vers la porte… À peine l’avait-elle entrouverte qu’un homme, enveloppé dans un long manteau au collet noir, pénétrait en coup de vent dans la chambre et refermait vivement la porte. Puis, s’inclinant avec toutes les marques du plus profond respect, il fit, sur le ton de la plus cérémonieuse déférence :
— Excusez-moi, marquise, de me présenter à vous de telle sorte et à pareille heure…
Il n’acheva pas.
Un mot, un nom où frémissaient la colère et l’indignation d’une grande dame outragée, venait de le cingler implacablement au visage comme s’il était à lui seul la plus mortelle des injures :
— Fouché !
V : Fouché
— Eh ! oui, madame la marquise, reprit l’homme au collet noir, avec un impressionnant sang-froid, Fouché, Joseph Fouché, ci-devant père oratorien et actuellement principal du collège de Nantes.
— Sortez ! ordonnait la belle Toinon, avec colère
Mais Fouché reprenait sans s’émouvoir :
— Marquise, permettez-moi de vous faire observer que le temps n’est plus où Marie-Thérèse de Tiffanges pouvait impunément frapper de sa cravache le précepteur de son frère parce qu’il avait eu l’audace de la contempler avec trop d’admiration…
— Monsieur !
— Permettez… Si la loi n’a pas encore proclamé l’égalité de tous les citoyens, les événements ne s’en sont pas moins chargés de briser la barrière qui s’élevait entre une dame de qualité telle que vous et un plébéien tel que moi. Aussi, avant de m’éconduire, écoutez-moi et j’imagine que vous n’aurez pas à vous en repentir.
— Rien, monsieur, ripostait la marquise avec hauteur, non, rien ne saurait m’empêcher de vous chasser de ma présence !
En vérité, madame, insistait Fouché, pourquoi m’accabler de votre mépris avant de connaître le but de la démarche que je tente ce soir auprès de vous ?
— Que puis-je attendre d’un prêtre qui a renié sa foi ?
— Lorsqu’il y a dix ans la scène qui m’a valu votre courroux se déroula dans la maison de M. le comte de Tiffanges votre père, je vous aimais… madame… Oh ! pardonnez-moi… oui, je vous aimais de toute l’ardeur tumultueuse d’un cœur qui jusqu’alors avait complètement ignoré les orages de la passion. Mais rendez-moi cette justice, jamais, jusqu’à cette heure fatale, je ne vous avais laissée soupçonner le feu qui me consumait. Jamais vous n’eussiez deviné ce qui se passait en moi si, un jour, un jeune seigneur ne s’était présenté à vous avec tous les droits du fiancé…
Fouché prit un temps ; puis, il poursuivit :
— Ne croyez pas, madame, que. je fus torturé par la jalousie ! Non ! Si j’étais plongé dans une aussi cruelle affliction, c’était parce que je n’ignorais point que celui qui allait vous épouser, et que j’avais eu pour élève au collège de Juilly, était indigne de devenir votre époux.
Pétri de mauvais instincts, qui n’avaient fait que se développer avec l’âge, le marquis de Navailles ne pouvait que vous rendre la plus malheureuse des femmes… Il n’y manqua point… Bientôt, il vous abandonna pour retrouver la fille d’opéra dont il avait fait sa maîtresse.
A ces mots, la marquise de Navailles cacha entre ses mains son visage qui reflétait tout le désespoir d’une existence prématurément brisée.
— Ne m’en veuillez pas, madame, s’empressa de déclarer Fouché, si je fais renaître en vous d’aussi cruels souvenirs. Mais il le faut pour que vous compreniez que moi, qui avais prévu votre longue suite d’infortunes, je n’aie pu jadis résister à la folle impulsion qui, au moment où vous alliez échanger avec M. de Navailles les promesses vous enchaînant à lui pour toujours, m’avait précipité vers vous ! Vous n’avez vu là que le geste odieux d’un prêtre indigne. Et le châtiment, en suivant aussitôt la faute, ne m’a pas permis de tomber à vos genoux, d’implorer ma grâce ! Chassé de votre présence, ma qualité d’ecclésiastique m’a seule valu de ne pas être bâtonné par vos valets et j’ai dû m’enfuir comme un voleur. A dater de ce moment, rongeant mon frein et dévorant ma honte, j’ai attendu l’heure où, m’arrachant à la servitude dans laquelle j’étais plongé, je pourrais devenir enfin un homme libre de ses actions et maître de sa volonté… Ce jour est venu, madame, et je le bénis de toutes les forces de mon être, puisqu’il me permet de vous sauver !
— Un autre s’en est chargé, monsieur, fit la marquise de Navailles, avec une froideur dédaigneuse.
— Le lieutenant Bonaparte !
— Comment, vous savez ? s’exclama la marquise, en rougissant.
— Oui, je sais !
— Vous nous espionniez donc ?
— Je m’intéresse beaucoup à ce jeune officier. Si je le connais assez pour bien augurer de son avenir, mon devoir est de vous déclarer que sa protection ne suffira pas à vous préserver de la mort.
— De la mort fit Mme de Navailles, dont les yeux s’étaient dirigés instinctivement vers la lettre qui se trouvait sur le guéridon. Fouché, gravement, continuait :
— Vous êtes accusée de correspondre avec la duchesse de Polignac, ci-devant favorite de la reine et actuellement réfugiée à Vienne, en Autriche. Un mandat de prise de corps a été décrété contre vous et votre arrestation n’est plus qu’une question d’heures, de minutes, peut-être.
— Eh bien ! que l’on m’arrête !
Pourquoi parler ainsi, lorsque tout peut encore très bien s’arranger.
Comment cela ?
— En partant avec moi. Et, tranquillement, Fouché ajouta :
— J’ai quelques accointances avec la police et j’ai pu me procurer un double passeport à mon nom et à celui de ma sœur Marie-Françoise. Une chaise de poste nous attend à l’angle de la rue Vide-Gousset et de la place des Victoires… Nous y montons et en quelques relais…
— N’ajoutez pas un mot.
— Pourquoi ?
— Je refuse, car je préfère la prison et même la mort à la pensée de vous devoir mon salut.
— Mais c’est de la démence !
— N’insistez pas…
— Un mot, cependant…
Et, dirigeant à son tour un regard cauteleux sur la lettre que Bonaparte avait remise à la belle Toinon, il reprit, d’un ton fielleux sous lequel se devinait la plus perfide des menaces :
— Vous oubliez une chose, madame… C’est qu’en refusant une offre que seul m’inspire mon profond dévouement à votre personne, non seulement vous vous condamnez vous-même, mais vous entraînez dans votre perte celui qui, non content de vous donner asile, vous a encore confié un message pour un agent royaliste, qui, si je suis bien renseigné — et je le suis — a été écroué ce tantôt à la prison des Carmes.
— Misérable ! rugit la marquise à bout de patience… à quel degré de bassesse en êtes-vous tombé, pour avoir l’audace de me proposer un pareil marché !
Et sublime de la plus noble indignation qui eût jamais fait battre un cœur de femme, Marie-Thérèse prononça :
— Allez ! prêtre indigne, religieux renégat, traître à votre Dieu et à votre roi ! Allez me livrer à votre justice… car je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous entendre… Vous me faites horreur !
— Eh bien, non ! rugit Fouché. Je ne m’en irai point avant que vous ne m’ayez écouté jusqu’au bout… avant que je vous aie révélé tout ce qu’il y a en moi de douleur et de rage… Car c’est vous qui avez fait de moi l’homme que je suis… C’est à cause de vous que je suis devenu un mauvais prêtre. C’est par vous que, fou d’un désespoir que j’ai dû cacher à tous, je suis devenu l’être astucieux, fourbe et méchant que vous avez sous les yeux.
— Infâme ! Infâme !
— Et lorsque j’arrive à temps pour vous sauver d’un danger terrible, vous me repoussez, vous me souffletez de mots bien plus cruels que votre coup de cravache… Ah ! c’en est trop, cette fois !… Suivez donc votre destinée !
Au paroxysme de la fureur, Fouché s’écria :
— Dites-vous que le jour où vous monterez à l’échafaud, Fouché le défroqué, Fouché le renégat, sera là pour voir votre tête tomber dans le panier !
Un coup violent ébranlait l’huis, suivi de ces mots prononcés d’une voix rude, impérieuse :
— Ouvrez, au nom de la loi !
Que vous disais-je ? ricana Fouché en se dirigeant vers la porte.
Un officier municipal, guidé par Grippe-Sols et accompagné de plusieurs sectionnaires, apparut sur le seuil.
— La ci-devant marquise de Navailles, demanda-t-il d’un ton sévère.
— C’est moi, fit Marie-Thérèse avec un air de dignité incomparable.
L’officier déclarait :
— J’ai reçu l’ordre de vous mettre en état d’arrestation et de vous conduire à la prison de l’Abbaye.
— Je vous suis, fit simplement la marquise, dont le visage avait déjà la beauté d’une martyre résignée au sacrifice.
Et, sans même jeter un regard à l’ex-oratorien qui affectait une attitude effacée, elle se dirigea vers l’officier qui ajouta :
— J’ai également le mandat d’arrêter le lieutenant Bonaparte.
— Le lieutenant Bonaparte n’est plus ici, répliqua Mme de Navailles.
Fouché, qui avait eu le temps de prendre la lettre sur le guéridon et de la faire disparaître adroitement dans une des poches de son manteau, intervenait d’une voix conciliante :
— Le lieutenant Bonaparte est de mes amis… et je me porte garant de son civisme.
Interloqué, l’officier municipal demandait d’un ton rogue :
— Qui donc êtes-vous, pour vous mettre ainsi en travers des décisions de la justice ?
Fouché ne répondit pas. Mais, s’approchant de l’officier, il lui mit sous les yeux un carton qu’il tenait dans le creux de la main et sur lequel quelques lignes imprimées étaient suivies d’une signature autographe sur laquelle était apposé un cachet représentant un triangle formé de trois piques et surmonté d’un bonnet phrygien à cocarde tricolore.
L’exécuteur de la loi, saluant Fouché avec déférence, reprit, instantanément radouci :
— C’est entendu, citoyen, le lieutenant Bonaparte ne sera pas inquiété.
Mme de Navailles, figée de surprise, se demandait à quel mobile Fouché pouvait bien obéir en sauvant son amant…
Mais le chef de section ordonnait :
— Citoyenne, en route !
Marie-Thérèse jeta un dernier regard sur cette chambre où, pour la première fois, elle avait senti battre contre sa poitrine un cœur vraiment digne du sien.
Et comme ses yeux s’arrêtaient sur Fouché, qui avait le cynisme de s’incliner une dernière fois devant elle :
— Judas ! proféra-t-elle en passant en face de lui d’un pas altier et la tête haute.
Tandis que le cortège s’éloignait, Grippe-Sols, dont le visage exprimait une profonde indignation, s’approcha de l’homme au collet noir et lui dit : Citoyen, j’aurais un mot à vous dire.
— Qu’y a-t-il, mon garçon ?
— Reprenez votre louis.
— Pourquoi, mon ami ?
— Parce que j’ai beau être un patriote et un pur…
— Oui, eh bien ?…
— Eh bien, je ne mange pas de ce pain-là !
— Ah çà ! grommela Fouché en empochant la pièce d’or, où les scrupules vont-ils se nicher ?
Comme il gagnait la sortie, la haute stature du sieur Maugeard, en chemise de nuit, en bonnet de coton, la face bouffie de sommeil, se profilait sur le seuil.
— Mille tonnerres ! clama-t-il, qu’est-ce que c’est que tout ce remue-ménage ?
— Patron ! répliqua Grippe-Sols, c’est Judas !
— Judas ! sursauta le colosse.
Et, apercevant Fouché qui tentait de s’esquiver, il le saisit par le bras, et, le jetant dans l’escalier, il lui lança, d’une voix qui acheva de réveiller tous ses locataires :
— Décampe, espèce de jean-fesse et de cuistre ! Et apprends que l’hôtel de Metz n’est pas fait pour les mouchards !
VI : En prison
Il était deux heures du matin…
Dans l’ancienne salle du Parlement de Paris, transformée en tribunal révolutionnaire, l’audience touchait à sa fin.
Encadrée de deux grenadiers en armes, Marie-Thérèse de Navailles, impassible, écoutait le réquisitoire du nouveau substitut, ci-devant procureur au Châtelet, le citoyen Fouquier-Tinville.
Tantôt il s’adressait aux trois juges assis sur une estrade devant une table recouverte d’un tapis vert et qui s’efforçaient de représenter la justice impartiale et rigide.
Tantôt, se penchant vers le banc où siégeaient les jugés, bourgeois et ouvriers, qui, tous, avaient fait leurs preuves de civisme, il développait d’une voix aigre et monotone, presque sans gestes, les griefs de l’accusation.
Et, son réquisitoire terminé, il laissa tomber cette phrase, au milieu d’un silence funèbre :
— Contre la ci-devant marquise de Navailles, coupable d’avoir conspiré avec les ennemis de la Nation, je requiers la peine de mort !
Ce fut à peine si un léger murmure d’approbation s’éleva du fond de la salle, dans la tribune publique, où s’entassaient les habitués de ces représentations tragiques.
Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ? interrogea le président.
— Non, répliqua nettement Marie-Thérèse qui, certaine de son sort, n’avait même pas songé à se faire assister d’un avocat.
Et pourtant Marie-Thérèse avait une raison puissante de tenir à la vie.
Au cours de sa captivité dans cette prison de l’Abbaye où, par miracle, elle avait échappé aux massacres de septembre, elle avait bientôt ressenti les premiers symptômes de la maternité.
Tout d’abord, elle éprouva ce grand coup de joie qui bouleverse toute femme lorsqu’elle s’aperçoit qu’elle porte en elle le fruit d’un amour partagé.
Mais une profonde amertume n’avait pas tardé à succéder à cette minute d’instinctive et sublime allégresse.
Certes, en déclarant sa grossesse, il lui était facile d’obtenir, conformément à un récent décret de la Convention, un délai qui lui permettrait d’attendre des jours meilleurs.
Mais une telle déclaration entraînait l’aveu d’une faute que, maintenant, seule en face d’elle-même, elle se reprochait avec tout le désespoir d’une âme restée ardemment chrétienne.
Voilà pourquoi elle s’était tue… Et, maintenant, dans la sérénité de sa conscience apaisée, elle attendait l’arrêt du tribunal.
Les jurés n’avaient pas tardé à se mettre d’accord. Au bout de quelques minutes, l’accusée, debout, sans forfanterie, mais avec un parfait courage, écouta la lecture du jugement qui la condamnait à avoir la tête tranchée, ce jour même, sur cette place de la Révolution (Aujourd’hui, place de la Concorde. (Note de l’auteur.)) que, trois mois auparavant, Louis XVI avait arrosée de son sang.
Sans une protestation, sans une larme, elle se laissa conduire au greffe de la Conciergerie, d’où, immédiatement, on la fit passer dans une vaste salle voûtée (La salle dite des condamnés occupait l’emplacement où se trouve aujourd’hui le restaurant du Palais de Justice. (Note de l’auteur.)), lugubre antichambre de la mort, où l’avaient précédée plusieurs condamnés qu’au matin la charrette du bourreau Sanson devait venir chercher.
Un conseiller au Parlement, un gentilhomme de la chambre du Roi et un simple valet des écuries, étendus sur de la paille, dormaient côte à côte leur avant-dernier sommeil… Un tout jeune homme traçait fébrilement des lignes d’adieu à sa fiancée. Deux femmes, la mère et la fille, agenouillées sur les dalles, pleuraient en s’appuyant l’une contre l’autre… Un prêtre très âgé psalmodiait des prières.
Marie-Thérèse s’en fut s’asseoir sur une des marches de pierre de la porte vitrée qui donnait sur la cour de Mai… A travers les carreaux gris de poussière se profilait dans le jour naissant la silhouette d’un municipal en armes.
Tirant de son corsage le Corneille que Bonaparte lui avait donné et dont, pendant sa longue captivité, elle aimait à relire les plus beaux passages, elle le feuilleta, s’arrêtant à ces admirables stances de Polyeucte, où le poète, emporté par sa foi, s’est élevé à la hauteur de Dieu : Vos biens ne sont pas inconstants, Et l’heureux trépas que j’attends . Ne vous sert que d’un doux passage Pour nous introduire au partage Qui nous rend à jamais contents !
Mais bientôt la marquise de Navailles dut cesser sa lecture. Les caractères d’imprimerie dansaient devant ses yeux et se brouillaient comme dans un nuage… Ce n’était plus un livre qu’elle tenait entre ses mains, mais une tête expressive et superbe qui la dévorait de son regard de feu et dont les lèvres laissaient échapper des paroles enfiévrées.
« Lui ! » fit-elle, enveloppée par cette hallucination qui la transportait du corridor de la guillotine dans la petite chambre de l’hôtel de Metz, lorsque, au soir de leur tragique rencontre, Bonaparte lui avait donné son premier baiser.
— Tu n’as pas le droit de détruire l’être qui est en toi, car il m’appartient autant qu’à toi-même. Je veux qu’il vive !
En proie à une sorte de vertige, la marquise de Navailles voulut se lever… Il lui semblait qu’un double cercle de fer enserrait ses poignets… tandis que la voix implacable scandait sans arrêt, d’un accent de plus en plus terrible :
— Je le veux !… Je le veux !
Secouée par un frémissement mortel, la malheureuse s’écroula sur le sol.
Quand elle revint à elle, le bourreau était là… Un de ses aides la secouait par le bras.
— Allons ! debout !… citoyenne !
Un autre valet s’approchait, des ciseaux à la main, et s’apprêtait à couper sa magnifique chevelure.
D’un bond, la marquise de Navailles se redressa… Elle venait d’apercevoir, à travers la porte ouverte, la fatale charrette qui stationnait dans la cour de Mai et dans laquelle déjà on avait fait monter quelques condamnés, les mains liées, la tête tondue et la chemise échancrée.
Un cri lui échappa… cri non de victime saisie d’horreur et d’épouvante, mais de mère qui vient de sentir son enfant tressaillir dans son sein, comme s’il réclamait d’elle le droit à la vie.
Tendant ses mains suppliantes vers les hommes de mort qui l’entouraient, elle clama d’un accent déchirant :
— Ne me tuez pas encore, car je vais être mère !
Dans l’ombre d’un étroit cachot de la Conciergerie, une femme assise sur un méchant lit de sangle donne le sein à un enfant de quelques semaines.
Elle contemple d’un air douloureux la frêle créature qui aspire avidement le lait maternel… Mais bientôt des pleurs coulent le long de ses joues amaigries.
Elle sait que ce n’est pas une grâce qu’elle a obtenue, mais un simple sursis à l’exécution de l’arrêt qui la condamne à mort. Elle n’ignore point que dans quelques jours, dans quelques heures, peut-être, le bourreau viendra de nouveau réclamer sa proie.
Torturée par les affres les plus cruelles qui peuvent bouleverser un cœur de mère, la malheureuse se dit :
« Puisque je n’ai pas eu le courage de résister à l’appel inconscient de l’être qui déjà vivait en moi, pourquoi ne l’ai-je pas laissé emporter dès sa naissance ?… Pourquoi l’ai-je gardé près de moi, m’attachant de toutes les fibres de mon cœur à celle dont on va bientôt me séparer pour toujours ? »
Oh ! l’horrible agonie de cette mère qui ne sait plus que sangloter, la tête penchée au-dessus de son enfant :
« Ma fille !… Ma chérie !… Ma bien-aimée !…»
Reprise par les transes qui l’avaient décidée tout d’abord à dissimuler sa maternité, et, comme elle le disait, à emporter avec elle son enfant dans sa tombe, elle se demande en pleurant :
« Que va devenir cette innocente ? »
Un commissaire de la Commune de Paris, qui la visitait quelques jours auparavant dans sa prison, et dont les yeux lui semblaient refléter quelque pitié, lui a bien déclaré :
Rassurez-vous, citoyenne, votre fille sera élevée par la Nation.
Mais cette parole, au lieu de la calmer, l’a plongée dans l’épouvante
Que signifie, en effet, pour cette fille d’aristocrates, pour cette dame d’honneur de Marie-Antoinette, le mot de Nation, qui a remplacé celui de Royauté, que, dès sa plus tendre enfance, elle a été appelée à vénérer et à chérir ?
Comment, dans cette foule surexcitée par des meneurs, exaltée par la fièvre de la liberté, grisée par ce sentiment, nouveau pour tous et incompréhensible pour elle, qu’est le patriotisme, pourrait-elle entrevoir la moindre lueur de compassion et de générosité.
Et, malgré elle, la malheureuse s’écrie :
« Chère petite, oh ! pouvoir te soustraire à mes ennemis ! Pouvoir te remettre à quelqu’un de sûr, qui t’emporterait là-bas, tout au fond de la Bretagne ou de la Vendée, et te confierait à l’une de ces paysannes qui ont gardé intacts le respect de leur maître et la foi en leur Dieu ! Mais je ne dois pas y songer. Car tu ne m’appartiens même plus. Tu es à la Nation, c’est-à-dire à ces assassins que j’ai vus portant au bout de leurs piques les têtes de nos gardes du corps massacrés par eux ! Tu es à ces énergumènes qui ont renversé le trône et l’autel, à ces régicides qui ont guillotiné mon roi… et qui vont me couper la tête à mon tour ! »
Et de son cœur saignant jaillissent ces paroles frémissantes :
« Seigneur, prenez ma vie, mais épargnez mon enfant… » Mais un bruit de verrous que l’on tire avec brutalité, suivi d’un grincement de clef dans une serrure, l’arrache à sa prière.
La porte du cachot s’ouvre violemment, livrant passage au guichetier en chef, suivi de plusieurs sectionnaires que commande un officier à l’allure martiale, au visage énergique et franc.
La prisonnière a tressailli.
Elle a compris qu’on venait la chercher. Pour la seconde fois, le bourreau l’attend. C’est l’heure !
Un homme robuste, aux yeux de chat, au teint de plomb, à la face grêlée et portant les insignes de substitut au tribunal révolutionnaire, émerge du groupe formé par les soldats et s’avance d’un air hostile et arrogant vers Marie-Thérèse qui l’a tout de suite reconnu.
C’est Fouquier-Tinville, c’est son accusateur, celui qui, pour ses débuts, a obtenu sa tête !
Debout, serrant sa fille contre sa poitrine haletante, elle supplie le ciel de lui donner la force de ne pas défaillir.
D’un ton solennel, le substitut attaque :
— Citoyenne, les délais que le tribunal t’avait accordés sont expirés ! Le moment est venu d’expier ton crime.
— Et mon enfant ? demande la condamnée.
Froidement, Fouquier-Tinville réplique :
— Conformément au décret rendu par la Convention le 12 prairial, de l’An I de la République une et indivisible, ta fille, ainsi que tous les rejetons de condamnés qui ont vu le jour dans les prisons, sera immédiatement dirigée sur l’hospice des Enfants assistés, où elle sera élevée aux frais de l’Etat.
Ces paroles galvanisent la malheureuse.
— Non ! non ! je ne veux pas ! s’écrie-t-elle… Vous ne me prendrez pas ma fille… Tuez-la plutôt avec moi… Mieux vaut pour elle la mort dans mes bras que la vie dans les vôtres !
Implacable, le substitut veut se saisir de la pauvre petite qui fait entendre un plaintif vagissement.
Mais, emportée par une force sacrée, Marie-Thérèse rugit :
— Arrière !… monstre… arrière ! tigre à face humaine ! Je veux te donner ma tête, mais je ne veux pas te livrer l’âme de mon enfant !
Et, s’adressant aux soldats qui l’entourent et s’efforcent de rester impassibles, elle supplie, folle, éperdue :
— Mais c’est horrible, cela, c’est horrible ! Il n’y en a donc pas un, parmi vous, qui aura pitié de moi ?
— Citoyenne, donnez-moi votre petite ! s’écrie soudain l’officier qui commande aux sectionnaires.
— Qu’est-ce à dire ? s’exclame le substitut.
— C’est-à-dire que je l’adopte ! réplique le militaire d’un ton bourru sous lequel on devine, en même temps qu’une réelle bonté, un absolu courage.
— Citoyen officier… veut protester le délégué.
— Citoyen substitut, riposte le soldat, l’adjudant Claude-François Malet a donné assez de preuves de son dévouement à la Nation pour que celle-ci puisse lui. confier sans crainte l’éducation d’une enfant d’aristocrate. Vous pouvez être tranquille, j’en ferai une bonne patriote.
Et, se tournant vers Marie-Thérèse, qui le contemple d’un œil hagard où il n’y a plus de larmes, il ajoute, presque avec douceur :
— … Et une vraie Française !
Mme de Navailles a un instant d’hésitation…
Mais le visage de cet officier respire une telle droiture, une si lumineuse franchise, que, d’un geste brusque, elle lui tend sa fille en disant :
— Eh bien ! prenez-la !
Malet s’en empare… Ses mains robustes tremblent légèrement sous le léger fardeau.
Alors, Marie-Thérèse fait d’un seul élan :
— Je vous la donne, monsieur, mais, au nom de mon honneur, jurez-moi que ma fille n’aura jamais d’autre nom que le vôtre…
— C’est promis, citoyenne ! répond Malet avec force.
— Merci !
Alors, la condamnée, qui semble s’être entièrement ressaisie, prend sous son matelas un volume qu’elle tend à l’officier.
— Promettez-moi aussi, monsieur, demande-t-elle, de lui faire apprendre à lire dans ce livre.
— Quel est son auteur ? interroge Fouquier-Tinville avec méfiance.
— Corneille, réplique fièrement Marie-Thérèse.
— Corneille ! gronde le substitut… mais c’était un royaliste.
— Un poète, rectifie Malet, comme j’en souhaite un à la République !
— Gardes, faites votre devoir, ordonne le substitut qui a verdi de rage.
Les sectionnaires entourent la victime.
Celle-ci se penche vers son enfant que Malet tient dans ses bras. Longuement, elle imprime sur le front pur de sa fille un baiser dans lequel elle fait passer toute son âme de martyre et de mère.
— Adieu, ma bien-aimée, murmure-t-elle en un suprême sanglot… Adieu, je vais prier pour toi.
Et voilà qu’en se relevant elle rencontre le regard de l’officier… Dans les yeux du farouche républicain elle a vu briller deux larmes… Alors, une expression de réconfort infini détend ses traits…
Marie-Thérèse de Navailles peut mourir en paix… Non seulement son honneur sera sauf… mais l’orpheline a retrouvé un père !
VII : Le général Malet
— À la fin, j’en ai assez ! s’écriait un homme d’une cinquantaine d’années, aux cheveux gris légèrement ondulés, au front dégagé, au regard ouvert, à la bouche énergique, au menton volontaire, aux allures martiales d’officier de carrière sous son pantalon à la hussarde et sa redingote prune au col de velours noir.
Tantôt arpentant fiévreusement un petit salon meublé simplement, mais avec goût, et dont les fenêtres donnaient sur la rue des Saints-Pères, tantôt s’arrêtant devant une femme plus jeune que lui de dix ans environ et qui, assise dans une bergère, le considérait avec une expression de tendresse anxieuse en même temps que de touchante admiration, il scandait avec âpreté : — Oui, j’avais bien raison de me méfier de ce Bonaparte. Dès le début de sa vertigineuse ascension vers la gloire, j’avais flairé en lui un ennemi de la liberté ! Je ne me trompais pas, puisque, non content de confisquer à son profit les conquêtes de la Révolution française et de s’édifier un trône sur les cadavres de nos soldats, il s’acharne aujourd’hui contre tous ceux qui, comme moi, sont restés fidèles à leur foi républicaine.
— Calme-toi, mon ami, conseillait la femme avec bonté.