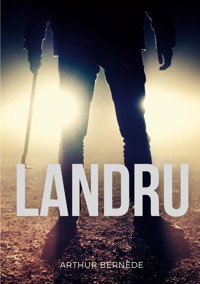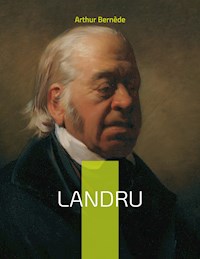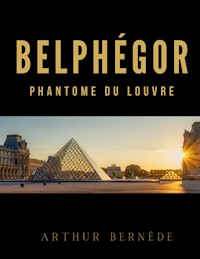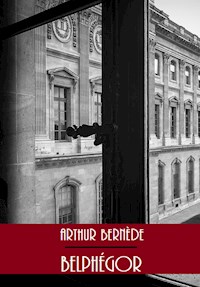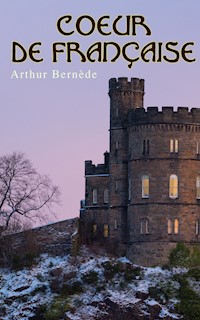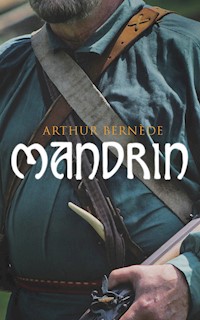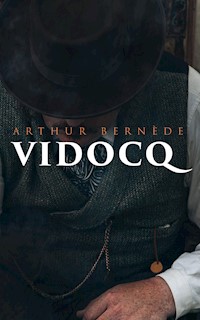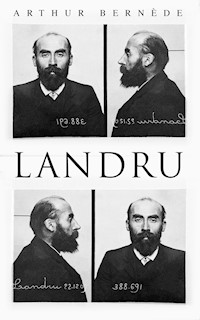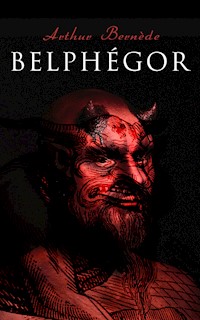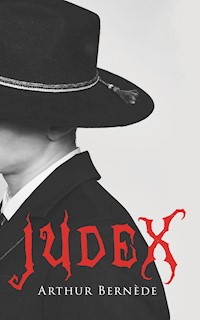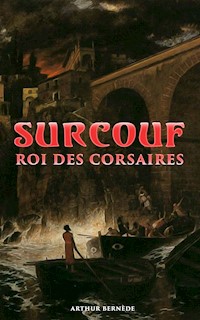Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Mandrin" d'Arthur Bernède est une oeuvre captivante qui plonge le lecteur dans l'univers tumultueux du XVIIIe siècle, une époque marquée par les inégalités sociales et les luttes pour la justice. Le roman retrace la vie de Louis Mandrin, un célèbre brigand français, connu pour ses exploits audacieux et son combat contre les abus de la Ferme générale, l'organisme chargé de collecter les impôts à l'époque. Mandrin émerge comme un héros populaire, un Robin des Bois moderne, défiant les autorités pour défendre les opprimés. Bernède nous entraîne dans une série d'aventures palpitantes où Mandrin, avec son charisme et son intelligence stratégique, déjoue les pièges tendus par ses ennemis. À travers des descriptions vivantes et un récit rythmé, l'auteur parvient à capturer l'essence de cette figure légendaire, tout en explorant les thèmes universels de la rébellion et de la quête de justice. Le lecteur est invité à s'interroger sur la frontière entre le bien et le mal, et sur la légitimité de la révolte face à l'injustice. "Mandrin" est plus qu'un simple récit d'aventures ; c'est une réflexion sur le pouvoir, la résistance et l'esprit indomptable de ceux qui osent défier l'ordre établi. L'AUTEUR : Arthur Bernède, né le 5 janvier 1871 à Redon et décédé le 20 mars 1937 à Paris, est un écrivain prolifique et scénariste français. Connu principalement pour ses romans populaires et ses scénarios de films muets, Bernède a marqué la littérature populaire du début du XXe siècle avec des oeuvres qui captivent par leur intensité dramatique et leur sens du suspense. Parmi ses créations les plus célèbres figure "Belphégor", un roman qui a connu plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles. Bernède a également collaboré avec le cinéaste Louis Feuillade, contribuant au succès de nombreux films à l'époque du cinéma muet. Son style se caractérise par une narration dynamique et une capacité à créer des personnages mémorables, souvent inspirés de figures historiques ou légendaires. Bien que moins connu aujourd'hui, Bernède a joué un rôle essentiel dans l'évolution du roman feuilleton, un genre littéraire qui a su captiver un large public grâce à ses intrigues haletantes. Sa contribution à la culture populaire française reste indéniable, et ses oeuvres continuent d'être redécouvertes par de nouveaux lecteurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
AVANT-PROPOS
PREMIERE PARTIE : Les Noces de Mandrin.
Chapitre I : Les contrebandiers.
Chapitre II : Tiennot le berger.
Chapitre III : Le frère Théatin.
Chapitre IV: La souricière
Chapitre V : Un odieux marché
Chapitre VI : De mystérieux préparatifs...
Chapitre VII : La corbeille de noce.
Chapitre VIII : La maison vide.
Chapitre IX : Au château des aigles.
Chapitre X : Mariée.
Chapitre XI : Une adresse machiavélique.
Chapitre XII : Maitre Alcofribas.
Chapitre XIII : Une nuit de noces mouvementée.
Chapitre XIV : Sourire mêlé de larmes.
Chapitre XV : Rusé comme un singe.
Chapitre XVI: Mandrin chez Voltaire.
Chapitre XVII : Une parole engagée à la légère.
Chapitre XVIII : Le devoir et l'amour.
DEUXIEME PARTIE : La trahison.
Chapitre I : Une décision d'importance.
Chapitre II : Encore un bon tour.
Chapitre III: Une rude bataille.
Chapitre IV : Un bon point pour Pistolet.
Chapitre V : Le démon tentateur.
Chapitre VI : Ou pistolet semble reprendre l'ayantage.
Chapitre VII : La caisse est vide.
Chapitre VIII : La favorite.
Chapitre IX : Le colonel de la Morlière.
Chapitre X : Le Roi Louis XV.
Chapitre XI : Un orage de palais.
Chapitre XII : Raison d'état.
Chapitre XIII : Le retour.
Chapitre XIV : La prisonnière.
Chapitre XV : Au Présidial de Grenoble.
Chapitre XVI : Les deux rivales.
Chapitre XVII : Assaut suprême.
Chpitre XVIII : Au secours de Mandrin.
Chapitre XIX : La messagère.
Chapitre XX : L'exécution.
EPILOGUE
AVANT-PROPOS
En l’an de grâce 1754, sous le règne de Louis XV, M. de Voltaire mandait à son ami le prince de Ligne, qui voyageait en Hollande :
Mon cher prince,
Vous n’ignorez point qu’en France, depuis 1681, une société de « partisans », moyennant une redevance annuelle de soixante millions, a le droit de percevoir tous les impôts : douanes, gabelles, domaines et même tabacs.
Ces gens, connus sous le nom de fermiers généraux, réalisent ainsi des bénéfices incalculables, qui leur permettent de mener joyeuse vie... On me conte, à ce sujet, une assez piquante anecdote... Sa Majesté Louis XV se promenait un jour aux environs de Fontainebleau, en compagnie de son exquise amie, la marquise de Pompadour, lorsque son attention fut attirée par une très luxueuse maison de plaisance, qui s’élevait au milieu d’un parc féerique.
— A qui cette « folie » ? interrogea le roi.
— Sire, au fermier général Bouret d’Erigny, répliqua un courtisan de la suite.
— Et ces bois magnifiques ?
— Sire, à M. Bouret d’Erigny.
— Et tous ces champs fertiles, qui s’étendent à perte de vue ?
— Sire, à M. Bouret d’Erigny.
— Et, là-bas, ce splendide château, qui domine la vallée de la Seine ?
— Sire, à M. Bouret d’Erigny.
Et Sa Majesté de s’exclamer :
— Mais c’est donc un vrai marquis de Carabas !
Jugez, mon cher prince, d’après un tel luxe, combien grande doit être la misère en notre pays de France...
Dans les villages, on ne voit que pauvres gens qui sont jetés hors de leurs demeures, et dont les meubles sont vendus à l’encan, parce qu’ils n’ont pu payer leur tribut à messieurs « les partisans »...
On me raconte que des familles entières en sont réduites à camper dans les bois ou à se réfugier dans des carrières abandonnées, où elles achèvent de mourir de faim et de froid...
Puisse, un jour prochain, surgir un homme assez audacieux pour venger tous ces malheureux !...
Voltaire
Le vœu de l’illustre écrivain n’allait pas tarder à être exaucé... Un jeune paysan, à l’âme exaltée d’aventurier sans peur et sans scrupules, mais au cœur généreux, allait lever l’étendard de la révolte, faisant bientôt trembler ces fermiers généraux, terreur des pauvres gens. Il se nommait Louis Mandrin...
Voici sa tragique et véridique histoire, remplie d’exploits fabuleux, dont le souvenir est demeuré légendaire.
Arthur Bernède
PREMIERE PARTIE : Les Noces de Mandrin.
Chapitre I : Les contrebandiers.
Par un beau jeudi de mai, vers dix heures du matin, la pittoresque localité de Beaujeu, accrochée au flanc des Alpes Dauphinoises, à quelques portées de fusil de la frontière savoyarde, était le théâtre d’une panique extraordinaire...
Des jeunes gens terrorisés traversaient en courant la grande place, faisant fuir devant eux des troupeaux d’oies qui agitaient éperdument les ailes... De vieux paysans cherchaient un refuge dans les auberges, dont les lourdes portes se refermaient avec fracas.
Un sacristain, l’air effaré, verrouillait promptement la porte de l’église... Des bergers se hâtaient de faire rentrer leurs bestiaux dans les écuries... Des femmes se sauvaient dans leurs maisons et s’y barricadaient avec leurs petits... Une pauvre vieille s’enfuyait sur ses béquilles, s’efforçant péniblement de regagner son modeste logis... Des gamins se terraient dans des buissons... et parmi les abois des chiens aux poils hérissés et aux gueules menaçantes, une rumeur montait d’un groupe de paysans, prudemment dissimulés derrière un mur, à l’entrée du pays.
La bande à Mandrin ! La bande à Mandrin.
Bientôt, une troupe de cavaliers coiffés jusqu’aux yeux de larges chapeaux couverts de poussière, armés jusqu’aux dents et encadrant plusieurs mulets chargés de ballots de tabac d’Espagne, débouchait sur la place déserte.
A leur tête un homme d’une trentaine d’années, monté sur un superbe cheval blanc... Très grand, musclé, son fier visage encadré d’une longue chevelure dont les boucles flottaient au vent, la taille entourée d’une ceinture de cuir, à laquelle pendait une immense rapière, et où s’accrochaient deux énormes pistolets, les yeux brillants d’une flamme révélatrice d’énergie indomptable et de volonté sans limites, — vêtu d’un habit de drap d’Elbeuf gris, d’une culotte de peau et de guêtres en ratine, coiffé, ainsi que ses compagnons, d’un grand feutre noir, dont l’aile était rabattue en visière, il semblait, malgré sa jeunesse, incarner cette force, cette autorité et cette expérience qui font reconnaître au premier coup d’œil un chef indiscutable et indiscuté.
— Halte ! commanda-t-il d’un ton impératif
Tous obéirent avec une régularité militaire qui dénotait un esprit de discipline ...
Sautant à terre, un des contrebandiers, qui portait un tambour, saisit ses baguettes et fit entendre une série de roulements plus joyeux que menaçants et qui eurent pour résultat immédiat de faire sortir les paysans de leurs abris et les enfants de leurs cachettes.
Les fenêtres et les huis s’entrebâillaient laissant apparaître des têtes exprimant plus de curiosité que de crainte...
Le sourire aux lèvres, le visage épanoui de santé et de belle humeur, le chef faisait de bienveillants appels de la main aux villageois qui, revenus de leur grande peur, se rapprochaient de lui, encore hésitants et timorés.
Alors, se dressant sur ses étriers, le cavalier attaqua d’une voix vibrante :
— Eh bien oui, je suis Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France.
« Mais, morbleu mes camarades, n’ayez pas une telle crainte ! Je n’en veux pas à vous, pas plus qu’à vos femmes et même à vos volailles. Je ne suis pas l’ennemi du peuple, je suis son défenseur... et je veux le venger des exactions des fermiers généraux.
Voila pourquoi je traque les traitants, les croupiers et les porteurs de contraintes ou tout quidam de cet acabit ; car autant l’impôt est chose sacrée, quand il a pour objet la prospérité et la défense d’un pays, autant il devient une chose inique et révoltante, quand il ne sert qu’à enrichir des faquins.
« Or, on vous vole, on vous pressure, on vous rançonne, on vous ruine, on vous tue !...
« Vous payez le sel douze fois sa valeur et vous n’avez même pas le droit de vous en priver.
« Ceux qui sont surpris avec une livre de faux sel sont condamnés à neuf ans de galère ou pendus, tandis que les intendants qui volent l'or par tonneaux sont honorés, applaudis, et leur richesse est faite de votre misère »
A ces mots, une grande clameur d’allégresse s’éleva de la foule de plus en plus compacte entourant l’orateur.
Ainsi Mandrin, que l’on représentait comme le pire des bandits, chargé de tous les crimes, qui passait pour un voleur, un faux-monnayeur, un assassin toujours prêt au pillage, était, au contraire, le révolté qui se dressait pour la défense des pauvres gens, persécutés par les commis des fermiers, le justicier qu’ils attendaient inconsciemment.
Il n’en fallut pas plus pour les rassurer, les réconforter, leur donner espoir et leur rendre confiance. Lorsque le « capitaine » reprit de sa voix claironnante :
— Ne voyez donc en moi qu’un ami, qu’un frère !... Je ne vous demande qu’une chose, celle de m’indiquer la demeure de l’entreposeur des tabacs.
Un bras se tendit, puis deux, puis dix, puis cent ! vers une maison d’apparence cossue, et qui, entourée d’un jardinet, s’élevait au fond de la place, en face de l’église...
Mandrin, à la tête de ses compagnons, suivi d’un cortège sans cesse grossissant de villageois, se dirigea vers l’habitation où semblait régner la paix la plus absolue.
L’entreposeur des tabacs de Beaujeu, le bonhomme Agénor Malicet ne s’attendait guère à cette visite matinale...
Vautré dans un confortable fauteuil, en face d’une table sur laquelle était ouvert un registre, il paraissait plongé dans de laborieux calculs de comptabilité... En réalité, il dormait.
En effet, en dehors de ses repas, copieux et abondamment arrosés de vins généreux, dormir était son occupation principale.
Soudain, un scribe, aux allures de rat de cave famélique, qui contemplait son maître d’un air irrévérencieux, eut un tressaillement de surprise...
Des poings vigoureux heurtaient la porte... qui s’ouvrait presque aussitôt avec fracas, livrant passage à Mandrin, escorté de plusieurs contrebandiers, portant sur le dos des ballots de tabac.
Le rat de cave, sidéré, disparut derrière un meuble... Sans lui accorder la moindre attention, Mandrin se dirigea vers le bonhomme Malicet, que cet envahissement n’avait pas réveillé, et qui continuait à ronfler bruyamment.
Le « capitaine » posa lourdement sa main d’acier sur l’épaule du receveur ; comme celui-ci hésitait à sortir de sa torpeur, il le secoua rudement ; et Agénor Malicet, éberlué, se décida enfin à entrouvrir les paupières.
— Le contenu de ta caisse !... ordonnait le chef des contrebandiers, sur un ton qui fit frémir le bonhomme.
— Man... Mandrin !... articula Malicet d’une voix étouffée.
— Oui, Mandrin... scanda le capitaine.
Et portant la main à la crosse de son pistolet, il ajouta :
— Allons, exécute-toi, car je n’ai pas de temps à perdre.
Malicet jeta autour de lui un regard d’effroi. Son bureau était rempli de contrebandiers aux allures dégagées... et aux mines peu rassurantes... Il ne pouvait compter sur aucun secours de la part de son scribe et de ses autres employés qui, paralysés par la peur, se tenaient cois dans une pièce voisine... Alors, d’un pas incertain il se dirigea vers une grande armoire qui occupait presque entièrement l’un des panneaux de la pièce et introduisit d’une main tremblante une clef dans la serrure.
— Mi-Carême... Carnaval, faites votre besogne commandait Mandrin.
Deux contrebandiers, le premier petit... sec... maigriot... au nez en quart de brie et aux yeux de renard en quête ; le second, un grand gaillard robuste, bien découplé, à la mine éveillée et au nez en trompette, s’avancèrent vers l’infortuné entreposeur.
Mon trésorier... et mon secrétaire, présentait pompeusement le « capitaine » au vieil Agénor livide et frissonnant.
Les deux contrebandiers s’emparèrent rapidement de l’argent que renfermait l’armoire et le firent disparaître dans un coffre.
Alors, Mandrin, qui s’était installé dans le fauteuil du maître de céans, attaquait, toujours souriant, et avec toutes les apparences de la correction la plus parfaite.
— Maintenant, monsieur l’entreposeur, si vous le voulez bien, réglons nos comptes.
— Nos comptes ?... nos comptes ! répétait Malicet en s’approchant rapidement du terrible capitaine.
— Parfaitement, appuyait celui-ci... Combien contenait votre caisse ?
— Trente-sept mille livres.
Mandrin s’empara d’une plume, et d’une écriture large traça ces mots sur un morceau de papier
« Reçu de M. Agénor Malicet la somme de trente sept mille livres, en échange de quoi je lui laisse quatre balles de tabac d’un poids et d’une valeur indéterminés.
« Capitaine Louis MANDRIN ».
Puis il passa le reçu à son interlocuteur qui, après l’avoir parcouru d’un œil effaré, bredouilla piteusement :
— Dieu m’est témoin que j’ai défendu jusqu’au bout les intérêts de Sa Majesté.
Soudain un cri, fait à la fois d'admiration et de surprise, échappait à Mandrin.
Une jeune fille, d’une grâce adorable et dont le charme délicieusement ingénu semblait l’auréoler d’une couronne de lumière, venait d’apparaître sur le seuil et, s’élançant vers le chef des contrebandiers, elle s’écriait avec un accent de crânerie, qui la rendait plus exquise encore.
— Je suis Nicole Malicet, et je vous prie de ne pas faire de mal à mon père.
— Mademoiselle, saluait Mandrin avec toute l’élégance d’un véritable grand seigneur.
Mais il n’eut pas le temps de poursuivre... Une importante bourgeoise, aux allures énergiques, derrière laquelle trottinait un amour de petite servante, faisait brusquement irruption dans le bureau. C’était Mme Thérèse Malicet, née Poisson.
Un instant, elle demeura médusée par le spectacle qui s’offrait à elle...
Successivement, son regard se dirigea sur Mandrin, dont le visage reflétait une étincelante bonne humeur, sur les contrebandiers qui partageaient visiblement la satisfaction de leur chef, sur son mari qui, effondré sur un siège, la contemplait avec une expression de terreur plus vive encore que celle que lui inspirait Mandrin, et, enfin vers l’armoire, dont les battants largement ouverts laissaient apercevoir les étagères vides de tout numéraire.
Alors, plus rouge qu’une pivoine, elle bondit sur Agénor, et, furieuse elle martela :
— A quoi vous sert-il, monsieur, d’avoir le profil de Louis XIV, pour vous laisser dépouiller par ces bandits ?
Thérèse ! voulut riposter Malicet.
— Vous êtes un niais, un lâche, un bélître.
Et fonçant vers Mandrin, elle vaticina avec une fougue et une audace qui paraissaient fort le divertir :
— Quant à vous, brigand, sachez que vous ne me faites pas peur. Apprenez aussi que je suis la cousine de la marquise de Pompadour et que je n’ai jamais tremblé devant personne !...
Mais un cri s’élevait au fond de la pièce.
— Laissez-moi !... mais laissez-moi donc !...
C’était Nicole qui se défendait bravement contre un contrebandier qui cherchait à la lutiner.
— Corbleu ! s’écriait l’irascible Thérèse en bondissant au secours de sa fille...
Mais Mandrin l’avait devancée !...
Se jetant sur le contrebandier, il l’envoyait d’un simple coup de poing rouler à terre... puis, se tournant vers Nicole, il lui déclarait, en s’inclinant avec une politesse raffinée :
— Mademoiselle, rassurez-vous... je vous jure que ce drôle sera cruellement châtié.
Nicole baissa la tête, intimidée par le regard étincelant qui l’éblouissait.
Et Mandrin, revenant vers M. Malicet, abruti de détresse, et Mme Malicet, suffoquée de colère, s’écriait, d’un ton enjoué :
— Madame, monsieur... excusez-moi, encore un coup, du dérangement que je vous ai causé ! Puissiez-vous ne point trop m’en tenir rancune.
Et se tournant vers ses compagnons, il ajouta :
— Et maintenant, camarades, en route.
Les contrebandiers se hâtèrent vers la sortie... Mais au moment où Mi-Carême et Carnaval allaient franchir le seuil, Mandrin les rappela :
— Restez, vous autres ; car je tiens à ce que ces dames ne gardent pas un trop mauvais souvenir de ma visite.
Et il adressa un signe mystérieux à Mi-Carême qui s’empressa d’enlever sa ceinture, ses armes et sa veste, et de dénouer le bout d’une pièce de dentelle enroulée autour de sa taille...
Puis, tandis qu’il tournait sur lui-même comme une toupie, Carnaval se mit à dérouler la pièce qui s’entassa à terre, au grand étonnement des Malicet, qui ne comprenaient rien à ce manège ; et, lorsque le tas fut complet, Mandrin s'empara de la dentelle, et, d’un ton empreint de délicatesse, il dit, en la présentant à Mme Malicet abasourdie :
—Permettez-moi, madame, de vous offrir cet humble cadeau, en compensation des ennuis que nous avons pu vous causer.
— Je ne sais si je dois accepter, hésitait l’opulente Thérèse, à moitié conquise, malgré elle, par le grand air et les façons chevaleresques du contrebandier.
— Non, non, c’est impossible se gendarmait le vieil Agénor.
Mais, poussée par cet esprit de contradiction qu'elle apportait dans toutes les manifestations de sa vie conjugale, la cousine de Mme de Pompadour déclarait aussitôt :
— Eh bien ! si, j’accepte.
Malicet eut un geste de désolation impuissante.
Toujours souriant, empressé, Mandrin, retirant de son petit doigt une jolie bague en or enrichie de brillants, s’emparait de la main de Nicole de plus en plus troublée, et glissait le riche anneau à l’index de la jeune fille, tout en disant :
Puisse, mademoiselle, ce modeste présent vous faire oublier l’inconvenance de l’un de mes soldats.
En un geste d’instinctive pudeur, Nicole retira promptement la bague.
Mais le beau « capitaine » poursuivait, d’une voix dont il cherchait à tempérer l’éclat :
— Puisse-t-elle aussi vous faire garder de Mandrin un souvenir qui ne vous sera pas trop désagréable.
Nicole, tout en rougissant, remit l’anneau à son doigt...
Alors Mandrin, se baissant vers la petite main toute tremblante qui, instinctivement, se tendait vers lui, y déposa un long baiser.
Outré, le bonhomme Malicet s’écriait :
— Ah par exemple, ceci dépasse les bornes.
— Agénor ! taisez-vous ! imposait sa compagne.
— Mais... madame.
— Imbécile scandait la dame Malicet, après vous être laissé dépouiller, voulez-vous que ces gens incendient notre maison et nous pendent haut et court ?...
— Rassurez-vous, madame, répliquait Mandrin avec un gracieux sourire, désormais vos personnes me sont sacrées.
Et, saluant les Malicet, comme l’eût fait le duc de Richelieu en personne, Mandrin, pirouettant sur les talons, regagna le dehors.
— Décidément, concluait la femme de l’entreposeur, ce Mandrin est peut-être un coquin, mais c’est un coquin joliment sympathique.
Une tempête d’acclamations s’élevait au dehors...
C'était la foule qui, à travers les fenêtres ouvertes, avait assisté à cette scène et applaudissait au succès de celui qu'elle considérait déjà comme un héros.
Mandrin, au milieu des bravos, lançait :
— Maintenant, mes amis, dites-moi où est la prison ?
— Par ici, capitaine. Nous allons vous y conduire clamèrent plusieurs paysans.
Le cortège gagna aussitôt une rue voisine et s’arrêta devant un bâtiment d’aspect sinistre, dont les fenêtres étaient munies d’épais barreaux de fer... Mandrin, avec le pommeau de sa rapière, frappa plusieurs coups sur la porte en chêne massif de la geôle...
A peine s’était-elle entrebâillée, laissant apparaître la tête effarée d’un guichetier, que le capitaine, avec une force irrésistible, l’ouvrait toute grande, empoignait le porte-clefs au collet, et l’entraînait, suivi de ses hommes, jusqu’au préau intérieur sur lequel donnaient toutes les cellules.
Plusieurs gardiens arrivaient à la rescousse. Mais, tandis que les contrebandiers les tenaient en respect, avec leurs fusils, Mandrin, immobilisant d'une main le guichetier en chef qui se débattait, et lui mettant de l’autre son pistolet sous le nez, ordonnait d’une voix tonnante :
— Que l’on ouvre tous les cachots et il ne vous sera fait aucun mal... Sinon, gare à vous !...
L’argument parut sans réplique. Les gardes, forcés de capituler, se dirigeaient vers les cellules, faisant manœuvrer les verrous... Quelques instants après, une vingtaine de prisonniers étaient rassemblés devant Mandrin, qui reprenait :
— Que ceux d’entre vous qui sont condamnés pour manquements au fisc ou pour faits de contrebande, viennent vers moi.
Une douzaine de captifs, après s’être consultés du regard, s’avançaient d'un pas hésitant, se demandant ce que pouvait bien leur vouloir ce singulier personnage qui leur parlait en maître.
Mandrin, souriant, reprit aussitôt :
— Amis, le capitaine Mandrin, au nom de la justice, vous rend la liberté.
Une expression de joie et de reconnaissance infinies rayonna soudain sur les visages de ces malheureux qui, spontanément, s’élancèrent vers leur libérateur.
Mais, se dégageant, Mandrin commandait aux autres prisonniers :
— Quant à vous, escrocs, banqueroutiers, voleurs et assassins, justement condamnés par les lois, rentrez dans vos cachots.
Un mouvement de révolte se dessina parmi ces malfaiteurs, qui s’attendaient, eux aussi, à être délivrés.
Mandrin, faisant deux pas en arrière, ordonnait à ses compagnons :
— En joue !
Les contrebandiers, en un mouvement d’une régularité mécanique, épaulaient leurs armes... forçant tout le lot de bandits à réintégrer, bien à contrecœur, leurs cellules dont les gardiens se hâtaient de refermer les portes.
Et Mandrin, porté en triomphe par les paysans et par ceux dont il venait de faire cesser la captivité, regagna la place, où quelques-uns de ses hommes l’attendaient avec les chevaux.
Un nouveau geste de Mandrin allait achever de porter jusqu’au délire l’enthousiasme de ses nouveaux partisans.
Apercevant, devant l’église, un vieux prêtre qui gesticulait au milieu d'un groupe, Mandrin s’en fut vers lui, et, prenant un sac d'écus dans le coffre que transportaient Mi-Carême et Carnaval, il le dénoua et s’écria, en le tendant au prêtre qui levait les bras au ciel, l’air scandalisé.
— Pour vos pauvres, monsieur le curé.
Le bon abbé, qui n’en croyait ni ses yeux ni ses oreilles, repoussa d’un geste affolé le présent des contrebandiers.
Une femme en haillons qui tenait un tout petit enfant dans ses bras s’empara du sac, et le tendant au pasteur, lui dit :
— Prenez, messire, c’est de l’argent bien gagné.
Le prêtre s’empara du sac, et Mandrin, puisant dans le coffre, se mit à jeter des écus à la foule ; puis, se dérobant aux remerciements, tout fier, tout heureux du bonheur qu’il venait de semer autour de lui, vite, il sautait sur son cheval blanc... et donnait à ses compagnons le signal du départ.
A ce moment, Nicole qui, debout sur une des marches, avait assisté à toute cette scène, et dont le visage reflétait l’admiration la plus vive, lançait à Mandrin, en un élan spontané, une rose qu’elle avait prise à son corsage... Mandrin la saisit au vol... la porta à ses lèvres... puis envoya un baiser à la jeune fille, qui semblait déjà regretter son geste audacieux.
Mandrin qui, avec sa troupe, s’apprêtait à quitter le village, se retourna, adressant un dernier geste d’adieu à celle que ses parents entraînaient, en la réprimandant...
Et, portant de nouveau la rose à ses lèvres, le capitaine murmura :
— C’est un peu de cette jolie enfant que j’emporte avec moi dans la montagne.
Chapitre II : Tiennot le berger.
Le même jour, à l’heure où le crépuscule du soir commence à voiler les cimes des Alpes Dauphinoises, Mandrin et sa bande, avant de s’engager dans le défilé abrupt qui conduit à la frontière savoyarde, où ils savaient trouver un sûr asile, avaient fait halte, pour le repas du soir, à mi-flanc de la montagne, au milieu d’un pittoresque éboulis de rochers...
Tandis que ses hommes achevaient de manger une soupe appétissante et de boire, en leurs gobelets d’étain, le vin clairet au bouquet de terroir, Mandrin, assis à l’entrée d’une grotte qui abritait un feu improvisé, semblait plongé dans de profondes réflexions.
Ses « soldats-camarades », ainsi qu’il appelait familièrement ses compagnons, respectaient, comme toujours, la méditation de leur chef.
Mandrin n'était-il pas, avec une rapidité foudroyante, devenu en quelque sorte le maître de cette vaste région, qui s’étend du pays lyonnais jusqu'à la Méditerranée ?
Partout, dès qu’il était apparu à la tête de ses hommes, triés sur le volet, animés du même esprit de bataille, et auxquels il inspirait un dévouement fanatique, n’avait-il pas vu venir à lui toutes les sympathies de ses populations malheureuses, où régnait déjà l’esprit républicain ?
Vite, il avait achevé de les gagner à sa cause, comme « ceux de Beaujeu », en leur prouvant que ce n’était point à ses compatriotes qu’il déclarait la guerre, mais qu’il n’avait, au contraire, qu’un but : les délivrer de ceux qui les opprimaient.
Aussi n’avait-il pas tardé à s’assurer de tous côtés et dans tous les milieux, et jusque dans les presbytères, de nombreuses complicités ; et bientôt il n’y eut guère d’hostellerie ou d’auberge dont le maître ne fût son affilié, peu de maisons où il ne fût accueilli, et dont il ne rémunérât largement l’hospitalité.
Les fonctionnaires civils eux-mêmes avaient pris le parti de fermer les yeux sur ses exploits... et chaque fois que la maréchaussée avait mission de le combattre, il se produisait toujours un incident inattendu et il arrivait même parfois un contre-ordre mystérieux qui permettait toujours au capitaine général des contrebandiers de France de regagner sans encombre le vieux château savoyard qui lui servait de quartier général, tout près du poste-frontière de Pont-de-Beauvoisin, où il avait établi son principal entrepôt de marchandises.
Et Mandrin, qui se croyait sûr de l’impunité et se plaisait à affirmer « que les troupes du roi avaient reçu la défense de l’attaquer », pouvait contempler, de son regard d’aigle vainqueur, le pays qui s’étendait à ses pieds.
Mais peu à peu, ses yeux, dont les prunelles étaient comme semées de sable d’or, prirent une expression de douceur étrange... C’est qu’ils s'étaient arrêtés sur la rose qu’il avait épinglée à son habit ; et la fleur évoquait en lui la pensée de celle qui la lui avait donnée.
L’image de l’adorable Nicole, tour à tour courageuse, craintive, indignée, timide, attendrie et légèrement coquette, l’enveloppait d’autant plus de charme, qu’il se sentait presque le droit de se dire qu’il n’était pas sans lui plaire... Et lui, auquel déjà tant de femmes avaient adressé leurs sourires, envoyé leurs baisers, lui qui avait pu lire dans tant de beaux regards une expression d’admiration qui est déjà tout un aveu d’amour, lui qui, emporté par le tourbillon des événements, lui, dont le cœur n’avait jamais battu que pour les luttes de géants et les splendides représailles, sentit tout à coup ses nerfs se détendre et son cerveau s’apaiser, sous l’irrésistible douceur d’un sentiment qu’il ne connaissait pas encore.
Cela mettait en lui une sorte de ferveur silencieuse, de paix, de j'oie, que ne traversait aucun désir... et l’aventurier formidable, le révolté sans trêve, se laissait aller à l’allégresse de cette idylle naissante qui ne pouvait, chez un être tel que lui, que prendre rapidement l’essor d'une passion dévorante, lorsque, tout à coup, son regard se tendit vers l’horizon.
Bientôt, il distinguait s’estompant dans la nuit tombante, le clocher de Beaujeu où, sans s’en rendre compte encore, il venait de laisser tout de lui-même, lorsqu’il aperçut une de ses sentinelles qui lui faisait un signe d’appel.
Instantanément repris par son devoir de chef, il s’empressait de se diriger vers le guetteur, qui lui désignait, tout en bas des rochers, deux hommes côtoyant un petit torrent, avec les allures de chasseurs en quête d’une piste.
Mi-Carême et Carnaval, le fusil à la main, avaient rejoint leur capitaine.
— Ces deux gaillards ne m’ont pas l’air très catholiques, grommelait Mi-Carême en vérifiant la pierre à feu de son arme.
— En effet... déclarait Mandrin, on dirait deux « gabelous ».
— Est-ce qu’on les descend ? interrogeait Mi-Carême.
De la main, Mandrin leur imposa silence. Il venait d’apercevoir, se défilant derrière un amas de broussailles, un jeune garçon qui tenait en laisse deux gros chiens.
Les deux douaniers avaient dû l’apercevoir aussi, car, simultanément, ils épaulèrent leurs fusils... mais ils n’eurent pas le temps d’en faire usage... Mandrin s’emparait du tromblon de Mi-Carême, l’épaulait... tirait... et la crosse du fusil de l’un des douaniers volait en éclats...
Alors, prompt comme l’éclair, le capitaine empoignait l’escopette de Carnaval... et, deux secondes après, l’arme du second douanier subissait le même sort que celle de son camarade.
Les deux « gabelous » terrifiés, constatant qu’ils n’avaient reçu que de légères éraflures, s’empressèrent de déguerpir à toutes jambes.
— Poursuivez-les !... ordonnait Mandrin à ses compagnons.
Et, s’élançant avec une agilité remarquable à travers les blocs de granit qui surplombaient le torrent, il se précipita vers l’adolescent, qui était demeuré sur place, littéralement pétrifié par cette scène.
A l’aspect du capitaine qui accourait vers lui, le jeune inconnu eut un brusque mouvement de frayeur...
Mais soudain son visage s’éclaira ; et il s’écria d’un ton vibrant :
— Capitaine Mandrin, je vous reconnais et je vous remercie.
Mandrin l’enveloppa d’un long regard où perçait déjà une réelle sympathie.
Mince, élancé, bien découplé dans son costume de berger des Alpes, la figure très fine, aux traits réguliers, les yeux superbes, mais voilés d’une profonde mélancolie, les cheveux noirs abondants, flottant sous son feutre gris, aux ailes relevées, les jambes fines, robustes et sanglées de guêtres en cuir jaunâtre, le jeune homme contemplait son sauveur avec une sorte de ferveur mystique... exprimant ainsi, mieux que par des paroles, l’admiration et la reconnaissance que lui inspirait le fameux « capitaine ».
— Qui es-tu ? interrogeait Mandrin avec bienveillance.
— Je m’appelle Tiennot... je suis berger, mais je fais surtout la contrebande du tabac.
— Et ta famille ?
— Je n’en ai plus.
— Que sont devenus tes parents ?
— Ils sont morts tous les deux.
— Il y a longtemps ?
— Oui, bien longtemps.
— Pauvre petit.
— As-tu des frères, des sœurs ?
— Non, capitaine.
— Des amis ?
— Non plus.
— Alors tu es seul au monde ?
— Tout seul.
— Tu dois être malheureux ?
— Très malheureux.
— Morbleu ! Tu m’as pourtant l’air d’un garçon énergique.
— Il le faut bien, capitaine. Si je ne l’avais pas été, il y aurait déjà beau temps que je me serais jeté dans un précipice... ou noyé dans un torrent...
« Si je ne l’ai pas fait, ce n’est pas parce que j’ai manqué de courage, mais parce que j’estime qu’on n’a pas le droit de se détruire. On ne sait jamais ! Un jour, on peut tout de même être utile à quelqu’un ou bon à quelque chose.
— J’aime ce langage, petit ! s’écria Mandrin ; car il me prouve que tu as du sang.
Et, avec un fier sourire, il ajouta :
— Alors, tu as entendu parler de moi ?
Qui ne connaît pas le capitaine Mandrin ? ripostait le berger. N’est-il pas celui en qui les honnêtes gens ont mis toutes leurs espérances ?
— Tu m’as déjà vu ?
— Oui, plusieurs fois, lorsque vous traversiez la montagne pour rentrer en Savoie... Mais je n’ai pas osé vous approcher... Songez, aujourd’hui, si je suis heureux, capitaine, puisque, pour la première fois que je vous parle, c’est pour vous remercier de m’avoir sauvé la vie.
— Tu me plais, berger... et, pour un rien, je rengagerais dans ma bande...
— Oh ! capitaine ! s’écria Tiennot, dont le visage s’éclaira.
Les contrebandiers ramenaient les deux douaniers qu’ils avaient réussi à capturer. Ceux-ci, d’ailleurs, en hommes qui ont conscience d’avoir accompli leur devoir, s’étaient vite ressaisis et faisaient bonne contenance.
Mandrin, fronçant les sourcils, marcha vers eux... Le verbe haut et les yeux fulgurants, il leur lança, violemment, en leur désignant Tiennot :
— N'avez-vous pas honte de tirer sur cet enfant ?
— Chacun son métier, répliquait, non sans crânerie, un des « gabelous.
—Alors Mandrin, avec un accent de réelle noblesse, s’écria :
— Si je faisais le mien, je vous ferais pendre... Mais je ne suis pas un assassin Allez-vous-en et ne retombez jamais entre mes pattes.
Les contrebandiers relâchèrent aussitôt les deux « gabelous », qui, enchantés d’en être quittes à si bon compte, s’éloignèrent sans demander leur reste.
Très simplement, Tiennot s’avançait vers le chef et lui demandait sur un ton de prière :
— Capitaine Mandrin, emmenez-moi ... Je vous serai dévoué jusqu’à la mort.
Le capitaine considéra un instant le jeune berger.
Puis, posant amicalement ses deux mains sur les épaules de Tiennot, il scanda :
— Viens, petit.
L’adolescent s’empara des mains de son chef et, longuement, les serra.
— Capitaine, dit-il... Je vous jure de ne vivre et de ne mourir que pour vous !
Quelques instants après, la bande à Mandrin s’engageait dans le défilé et, bientôt passant la frontière, regagnait l’antique château de Rochefort, vieille ruine pittoresque, dont le capitaine avait su faire une imprenable citadelle. La nuit venue ; et tandis que ses soldats allaient prendre un repos bien gagné, Mandrin juché tout au sommet du pic ou se dressait son repaire, demeura longtemps les bras croisés, contemplant les feux qui s’allumaient dans la plaine.
Alors, il lui sembla que tout au loin, là-bas, une lumière brillait, plus scintillante que les autres, et il eut l’impression que c’était l'âme de la gentille Nicole qui lui envoyait comme un reflet de son tendre rayonnement.
Mandrin, le lion de la révolte, Mandrin l’aigle de la contrebande, commençait à aimer.
Ce soir-là, à Paris, dans l’un des somptueux salons de son splendide hôtel, véritable palais, qui se dressait orgueilleusement au cœur même du faubourg Saint Germain, M. le fermier général Michel Bouret d’Erigny recevait ses collègues.
Réunis autour d’une grande table, à leur visages graves, compassés, il était facile de deviner qu’il était cette fois question, non plus de plaisir, mais d’affaires sérieuses.
Autour de Bouret d’Erigny, il y avait Grimod de la Reynière, celui dont les chevaux avaient des mangeoires d’argent ; Brissard, qui habitait, aux environs de Versailles, une sorte de palais enchanté ; Dupin, propriétaire à Paris du fameux hôtel Lambert, décoré par les illustres peintres Le Sueur et Le Brun, et, véritable roi du château de Chenonceaux, l’opulent Faventines, qui possédait dix châteaux, et dont le pied-à-terre de Puteaux contenait cent quarante matelas, dont quatre-vingt-quinze à l’usage des domestiques... Ville-mur, dont les maisons poussaient sur les boulevards comme les fleurs d’un magique parterre ; Beaujon, qui dépensait deux cent mille livres par an pour que, chaque soir, de jeunes et jolies femmes en toilettes de bal vinssent autour de son lit lui murmurer des contes jolis et lui fredonner des ariettes jusqu’à ce qu’il fût endormi...
Bref, toute cette cohorte pleine de morgue, dont le lieutenant de police, marquis d’Argenson, pouvait dire :
« Ils ont tous la tête bien haute... Ils ne rendent plus de visites, à l’exemple de M. le chancelier et des ministres ! »
Jusqu’à ce jour, bien que l’on s’indignât justement, même dans les hautes classes de la société, de leurs actes tyranniques, et qu’on leur reprochât ouvertement « d’abuser de leur situation, de commander aux monarques et d’obliger les pouvoirs publics à faire des lois à leur mesure », ils avaient réussi à exercer sans résistance leur monopole aussi dangereux pour les finances de l’Etat que pour les deniers des contribuables...
Louis XV, qui avait déjà pour principe de remettre au lendemain les affaires sérieuses, et entendait mener sans trouble ni souci l’existence de satrape à laquelle il s’était voué, avait fermé l’oreille à ce qu on appelait les criailleries des mécontents.
Et voilà que, tout à coup... un paysan, un montagnard, un contrebandier, levait contre eux l’étendard de la révolte et osait leur déclarer la guerre.
Tout d’abord, ils en avaient fait fi... persuadés que la maréchaussée se chargerait de réduire promptement à merci cet insolent énergumène...
Mais Mandrin, qui semblait imprenable autant qu’invincible, n’avait cessé de grandir le cercle de ses opérations, de remporter victoires sur victoires, et d’acquérir une telle popularité, qu’édifiés par les rapports de leurs agents, MM. les fermiers généraux, redoutant que l’incendie allumé dans le Dauphiné ne gagnât toute la France, avaient daigné considérer Mandrin, non plus comme un bandit de grands chemins bon pour la roue ou la potence, mais comme un adversaire qu’il faut écraser à tout prix. Aussi avaient-ils décidé d’en finir...
— Messieurs... déclarait Bouret d’Erigny, le moment est venu d'en finir, une bonne fois pour toutes, avec cet ennemi redoutable qu’est Mandrin.
« Je vous ai offert de prendre moi-même l’affaire en main... Vous avez accepté... Votre confiance m’honore, et j’ose espérer que je m’en montrerai digne.
— Nous n’en doutons pas un seul instant, s’écriait l’important Grimod de la Reynière.
— Vous étiez le personnage tout désigné pour cette besogne, déclarait le nonchalant Brissard...
— N’êtes-vous pas le plus jeune d’entre nous ?... scandait le gros Dupin.
— Le plus actif, proclamait le subtil Faventines.
— Le plus hardi... surenchérissait l’affable Villemur.
— Le plus riche, ronronnait l’épicurien Beaujon.
Impassible sous ce concert d’encouragements et d'éloges, Bouret d’Erigny poursuivait d’une voix cassante :
J’ai eu, ce matin, une audience de M. le lieutenant général de la police ; je lui ai exposé nos doléances, je lui ai montré quelles conséquences cette odieuse rébellion, si elle n’était promptement matée, pouvait avoir, non seulement pour nos intérêts particuliers, mais encore pour la sécurité de l’Etat... et je l’ai prié d’agir auprès de Sa Majesté, pour qu’Elle consente à mettre à notre disposition les forces militaires dont nous avons besoin pour réduire à merci Mandrin et sa bande...
« M. d’Argenson, qui m’avait écouté avec beaucoup d’attention, m’a répliqué :
« — Je me garderai bien d’entretenir Sa Majesté de cette affaire... Elle me répondrait, comme à l’ordinaire, que je la fatigue avec mes calembredaines... D’ailleurs, je crois qu'il serait fort imprudent d’envoyer les troupes du roi contre ces brigands. Ce serait à la fois leur faire trop d’honneur et risquer, en groupant autour d’eux les forces encore éparses du populaire, de transformer une émeute locale en une révolution qui pourrait ébranler les assises de la monarchie elle-même, »
A ces mots, les fermiers généraux firent entendre quelques protestations... Mais, d’un geste impérieux, Bouret d’Erigny leur imposait silence et reprenait avec autorité :
— Attendez, messieurs ! ... Voici ce que M. le lieutenant de police a ajouté :
— Ce qui importe avant tout, c’est de frapper la tête... c’est-à-dire Mandrin ! Morte la bête... Mort le venin !... Emparons-nous de ce brigand... livrons-le au bourreau et, croyez-en mon expérience, tout rentrera dans l’ordre, sans le moindre délai ! »
Avec autorité, Bouret d’Erigny concluait :
— Je ne vous cacherai pas, messieurs, que je partage entièrement les vues de M. le marquis d’Argenson...
— Ce Mandrin, interrompait Grimod de la Reynière, n’est pas un gibier facile à prendre au collet...
— M. le lieutenant général, ripostait Bouret d’Erigny, met à notre disposition son meilleur limier... C’est, paraît-il, un homme extraordinaire qui a déjà à son tableau de chasse un nombre incalculable de malfaiteurs. Chaque fois qu’il s’attache à une piste, on peut être sûr qu'elle le conduit au succès... Jamais, paraît-il, ce policier n’a manqué son homme.
« J’attends, messieurs, votre décision pour vous le présenter.
— Il est ici ? interrogeait Dupin.
— Dans mon antichambre.
— Eh bien ! cher ami, faites-le entrer, invitait Faventines, approuvé par M. de Villemur, qui se rengorgeait, et par M. de Beaujon, qui se tournait les pouces, rêvant sans doute aux jolies chansons que ses « berceuses » lui murmuraient le soir avant qu’il s’endormît.
Bouret d’Erigny fit résonner un timbre. Un laquais chamarré apparut.
— Introduisez la personne qui attend, ordonnait le fermier général.
Un individu aux allures étranges apparut sur le seuil.
Il portait la tenue sombre et classique des exempts de cette époque... et, à en juger par l’acuité de son regard louche, l’expression énigmatique de son sourire, et par la facilité avec laquelle son échine se courbait en une cérémonieuse révérence, son âme devait être aussi noire que son costume, ses cheveux et son visage...
Il parut cependant faire une excellente impression sur les fermiers généraux qui, du premier coup d’œil, avaient flairé en lui le personnage retors et sans scrupules dont ils avaient besoin pour mener à bien leur campagne contre Mandrin.
D’un geste hautain, mais tempéré par une certaine condescendance, Bouret d’Erigny présentait :
— Le sieur Troplong, dont je viens de vous parler...
L’exempt s’inclina jusqu’à terre devant le brillant aréopage qui l’examinait avec une curiosité presque bienveillante. Puis il reprit, d’une voix papelarde :
— Troplong, dit Pistolet, qui se charge, messieurs les fermiers généraux, de vous livrer Mandrin avant que les cloches de Pâques aient sonné.
Oh ! oh ! c’est bien vous avancer... lançait Grimod de la Reynière en secouant, avec scepticisme, les fines dentelles qui ornaient son jabot.
— Monsieur le fermier général, répliquait le limier, en accentuant encore l’humilité de son attitude, j’ai toujours eu pour principe de tenir plus que je ne promettais.
— Vous n’ignorez pas, intervenait Brissard, que vous allez avoir affaire à un bandit de grande envergure.
— J’en ai maté de plus terribles ; et, sans me donner de gants, je crois pouvoir vous affirmer que celui-là ne pèsera pas lourd entre mes mains.
— Oh ! oh ! exempt Trolong, ricanait Faventines, vous m’avez l’air d’avoir une bien haute opinion de vous-même.
L’homme noir, dont les manières et le ton plein de modestie contrastaient étrangement avec son langage, reprit en esquissant une nouvelle courbette :
— M. le lieutenant de police veut bien me reconnaître quelque expérience ; et les résultats sont là pour démontrer qu’il n’a pas tout à fait tort d’avoir confiance en moi.
— En ce cas, s’écriait M. de Villemur, dites-nous comment vous pensez vous y prendre pour capturer Mandrin.
— C’est impossible, monsieur le fermier général.
— Pourquoi ?
— Parce que je n’en sais rien encore.
Quelques exclamations ironiques suivirent cette déclaration dépourvue de tout artifice.
Sans s’émouvoir, toujours sur le même ton onctueux, et avec des gestes compassés, Pistolet reprenait :
— L’art du policier, messieurs les fermiers généraux, ne consiste pas à mûrir d’avance des plans laborieux et compliqués qu’un simple incident suffit souvent à faire écrouler comme de simples châteaux de cartes...
« Il doit, avant tout, s’inspirer du temps, du lieu et des circonstances au milieu desquels il doit opérer.
« Permettez-moi donc de faire connaissance avec le sieur Mandrin, d’étudier le théâtre de ses exploits, de me familiariser avec ses habitudes, de démêler ses intrigues, de me mettre en rapport avec ses amis et ses complices, et de découvrir ainsi le point faible de sa cuirasse.
« Alors, soyez persuadés que je frapperai à coup sûr... Je vous ai demandé jusqu’à Pâques pour atteindre mon but... Je prends l’engagement de ne pas vous réclamer de délai, même jusqu’à la Trinité. »
Cette déclaration parut rallier tous les suffrages de l’assistance, et, cette fois, ce fut une rumeur d’approbation générale qui accueillit le petit discours de l’exempt.
— Je vois, messieurs, s’empressait de déclarer M. d’Erigny, que nous sommes tous d’accord pour confier nos intérêts au sieur Troplong.
« D’ailleurs, il ne partira pas seul pour le Dauphiné... Je l’accompagne muni de pleins pouvoirs par M. le lieutenant de police ! »
Et, avec un accent de haine indicible, il martela, le poing crispé :
— Le sieur Troplong vous a promis de vous livrer Mandrin, moi je vous jure de vous apporter sa tête !...
Le soir venu, Bouret d’Erigny et Pistolet se mettaient en route pour la grande aventure.
Chapitre III : Le frère Théatin.
Quelques jours après les événements que nous venons de décrire, plusieurs habitants de Beaujeu, réunis sur la place, lisaient une affiche qui avait été placardée le matin sur le portail de l’église.
Elle était ainsi libellée :
Arrêté du Parlement de Grenoble.
Au nom du Roi, nous déclarons le sieur Louis Mandrin coupable de rébellion envers Sa Majesté, et le condamnons par contumace à être roué vif, en même temps que nous enjoignons à tous les su jets de Sa Majesté de s’emparer de sa personne, ainsi que de tous ceux qui se seraient faits ses complices, soit en lui prêtant asile, soit en traitant avec lui de quelque façon que ce soit.
Tandis que les curieux échangeaient avec animation leurs impressions — et nous devons reconnaître qu'elles étaient plutôt favorables à Mandrin que sympathiques au décret parlementaire — Mr, Mme et Mlle Malicet faisaient leur apparition sur la place. Intrigués par ce rassemblement, ils s’approchèrent, pour prendre connaissance à leur tour du terrible document.
— Enfin ! approuvait l’entreposeur des tabacs. On se décide à agir contre ce misérable.
— Silence ! imbécile ! grondait l’irascible commère, en accompagnant, comme toujours, ses paroles d’une bourrade vigoureuse à l’adresse de son somnolent mari.
— Thérèse ! tu me fais mal !... protestait Agénor.
— Assez ! te dis-je !...
Et baissant la voix, elle ajouta :
— Il se pourrait fort bien qu’un espion de Mandrin rôdât aux alentours et surprît tes paroles. S’il te plaît d’être rôti à petit feu ou coupé en morceaux, c’est ton affaire, et, pour ma part, je n’y vois pas d’inconvénient. Mais, moi, j’aime mieux mourir dans mon lit, et le plus tard possible. Voilà pourquoi je t’ordonne de te taire.
Tandis que le ménage Malicet échangeait ces aménités, menue monnaie de leurs discussions conjugales, une scène étrange se déroulait tout près d’eux.
Un paysan s’était approché furtivement de Nicole dont le regard attristé demeurait fixé sur l’ordre implacable qui condamnait Mandrin à mort ; et, après lui avoir glissé rapidement un billet dans la main, il disparaissait avant que la jeune fille eût le temps de revenir de sa surprise.
Instinctivement, Nicole cachait le billet dans son corsage. Il était temps. Ses parents se retournaient vers elle.
— Ah çà ! qu’est-ce que tu as ?... interrogeait sa mère, en remarquant la tristesse répandue sur ses traits.
— Rien, maman.
— Tu mens... on dirait que tu vas pleurer.
Et, tout en entraînant Nicole, Mme Malicet se mit à vitupérer :
— Ce n’est pas une raison parce que ce Mandrin nous a offert quelques bouts de dentelles pour que tu t’attendrisses ainsi sur son sort.
Nicole refoula deux larmes prêtes à jaillir de ses paupières.
— Ah çà ! mademoiselle, s'exclamait l’irascible Thérèse, est-ce que ce bandit vous aurait tourné la tête ?
— Mandrin n’est pas un bandit, ripostait d’un élan la jolie Nicole.
— Ma fille ! intervenait le bonhomme Malicet avec indignation.
Il n'acheva pas.
D’un vigoureux coup de coude dans le creux de l’estomac, sa respectable épouse venait d’interrompre, une fois de plus, le fil de son discours.
— Toi ; d’abord s’écria-t-elle... mêle-toi de ce qui te regarde... Quand on riest bon, comme toi, qu’à boire, à manger et à dormir, on boit, on mange, on dort... mais on se tait... Tu m’as compris ?
— Oui, Thérèse.
Dompté, mais soufflant à pleins poumons, Agénor Malicet se résigna à suivre non sans peine, sa femme et sa fille, qui regagnaient leur demeure.
Tandis que Malicet s’installait dans son fauteuil, désireux de se remettre, par un bon somme, des émotions qu’il venait de traverser, Mme Malicet passait sa mauvaise humeur sur sa servante Martine, qu'elle avait surprise en train d'échanger des baisers par la fenêtre de sa cuisine avec l’un des scribes de son mari... Et Nicole, s’esquivant par une petite porte, gagna le jardin et s’en fut s’asseoir près de la margelle d’un vieux puits.
Tirant de sa cachette le billet que le mystérieux inconnu venait de lui remettre, toute tremblante d’émotion, elle le déplia et en commença la lecture.
Aussitôt, une vive rougeur colora ses traits. Son cœur se mit à battre précipitamment sous la fine mousseline du corsage... et, en un geste spontané, elle porta le billet à ses lèvres, qui s’entr'ouvraient en un sourire de virginale extase.
Voici ce qu'elle venait de lire :
« Je pense à vous et je vous aime.
Capitaine MANDRIN. »
Il m’aime ! Il m’aime !... murmura-t-elle... avec une expression de joie, adorablement triomphante.
C’est que si, depuis le jour de leur première rencontre, Mandrin n’avait pas cessé de rêver à Nicole, Nicole n’avait pas cessé de rêver à Mandrin,
Mais si l’aventurier s’était tout de suite laissé aller, sans s’en défendre, au charme d'un rêve par lui encore insoupçonné, Nicole, dans toute la pureté de son cœur, s’était défendue contre le sentiment dont elle n’avait pas tardé à comprendre, non sans frayeur, l’irrésistible intensité et la délicieuse tyrannie !...
Elle ne pouvait détacher sa pensée de celui qui lui était apparu tout à coup si beau, si généreux, si vibrant, si romanesque... Sa voix chantait sans cesse à ses oreilles. Elle gardait sur sa main satinée, tout près de la bague qu’il lui avait donnée, l’ineffable mais très douce brûlure de ce baiser qu’y avait déposé le galant capitaine.
Et malgré elle, cherchant à se mentir à elle-même, elle soupirait :
— Tout cela n’est que folies, que chimères Vaillante et chaste jusqu’au bout, elle se raccrochait à l’espoir que l’oubli la délivrerait bientôt de ce rêve impossible.
Ah ! comme elle se trompait, la pauvre petite... Elle l’avait bien senti, en lisant l’arrêt du Parlement de Grenoble, puisqu’elle avait eu grand’peine à retenir ses larmes et que, du fond de son cœur, avaient jailli ces mots :
— Quel malheur ! Je ne le reverrai plus jamais.
Et voila que ce simple billet si décisif dans son laconisme, lui apprenait qu’elle aussi était aimée.
A la première minute d’indicible bonheur qui l’avait galvanisée, succédait maintenant un désarroi qui allait vite se préciser en un irrésistible besoin de confidence.
Mais à qui ouvrir son cœur ?... A ses parents ?... Il ne fallait point y songer... A ses amies ?... Elle ne pouvait compter que sur leur indiscrétion et leurs moqueries... Un tel secret était trop grave pour le confier à des êtres humains. Il ne relevait que de Dieu ; et Nicole, bouleversée, résolut de se rendre aussitôt à l’église. Se levant, elle fit quelques pas dans l’allée et jeta un coup d’œil à l’intérieur de la maison.
A travers la fenêtre entr'ouverte du petit salon campagnard, elle aperçut son père qui reposait béatement dans son fauteuil, puis... Mme Malicet qui ajustait à son bonnet les dentelles dont Mandrin lui avait fait présent.
Alors, tranquillisée, elle se dirigea vers la porte du jardin qui donnait sur la rue, et elle allait en franchir le seuil, lorsqu’elle se trouva en face d’un moine, courbé en d.eux sous sa robe de bure et qui, le capuchon rabattu sur les yeux, lui tendait la main en un geste d’aumône.
— Mon enfant, murmurait-il, avec la voix cassée d’un vieillard qui a beaucoup souffert, je suis un frère quêteur de l’ordre des Théatins... Pour l’amour de Dieu, je vous demande la charité.
Nicole tira de sa bourse une pièce d’argent qu'elle remit au moine. Celui-ci, tout en la faisant disparaître dans une poche de son froc, reprenait d’un ton de plus en plus dolent :
— Je suis harassé de fatigue. Voulez-vous me permettre de me reposer ?... Un peu de paille me suffirait...
— Mon frère, déclarait la jeune fille avec un accent de grande bonté, ceux qui agissent au nom des pauvres sont toujours les bienvenus dans notre demeure... Venez.
Le Théatin, d’un pas traînant, mal assuré, suivit Nicole dans le jardin ; et comme il était sur le point de succomber à la fatigue qui l’accablait, il se laissa choir sur la margelle du puits.
Tandis que Nicole le contemplait avec pitié, le moine, brusquement, releva son capuchon... Nicole eut un cri étouffé. Elle venait de reconnaître Mandrin.
— Je suis venu pour vous... attaquait le beau capitaine avec un accent enflammé... oui pour vous, dont la pensée remplit maintenant ma vie à un tel point que je ne trouve pas de mots pour vous le dire.
Nicole, bouleversée, se cacha la tête entre les mains.
Mais Mandrin, dont le froc était tombé à terre, poursuivait avec un accent de sincérité et d’ardeur :
— Nicole, la fleur que vous m’avez lancée quand je passais devant vous, la jolie rose aujourd’hui flétrie, mais que je garderai toujours comme le plus précieux des talismans, m’a enveloppé d’un délicieux sortilège.
« Grâce à elle, je connais le plus doux des bonheurs : celui d’aimer Car je vous aime... de toutes les fibres de mon être... de tous les élans de mon cœur...
« Oui, vous avez accompli ce miracle d’apporter, à travers la tempête qui était en moi, la clarté d’un soleil qui me permet de contempler la beauté dans tout ce qu'elle a de plus pur, de plus noble et de plus attirant...
« Mais rassurez-vous, je ne veux pas troubler votre existence, vous arracher à votre foyer, vous emporter...
« Non ! je veux simplement vous dire : Moi qui vous adore, puis-je espérer qu’un jour par vous je serai un peu aimé ? »
Nicole, éperdue, allait tomber dans ses bras ; mais se ressaisissant devant le danger, elle reprit, d’une voix dans laquelle passait un tremblement de sanglots, qui était comme un demi-aveu de sa faiblesse :
— Comment pourrais-j e vous aimer ? N’êtes-vous pas hors la loi ?
— Oui, reprit Mandrin, dont le front s’était assombri... Oui, l’arrêt du Parlement de Grenoble me condamne à la roue... Mais ils ne me tiennent pas encore et j’ose même dire qu’ils ne me tiendront jamais.
Nicole se cacha la tête entre les mains.
Le beau capitaine poursuivait avec amertume :
— Je vous fais peur, n’est-ce pas ?... Sans doute, vous ne voyez en moi qu’un brigand, qu’un misérable... digne du supplice que l’on me promet... Et pourtant, je vous le jure, je ne suis pas un bandit... Je suis un justicier.
Nicole voulut s’enfuir... mais Mandrin lui prit les mains et les emprisonnant tendrement dans les siennes, il la supplia :