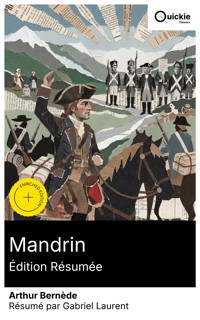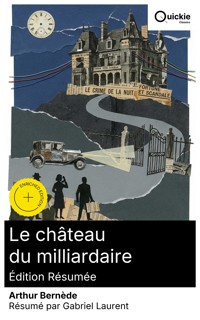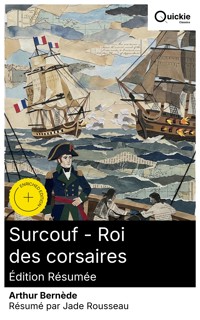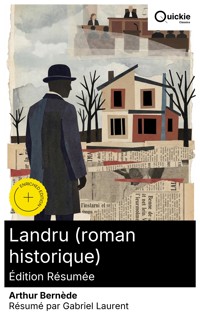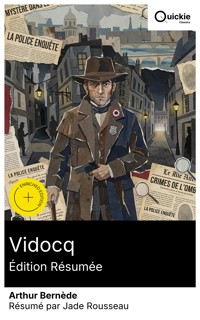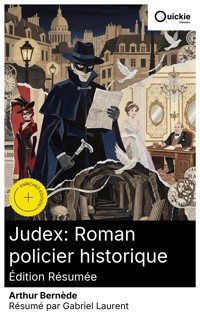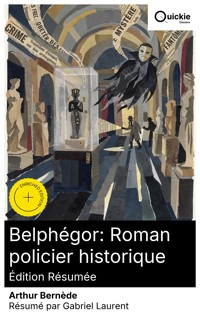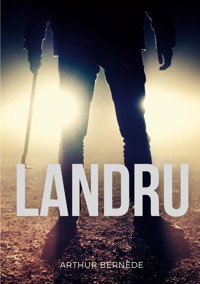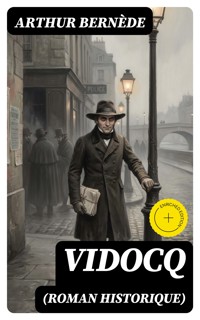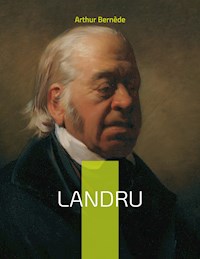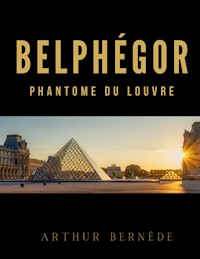Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Surcouf, roi des corsaires" d'Arthur Bernède nous plonge dans l'univers tumultueux de la piraterie et des guerres maritimes à travers la vie de Robert Surcouf, un corsaire légendaire dont les aventures ont marqué l'histoire navale française. Ce récit captivant retrace la carrière de Surcouf, depuis ses débuts modestes à Saint-Malo jusqu'à sa renommée internationale en tant que redoutable corsaire. Le livre dépeint avec précision les batailles navales épiques contre les Britanniques, où Surcouf se distingue par sa bravoure et son ingéniosité. Bernède explore également les aspects plus personnels de la vie de Surcouf, révélant un homme complexe, à la fois charismatique et stratégique, qui navigue habilement entre ses ambitions personnelles et les exigences de son époque. En s'appuyant sur des faits historiques et des anecdotes vivantes, l'auteur réussit à rendre hommage à cet homme hors du commun, tout en offrant une réflexion sur les enjeux politiques et économiques de l'époque napoléonienne. Ce livre est une véritable odyssée maritime, riche en détails et en émotions, qui transporte le lecteur dans un voyage inoubliable à travers les mers et les légendes. L'AUTEUR : Arthur Bernède, né en 1871 à Redon, est un écrivain prolifique et scénariste français, connu pour ses romans d'aventure et ses pièces de théâtre. Après avoir débuté sa carrière littéraire à Paris, il se fait rapidement un nom grâce à son style narratif captivant et ses intrigues bien ficelées. Bernède est également reconnu pour sa collaboration avec le cinéaste Louis Feuillade, avec qui il coécrit plusieurs scénarios de films muets, contribuant ainsi au développement du cinéma français. Parmi ses oeuvres les plus célèbres, on compte "Belphégor", qui a connu plusieurs adaptations, et "Judex", un feuilleton populaire. Son intérêt pour l'histoire et les personnages hors du commun se manifeste dans ses récits, où il parvient à mêler réalité et fiction avec habileté. Bien que ses oeuvres aient parfois été éclipsées par d'autres auteurs de son époque, Bernède reste une figure importante de la littérature populaire française du début du XXe siècle. Il décède en 1937 à Paris, laissant derrière lui un héritage littéraire riche et varié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
MOT DE L’AUTEUR
PROLOGUE
PREMIÈRE PARTIE : LES FIANCAILLES TRAGIQUES
I : LE RETOUR DU VAINQUEUR
II : MADIANA
III : L'AMITIÉ ET L’AMOUR !
IV : UN CŒUR DE BRETONNE
V : LE MALOUIN ET LE LORIENTAIS
VI : LE MYSTÈRE DU KENT
VII : À L'ABQRDAGE !
VIII : APRÈS LA BATAILLE
IX : À SAINT MALO
X : À BORD DU CROWN
XI : L'ÉTRANGÈRE
XII : MARCOF
XIII : LE BONHEUR DES UNS, LE MALHEUR DES AUTRES
XIV : LES PRISONNIERS ANGLAIS
XV : TAGORE
XVI : LIBERTÉ ! LIBERTÉ CHÉRIE !
XVII : UN COUP DE THÉÂTRE
XVIII : LE SACRIFICE
XIX : PRÉPARATIFS D'EXPÉDITION
XX : EN FACE DE LA CROIX
XXI : LE TESTAMENT DU CORSAIRE
XXII : OÙ NOUS VOYONS SURCOUF FAIRE PREUVE D’UNE HABILETÉ ÉGALE À SON AUDACE
DEUXIÈME PARTIE : LA CHASSE A L’HOMME
I : A LA GRACE DE DIEU
II : L’HÔTE INATTENDU
III : OÙ L’ON VOIT TAGORE CONTINUER SON ŒUVRE INFÂME
IV : FRANCE... ANGLETERRE !
V : EN PRISON
VI : LE MESSAGE
VII : DANS LES RUINES DU GUILDO
VIII : LE GUET-APENS
IX : SURCOUF ET BONAPARTE
X : UNE FAMILLE EN DEUIL
XI : LES TROIS DUELS DU COMMANDANT SURCOUF
XII : L’ADIEU SUPRÊME
XIII : NUIT D’AGONIE
XIV : LE COUP DE POIGNARD
XV : UN MIRACLE
XVI : L’ADIEU À L’ÉQUIPAGE
XVII : DE VRAIS AMIS
XVIII : EN ATTENDANT LA MORT
XIX : CE QUE CONTENAIT LE MESSAGE DE BONAPARTE
XX : LE DERNIER CRIME DE JACQUES MOREL
XXI : IL ÉTAIT ÉCRIT LÀ-HAUT...
ÉPILOGUE
MOT DE L’AUTEUR
Il ne faut pas confondre corsaires avec pirates... Le pirate était un bandit qui exerçait en tout temps son métier infâme. Le corsaire, lui, n'armait qu’en temps de course, muni d’une autorisation expresse de son gouvernement appelée « lettre de marque ». Et les corsaires, noblement, accomplirent de fameux exploits.
C’est l’histoire du plus grand de tous, Robert Surcouf le Malouin sans peur et sans reproche, que, d’après des documents rigoureusement authentiques, nous allons vous raconter.
A.B.
PROLOGUE
Le 20 septembre 1786, une tempête terrible bouleversait la Manche. D’énormes vagues battaient les murs de Saint-Malo, patrie des rudes marins et des grands corsaires.
Les navires de cabotage et les baraques de pêche avaient pu rallier à temps le port, où leurs coques se pressaient les unes contre les autres, comme un troupeau-de moutons noirs à l’approche de l’orage ; et leurs mâts, dépouillés de toute voilure, se courbaient en gémissant sous la rafale.
Sur les remparts, cuirasse plusieurs fois séculaire de la vieille cité bretonne, des hommes, ruisselants sous les paquets de mer, des femmes, dont la pluie détrempait les ailes de leurs coiffes blanches, entouraient, anxieux, un vieux capitaine au long cours, au visage hâlé, creusé de rides et encadré d’un épais collier de barbe blanche. Celui-ci, à travers une longue-vue, regardait un frêle canot qui, à un mille de la côte, secoué par les lames gigantesques, semblait, à chaque instant, sur le point de s’abîmer dans les flots.
Tout à coup, l’observateur s’écria :
— Mille tonnerres de Brest ! mais c’est un enfant qui est dans cette barque !
— Un enfant ! répéta aussitôt une voix vibrante.
Et un homme d’une trentaine d’années, à la carrure puissante, à l’œil brillant, à la figure énergique, et portant l’uniforme d’officier corsaire, s’approcha vivement du capitaine.
La foule s’écarta avec respect. Elle venait de reconnaître le commandant Marcof, dont les exploits retentissants et quasi légendaires inspiraient une aussi vive terreur aux Anglais qu’une admiration enthousiaste à ses compatriotes.
Brusquement, Marcof s’empara de la longue-vue et sonda l’horizon.
Bientôt, il scanda, d’une voix rude :
— Vous avez raison, père Lequellec, c’est un moussaillon qui est dans cette coquille de noix... Il se défend bien, le petit bougre ! N’empêche qu’il est perdu si nous n’allons pas vite à son secours.
Et s’adressant à plusieurs marins de son équipage qui l’avaient rejoint :
— Venez, les amis ! lança-t-il... Il ne sera pas dit que nous aurons laissé périr sous nos yeux un p’tit gars de chez nous !
Suivi par ses compagnons, Marcof dégringola quatre à quatre un escalier qui conduisait à la grève... Une chaloupe gisait sur le sable, couchée sur le flanc. Sa coque, qui disparaissait à moitié sous les flocons d’écume, frissonnait sous les attaques du vent.
Marcof contempla un instant, d’un regard assuré, la mer déchaînée qui semblait défier son courage. Puis, d’un ton bref, impérieux, il ordonna à ses hommes :
— Mettez cette embarcation à l’eau !
Silencieusement, les matelots poussèrent la chaloupe au milieu du rejaillissement des vagues et s’y précipitèrent avec leur chef. Ils empoignèrent les avirons, et, arc-boutés sur leurs bancs, ils se mirent à ramer vigoureusement au milieu de la tourmente, tandis que Marcof, s’emparant de la barre, lançait ce cri, qui domina le tumulte de l’ouragan :
Hardi ! mes Bretons ! Hardi ! mes Malouins ! Et que Dieu nous garde !
L’enfant continuait à lutter avec une vaillance qui révélait une volonté et une adresse que lui eussent enviées bien des professionnels... C’était un garçonnet de treize à quatorze ans, courageux, ardent, râblé, intrépide. Les mains crispées sur les avirons, il s’évertuait, avec une opiniâtreté et une vigueur bien au-dessus de son âge, à regagner le port.
Mais ses forces commençaient à s’épuiser... L’eau envahit la barque... Une rame se cassa en deux. Soulevé par une énorme montagne liquide, le canot fut se jeter sur un rocher contre lequel il se brisa, et l’enfant disparut dans un remous.
Marco fallait-il arriver trop tard ?
Mais voilà qu’une tête émerge au milieu du ressac qui ceinture le rocher d’une mousse bouillonnante...
Toutes ses forces galvanisées en un effort suprême, le pauvre petit veut lutter encore... Il nage éperdument vers le bloc de granit cause de son naufrage, devenu maintenant son unique espoir... Mais il est épuisé... à bout... Il va couler de nouveau... et cette fois pour toujours... lorsqu’une lame énorme l’enveloppe, le soulève et le projette avec violence jusqu’au sommet de la roche qui forme une étroite plateforme sur laquelle il demeure étendu, évanoui, le front ensanglanté, au milieu de l’infernal concert où les hurlements du vent en furie se mêlent au tonnerre assourdissant des coups de mer heurtant, déchiquetant et menaçant de submerger le minuscule îlot battu par la tempête.
*
— Que me racontez-vous là, monsieur le supérieur ? Comment ! Robert s’est échappé ?
— Hélas ! oui, monsieur Surcouf, et j’arrive tout exprès de Dinan, par ce temps épouvantable, pour vous mander cette fâcheuse nouvelle.
Et le révérend père Monnier, régent du collège des jésuites à Dinan, vieil ecclésiastique froid et ascétique, ajouta d’un ton lugubre :
— Vous m’en voyez outré et peiné plus que je ne saurais vous le dire !
M. Surcouf— un homme de quarante-cinq ans environ, aux allures de grand bourgeois frotté d’aristocratie, très digne, très sévère, et quelque peu solennel — se tourna vers sa vieille mère, au visage si doux sous ses bandeaux de cheveux blancs et dont les yeux tout de claire bonté s’étaient embués de larmes.
Puis il exprima d’une voix tremblante de colère :
— Vous entendez, grand-maman... Je vous l’avais toujours dit que Robert serait la honte et le désespoir de notre famille !
Et il poursuivit, de plus en plus furieux et véhément, tout en arpentant à grands pas son vaste salon, dont les doubles fenêtres, secouées par de violentes rafales, donnaient sur une terrasse qui communiquait directement avec les remparts de la ville :
— Déjà, quand Robert était ici, nous ne pouvions pas en venir à bout... Il passait son temps à faire l’école buissonnière, à courir sur la grève avec la marmaille des pêcheurs, grimpant sur les rochers, se disputant, se battant, ne rentrant qu’au soir, les vêtements en loques et recommençant le lendemain, malgré les corrections que je lui infligeais !
« Et moi qui avais la naïveté de croire que sous la férule du père Monnier il finirait par s’amender ! Ah ! bien oui ! voilà, maintenant, qu’il se sauve comme un malfaiteur !...
Mais je ne me laisserai pas attendrir... Et c’est dans un pénitencier que je vais faire enfermer, cette fois, ce fils dénaturé, ce misérable !
— Calme-toi ! implorait l’aïeule bouleversée... Et vous, mon révérend père, dites à mon fils de ne pas se montrer aussi dur envers cet enfant.
— Madame, répliquait le Supérieur sur un ton de juge qui rend un verdict implacable, j’ai le regret de vous dire que votre petit-fils est indigne de toute pitié... Depuis trois mois qu’il est mon pensionnaire, il s’est montré l’élève le plus indiscipliné de tout le collège, entraînant ses camarades aux pires incartades, aux plus coupables extravagances.
« Ce matin, à l’heure de la récréation, ce véritable démon n’avait-il pas improvisé, dans la cour, un bateau avec des bancs et une vieille caisse ? Et tout en brandissant un drapeau fait avec un vieux chiffon flottant au bout d’un manche à balai, il s’écriait :
« — Moi, je suis Marcof, le corsaire !
« Puis, avisant le petit Jacques Morel, élève docile et studieux entre tous, il lui ordonnait :
« — Toi, tu es l’amiral anglais !
« Mais Jacques Morel, pas plus que ses camarades, ne voulait représenter l’ennemi... Alors, Robert se jeta sur lui et le frappa brutalement.
« Je me précipitai, je séparai les combattants... Je m’emparai de votre fils et je voulus lui administrer le fouet devant tous ses camarades... Mais, au moment où, tout en le tenant d’une main, je brandissais mon martinet, il se retourna, se cramponna à mes jambes, et me planta ses dents au gras du mollet...
— C’est un cannibale !... ponctuait M. Surcouf, au comble de l’indignation.
— Surpris par la douleur, continuait le père Monnier, je lâchai ce jeune misérable... qui en profita pour s’enfuir... escalader un mur... et disparaître dans la campagne... J’ordonnai aussitôt que l’on s’élançât sur les traces du fugitif... Mais il fut impossible de le rejoindre.
« Un marin du port de Dinan prétend l’avoir vu sauter dans un canot et s’éloigner sur la Rance, vers Saint-Malo... C’est, hélas ! tout ce que je puis vous dire.
— Mon Dieu ! soupirait la vieille Mme Surcouf, pourvu qu’il ne lui soit pas arrivé malheur !
Et elle se laissa tomber, en pleurant, sur une chaise.
Une adorable fillette de six ans accourait vers elle, l’entourait de ses bras, et lui murmurait avec un accent d’exquise tendresse :
— Ne pleurez pas, ma bonne marraine, Robert va sûrement revenir.
C’était Marie-Catherine, une nièce, une orpheline, que Mme Surcouf avait recueillie et qu'elle aimait autant que si elle eût été vraiment sa petite-fille.
Mais M. Surcouf paraissait de moins en moins disposé à la clémence.
— Je pars à la recherche de ce garnement, décidait-il.
Et, tout en s’emparant de sa canne, il martela :
— Pour commencer, je vais lui flanquer une de ces volées dont il se souviendra toute sa vie.
— Charles, mon ami... suppliait Mme Surcouf en se précipitant vers son fils et en cherchant à lui arracher son bâton.
Parrain !... parrain !... suppliait Marie-Catherine.
Mais M. Surcouf scandait, en frappant du pied :
— La paix, vous autres ! je porte un nom trop honorable pour le laisser salir, un jour, par le chenapan que menace d’être mon fils.
— Pitié pour lui ! implorait l’aïeule.
— Voyons, ma mère, vous oubliez donc que les Surcouf de Boigris sont des gentilshommes... que du sang de Duguay-Trouin coule dans leurs veines ?... Que votre arrière-grand-père, Porçon de la Barbinais, le plus illustre corsaire du XVIIe siècle, mourut comme un héros pour la gloire de la France, et que nul d’entre nous n’a jamais forfait à l’honneur !... Encore un coup, je ne tolérerai pas que notre nom soit traîné dans la boue !...
Mais, soudain, la porte s’ouvrait avec fracas, laissant apparaître une jeune servante qui annonçait, la mine effarée :
— Voilà monsieur Robert !
Tandis que M. Surcouf proférait un grognement de colère, et que le père Monnier se figeait en une attitude renfrognée, la grand-mère et Marie-Catherine s’élançaient au-devant du fugitif.
Mais toutes deux laissèrent échapper un cri de détresse...
Sur le seuil, le commandant Marcof venait d’apparaître, tenant dans ses bras un enfant évanoui.
— Robert, mon enfant, blessé !... mort, peut-être ! s’écriait la grandmère.
— Rassurez-vous... rien de grave... se hâtait de déclarer Marcof, en déposant l’enfant sur un canapé.
Mme Surcouf se pencha vers son petit-fils, dont les vêtements ruisselaient et dont les cheveux s’entremêlaient de brins d’algues et de varechs humides.
— Mon petit... mon petit ! répétait-elle en le serrant dans ses bras.
Marie-Catherine, doucement, s’était emparée d’une des mains de Robert et la tenait dans les siennes comme pour le réchauffer.
— Ah çà ! d’où vient-il donc ? interrogeait M. Surcouf.
— D’un voyage au long cours qui a failli mal finir, répliquait le corsaire avec un large sourire... Ah ! il peut se vanter de l’avoir échappé belle !
L’enfant, sous les caresses de sa grand-mère, s’était ranimé... Ses paupières relevées laissaient apercevoir une paire d’yeux d’un gris d’acier qui, instantanément, avaient repris tout leur éclat... éclairant son visage encore un peu pâle d’une étrange lueur de farouche audace et d’indomptable volonté.
— Remercie notre ami Marcof, invitait Mme Surcouf, car c’est lui qui t’a sauvé !
Robert eut un cri de reconnaissance et de joie ; et se levant sans effort, déjà d’aplomb sur ses jambes nerveuses, la poitrine palpitante sous sa chemise en loques et toute trempée, il s’avança en souriant vers le corsaire. .. Mais son père lui barra la route... et, lui désignant le père Monnier toujours silencieux et impitoyable, il imposa d’un ton autoritaire :
— Demande d’abord pardon à ton maître !
Robert dirigea vers le régent un regard chargé d’hostilité et de colère. Puis, négativement, il secoua la tête.
— Obéis ou gare à toi ! menaçait M. Surcouf.
Mais le petit, les poings crispés, répliquait :
— Le père Monnier a voulu me battre... je me suis défendu ! Je n’ai pas à lui demander pardon !
— A genoux, vaurien ! Imposait le père, en secouant son fils par le bras.
Mais, échappant à son étreinte, Robert courait se réfugier dans les bras de Marcof en criant :
— Emmenez-moi, commandant ! Emmenez-moi ! Moi aussi, je veux être marin ! Moi aussi, je veux être corsaire !
— Ça, jamais ! se révoltait M. Surcouf.
— Vous avez tort, intervenait nettement Marcof... Vous devriez, au contraire, me confier cet enfant... Il est brave, solide, intelligent... aventureux. .. Il aime la mer... Il ferait un admirable marin.
— Voyons, Marcof ! vous n’y songez pas ?
— C’est sa vocation... soyez-en sûr !
— Oh ! oui, papa !
Et, transfiguré, Robert lança avec force :
— Si vous ne me laissez pas aller sur la mer, eh bien, je me jetterai dedans !
— Polisson ! vitupérait M. Surcouf, qui, quelque peu démonté par cette apostrophe, dirigea son regard vers le père Monnier comme pour lui demander conseil.
Alors le religieux, s’évadant de son impassibilité, fit, en désignant de son index squelettique Robert, qui, haletant d’émotion, attendait la décision paternelle :
— Laissez-le partir, car vous n’en ferez jamais rien de bon.
Radieux, l’enfant exultait.
— Oh ! oui, papa, donnez-moi au commandant Marcof... et je deviendrai, moi aussi, un corsaire !
M. Surcouf se taisait, perplexe. On eût dit qu’en proférant cette phrase, jaillie du fond de son cœur ardent et enthousiaste, son fils venait de se révéler à lui de telle sorte qu’il lui devenait impossible de contrecarrer sa destinée.
— Eh bien ! soit, articula-t-il... Qu’on me débarrasse de ce chenapan !
A ces mots, Mme Surcouf eut un sanglot douloureux... Elle adorait cet enfant dont elle avait remplacé la maman, prématurément disparue... et la pensée qu’il allait courir, si jeune, de si grands dangers, la bouleversait d’angoisse...
Mais Robert se précipitait vers elle.
— Grand-mère, s’écria-t-il, n’aie pas de chagrin... Je te rapporterai bientôt un beau cachemire des Indes...
— Mon pauvre petit, se désolait la brave femme, tu peux périr dans un naufrage, tu peux être tué au cours d’une bataille !
— Bah ! vous me mettrez au cou une médaille de sainte Anne d’Auray et je passerai au travers de la tempête et de la mitraille.
Et, s’adressant à Marie-Catherine qui, elle aussi, pleurait de toute sa pauvre âme affectueuse et tendre, il ajouta :
— Console-toi, petite cousine, je te ferai cadeau d’un collier de corail que tu mettras les jours de fête... et à toi, papa, j’offrirai une belle pipe que tu fumeras, le soir, sur la terrasse !
Puis, retournant vers Marcof, qui le contemplait avec une orgueilleuse allégresse, il fit, en rejetant en arrière ses cheveux qui découvrirent un front superbe, un de ces fronts qui semblent faits pour abriter les idées généreuses, les volontés inébranlables, les ardeurs sublimes :
— Commandant... quand partons-nous ? — Demain ! p’tit gars... répondit Marcof. — Quel bonheur !
Et tout en posant sa main, en un geste de protection fraternelle sur la tête de Robert, Marcof ajouta :
— Rappelez-vous ce que je vous dis, monsieur Surcouf, votre fils sera un jour un grand corsaire !
PREMIÈRE PARTIE : LES FIANCAILLES TRAGIQUES
I : LE RETOUR DU VAINQUEUR
Quatorze ans après les événements que nous venons de décrire, une corvette gracieuse, fine, légère, et qui semblait ralentir volontairement sa course, afin de permettre à quatre puissants vaisseaux de la suivre, arrivait en vue de Saint-Malo.
Sur la dunette, un homme très jeune encore, et dont l’uniforme de commandant corsaire faisait valoir la haute stature athlétique, le visage bronzé et magnifiquement volontaire, contemplait d’un air d’orgueilleuse allégresse la silhouette pittoresque de la vieille ville bretonne qui, incrustée à son rocher, se précisait peu à peu, avec ses fiers remparts à jamais inviolés que surplombaient les toits en ardoises des maisons étroitement massées autour du beau clocher de la cathédrale.
La prédiction de Marcof s’était réalisée.
Robert Surcouf rentrait en vainqueur dans sa petite patrie.
Après un rude apprentissage sous les ordres de Marcof, Robert était devenu, en effet, mieux qu’un habile marin, un chef formidable.
A la suite de nombreux exploits où il avait fait preuve d’une bravoure sans limites et d’une intelligence prodigieuse, Marcof, qui s’était pris pour lui d’une affection fraternelle, lui avait dit : — Maintenant, mon garçon, tu peux voler de tes propres ailes.
Généreusement, Marcof avait sollicité et obtenu du ministre de la Marine, pour son brillant élève, une lettre de marque grâce à laquelle le jeune Robert allait pouvoir armer un navire et faire la guerre de course pour son propre compte.
Surcouf s’embarquait aussitôt pour l’Ile de France, dernier fleuron de notre empire colonial des Indes, devenu le havre de nos plus hardis corsaires.
Il convainquit promptement un armateur de ce pays de lui donner le commandement d’un bateau ; puis, se libérant bientôt de cette tutelle, il se faisait construire un navire, un navire bien à lui, et quel navire ! la Confiance, une corvette mince, élancée, rapide comme une hirondelle, truquée comme un décor de féerie, pouvant se transformer presque instantanément en un paisible brick de cabotage ou en un merveilleux instrument de combat, dont le seul pavillon tricolore, lorsqu’il surgissait à l’horizon, suffisait à mettre en fuite l’adversaire, quand bien même celuici eût été dix fois supérieur en tonnage, en hommes et en canons.
Effroi des Anglais avec lesquels nous étions en guerre, s’emparant de leurs bâtiments de commerce, s’attaquant même à leurs vaisseaux de ligne, tantôt s’en emparant, tantôt les coulant à pic, se battant à la fois pour l’argent et l’honneur, le profit et la gloire, aussi audacieux que fertile en ruses, mais toujours généreux et chevaleresque, doué d’une de ces forces herculéennes qui n’appartiennent qu’à des Titans, Robert Surcouf, à l’âge de vingt-sept ans, était déjà nimbé d’une auréole quasi légendaire.
Adoré de ses matelots, qu’il courbait sous une discipline de fer, mais qui l’eussent suivi au bout du monde, tant il leur inspirait d’admiration et de dévouement, célèbre, redouté, il vivait mieux que l’existence qu’il avait rêvée dès son enfance, il exerçait sur les mers une dictature incontestable et incontestée.
Aujourd’hui, traînant à sa suite quatre bâtiments pris à l’ennemi et chargés d’un riche butin : le Pingouin, le Cartier, le Triton et la Diana, qui, à elle seule, ne comptait pas moins de six mille balles de riz dans sa carène, Robert Surcouf, trompant la surveillance de la flotte anglaise, revenait pour la première fois dans sa ville natale.
Après avoir doublé le fort Harbour, le grand et le petit Bé, îlots armés qui défendaient les abords de la ville et l’entrée de la Rance, la flottille, profitant de la marée haute, pénétra dans le port qui se trouvait à l’emplacement actuel des bassins et où les corsaires avaient l’habitude d’échouer leurs bateaux à marée basse.
Une vive agitation régnait sur l’estacade. Les Malouins s’apprêtaient à fêter leur compatriote.
Dès que la Confiance eut accosté, Surcouf sautait à terre au milieu des acclamations. Toutes les mains se tendaient vers lui, en un élan d’indescriptible enthousiasme... C’était vraiment le cœur de la vaillante cité qui, fière de son jeune héros, dont la renommée lui était parvenue à travers les océans, battait noblement à l’unisson du sien.
Entraîné par ses amis, Surcouf, après avoir passé sous un arc de triomphe fait de trophées maritimes et dont le fronton portait cette inscription en grosses lettres : « Honneur à Surcouf, roi des corsaires », tout en marchant sur les fleurs que des femmes jetaient sous ses pas, se hâtait vers la maison paternelle, où les siens l’attendaient.
Echappant à ses admirateurs, le corsaire gravit juvénilement les degrés de l’escalier qui donnait accès à la terrasse. M. Surcouf et la bonne grand-mère s’avançaient tous deux, un peu vieillis... lui, maîtrisant avec peine l’émotion qui l’étreignait, elle, souriant à travers ses larmes heureuses.
Robert attira contre lui Mme Surcouf et la garda dans ses bras en une longue étreinte... Puis le père et le fils échangèrent une chaleureuse accolade. Vite, Mme Surcouf, s’emparant de nouveau de son petit-fils, l’entraînait par la main vers une exquise jeune fille qui, dans tout l’épanouissement de sa vingtième année, apparaissait sur le seuil...
Déjà sous le charme, Surcouf la considérait avec une expression d’étonnement joyeux.
— Mais c’est Marie-Catherine ! s’écria-t-il.
Et, tout en lui prenant la main, il ajouta :
— Que tu es devenue jolie !
Marie-Catherine baissa la tête en rougissant.
— Eh bien ! embrasse-moi... invitait Surcouf.
La jolie Bretonne tendit son front pur comme celui d’une madone... Robert y appuya ses lèvres.
Mais Surcouf disait à son fils, en lui désignant un jeune homme d’aspect malingre, au visage tourmenté, au regard sombre et fuyant et qui, jusqu’alors, s’était tenu discrètement à l’écart : — Tu ne reconnais donc pas Jacques Morel, avec qui tu te battais autrefois ?
— Comment ! c’est toi ! s’écriait Surcouf, en tendant loyalement la main à son ancien condisciple du collège de Dinan.
Et, rondement, il ajouta :
— Qu’es-tu devenu, mon cher Jacques ?
Morel répliquait, avec une humilité marquée d’une certaine amertume : — Oh ! pas grand-chose ! Je suis simplement commis aux écritures chez un armateur de Saint-Malo... Moi, je n’ai jamais eu de chance !
Mme Surcouf, se rapprochant de son petit-fils, lui demandait avec une tendre et timide anxiété : — Alors, tu vas rester un peu avec nous ?
— Longtemps... toujours... s’écria le corsaire... Je suis riche à présent, et je veux que nous soyons tous heureux !
La bonne maman eut un cri d’allégresse... Elles étaient donc finies, les longues journées d’attente, les interminables nuits d’angoisse... Et, chancelant sous le poids de son trop grand bonheur, elle murmura, les mains jointes : — Est-ce possible, mon Dieu ? Est-ce possible ?
Robert, qui la dominait de sa haute taille, l’attira de nouveau dans ses bras...
— Venez, fit-il, nous avons tant de choses à nous dire...
Et il disparut avec elle dans la maison, suivi par son père exultant d’orgueil, par Marie-Catherine radieuse d’allégresse, et par Jacques Morel toujours taciturne et amer.
Jusqu’au soir, Surcouf, avec la simplicité, la modestie des vrais héros, raconta ses exploits aux siens... Puis ce fut, après tant d’années, le premier repas en famille... et quel repas !... solide, plantureux, et sans cesse égayé par la verve truculente, l’entrain véhément du grand marin , dont son père et son aïeule, ainsi que Marie-Catherine, buvaient chaque parole, s’enthousiasmant à ses récits, les revivant avec lui, et ne cessant de l’inciter à parler...
Jacques Morel, lui-même, s’efforçait de se mettre à l’unisson. Mais personne ne faisait attention à lui... Il était écrasé par le voisinage du grand homme... et, sous son sourire figé, il ne parvenait pas à dissimuler le dépit que lui inspirait sa présence.
Tour à tour son regard sournois s’arrêtait sur Robert et sur Marie-Catherine et, lorsqu’il entendait celle-ci, qui n’avait d’yeux que pour son beau cousin, s’exclamer d’admiration, lorsqu’il la voyait battre des mains et se pencher naïvement vers le narrateur, comme pour mieux goûter encore le charme ardent de sa parole, un frisson d’âpre jalousie le secouait de la nuque aux talons et c’était de la haine qui commençait à s’emparer de son cœur aigri et de son âme tourmentée.
A la fin du souper, les matelots de la Confiance apparurent, portant des coffrets lourdement chargés, que, sur un ordre de leur commandant, ils déposèrent dans un coin de la salle.
Surcouf, leur lançant une bourse pleine d’or, s’écriait :
— Allez, mes braves, allez faire ripaille dans tous les cabarets de la ville, vous l’avez bien mérité !
Les matelots se retirèrent en agitant leurs bonnets de laine.
Alors Surcouf fit, le visage illuminé d’une joie presque enfantine : — Ce sont des cadeaux que je vous apporte !
Et, tout de suite, il s’en fut quérir l’un de ces coffres, dits de mer, défendu par une forte serrure et tout peinturluré de couleurs éclatantes : — Vous voyez, s’exclamait-il, je tiens mes promesses !
Tirant de la malle un superbe cachemire des Indes, il s’en fut le placer sur les épaules de sa grand-mère.
— Marie-Catherine !... appela-t-il gaiement.
— Mon cousin ?... répliqua la jeune fille en le rejoignant aussitôt.
Surcouf lui entoura le cou d’un collier, non pas de corail, mais de perles d’un orient magnifique.
— Et moi, je n’ai rien ? interrogeait M. Surcouf avec bonhomie, tandis que Jacques Morel, les lèvres pincées, dirigeait un mauvais regard vers Marie-Catherine, qui, toute confuse, faisait admirer à sa marraine le royal présent du corsaire.
Surcouf, plongeant dans le coffre, en retira un coffret d’ébène, aux incrustations d’ivoire ; et il revint vers son père, en disant : — Ouvrele... Il renferme une surprise !
La surprise, c’était une superbe pipe en écume de mer, montée en or, et qui, finement ciselée, reproduisait, avec un art véritable, les traits de Duguay-Trouin.
Le brave papa, étouffant d’émotion, ne put que murmurer :
— Ah ! mon fils... c’est trop beau... c’est trop beau !...
Mais déjà Surcouf brandissait deux splendides pistolets damasquinés qu’il avait pris dans le coffre.
— Cela, fit-il, c’est un souvenir que je rapporte à mon ancien commandant. .. à mon vieil ami Marcof.
Au nom de Marcof, un grand silence se fit...
Une expression de tristesse s’était instantanément répandue sur tous les visages.
Inquiet, Surcouf interrogeait :
— Lui serait-il arrivé malheur, pendant mon absence ?
— Non, répliquait M. Surcouf, il fait toujours la course entre Saint-Malo et Portsmouth, sur son bateau le Jean-Bart. Seulement... ce n’est plus l’homme que tu as connu.
— Comment cela ?
— C’est toute une histoire, déclarait M. Surcouf avec mélancolie.
« Imagine-toi qu’il a ramené, l’an passé, de l’un de ses voyages, une femme étrange, qu’il s’est bien gardé de présenter à ses amis... Ceux qui l’ont aperçue disent qu'elle est vêtue d’un costume oriental et qu'elle est belle... très belle... mais qu'elle ressemble plutôt à une Européenne qu’à une femme de là-bas...
« Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Nul ne le sait ! Sauf lui et peut-être les hommes de son équipage... mais ceux-ci, respectueux du secret de leur chef, n’ont jamais voulu répondre aux questions qu’on leur posait à ce sujet... Toujours est-il qu’il s’est enfermé avec elle dans sa propriété du Chêne-Vert, sur les bords de la Rance... où il vit... comme un sauvage.
— Ah ! par exemple !... scandait Robert, au comble de l’étonnement.
— Cette païenne l’a ensorcelé, affirmait Mme Surcouf, avec une expression de crainte superstitieuse.
— Marcof amoureux ! Marcof ensorcelé ! s’écriait gaiement le corsaire... En voilà une nouvelle ! et sans attendre à demain, je vais me rendre tout de suite au Chêne-Vert.
— Il ne te recevra pas, ponctuait M. Surcouf.
— Moi, son meilleur ami... moi qu’il a toujours appelé son frère !...
Et, tout en passant les deux pistolets à sa ceinture, Surcouf se dirigea vers la porte.
Mais Marie-Catherine s’élançait vers lui, suppliant :
— Robert, n’allez pas là-bas !
— Pourquoi, petite cousine ?
Alors, toute pâle, toute tremblante, la jolie Bretonne murmura :
— Il paraît que cette femme porte avec elle le malheur !
Surcouf répliqua, tout en lui tapotant la joue :
— Comment ! Marie-Catherine, tu crois encore aux mauvais sorts ! Eh bien ! je ne la crains pas, cette mystérieuse inconnue, pas plus d’ailleurs que personne...
Et, tout en repoussant doucement Marie-Catherine qui, en un geste instinctif, irraisonné, s’était emparée de sa main, il ajouta : — Bonsoir, petite cousine, bonsoir, tout le monde !... A demain !
D’un pas allègre, il gagna la terrasse et disparut dans la nuit. Marie-Catherine, incapable de maîtriser l’angoisse qui l’étreignait, inclina la tête en pleurant.
Mme Surcouf s’approcha d’elle et lui dit avec bonté :
— Il ne faut tout de même pas te forger de pareilles idées.
Mais Marie-Catherine se jeta dans ses bras en sanglotant :
— Marraine, fit-elle... j’ai peur pour lui... j’ai peur !...
Et Jacques Morel, plus blême encore que de coutume, le front barré d’un pli et la bouche entrouverte en un rictus de sourde colère, grinça entre ses dents : — Elle l’aime !
II : MADIANA
Par un admirable clair de lune, sur une terrasse dominant la Rance, ce joli fleuve aux rives si pittoresques qui, après avoir pris sa source aux monts Menez, cœur de la Bretagne, vient se jeter dans la mer entre Dinard et Saint-Malo, une femme à la beauté troublante, vêtue d’une tunique de soie blanche, ses splendides cheveux noirs dénoués sur ses épaules aux reflets d’ambre, se tenait debout, près du parapet qui avait conservé la dentelure de ses vieux créneaux.
Son regard, perdu dans le vague, semblait dédaigner ce beau paysage fait d’eau miroitante et de collines aux verdures estompées d’ombre qui s’offrait à elle comme pour l’envelopper de sa délicieuse poésie.
Immobile, les yeux levés au ciel en une attitude extatique, elle semblait interroger les étoiles... et n’eussent été le rythme régulier qui soulevait légèrement sa poitrine et, par instants, le frémissement de ses narines aspirant l’air de la nuit où se mélangeaient les senteurs de la brise marine et le parfum pénétrant de la campagne environnante, on eût dit une de ces statues étranges, féeriques, telles que la tradition veut qu’autrefois, sous leurs baguettes magiques, les enchanteurs faisaient jaillir d’une source cristalline ou d’une prairie en fleurs.
Tout était en elle grâce et harmonie... On eût dit une perle de l’Orient enchâssée dans un bijou serti par le plus artiste des orfèvres de France.
Mais ce qu'elle avait de plus beau, c’étaient ses yeux. D’un noir de velours, caressants et doux, ils exprimaient une fierté native qui révélait ses hautes origines. Il semblait qu’ils eussent été créés uniquement pour exprimer les plus nobles sentiments... et leur rayonnement superbe annonçait beaucoup plus la fille des dieux que la compagne des hommes.
Près d’elle, sur un banc, un homme de quarante-cinq à cinquante ans, mais dont le mâle visage aux tempes blanchies révélait, sous son masque tourmenté, une vitalité intense, la contemplait en silence avec une expression d’ardent amour.
Tout à coup, la jeune femme tressaillit... Un cri lui échappa... Son visage se crispa et ses yeux si limpides s’assombrirent d’épouvante...
D’un bond, Marcof s’était levé ; et, l’attirant dans ses bras, il lui demandait d’une voix dont il s’efforçait de tempérer la rudesse naturelle :
— Qu’as-tu, Madiana ?
Celle que Marcof avait appelée de ce nom doux comme le chant d’un oiseau des iles répondit en un français à peine teinté d’un léger accent exotique :
— Je viens de voir une ombre rôder au pied de la terrasse.
Marcof se pencha... La berge, que la marée basse laissait à découvert, était déserte. Au loin, venant de la mer, un petit canot traçait sur le fleuve un paisible et silencieux sillage.
— Tu vois, fit-il constater, il n’y a rien... sauf là-bas, une barque de pêche qui sans doute regagne l’anse de Saint-Suliac.
— Si, si, j’en suis sûre... insistait Madiana... J’ai vu... j ai vu !
— Encore ces vilaines idées !
Et Madiana, appuyant sa tête contre la robuste poitrine du marin, fit avec une expression d’effroi indicible :
— Sans cesse je revois ces hommes, ces bourreaux prêts à me frapper !
— Tu n’as rien à craindre... rassurait Marcof... N’avons-nous pas mis entre eux et toi la distance infinie des océans ?
— Tu les connais, insistait Madiana... Ils sont capables de toutes les ruses... aussi bien que de toutes les infamies... Ils disposent de moyens surnaturels... Ils ont juré de me faire périr !... Ils me tueront !... Pierre, ils me tueront !...
— C’est impossible... puisque je suis près de toi.
— Oh ! oui, ne me quitte pas... ne me quitte jamais ! Je ne suis vraiment tranquille que lorsque je suis avec toi, à bord de la corvette... au milieu de tes braves matelots... Là, je n’ai peur de rien, pas même des risques de la bataille... des dangers de l’abordage... parce que je suis sûre que tu seras toujours vainqueur !...
Et, étendant la main vers le château qui profilait, au fond de la terrasse, sa masse sombre flanquée de deux tourelles, elle poursuivit :
— Mais là... dans cette grande maison, je tremble... La nuit, il me semble que j’entends des pas... que je vois des fantômes errer dans les escaliers. .. parmi les couloirs. Oh ! Pierre, nous repartirons bientôt sur ton beau navire. C’est là seulement, près de toi, au milieu de tes marins qui m’aiment comme une sœur et me respectent comme une reine, que je suis parfaitement heureuse !
« Toutes les visions qui me hantent ici, toutes les craintes qui m’obsèdent disparaissent aussitôt au souffle du vent, au bercement de la mer... Tandis que, dans cette maison, si bien gardée que j’y sois par toi, j’ai peur... j’ai toujours peur... car j’ai le pressentiment qu’il m’y arrivera malheur !
— Calme-toi, je t’en prie...
— Emmène-moi, Pierre, je t’en supplie, emmène-moi...
— Nous partirons bientôt... dans quelques jours...
— Demain.
— Eh bien ! oui, demain... je te le promets...
— Merci !
Approchant ses lèvres du front fiévreux de la jeune femme, Marcof y déposa un long baiser.
Puis il reprit :
— Viens et dis-toi bien que nul au monde n’oserait s’attaquer à toi lorsque je suis à tes côtés, lorsque je te tiens dans mes bras !
Doucement, il l’entraîna vers la demeure, un charmant castel du XVIe siècle, que le corsaire avait fait restaurer quelques années auparavant afin de s’en faire un asile de repos entre deux croisières...
Ils en atteignaient le seuil lorsqu’un appel joyeux, sonore, monta de la Rance :
— Ohé ! Marcof !... Ohé !
Tous deux s’arrêtèrent... Marcof un peu troublé, Madiana frissonnant de crainte.
Mais la voix lançait de nouveau :
— Ohé ! Marcof ! Ohé ! c’est moi, Surcouf !
— Surcouf ! tressaillit le corsaire, dont le visage se rasséréna.
Et il dit à Madiana :
— C’est un ami, celui dont je t’ai parlé si souvent... Surcouf... le meilleur, le plus brave !... Je vais le recevoir... Va m’attendre dans la grande salle. Je te le répète... je te jure... tu n’as rien à redouter. Va !
Madiana obéit à regret.
Tandis que Marcof s’éloignait, elle entra dans la maison, traversa un large vestibule et pénétra dans une salle d’aspect sévère, aux vieux meubles bretons en bois sculpté et uniquement éclairée par une lampe d’église, en argent massif, qui pendait à la voûte.
Au fond, une fenêtre garnie de vitraux était ouverte...
Madiana s’en approcha... et, comme elle se penchait au-dehors, une exclamation lui échappa.
Elle venait d’apercevoir une échelle de corde fixée par des crochets de fer à la barre d’appui et descendant jusqu’à la berge du fleuve qui, en un angle en retrait à peine arrondi, contournait le castel.
A la rive... en bas de l’échelle... une barque vide était attachée.
— Pourquoi cette échelle ?... Pourquoi ce canot ?... se demandaitelle avec épouvante...
Mais une tenture se soulevait... Deux hommes vêtus de tuniques noires, véritables démons surgissant des ténèbres, s’élançaient vers elle.
— A moi !... au secours !... eut-elle le temps de proférer en un cri d’épouvante.
Les deux inconnus aux visages bronzés, aux yeux de braise, aux mouvements de félin, s’étaient rués sur Madiana qui, après s’être vainement débattue, s’évanouissait dans leurs bras...
L’un d’eux, très grand, très robuste, s’emparait d’elle et se dirigeait vers la fenêtre... lorsqu’un bruit de pas saccadés retentit sur les dalles du vestibule...
Vite, le second personnage, un homme très jeune, presque un adolescent, au corps agile, onduleux, s’en fut, d’un bond de panthère, s’embusquer derrière la porte.
Brusquement, celle-ci s’ouvrait, livrant passage à Marcof qui, attiré par les cris de Madiana, s’était précipité dans le château.
A peine avait-il pénétré dans la pièce qu’il chancelait et s’écroulait comme une masse... L’homme aux aguets lui avait planté son poignard entre les deux épaules.
Vite, l’assassin se hâtait de rejoindre son complice qui s’apprêtait à fuir avec sa proie par l’échelle de corde... Il n’en eut pas le temps...
Un homme surgissait tout à coup, colossal, formidable... C’était Surcouf !
A sa vue, les deux agresseurs eurent un instant d’hésitation.
On eût dit qu’ils avaient la subite compréhension qu’ils se trouvaient en face d’une des forces de la nature à laquelle rien ne peut résister.
Surcouf en profita pour saisir l’assassin de Marcof et, lui broyant le bras dans une étreinte d’acier, il le forçait à lâcher son arme. Le ravisseur de Madiana, abandonnant sa victime, se glissait vers le corsaire, cherchant, comme l’avait fait son complice, à le frapper dans le dos... Surcouf, se retournant brusquement, l’empoigna à la gorge... et il allait l’étrangler sans coup férir, lorsque l’autre bandit, qui s’était relevé, s’armait d’un siège et le lançait dans la direction du corsaire...
Mais il avait mal calculé son but et l’objet, au lieu d’atteindre Surcouf, s’en fut heurter la lampe qui s’éteignit, à demi fracassée... Et ce fut l’obscurité absolue...
Surcouf sentit son adversaire lui glisser entre les mains comme un serpent...
Emporté par la fureur, il voulut le rattraper... Mais, se heurtant au corps de Madiana et de Marcof, étendus sur les dalles, trébuchant contre les meubles, il ne put qu’entrevoir vaguement deux ombres qui s’agitaient et disparurent tels des fantômes s’évaporant dans la nuit.
Courant vers la fenêtre, il se pencha au-dehors et aperçut un canot qui s’éloignait à force de rames vers la rive droite de la Rance...
Quant à l’échelle de corde, elle avait disparu !
Surcouf eut un moment l’intention de s’élancer à la poursuite des mystérieux malfaiteurs... Mais une plainte s’élevait
— Grâce !... Pitié !... À moi !... À moi !...
Vite, Surcouf battit un briquet et alluma une chandelle de cire plantée dans un flambeau d’étain.
A sa lueur sinistre, il aperçut une femme agenouillée près de Marcof qui baignait, inanimé, dans une mare de sang.
Les yeux hagards, les cheveux en désordre, les traits convulsés par une terreur folle, elle bégayait :
— Ils l’ont assassiné !... Ils l’ont assassiné !
Surcouf s’approcha d’elle... A la vue du corsaire, son épouvante parut grandir encore... Elle étendit en avant ses bras magnifiques en un geste d’imploration suprême.
Mais Surcouf, bouleversé par cette tragique apparition, s’écriait
— Ne craignez rien ! C’est moi qui vous ai sauvée !
Et, s’agenouillant près de Marcof, dont il souleva doucement la tête, il ajouta, en dirigeant vers Madiana un regard plein de profonde pitié :
— Je suis Robert Surcouf !
Mais Madiana continuait à fixer Marcof qui baignait dans son sang.
— Il est mort ? interrogeait-elle avec épouvante.
— Non... blessé seulement... répondait Surcouf.
Et avec ce sang-froid, cette promptitude de décision qui le caractérisaient, il ajoutait :
— Conduisez-moi jusqu’à sa chambre... Je vais lui donner tous les soins nécessaires.
Dominée par l’ascendant du grand corsaire, en même temps que rassurée par sa présence, Madiana, d’une main encore tremblante, s’empara de la chandelle de cire et conduisit Surcouf, qui portait dans ses bras vigoureux Marcof évanoui, jusqu’à une chambre du rez-de-chaussée qui donnait sur un large vestibule.
Avec précaution, Robert déposa son ami sur un grand lit à baldaquin et, s’adressant à la jeune femme, il fit, d’un ton bref, impératif :
— Apportez-moi vite de l’eau et du linge blanc...
Madiana, dont les teneurs semblaient à présent entièrement apaisées, s’empressa d’obéir.
Quelques instants après, elle revenait avec les objets demandés.
Surcouf, qui avait enlevé la veste de Marcof, écarta sa chemise tout empourprée et examina sa blessure encore saignante.
Puis il continua à la laver doucement, sous le regard anxieux de Madiana qui, silencieuse, n’osant l’interroger, le contemplait avec une expression dans laquelle il y avait déjà de l’admiration, de la gratitude et de l’amitié.
Surcouf, maintenant, transformait en un tampon de charpie un morceau de toile de lin d’une blancheur immaculée que lui avait apporté l’étrangère ; ensuite il l’introduisit dans la plaie béante avec une dextérité que lui eussent enviée plus d’un chirurgien professionnel et, tranquillement, méthodiquement, il terminait son pansement en enroulant autour du corps de Marcof le restant de la bande de toile dont il noua solidement les deux bouts.
Et, se tournant vers Madiana, il fit, en poussant un soupir de soulagement :
— Rassurez-vous... Je m’y connais... et j’en ai vu bien d’autres, lui aussi, d’ailleurs.
« Ce ne sont pas quelques pouces de fer dans le corps qui peuvent abattre un gaillard tel que Marcof. Dans quelques jours, il n’y paraîtra plus.
Madiana, toujours muette, contemplait Surcouf. Il n’y avait plus, à présent, aucune trace de frayeur sur son visage... que, seule, une immense ferveur transfigurait.
De son côté, le corsaire se sentait attiré vers cette femme d’une beauté si étrange, presque surnaturelle, par une sympathie aussi ardente qu’instantanée...
Il commençait à comprendre que Marcof eût été, comme on le disait au pays, ensorcelé par cette étrangère... Et sa curiosité s’avivait de savoir qui elle était, comment Marcof l’avait connue et par quelle suite d’événements mystérieux, imprévus, elle était devenue la compagne de son bienfaiteur, de son maître.
Il se préparait à l’interroger... Mais Marcof revenait à lui.
Son premier regard rencontra ceux de Surcouf et de Madiana en quelque sorte rivés l’un à l’autre. Il eut un léger tressaillement.
Madiana s’approchant de lui, se pencha en un geste plein de grâce affectueuse et murmura sur un ton mystérieux et encore tout frémissant d’angoisse :
— Je te l’avais bien dit : Ils sont venus jusqu’ici !
Et, désignant Surcouf, que l’attitude charmante et la voix si mélodieuse de la jeune femme semblaient plonger dans un véritable ravissement, elle ajouta encore toute tremblante de crainte :
— Sans ton ami, qui les a mis en fuite, ils m’enlevaient après avoir voulu te faire périr !
« Car c’étaient bien leurs ombres que j’avais aperçues rôdant autour de la maison.
« Tu le vois, Pierre, j’avais raison de trembler !
Marcof saisit la main de Madiana qu’il porta jusqu’à ses lèvres.
Puis il reprit :
— Robert... viens aussi auprès de moi !...
Surcouf s’avança, pénétré d’une émotion telle qu’il n’en avait encore jamais ressentie.
— Mon ami, mon frère, s’écriait Marcof, qui ajouta :
« Madiana, je t’avais bien dit que Surcouf était, de tous mes amis, le meilleur et le plus brave.
« Maintenant, nous allons être deux à veiller sur toi.
— Repose-toi... intervenait le jeune corsaire... Si tu restes calme, je réponds de ta prompte guérison. Mais ne parle plus jusqu’à demain.
« Et vous, madame, allez prendre un peu de repos...
« Soyez tranquille... Ces gredins ne reviendront pas de sitôt...
« Je suis là et je veille !
Madiana, après avoir appuyé ses lèvres sur le front fiévreux de Marcof, se tourna vers Surcouf et, tout en lui tendant la main, elle fit simplement :
— Merci !
Dans ce simple mot, il y avait un si pur élan, une si loyale sincérité, et aussi... un si total abandon dans la confiance, que le corsaire sentit son émotion grandir encore.
Mais, docile et rassurée, comme si elle se sentait désormais invulnérable sous cette protection inattendue à laquelle elle devait déjà sa liberté et peut-être même sa vie, elle s’éloignait, soulevait une tenture, pénétrait dans une pièce voisine et disparaissait en laissant derrière elle, dans cette atmosphère de meurtre et de rapt, un sillage lumineux de fascination et de rêve.
Marcof avait fermé les paupières. Presque aussitôt il s’endormait sous la garde vigilante de son ami, qui était installé à son chevet et se demandait :
« Quelle est cette femme et quels sont lés gens qui ont voulu s’en emparer et frapper Marcof ? »
Et, toute la nuit, n’osant rejoindre Madiana, il attendit le réveil de son ami, ne cessant de se demander :
« Quel est ce mystère ? »
Au point du jour, Marcof, dont la fièvre était tombée, se réveilla en murmurant un mot, un seul :
— Madiana !
Surcouf s’en fut soulever la tenture... La jeuné femme, étendue sur son lit, dormait profondément.
— Elle repose ! fit Surcouf en laissant retomber le rideau.
Puis il revint vers Marcof... et, tout en lui tendant un verre qu’il avait rempli de vieille eau-de-vie de France dont il avait trouvé une bouteille dans une vaste armoire qui se dressait au fond de la salle :
— Prends, fit-il... Pour nous, les loups de mer, ça vaut mieux que toutes les drogues et pharmacopées bonnes pour les vieilles femmes de nos campagnes ou les freluquets des villes.
Marcof but, à petites gorgées, le cordial que lui présentait le corsaire.
Puis, réconforté, il reprit :
— Ainsi, les craintes de Madiana, que je prenais pour des visions, pour des chimères, étaient donc fondées, puisque ceux qui ont juré sa mort ont réussi à l’atteindre et à me frapper aussi.
« Pour être venus jusqu’ici, il faut que ces misérables disposent, sinon de forces surnaturelles, mais tout au moins de moyens d’action si puissants, si mystérieux qu’ils échappent à notre entendement et sont capables de désarmer notre prudence et de vaincre notre courage.
« Sans toi, Robert, le double crime était accompli.
« Tu nous as sauvés tous les deux, je ne l’oublierai jamais !
— Pierre, répliquait le Malouin ; je te dois tout et je n’ai fait que payer une faible partie de la dette que j’avais contractée.
— Ne dis pas cela ! protestait Marcof. Tu as fait mieux que me secourir. Tu as protégé, défendu la femme qui, pour moi, est tout au monde, celle qui, en s’emparant de mon cœur de rude marin, m’a révélé ce qu’étaient les élans de la passion, le charme de l’amour.
Surcouf reprenait avec une nuance de tristesse :
— Ils diraient donc vrai, ceux qui te prétendent ensorcelé !
— Ensorcelé ! s’écriait Marcof... Oui, je le suis... mais par la plus pure, la plus tendre, la plus noble des magiciennes...
Quand tu connaîtras bien Madiana, car je veux que tu l’aimes comme une sœur... je veux que tu sois pour elle comme tu l’es pour moi, un ami, un frère, tu comprendras non seulement par quels liens je suis attaché à elle, mais aussi pourquoi je garde jalousement ce trésor d’une incalculable richesse...
Marcof poursuivait avec fièvre :
— Elle est mieux pour moi qu’une femme, que la femme ! Je la tiens comme un de ces êtres de là-haut... comme un reflet du paradis... Ah ! cela te surprend de m’entendre parler ainsi, moi le corsaire violent et brutal qui, faisant fi de tout ce qui n’était pas son métier, n’avait eu jusqu’alors pour amie et pour confidente que la mer... notre maîtresse commune à tous... qui nous prend tellement que nous la chérissons encore davantage au moment où elle menace de nous garder pour toujours. ..
« Eh bien ! c’est elle, c’est Madiana qui m’a transformé, non pas en amoureux transi, en soupirant timide, en Hercule filant la laine aux pieds d’Omphale, comme on nous l’apprenait au temps où nous faisions nos humanités, mais en un amant qu’a grandi son amour !
« Non, Surcouf, crois-le bien, elle n'a pas éteint en moi la flamme du devoir, elle l’a purifiée !...
« Elle l’a débarrassée des fumées noirâtres qui en obscurcissaient l’éclat. Elle m’a enlevé à ces plaisirs grossiers, à ces orgies stupides qu’étaient nos lendemains de grandes victoires...
« Elle ne m’a pas détourné de ma mission, puisque je continue et nos ennemis en savent quelque chose, à risquer ma vie dans l’accomplissement de ma tâche.
« Au contraire !
« Elle a stimulé mes ardeurs, puisque, à présent, je ne me bats pas seulement pour mon pays, pour mon profit et pour ma gloire, mais aussi pour elle !
— Marcof, reprenait gravement Surcouf, ne crois pas un seul instant que j’aie douté de ta vaillance... Et je me félicite de voir quelle heureuse influence cette femme a eue sur ton caractère et sur ta destinée... Mais puisque tu veux que je l’aime comme une sœur, et j’y suis tout prêt... parle, ne me cache rien... Apprends-moi toute la vérité...
— Tu as raison... reconnaissait Marcof. Pour un ami tel que toi, je n’ai pas le droit d’avoir un secret... Je vais donc tout te dire !
« Il y a deux ans... naviguant dans l’océan Indien, j’avais jeté l’ancre en face de Mandagore, sur la côte du Bengale, et j’étais descendu à terre avec quelques matelots de mon équipage pour renouveler ma provision d’eau douce, lorsque je vis accourir vers moi une jeune fille hindoue qui, se jetant à mes genoux, me désignait avec effroi des guerriers lancés à sa poursuite...
« Ceux-ci se dirigeaient vers nous dans l’intention de s’emparer d’elle. Mais la malheureuse enfant se cramponnait à moi, en criant : “Sauvez-moi ! Ils veulent me tuer !“
« Je fis signe aux Hindous de s’éloigner... Mais excités par un brahmane, ils se ruèrent sur nous... Nous étions prêts à les recevoir et un violent combat s’engagea.
« Nous eûmes vite fait de mettre en fuite ces sauvages... Après avoir abattu deux de mes adversaires à coups de sabre, je m’élançai sur le brahmane qui cherchait à entraîner sa proie et, d’un coup de pointe, je le clouai sur le sol... Alors, le prêtre hindou se souleva, sanglant et terrible. .. et il s’écria en tendant le poing vers sa victime qui s’était réfugiée dans mes bras :
« — Tu as causé la mort d’un brahmane... Sois maudite ! ... Je serai vengé !
« Puis il retomba lourdement... Il était mort...
« J’emmenai celle que je venais de sauver à bord du Jean-Bart... Elle me raconta qu'elle était née aux Indes d’un père français et d’une mère hindoue.
« Ses parents ayant été massacrés au cours d’une révolte de “Parsis”, elle fut recueillie et élevée par une mission catholique où elle reçut une instruction et une éducation françaises... Un jour, les brahmanes la firent enlever et l’emmenèrent dans un de leurs couvents, d’où elle parvint à s’évader.
« Quand elle eut fini son récit, elle m’embrassa les mains et me déclara :
« — Grâce à vous, j’ai pu échapper à ces hommes qui, en vertu de leurs lois barbares, m’eussent brûlée vive si j’étais retombée entre leurs mains... Oh ! gardez-moi près de vous... Je ne suis qu’à moitié française de sang, mais je le suis tout à fait d’esprit et de cœur... car les bons missionnaires m’ont tellement parlé de votre beau pays, que j’ai toujours désiré le connaître... Emmenez-moi avec vous, Oh ! oui, emmenez-moi !
« Je lui déclarai que j’étais corsaire et, par conséquent, exposé aux pires dangers...
« Elle me répondit :
« — Ces dangers-là, je ne les crains pas !... Je vous ai vu me défendre ; vous serez toujours le plus fort !
Et Marcof ajouta :
— Elle était chrétienne !... Je l’ai épousée devant un prêtre.
« Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés... Elle a partagé ma vie à terre comme à bord de mon bateau. Je l’ai vue assister sans frémir aux plus rudes combats, puis, l’ennemi repoussé, prodiguer ses soins aux blessés, fermer les yeux des morts et pleurer doucement sur ces pauvres corps que nous n’avions pas le temps d’ensevelir en terre sainte et que nous étions obligés d’abandonner à la mer.
« Elle est devenue l’idole de tout mon équipage qui, d’abord, la considérait comme une intruse et craignait qu’en s’emparant de mon cœur elle n’amollît mon courage... Mais maintenant qu’ils ont vu, maintenant qu’ils savent, il n’est pas un de mes marins qui ne soit prêt à donner tout son sang pour elle ; car, depuis qu'elle est avec nous, je n’ai connu que des victoires.
« Elle est l’ange tutélaire de notre Jean-Bart, comme elle est le rayonnement de mon existence.
« Aussi, je les laisse dire, ceux qui m’accusent de m’être laissé ensorceler par une païenne... Je hausse les épaules à ces propos stupides que j’ai même interdit à mes matelots de démentir.
« Que m’importe ce que l’on dit de moi... ce que l’on pense d’elle !
« N’est-elle pas au-dessus de toutes les médisances, de toutes les calomnies... comme je suis au-dessus de toutes les injures ?... il n’y a que des hommes comme toi, comme mes compagnons du Jean-Bart, qui puissent m’approuver... Les autres... des envieux... des sots... des méchants... Est-ce que je leur dois des comptes ?... Et puis, ils ne comprendraient pas ! Ils riraient d’elle... Ils se moqueraient... Elle est si différente des autres... C’est un tel trésor que je ne veux pas que le commun des mortels en connaisse même le rayonnement !
« Vois-tu, Robert, je l’aime, oui, je l’aime à en mourir !
A peine Marcof avait-il prononcé ces mots dans lesquels vibrait toute son âme, que Madiana apparut sur le seuil.
Se soulevant à demi, Marcof lui désigna le corsaire qui la contemplait en silence.
— Madiana, fit-il, j’ai tout appris à Surcouf.
La belle Hindoue attacha sur le Malouin son regard tout de charme enveloppant et de troublant mystère.
— Capitaine, fit-elle de cette voix harmonieuse comme le chant d’une harpe céleste, Pierre m’avait déjà beaucoup parlé de vous... il m’avait fait le récit des nobles victoires que vous aviez remportées ensemble... Souvent il me répétait qu’il était fier, très fier de vous et qu’il ne regrettait qu’une chose, c’était que la destinée vous eût séparés. « Maintenant, vous voilà réunis... Je souhaite que ce soit pour longtemps. .. pour toujours.
Et, tendant sa main à Surcouf, qui, charmé, ébloui, s’en empara et la garda dans les siennes jointes en une douce étreinte, elle ajouta :
— Marcof était votre frère... Moi, je sens que je vous aime déjà comme une sœur.
Marcof reprit, d’une voix presque solennelle :
— Robert, tu connais maintenant toute la vérité ! Parce qu’un brahmane est mort à cause d’elle, ces Hindous fanatiques la poursuivront obstinément de leur vengeance. Et cette nuit, sans toi, ils accomplissaient leur odieux forfait...
Aussi, jure-moi, si je venais à disparaître, de la protéger... de la défendre.
Et, tout en gardant entre ses mains celle que Madiana, toute émue, lui abandonnait, Surcouf répondit d’une voix qui tremblait légèrement :
— Je te le jure !
III : L’AMITIÉ ET L’AMOUR !
Bien que la propriété de Marcof fût gardée par les plus fidèles marins du Jean-Bart qui, nuit et jour, exerçaient autour d’elle une surveillance extrêmement rigoureuse, Surcouf, pendant la convalescence de son ami, n’avait guère quitté le Chêne-Vert.
C’est à peine si, de temps en temps, il faisait au domicile paternel une brève apparition, au cours de laquelle il se montrait de plus en plus nerveux, préoccupé, irritable...
Pendant les rares repas qu’il prenait en famille, lui qui, le jour de son arrivée, ne respirait que la joie de vivre, était en proie à une étrange mélancolie... Lointain, pensif... comme hanté par une idée fixe, il avait d’inquiétants silences dont il ne s’évadait qu’avec peine.
Alors, son regard s’arrêtait, tantôt sur sa vieille grand-mère, tantôt sur la jolie Marie-Catherine avec un subit attendrissement... Puis il se levait, gagnait la terrasse, demeurait quelques instants en contemplation devant la mer et s’en allait brusquement, après avoir lancé aux siens, consternés, un laconique au revoir.
La bonne-maman Surcouf se désolait :
— Je crois que Robert s’ennuie avec nous.
M. Surcouf cherchait à la rassurer :
— Laissons-lui le temps de s’habituer à cette vie nouvelle !
— Crois-moi, objectait l’excellente femme. Il regrette déjà cette existence de combats, d’aventures, de dangers ! Robert n’est pas fait pour la vie paisible qui l’attend ici... Je suis sûre qu’il pense déjà à reprendre la mer... La preuve, c’est qu’il n’a pas congédié son équipage.
— Robert, répliquait M. Surcouf, est trop généreux pour ne pas garder ses compagnons tant qu’ils n’auront pas trouvé d’engagement.
— Oui, je le sais... Malgré tout, je ne suis pas tranquille ; j’ai la conviction que Robert traverse en ce moment une crise morale dans laquelle se jouent son avenir et peut-être sa destinée ; et que, par crainte de nous chagriner, il n’ose pas s’en ouvrir à nous. Ah ! je le crains bien, mon fils, je n’ai pas fini de pleurer.
— Prenez garde ! Le voici... intervenait Marie-Catherine qui, assise près d’une table, brodait de la dentelle.
Surcouf, l’air sombre, venait d’apparaître.
Visiblement distrait, loin de tous, il s’en fut effleurer d’un rapide baiser le front de son aïeule, adressa à l’orpheline un bonjour presque indifférent, et sera à peine la main que lui tendait son père. Puis, s’installant sur un siège il se plongea dans de profondes réflexions.
M. Surcouf, après avoir dirigé son regard vers sa mère, dont les bons yeux étaient pleins de larmes, et sur Marie-Catherine qui, douloureuse elle aussi, affectait de s’absorber dans sa besogne, s’en fut vers son fils et, tout en lui posant affectueusement la main sur l’épaule, il attaqua :
— Ah çà ! Mon garçon, je ne te reconnais plus... Qu’est-ce que tu as donc ?
Robert tressaillit légèrement, puis répliqua d’un ton sous lequel perçaient de l’agacement, de la mauvaise humeur :
— Je n’ai rien !
— Pourquoi fais-tu une tête pareille ? La grand-maman nous disait tout à l’heure qu'elle avait peur que tu ne t’ennuies chez nous.
Le corsaire eut un léger haussement d’épaules.
Et, se levant, il s’en fut vers une fenêtre à travers laquelle on apercevait la mer qu’il se mit à contempler avec une singulière insistance.
Son père le suivit et lui demanda :
— Songerais-tu à repartir déjà ?
— Non, répliquait catégoriquement Robert.
La grand-mère eut un cri de joie. Marie-Catherine se baissa encore un peu plus sur son ouvrage.
M. Surcouf eut un hochement de tête qui n’allait point sans un certain scepticisme.
Pourtant il connaissait la loyauté de son fils. Il savait que celui-ci était incapable d’une inexactitude et à plus forte raison d’un mensonge.
Alors que se passait-il donc en lui, pour qu'après l’allégresse du retour et les démonstrations de tendresse que Robert leur avait prodiguées, il se montrât si rapidement changé, si étrangement morose ?
Un grand silence pesa lourdement dans cette pièce qui, quelques jours auparavant, retentissait de baisers sonores et de francs éclats de rire ?
Le père Surcouf se mit à bourrer la pipe que lui avait donnée son fils, puis il lança avec bonhomie :
— Et ton ami Marcof, est-ce qu’il se remet de sa blessure ?
— Tiens... vous avez appris ?... fit le corsaire en se retournant brusquement.
— Toute la ville de Saint-Malo ne parle que de son aventure.
— Ah ! vraiment !... Et que raconte-t-elle donc, cette bonne ville de Saint-Malo ?
— Que Marcof aurait été attaqué, la nuit, dans sa propriété des bords de la Rance, et qu’il aurait failli être assassiné par des individus qui ont disparu du pays sans qu’il fut possible de retrouver leur trace.
— C’est vrai ! reconnaissait Robert.
— On prétend même, poursuivait M. Surcouf, que ces bandits mystérieux étaient venus pour enlever la femme de Marcof.
— C’est encore vrai !
— Et que c’est toi qui les aurais mis en fuite !
— C’est toujours vrai !
— Pourquoi ne nous as-tu pas raconté tout cela ?
— Parce que Marcof voulait que l’on fît le silence sur cette affaire.
— Est-ce donc cela qui te préoccupe ainsi ?
— Peut-être !
— Sans doute, émettait M. Surcouf, Marcof redoute-t-il de nouvelles attaques de la part de ses ennemis ?
— Oh ! maintenant, affirmait le corsaire dont l’œil s’embrasa d’une grande flamme... ils peuvent venir, ils seront bien reçus... Je crois d’ailleurs qu’ils ne s’y frotteront pas.
— Marcof a-t-il des soupçons ? poursuivait M. Surcouf.