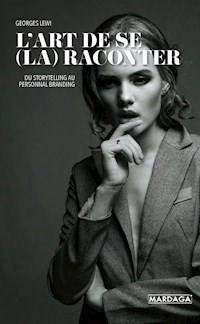
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Un ouvrage audacieux qui révélera les secrets d'un storytelling réussi que ce soit en entreprise ou dans votre vie privée !
Lorsque vous devez vous présenter ou vous mettre en avant, vous hésitez, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous paniquez même peut-être. Pourtant, vos premiers mots sont primordiaux : vous intéressez votre interlocuteur tout de suite… ou jamais. Et l’enjeu peut être important : un futur employeur, un client potentiel, une rencontre décisive qui peut changer votre vie. Comme le font les hommes ou femmes politiques, les grandes marques et les influenceurs, vous voudriez savoir vous raconter pour intéresser et convaincre ? L’art du storytelling, mêlant émotion et précision, va vous y aider !
Grâce à cet ouvrage, apprenez, vous aussi, à vous mettre en valeur, dans votre vie professionnelle comme personnelle ! Un expert reconnu du storytelling et du branding vous présente toutes les techniques qui vous aideront à vous vendre, à convaincre mais aussi à impressionner. Avec un petit « truc » en plus : se référer dans votre propre storytelling à l’un des mythes universels de l’Olympe pour vous faciliter l’exercice et vous donner l’assurance nécessaire.
Entre poudre aux yeux, techniques éprouvées et récit sincère, découvrez enfin le bon équilibre !
Au moyen d'exemples concrets, Georges Lewi vous donnera les outils afin d'apprendre à vous aimer et surtout, d'oser le montrer !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Georges Lewi est un expert reconnu du storytelling et du branding." - La Libre
"Livre qui s'intéresse à la façon dont on se raconte." - Arnaud Ardouin, SMART JOB
"Quand on se raconte, on se "la" raconte. On finit par croire à notre propre récit." - Georges Lewi, Marketing is dead
À PROPOS DE L'AUTEUR
Georges Lewi est un expert européen reconnu du storytelling et du branding (stratégies de création de marques). Conférencier expérimenté, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, il est aussi romancier et dramaturge. Par son travail de consultance, il a conseillé les plus grandes entreprises (Samsung, Coca-Cola, Microsoft, Decathlon, Canal+...) et coache aussi certains de leurs managers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’art de se (la) raconter
Georges Lewi
L’art de se (la) raconter
Du storytelling au personal branding
Être différent n’est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même.
ALBERT CAMUS
INTRODUCTION Trouver le bon compromis entre modestie maladive et orgueil déplacé
Ce livre n’est pas un ouvrage de plus sur le personal branding ou « comment faire de soi une marque ». Il n’a pas été conçu pour ceux qui veulent devenir des stars ou qui ont pour ambition de vivre de leur chaîne YouTube. Cet aspect sera certes développé dans un chapitre, mais il n’est pas la préoccupation principale, car ce n’est pas le souci de la majorité des gens.
Ce livre s’adresse à chacune et chacun d’entre nous. Comment se présenter en particulier dans la vie professionnelle ? Mais pas uniquement. Comment faire un CV attractif, se présenter à un entretien d’embauche, se confronter à ses collègues, ses collaborateurs, son patron, ses clients, ses amis ? Comment exister ? Comment rendre sa vie intéressante pour soi-même et pour les autres ?
Longtemps, j’ai vécu avec ce problème : comment me présenter professionnellement en particulier ? Je n’excellais dans aucune matière, je n’étais pas nul non plus. Donc, ni point fort ni point faible dont je puisse me glorifier. J’en venais presque à admirer les daltoniens ou les gauchers qui avaient quelque chose de différent et pouvaient mettre en exergue un élément original dans leur présentation. Ils pouvaient susciter un intérêt. Pas moi !
J’eus un choc à 23 ans. Nous fêtions entre copains l’anniversaire de l’un d’entre nous. Nous avions quasiment terminé nos études, nous devisions sur notre avenir. Avant même que je ne m’exprime, mon meilleur ami a pris la parole pour moi : « Georges, avec son grec ancien, il est bon pour le chômage à vie. » Je ne m’en souviens pas précisément, mais je suppose que tout le monde a ri. Je terminais un long cursus de lettres classiques et j’avais alors le sentiment de tutoyer tous les matins Socrate dans sa langue natale. Comment, en effet, songer à un métier quand on a cette chance ? Je n’en ai pas moins reçu un coup sur la tête. D’abord parce que j’avais été incapable de dire quelque chose sur mon avenir professionnel, ensuite parce que c’était assez bien vu. L’échec de ma situation professionnelle était une quasi-certitude dont je ne savais comment sortir. Grâce à cet ami, indélicat sur le moment, j’ai repris des études à la Business School de Lyon vers une seconde formation en marketing, très différente et presque à l’opposé de la première.
Je raconte souvent cette histoire et j’ajoute que, depuis trente ans, j’essaye de faire se rencontrer les deux parties de mon cerveau et ma double formation : l’art du récit issu des humanités et la connaissance du pouvoir des chiffres venant de mes études de marketing. Cerveau droit et cerveau gauche.
C’est ainsi que, presque naturellement, je suis devenu un spécialiste de la marque dont je donne cette définition non académique : « Une marque est une belle histoire qui peut rapporter gros. » Car le récit des marques s’inscrit autant dans la mémoire des gens que dans le portefeuille des entreprises. Les grandes marques appartiennent juridiquement à des entreprises, mais socialement à la mémoire collective des consommateurs.
Pour mon premier « vrai » travail, j’ai eu de la chance. Ma femme, me voyant « mal parti », en tout cas pour nourrir la famille, avait découpé à mon intention une petite annonce de vendeur dans une grande librairie indépendante de la région lyonnaise. J’avais a priori peu de chances de remporter le poste face à des libraires déjà confirmés. Ce qui a alors retenu l’intérêt de mon futur patron fut qu’étudiant, j’avais créé un « bibliobus » (bibliothèque ambulante) pour une association. Pour mon patron, c’était signe que je saurais sortir la librairie de son magasin, du « carcan » où le livre est encore trop souvent enfermé. Car c’était l’objectif de ce jeune repreneur de l’entreprise familiale de développer une « librairie hors les murs ». J’ai retenu de cette première « vraie » embauche que tout sert dans la vie et que ce qui suscite l’intérêt se niche souvent plus dans les détails « sans importance » que dans les grandes lignes de la vie.
Savoir se présenter, dire qui on est et ce que l’on veut faire dans la vie, en toute franchise, n’est pas un exercice évident. Ce serait même, dans notre environnement social, jugé contre nature. Car notre culture a placé la modestie au rang de qualité et l’orgueil dans la case « gros défaut ». Jadis, l’individu n’existait pas en tant que tel, mais seulement en qualité de représentant d’une « communauté », d’une « caste » religieuse, sociale, professionnelle, idéologique, etc. Parler de soi n’avait, par conséquent, pas lieu d’être. L’état social de l’individu parlait pour lui. « La coutume a fait le parler de soi vicieux », affirmait Montaigne. La bienséance nous a inculqué que « ce n’est pas bien de parler de soi ». Cette « modestie » a été longtemps considérée comme le b.a.-ba de la vie sociale.
Un siècle après Montaigne, le fabuliste Jean de la Fontaine, au XVIe siècle (le siècle dit « classique »), réitéra ce conseil dans la fable L’abeille et la mouche :
Il faut en toute compagnie Le moins possible parler de soi.
Un siècle plus tard encore, Voltaire, qui pourfendait, à bien des égards, les privilèges, affirma cependant, dans la lignée de ses prédécesseurs : « L’orgueil des petits consiste à parler toujours de soi ; l’orgueil des grands est de n’en parler jamais. »
À cette époque, la société reposait encore sur un ordre établi. Être « bien né », d’une « bonne lignée », c’est-à-dire appartenir à la noblesse, suffisait à se faire reconnaître. Pour les autres… il fallait avoir un métier reconnu. Les membres étaient regroupés en corps de métier, les « jurandes », qui promettaient d’observer les règlements et faisaient serment de morale professionnelle. La position sociale, familiale, professionnelle de l’individu faisait office de storytelling.
Mais presque au même moment, des contestataires de cette société de castes, voulant se faire une place, un nom, en bousculant l’Ancien Régime, se sont mis à prétendre le contraire. Et l’ont mis en œuvre.
Dans Les Confessions1, Jean-Jacques Rousseau utilise son récit personnel, son autobiographie, son « personal storytelling » non seulement comme forme originale d’écriture, mais comme « fonds de commerce ». Il invente alors le métier qu’exercent, de nos jours, les influenceurs. Dès lors, Rousseau suscite un intérêt. Pour rendre son discours intéressant, Jean-Jacques Rousseau doit se faire passer pour différent, voire marginal. Il doit apparaître comme un être à part, un philosophe détaché de la vie sociale, contrairement à Voltaire, qui se revendique l’ami des grands de ce monde.
Rousseau insiste sur le caractère inédit de son projet. Il en souligne l’originalité et rompt avec la modestie des auteurs qui le précèdent. « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitation. » Très actuel dans cette quête de la transparence, l’auteur continue : « Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur, et pour cela je cherche à la lui montrer sous tous les points de vue […] afin qu’il puisse juger par lui-même […] en lui détaillant avec simplicité tout ce qui m’est arrivé. » Dans la même introduction, il ajoute : « Je ne m’attacherai point à rendre [le style] uniforme ; j’aurai toujours celui qui me viendra, j’en changerai selon mon humeur sans scrupule, je dirai chaque chose comme je la sens, comme je la vois. »
Quelle actualité ! On croirait entendre les excuses de la blogueuse Enjoy Phoenix dans sa vidéo publiée en mai 2017 sur sa chaîne YouTube, « Je suis désolée de vous avoir menti2 ». Beaucoup se questionnent sur la part de vérité des influenceurs. Marie Lopez, de son vrai nom, s’excuse d’avoir « menti » à ses millions de followers en expliquant qu’elle ne se reconnaît plus dans le contenu qu’elle publie depuis plus d’un an. Elle affirme avoir créé un contenu pour coller aux évolutions de YouTube, pour correspondre aux tendances, pour s’adapter à sa nouvelle célébrité… Initialement considéré comme une expression spontanée puis comme un phénomène de mode, influenceur est devenu un métier. « Plus ciblé qu’un média généraliste, plus proche de son lectorat, un blog, un compte Instagram ou une chaîne YouTube sont les médias stars en constante évolution. La pression de la publicité et des annonceurs est-elle en train de changer ce phénomène ? Où est le vrai du faux et est-ce que ces influenceurs mentent3 ? » s’interroge Stratégies, hebdomadaire de la publicité.
N’en déplaise à Voltaire, on est, désormais, bien souvent obligé de parler de soi. À l’école, on fait des rédactions pour se décrire, puis on rédige son CV, on se présente en public. Dès 10 ou 12 ans, désormais, on a « sa page Facebook », « son compte Insta4 » ou son « profil TikTok » et, par conséquent, une identité numérique. Le personal storytelling s’est imposé comme un impératif social. Il s’agit là d’une nouvelle respiration dont la plupart des adolescents ont autant besoin que d’air.
Savoir parler de soi est une part importante de sa réussite. Cela devient un enjeu personnel au même titre que sa façon de se vêtir, qui fait partie intégrante du personal storytelling. La question n’est plus aujourd’hui : « Faut-il parler de soi ? », mais « Comment parler de soi ? »
Un provocateur comme Oscar Wilde prend même le contrepied de la sagesse classique en affirmant : « Il n’y a qu’une seule chose plus désagréable que de faire parler de soi : c’est ne pas faire parler de soi5. » Parler de soi n’est plus un interdit, mais une revendication. Cela devient une nécessité vitale pour Oscar Wilde, poète persécuté.
Depuis la nuit des temps, les conteurs de toutes les civilisations ont présenté la vie des héros. Les linguistes ont étudié comment étaient faits ces récits qui sont arrivés jusqu’à nous, alors qu’ils auraient dû disparaître mille fois. Pouvons-nous appliquer ces règles de la narration, presque des « recettes » universelles, à notre modeste ego ?
Des archétypes existent. Ils peuvent servir de « catégories symboliques » pour nous permettre de voir plus clair en nous-mêmes, de ressentir que nous ne sommes pas seuls et que depuis la plus haute Antiquité, les êtres humains se ressemblent et se posent les mêmes questions. Je suis volontairement remonté à la source et j’ai choisi les quatorze divinités de l’Olympe comme identifications possibles. C’est plutôt rassurant de voir ainsi la pérennité du genre humain. La parole (en particulier sur soi) s’est développée et les réseaux sociaux sont devenus une source permanente de récits dans laquelle chacun ressent le besoin de trouver sa petite place.
Vos interlocuteurs veulent en savoir plus sur vous, ils espèrent connaître votre identité profonde pour savoir si celle-ci va « coller » avec l’entreprise, avec l’équipe constituée, avec leurs valeurs, le sens de la vie qu’ils défendent, etc.
Mais comment faire ?
Ce livre a pour ambition de montrer la réalité et de révéler les secrets d’un storytelling réussi. Au moins un ! Il aborde les aspects concrets du storytelling en entreprise et dans la vie personnelle. On analysera les erreurs à éviter, les étapes à privilégier. Et bien sûr, pour celles et ceux qui, comme Jean-Jacques Rousseau, veulent en faire un métier, on cherchera à savoir comment réussir là aussi. Car cet ouvrage est celui de la réussite vis-à-vis des autres, de notre entourage, de la société mais d’abord vis-à-vis de soi. Il doit permettre à chacun de mieux se connaître pour mieux s’apprécier.
Lisez ce livre comme une déclaration d’amour que vous vous faites à vous-même !
1. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Paris, Folio classique, 2009.
2. Enjoy Phoenix, Je suis désolée de vous avoir menti, https://www.youtube.com/watch?v=S_S6Qv8LtQE.
3. Maxime Cool, « Les influenceurs mentent-ils ? », 21 septembre 2017, https://www.strategies.fr/blogs-opinions/idees-tribunes/1070837W/les-influenceurs-mentent-ils-.html.
4. Le réseau social Instagram.
5. Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Livre de Poche, 1972.
PARTIE I Trouver qui l’on est
De la difficulté de parler de soi : qui est-on vraiment ?
Le rapport de l’individu, pris isolément, à la société reflète la difficulté humaine de vivre. C’est-à-dire de vivre avec les autres. La société est formée d’individus. L’idéal social serait celui d’un mur constitué de briques individuelles. Mais une brique n’a pas à s’exprimer, à se présenter pour se fondre dans le mur. Le maçon le fait pour elle et va dire : « Tiens, cette brique un peu bizarre ira bien dans ce coin ! » Il choisit une place pour cette brique dans le mur et la scelle définitivement à cette place.
L’être humain n’aime pas qu’on lui attribue une place définitive. La littérature et le cinéma sont nourris d’histoires de personnalités qui tentent de sortir de leur univers initial, de leur classe sociale, de leur religion, de leur pays pour changer d’identité. À la douane, notre passeport parle pour nous et nous évite de devoir nous présenter. Notre identité officielle nous sert de parole. Très souvent, nous ne connaissons pas la langue du pays où nous allons, nous ne pouvons pas communiquer avec le douanier. Mais nos empreintes digitales sur un petit carnet nous servent de laissez-passer. Quand, cependant, par hasard, il nous faut ouvrir la bouche, c’est souvent la panique. Il va falloir se présenter, se dévoiler, avec nos mots maladroits. Et comment se présenter ? D’où vient-on ? Qui va-t-on voir ? Où va-t-on résider précisément ? Qu’est-ce qu’on vient faire dans ce pays ? Y a-t-on de la famille, des amis ? L’individu face à la société se sent tout nu ! Même pour un authentique héros, cet exercice est compliqué, voire périlleux.
Se présenter aux autres, comme si l’on était à vendre ou que l’on devait se vendre, est tout sauf naturel. Et pourtant, on doit l’assumer de plus en plus.
Qui est-on vraiment ? Le sait-on, au juste ? Que faisons-nous ici, maintenant, sur Terre ? Nous aimons cacher notre identité profonde. C’est pourtant celle qui intéresse le plus les autres, douanier, patron, collaborateur, ami, amie, amant, maîtresse ou simple consommateur. Pour se présenter ou se cacher, il faut s’exprimer sur soi. Et par conséquent se connaître. Socrate formulait son « Connais-toi toi-même » comme la première exigence de tout être humain qui se respecte. Se connaître vraiment est cependant un exercice particulièrement complexe. La « brique humaine » peut se trouver de nombreuses places qui lui « iront bien » dans le mur. Et quelquefois, la brique humaine aime changer de place…
Dans L’Odyssée d’Homère, l’un des premiers récits humains d’Occident, Ulysse, le héros de la guerre de Troie, revient chez lui après vingt ans d’absence. Il aborde son île, son royaume après des années d’errance en mer. Ce n’est pas un douanier qui l’accueille, mais son propre fils, Télémaque, le prince de la cité. Ulysse doit d’abord être reconnu s’il veut avoir une chance de reconquérir son royaume. Télémaque venait de naître quand Ulysse est parti pour la guerre de Troie. Lorsqu’il rencontre son père, c’est naturellement un étranger qu’il voit. Ulysse lui dit simplement : « Je suis ton père6. » Rien d’étonnant à ce que le jeune homme, méfiant, lui réponde : « Tu n’es pas mon père. » Mais Ulysse ajoute alors : « Il ne viendra pas d’autre Ulysse que moi, c’est moi qui suis Ulysse. Après avoir beaucoup souffert, beaucoup erré, je reviens au bout de vingt ans dans ma patrie. » Il se tient droit comme s’il faisait un serment. Comme lorsqu’on se trouve face à un douanier ou face à un examinateur. Puis il s’assoit calmement. C’est suffisant pour convaincre Télémaque qui étreint alors son père. Ils se mettent tous deux à pleurer. Le soir, Télémaque, qui n’a rien dit jusque-là, se rapproche et lui murmure : « Mon père bien-aimé7 », donnant ainsi à Ulysse le nom de « père ». La particularité de cette scène est la puissance d’une parole rare : elle s’avère à la fois nécessaire et suffisante.
Se présenter, c’est raconter en raccourci toute sa vie, c’est-à-dire mettre sur la scène publique son identité profonde. Chacun est héros de sa propre vie. Le célèbre youtubeur Norman (alias Norman Thavaud) commence ainsi l’une de ses vidéos : « Bonjour ! Bah voilà, je m’appelle Norman et je fais des vidéos où je raconte ma vie, mais surtout je parle de choses qui nous concernent tous ! Enfin je crois… » Parler de soi est en effet une autre façon de parler des autres, de les renvoyer à leur propre identité. Ils vont pouvoir, par rapport à vous, s’identifier ou se différencier, totalement ou partiellement, mais auront intégré votre identité comme une donnée quasi objective.
Dans cette vidéo, dont nous reparlerons, Norman raconte sa vie de « chti », sa situation d’enfant bouc émissaire de sa classe, ses difficultés scolaires puis la révélation venue, presque par hasard, de ses « fans », le public de sa chaîne YouTube grâce à la… vidéo.
Ulysse et Norman Thavaud ne nous abreuvent pas de paroles. Peu de mots suffisent. Les deux nous confirment que le récit le plus efficace est souvent le plus concis. Ils racontent, au travers de l’histoire spécifique, la grande histoire de l’humanité. Un héros grec qui rentre chez lui, fatigué, et un p’tit gars du Nord qui voudrait exister nous font comprendre que leur vie nous concerne, que l’on soit « héros, Monsieur ou Madame tout le monde ». Ce sont des êtres humains comme les autres, et si singuliers. Comme vous, comme moi !
Quel portrait-robot ?
Nous aimerions pouvoir nous retrancher derrière des images toutes faites, qui nous facilitent la vie quand on se présente aux autres. Certes, elles jouent ce rôle, mais nous réduisent, bien souvent, à cet unique aspect lorsque nous les « utilisons trop ».
Habiter Paris intramuros dans le VIe arrondissement ou à Bruxelles dans le clos des milliardaires évite de devoir présenter son compte en banque et d’en dire plus sur son rang social. Être professeur, médecin ou expert-comptable, boulanger, routier, paysan, libraire, etc. nous dédouanent également d’en dire plus. Notre interlocuteur va pouvoir se faire une première idée de la personne qu’il a en face de lui.
Mais qu’est-ce qui va vous distinguer d’un autre professeur, d’un autre expert-comptable, boulanger, paysan, etc. ?
Pour un CV, avoir fait HEC, Sciences Po, le Celsa, un master en sciences de gestion à la Louvain School of Management est un fait, une base minimale pour postuler pour un travail, puisque ces diplômes ou équivalents sont requis dans l’offre d’emploi. Sur quoi va se focaliser le recruteur pour essayer de vous cerner dans les quelques minutes que va durer l’entretien ? Il vous est préconisé dorénavant de noter vos hobbies, vos centres d’intérêt. Mais il faut bien constater que la plupart des jeunes postulants ont tous coché la case sport, la case humanitaire et la case culture. Tout est donc à faire pour le recruteur !
En oral d’embauche, ou d’entrée dans une grande école, le recruteur a peu de temps en règle générale. Il lui faut cependant parvenir à cerner au mieux le ou la futur(e) admissible. Lorsque je participais au jury de concours d’une grande école française, j’apportais le journal Le Monde du jour et demandais au candidat de choisir le numéro d’une page. Je lui indiquais dans celle-ci le titre de l’article principal et lui demandais de s’exprimer personnellement, avec le maximum de franchise, à son sujet.
Cela ne plaisait pas toujours aux autres membres du jury. Comme si le hasard risquait de rompre un semblant d’égalité. Cependant, on en savait très vite beaucoup plus sur le candidat qu’en l’entendant « réciter » son CV trop bien préparé. Au hasard du jour8, on aurait demandé aux postulants de s’exprimer sur un squelette de dinosaure vendu aux enchères 31 millions de dollars, la communication de Donald Trump à la sortie de l’hôpital, les nouveaux enjeux liés au télétravail, le risque de match truqué à Roland-Garros, le vêtement genré ou non à la Paris Fashion Week ou… les bananes flambées. Cette école, qui a abandonné cette pratique peu conventionnelle, continue de se plaindre du peu de diversité de ses étudiants. Tout comme la plupart des entreprises qui demandent à leurs futurs salariés d’être conformes aux normes sociales de l’entreprise et regrettent ensuite le peu d’idées nouvelles qui naissent en son sein.
Nous savons toutes et tous construire un discours adapté à la demande des jurys ou des recruteurs. C’est un discours essentiellement rationnel. Mais la vie est faite de chair et de sang et les sens s’expriment différemment. On ferait parler de la couleur bleue, de la senteur du pissenlit, du rôle de l’ortie, du bruit d’un marteau-piqueur, du rôle de la taille de la forêt, de la perception d’avoir une limace au creux de la main… en entretien d’embauche, le recruteur ou la recruteuse aurait une meilleure perception de la personne en face. La vie le fait spontanément. En rendez-vous amoureux, tout passe au crible de ce qui nous rassemble ou nous sépare : coucher dans l’herbe ou non, manger cru ou manger cuit, partir à l’improviste ou bien préparer son voyage, se laver zéro fois, une fois, deux fois par jour ou plus, avoir un compte en banque commun ou deux comptes séparés, peindre la pièce à vivre en vert amande ou en blanc…
En bref, les perceptions naturelles de nos sens sont le fondement de notre vraie vie. Les héros sont d’abord des êtres humains « normaux ». Écoutons l’astronaute Thomas Pesquet parler de sa vie :
Depuis que je suis revenu, je fais du sport, pas uniquement pour regagner la masse musculaire que j’ai perdue, mais pour le plaisir ! Courir avec Anne [sa femme], bien plus endurante que moi, réessayer le kitesurf et marcher dans la nature… Des choses toutes simples qui m’ont manqué. J’ai aussi de la lecture à rattraper, même si j’avais emmené Le Petit Prince de Saint-Exupéry9…
Après le confinement dû au coronavirus, chacun retrouve les plaisirs simples qui nous ont manqué et qui en disent plus sur nous que de longs discours.
Parlez couleur !
Êtes-vous prêt à vous présenter en disant : « Ce que j’aime par-dessus tout, c’est la couleur bleue » ? Cela ne vous empêchera pas de répondre aux questions techniques posées sur votre parcours professionnel.
Vous pouvez, à un moment de la conversation, dire, par exemple : « Dans mon bureau, si ce n’est pas interdit dans l’entreprise, j’aimerais mettre une reproduction d’un monochrome d’Yves Klein représentant un carré bleu, le fameux bleu de Klein. Je suis dingue de ce bleu si particulier. Il représente pour moi comme un absolu. »
Votre interlocuteur va devoir s’y intéresser, ou du moins faire semblant. Nul ne peut être totalement insensible à l’art, à la culture et surtout à la surprise générée par votre propos. Et cela va vous amener à préciser votre amour du bleu, c’est-à-dire votre vision de la vie, votre quête d’absolu, de perfection… Vous allez alors pouvoir présenter une personnalité riche, sensible, engagée : « Cette couleur m’évoque la planète bleue, une planète à protéger, le ciel, tout l’espoir qui va avec, la mer, sa richesse en biodiversité. Dans l’Antiquité, le mot “bleu” n’existait pas. Car tout était bleu. Puis, curieusement, le bleu a été réservé aux familles royales. Il exprime les sentiments rares, comme la sérénité dont c’est la couleur. Il paraît que sa vue fait baisser la tension artérielle et le stress au travail. Disons que j’aime le bleu car c’est la couleur de la confiance. »
Vous avez tout dit au travers de ces quelques mots : votre sensibilité à la nature, votre connaissance de l’histoire et même de l’anthropologie, votre rejet du stress, votre confiance en l’avenir et par conséquent votre ouverture pour ce nouveau travail.
Comment ne pas vouloir vous connaître plus, après tant de promesses exprimées avec tant de vécu et de tact et si peu de concepts abstraits ?
La meilleure façon de parler de vous, c’est de laisser la nature et la culture vous accompagner. Nos sens sont nos meilleurs ambassadeurs. La réussite en storytelling passe toujours par du concret et laisse l’abstrait, les concepts flous, souvent sujets à polémique, de côté. Votre mode de vie devient palpable et perçu comme réaliste, contrairement aux concepts. Les critiques littéraires citent souvent la première phrase du roman Du côté de chez Swann, premier tome d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure10 », comme l’une des introductions de roman les plus réussies. Car chacun d’entre nous comprend immédiatement pour l’avoir vécu ou combattu ce mode de vie qui illustre un personnage, le narrateur, c’est-à-dire Marcel Proust. Chez Flaubert, Charles Bovary est immédiatement catalogué par l’affreuse casquette, « une de ces pauvres choses dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile11 ». Ce personnage est définitivement « croqué » par ce détail vestimentaire.
Imaginez que vous annonciez, au lieu de clamer votre amour du bleu, votre optimisme, votre foi en l’avenir ! Vous risquez presque à coup sûr d’avoir des questions sur l’état du monde et des remarques sur votre manque de réalisme.
Bien sûr, vous pouvez choisir une autre couleur, une odeur, une forme géométrique, un paysage, un animal, une plante, une fleur, un artiste, etc. Comme vous le voyez, toute la nature, toute la culture vous accompagnent et vous introduisent. Quel honneur… mérité !
Leçon no 1 : Pour pallier la difficulté de parler de soi, faites parler vos sens, vos cheveux, votre nez trop petit ou trop long, la couleur de vos yeux, celle de vos ongles, la taille de vos pieds, la forme et la signification de votre tatouage, un vêtement, une écharpe, le lieu où vous vivez, le nom de la rue, la forme d’un arbre ou celle d’un nuage, votre cœur, votre sensibilité, votre regard plutôt que votre intellect. Les idées abstraites ne sont pas de bons supports au storytelling. Ce sont les éléments de vraisemblance, les détails concrets, les photographies de la vraie vie qui servent de point de départ à une grande histoire.
Quel storytelling choisir ? Quel mentor pour vous ?
Ce qui nous fascine souvent dans les romans, les nouvelles, les différentes formes littéraires, ce sont les histoires. En politique, on s’intéresse aux idées, mais la plupart du temps, on aime bien connaître la vie des protagonistes, leur vie officielle et leur vie secrète. Il en va de même pour les marques. On apprécie la qualité des produits, mais on achète les produits des marques parce que celles-ci savent nous raconter de belles histoires, vraies ou fausses, mais vraisemblables la plupart du temps.





























