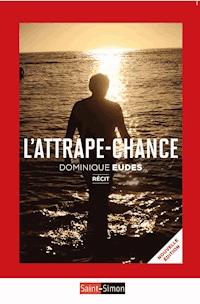
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Simon
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Pour lutter contre un cancer, il est prêt à tout expérimenter
C’était l’unique et dernière chance
Envahi par un cancer inguérissable, Dominique Eudes se soumet, dans la « Clinique d’expérimentation humaine » de Bethesda, aux violences d’un traitement révolutionnaire dont les résultats problématiques doivent, seule certitude dans la tempête, se payer d’effets secondaires ravageurs.
Refusant de subir son statut de patient, il entre résolument dans le camp de ses savants tortionnaires en assumant toutes les épreuves que la science va lui infliger sans jamais cesser de célébrer cette vie qui menace de le quitter. Il tisse ainsi une trame où se conjuguent la passion et la raison, l’âpreté de la douleur et la soif de vivre, le courage et la gourmandise de l’instant.
« J’ai aimé la vie passionnément pendant cette saison où elle m’a été contestée. Je l’ai aimée avec gravité et futilité, avec frivolité et fidélité, avec exigence et nonchalance. Et, comme tous les amoureux fervents, je veux croire que si je vis encore, c’est parce qu’en retour j’ai dû être quelque peu aimé d’elle. À travers tous les désirs, toutes les pulsions, toutes les émotions qui plantaient des lumières dans mon jardin dévasté, j’ai cultivé les petites vies de l’âme, et c’est ainsi que j’ai tenté d’attraper la chance. »
Un ancien condamné devenu gibier de laboratoire propose dans un style vivant, émouvant et souvent drôle, une éclatante leçon d’espoir.
L'auteur raconte avec force son parcours contre la maladie, au travers des traitements expérimentaux et des essais cliniques qu'il a subis.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Un type qui aime la vie comme ça, c'est rare. Et un type qui fait somptueusement l'éloge de celle-ci, c'est encore plus rare dans les époques moroses. (...) Tout cela dans une écriture souveraine, émouvante et limpide. Impeccable."
(Philippe Bott, Service littéraire, décembre 2014)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste, scénariste et écrivain,
Dominique Eudes a été chef de la rédaction à Paris Match de 1985 à 1998. Après avoir vaincu un cancer pour lequel on le disait perdu d'avance, il a choisi de partager son expérience en publiant
L'Attrape-chance.
EXTRAIT
Ces matins-là, j’aimais me réveiller deux fois. C’était des matins d’été en Grèce, dans l’île de Spetsai, où ma chambre ouvrait à l’est. Je buvais d’abord un demi-rêve de lumière froide. Et je me rendormais jusqu’à ce que la caresse du soleil devienne brûlure pour me faire émerger dans la violence du jour éclaté. Le signal plus doux du premier éveil venait toujours de la mer. C’était le staccato d’un moteur de caïque qui passait de gauche à droite sous la maison de Claude. Il rebondissait sur l’eau avec la jubilation têtue d’une danse à deux temps. Comme un cœur sur un tambour. Derrière les jalousies bleues qui faisaient jaillir une harpe de lumière, Thanassis passait, cassé en deux, penché par-dessus le bord de sa barque, la tête à demi enfouie dans le seau à fond de verre qui gommait les vagues et les reflets de la surface pour lui livrer les paysages noyés qu’il survolait comme un oiseau avide. Cette lucarne immergée lui permettait de débusquer les poulpes lorsqu’il arrêtait son moteur et laissait son bateau dériver lentement mais, même pendant ses déplacements d’un point de pêche à un autre, il continuait, comme un astronome fasciné derrière l’oculaire de sa lunette géante, à garder la tête dans son seau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
Pourquoi moi ?
Si les statistiques étaient une science exacte je ne serais pas loin d’être une aberration vivante.
Alors, pourquoi moi ? La question n’est pas un cri de révolte contre le caprice d’un destin qui m’aurait condamné au hasard ; elle interroge une énigme vitale dont la solution pourrait contenir quelques promesses utiles. Elle aimerait savoir par quelle injustice, par quel mérite, par quel opportunisme, par quel aveuglement, par quel acharnement, par quelles manigances, par quels enchaînements de la chance je suis encore vivant.
Cette question reste encore ouverte puisque, vingt-cinq ans après mon improbable combat contre un cancer réputé incurable, je me la pose encore.
J’ai traqué la réponse et crois l’avoir en partie trouvée en écrivant ce récit que j’intitule désormais « l’Attrape-chance ». Mon histoire se tenait et se tient toujours je crois, dans les trames de la science, des souffrances et de l’espoir que j’ai tenté de tisser avec des mots.
Pour lutter contre le cancer qui avait prospéré dans mon rein gauche avant d’aller coloniser mes poumons, il n’y avait rien. Rien sinon une idée nouvelle née d’une molécule récemment isolée par le génie génétique et étayée par quelques premiers résultats plus prometteurs qu’avérés.
Dix pour cent de chances, m’avait-on dit, si, pour me faire administrer la potion révolutionnaire, je parvenais à être admis au nombre des bipèdes de laboratoire dans la clinique d’expérimentation humaine du NIH près de Washington.
J’ai été admis, ce qui n’était déjà pas une mince affaire, et à l’arrivée ce ne furent pas dix pour cent de résultats positifs mais tout compte fait, après les rechutes : un pour cent. Nous étions trois cents ; nous sommes trois rescapés ; et je ne suis pas certain pour les deux autres.
Alors pourquoi moi ?
La science comprendra peut-être un jour quelle déficience particulière combattue par quel effet particulier de la molécule en question (l’interleukine) m’a valu ce résultat d’exception.
Mais il faudrait aussi tenter de peser les choses de la vie. On parle volontiers, avec raison, du rôle de la force mentale dans la lutte contre la maladie. En ce qui me concerne je crois que cette source d’énergie a fourni les doses les plus addictives de ma dépendance à la vie. Et ce fut sans doute ma sagesse d’y succomber. Une sagesse que je voudrais tenter de partager.
En me retournant sur les six mois d’un traitement dont les effets secondaires étaient si éprouvants qu’on a fini par renoncer à l’appliquer, je n’ai pas pu m’empêcher d’être encore et toujours stupéfait par ma furieuse obstination à aller de l’avant. Et je crois avoir compris d’où je puisais cette énergie. Je la tenais de ma fragilité. La précarité même de ma survie me donnait, je crois, une perception exacerbée qui me permettait de ne rien rater de ce qui pouvait – jusque dans les instants les plus minuscules d’un carpe diem en péril – m’être favorable. Cet opportunisme radical, cette chasse permanente à la chance la plus infime, ont fait que je n’avais pas une chance sur cent de survivre, mais mille sur cent mille. Et ce n’est pas tout à fait pareil. J’ai cueilli des milliers de chances. À l’aune de la raison, ce n’est pas vraiment réjouissant. Mais ça aide et c’est le risque de vivre.
Si j’ai survécu, ce n’est certainement pas grâce à ce seul viatique. J’aurais pu (pour ne pas dire « j’aurais dû ») mille fois mourir et je ne sais vraiment pas pourquoi je vis encore. Mais ce dont je suis certain, c’est que si je n’avais pas réagi de cette manière, je serais mort.
Cela ne peut se comprendre et se transmettre qu’à travers le tissu d’une histoire. C’est pourquoi, vingt-cinq ans après l’avoir vécu, dix ans après l’avoir livré une première fois, et je ne sais toujours pas combien de temps avant d’affronter l’épreuve qu’on ne gagne ni ne racontera jamais, je ne crois pas inutile de reprendre ce récit.
D.E. Fuerteventura, septembre 2014
À May
Nous qui mourrons peut-être disons l’homme immortel au foyer de l’instant. SAINT-JOHN PERSE
Elle est retrouvée. Quoi ? – L’Éternité C’est la mer allée Avec le soleil. ARTHUR RIMBAUD
Un peu d’eau dans mon vin
Ces matins-là, j’aimais me réveiller deux fois. C’était des matins d’été en Grèce, dans l’île de Spetsai, où ma chambre ouvrait à l’est. Je buvais d’abord un demi-rêve de lumière froide. Et je me rendormais jusqu’à ce que la caresse du soleil devienne brûlure pour me faire émerger dans la violence du jour éclaté. Le signal plus doux du premier éveil venait toujours de la mer. C’était le staccato d’un moteur de caïque qui passait de gauche à droite sous la maison de Claude. Il rebondissait sur l’eau avec la jubilation têtue d’une danse à deux temps. Comme un cœur sur un tambour. Derrière les jalousies bleues qui faisaient jaillir une harpe de lumière, Thanassis passait, cassé en deux, penché par-dessus le bord de sa barque, la tête à demi enfouie dans le seau à fond de verre qui gommait les vagues et les reflets de la surface pour lui livrer les paysages noyés qu’il survolait comme un oiseau avide. Cette lucarne immergée lui permettait de débusquer les poulpes lorsqu’il arrêtait son moteur et laissait son bateau dériver lentement mais, même pendant ses déplacements d’un point de pêche à un autre, il continuait, comme un astronome fasciné derrière l’oculaire de sa lunette géante, à garder la tête dans son seau. Il faisait alors sa route, comme un aviateur, en se repérant sur les fonds qui déroulaient sous lui des vallées rouges, des forêts dansantes et des processions de promeneurs suspendus.
Ce matin-là, la musique de son bateau devait être plus claire ou plus éloquente que d’habitude. Au lieu d’annoncer mon naufrage dans une nouvelle tranche de sommeil, son appel m’a maintenu éveillé et m’a soudain donné le désir d’aller moi aussi voler sans attendre dans le bleu de Thanassis.
Sur l’escalier qui descend à la petite crique, mes pieds nus me transmettent la fraîcheur qui monte des dalles de pierre grise aux interstices blanchis à la chaux. J’attrape au passage mon masque, mes palmes, mon tuba et l’arme dérisoire de mes exploits sous-marins, une fourchette qui me sert à décoller des rochers les oursins que j’offrirai à la maisonnée pour fêter son réveil.
Le caïque de Thanassis s’éloigne en traçant comme un rasoir une ligne parfaite sur la laque rose qui enflamme la mer. Un de mes plus grands bonheurs consiste à nager quand l’eau devient lumière, à fracasser la mosaïque du couchant ou à déchirer comme aujourd’hui la soie à peine frissonnante du petit matin.
À ma troisième descente vers des profondeurs pourtant très raisonnables, une douleur que n’explique pas la pression normale de l’eau sur mes tympans m’oblige à remonter à la surface. Je m’ébroue, fais tourner l’extrémité de mon index dans l’entrée de mon conduit auditif, prends de l’eau dans ma bouche et renverse la tête pour me gargariser. J’accomplis tous les rites païens d’une thalassothérapie immémoriale et je replonge dans l’espoir de constater la disparition du mal. Mon oreille droite proteste et la gauche commence très vite à manifester un déplorable esprit de symétrie. La douleur envahit le bas de mon visage et m’empêche de serrer les mâchoires. Seul, éclaboussant la lumière de l’aube, j’enrage. Ce qui me révolte le plus à ce moment, ce n’est pas tant une sensation physique désagréable que l’indignation devant une sorte de profanation, d’incongruité dans le culte que je crois rendre à la nature, lors des parenthèses balnéaires d’une vie plutôt négligée sur le plan des disciplines naturelles.
J’ai connu avec l’âge l’inflation galopante du prix de mes agapes. Les méchantes arrière-pensées de l’alcool et du tabac faisaient partie de ces réalités navrantes que j’avais fini par accepter. Mais je n’avais pas l’intention de me résigner devant les dernières perfidies de mon organisme qui semblait depuis quelque temps s’ingénier à gâcher mes plaisirs les plus sains. Le soleil lui-même s’était mis à provoquer sur ma peau des allergies qui enfonçaient ma première semaine de vacances dans la misère des scrofuleux. Et voilà que maintenant la mer, s’en prenant à mes oreilles, entrait dans le complot.
Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Éternité
C’est la mer allée
Avec le soleil.
C’était rien moins que l’éternité de Rimbaud qui se liguait au complet contre moi. Ou plutôt mon corps qui se montrait inapte à la célébrer. Il fallait réagir vigoureusement.
Je suis donc aussitôt descendu à bicyclette vers la Dapia, où venaient d’arriver les journaux de France qui m’ont aidé à attendre sur le port l’ouverture de la pharmacie. Depuis longtemps les relations cavalières que j’entretenais avec ma santé se limitaient à l’autoprescription de doses copieuses de médicaments dont j’allais sans ordonnance – c’était à la fois un plaisir et un gage de réussite – négocier âprement l’acquisition auprès des apothicaires des divers pays que je traversais. Ce matin-là, mon pouvoir de persuasion, qu’aurait normalement dû accroître la compassion provoquée par ma misérable connaissance de la langue, se heurta à l’appareillage cyclopéen d’un mur déontologique. La pharmacienne de Spetsai, qui s’était montrée moins farouche dans les années passées, avait opté pour une attitude implacable et moderne. Elle refusa de me délivrer les gouttes à base de cortisone dont je connaissais l’efficacité et m’indiqua le chemin qui, dans le labyrinthe des ruelles blanches déjà brûlantes de soleil, devait me conduire chez un médecin.
Près de la table d’auscultation se dressait un objet lourd et arrondi supportant une colonne de mercure appuyée à une énorme règle graduée. Le médecin à qui j’avais d’emblée tenté de dicter l’ordonnance que j’attendais de lui n’avait ni voulu ni sans doute pu me comprendre et m’indiquait d’un geste impérieux la table sur laquelle il m’invitait à m’allonger. Quelques minutes plus tard, la colonne de mercure de l’engin rapporté de Russie indiquait que ma tension s’était égarée dans une fourchette périlleuse, entre vingt et dix-huit. Le dialogue était difficile avec le jeune médecin qui avait débarqué l’année précédente de Tachkent. Comme tous les fils d’émigrés communistes qui avaient suivi Markos Vafiadis après la guerre civile, en 1949, il avait fait ses études quelque part du côté de Samarcande, où la mort attendait aussi les rêves de toute une génération. C’est un drame que je connais bien pour avoir, après une longue enquête à travers cette diaspora des années cinquante, écrit un des premiers livres indépendants sur la victoire trahie de la Résistance grecque et l’épouvantable affrontement qui avait suivi. Pourtant mes connaissances historiques ne me furent d’aucun secours pour expliquer à mon interlocuteur la façon dont j’avais l’habitude de juguler mon otite. Il s’entêta à vouloir me traiter avec des antibiotiques.
Un sourire d’autosatisfaction triomphante se dessina sur le visage de la pharmacienne lorsqu’elle me vit revenir avec une ordonnance où ne figurait pas la cortisone que j’avais prétendu lui arracher une heure plus tôt. Je repartis donc le long de la mer avec un chargement d’antibiotiques, de seringues et de diurétiques destinés à faire tomber un excès de tension qui était déjà, sans que je l’imagine, le signe annonciateur d’une saison difficile.
Pour l’heure, la seule saison que je vivais, et dont j’avais décidé de profiter, malgré les effarouchements d’un médecin venu du froid, était mon été grec. Condamné à nager la tête hors de l’eau, je dus m’administrer deux séries de piqûres pour venir à bout de mon otite, mais ma tension, vérifiée trois fois par semaine, refusait de descendre. Je m’étais pourtant imposé un régime – pas trop héroïque – consistant, comme Platon préparant les libations qui délient la langue, à mettre plus ou moins d’eau dans mon vin. J’attribuais à cette ascèse tranquille, couplée à l’effet des médicaments, une sensible perte de poids dont je ne pouvais que me féliciter.
Chez Claude, la jardinière de mes délices, le temps filait comme du miel. Insaisissable de douceur parfaite. Mêmes bruits venant de la mer sous les terrasses fastueuses, mêmes reflets mouvants sur la laque des volets bleus, même vacarme des cigales autour de la klimataria, la pergola drapée de vigne et de bougainvillées. Mêmes rires de Jeannette et Andréas, l’âme de ma Grèce, venus partager les plats de Soula, dont le monopole de la perfection exigeait qu’elle allât jusqu’à préparer le pain à la maison, mêmes chansons autour de Moustaki qui débarquait avec son accordéon, même émotion à faire monter dans le ciel les cerfs-volants de Nata qui achevait sur sa terrasse la statue de la Bouboulina aujourd’hui dressée sur l’esplanade de Dapia, même présence courtoise et chaleureuse du voisin Michel Déon, cerné par les bulldozers qui bétonnaient les abords de son Balcon de Spetsai. Les repères du temps étaient trop doux, aucune aspérité ne venait jalonner son cours. Je n’éprouvais aucune appréhension. J’avais l’impression de retrouver une silhouette de jeune homme. Je mettais seulement un peu d’eau dans mon vin.
Pour prolonger les bonheurs de Spetsai, nous avions pris l’habitude, May et moi, de partir seuls à l’aventure. Cette fois, après un court passage à Athènes, nous avons embarqué pour Chio avec l’intention d’y débusquer, sous forme de criques vierges, de balcons sur la mer et de tavernes sous les oliviers, quelques trésors initiatiques de la douceur de vivre. Depuis des années, la carte de la mer Égée avec ses trois cent cinquante îles exerce sur moi la fascination des parchemins codés des histoires de pirates avec leurs fabuleux butins enfouis sous des cocotiers indéchiffrables. Je rêve de les parcourir toutes mais, en attendant, j’y chasse au hasard, levant devant moi suffisamment de merveilles pour me dédommager largement de quelques nuits passées dans des bouges douteux ou sur des sites défigurés. Ce sont les risques du métier d’amateur.
Sur le petit port d’Emporio, dans le sud de Chio, la chambre où nous avons posé notre sac donnait sur la mer et, cette fois, sur le couchant. Il suffisait le soir de descendre un petit escalier pour plonger dans la mosaïque de feu. Dès mon arrivée sur l’île, je m’étais procuré chez un pharmacien sensible au pataquès de mon éloquence hellénique les gouttes qui me permettaient de fréquenter à nouveau le jardin des poulpes. I’d like to be under the sea in an octopus in the shade garden’s, chantaient à nouveau pour moi les Beatles. En dehors de mes flâneries subaquatiques, pendant que May se surdorait sur une très longue plage de galets noirs caressée par une mer curieusement fraîche et d’une limpidité si parfaite qu’on s’étonnait d’être porté par elle, je promenais ma nouvelle silhouette en voie de filiformité sur une petite moto tout-terrain, mulet mécanique qui dévorait vaillamment les cailloux des sentiers de montagne. Le soir, nous allions tenter de déchiffrer le langage des murs de Pyrghi. Les habitants de ce village perché ont la particularité de décorer leurs maisons, leurs boutiques, leurs bâtiments administratifs et leurs églises de signes géométriques noirs, gris et blancs. Sur un canevas formé de carrés d’une trentaine de centimètres dont la régularité n’est interrompue que par les arcs et les encadrements des portes et des fenêtres, ils peignent des triangles, des volutes, des étoiles, des cercles, des idéogrammes, des visages et des corps stylisés. Miró, s’il était venu à Pyrghi, y aurait trouvé, comme dans un film en noir et blanc, ses créatures alignées sur tous les murs de la ville. Certains signes seraient la marque des familles et, avec les clés, on pourrait lire sur les façades des siècles d’histoires, de rencontres, d’unions et sans doute de passions et de drames. Sur ces maisons de pierres sèches et de chaux, la richesse de l’imaginaire apprivoise la violence de la lumière, transfigure la rudesse et la pauvreté de la matière.
Dans la plus vieille taverne d’Emporio, mes quelques connaissances de l’idiome me valaient d’être traité avec égards et surtout de voir arriver sur ma table des plats que la redoutable tenancière refusait d’offrir aux touristes. Ayant un soir fait partager ce privilège à un couple d’Anglais qu’elle n’avait jamais daigné servir, je me suis entendu signifier que je devrais désormais m’abstenir de distribuer des passe-droits à des étrangers. Mais, pour bien me confirmer mon intégration, critère essentiel de la qualité de mes séjours, elle m’initia aux vrais secrets de l’établissement, qui écoulait furtivement de l’absinthe et de l’alcool de figue, interdits. Joie puérile d’être admis à la consommation des breuvages défendus… Je ne savais pas encore quels poisons beaucoup plus modernes et beaucoup plus violents l’avenir me réservait.
De temps en temps, le plus rarement possible, il fallait pourtant ouvrir des brèches dans le rempart tendre de cette parenthèse parfaite et communiquer avec le monde utile. Mais le téléphone même s’ingéniait alors à se donner des airs de magie, tant par les caprices de son fonctionnement que par les lieux où s’opérait le prodige. À Emporio, le culte d’Edison se rendait sur une colline qui dominait le port. On y accédait par un raidillon caillouteux, et on attendait son tour sous les pampres mûrs d’une tonnelle avant de pénétrer dans le minuscule édifice à la blancheur éclatante, où le combiné, entre deux bouquets de basilic, reposait sur une table de pierre comme sur un autel. Mieux que cette charmante variation dionysiaque de la cabine des PTT, j’avais fréquenté, à Naxos, la grotte du village d’Apyranthos. Un moine animé par une vigilance sacrée y veillait sur l’engin troglodytique et vous laissait avec un sourire séraphique tenter votre chance à la loterie du cadran. Après vous avoir accordé le temps de mesurer votre impuissance, il vous écartait de la roulette électronique et officiait. Avec des gestes d’une grande délicatesse, suspendus par instants, mains en l’air, dans une sorte d’imploration muette, il enchaînait les chiffres. Et avec un sourire illuminé il vous tendait le combiné. « Salut, coco, il fait beau chez toi ? » La voix de la standardiste du journal résonnait comme un Te Deum dans la grotte d’Apyranthos. Et, plus magique encore, celle de la lointaine Isabelle que je jouais, en l’appelant à des heures impossibles, au hasard des facéties de la téléphonie insulaire.
C’est ainsi que, un jour faste, un caprice de la technique me permit de donner rendez-vous à Jeannette et Andréas dans une région de la Grèce continentale que je ne connaissais pas. Notre amie Hélène Caracosta avait une grande maison dans le village de Kalamaki, au-dessus de Volos, sur le versant nord du mont Pélion. Je me souvenais vaguement que, dans la mythologie, les Géants hirsutes aux pieds de serpents avaient entassé Pélion sur Ossa pour tenter d’aller dire deux mots à Zeus qui avait encore abusé de sa foudre, mais je n’imaginais pas le somptueux paradoxe qui nous attendait. Kalamaki, c’est la montagne à la mer. C’est le décor de Jules et Jim reflété dans le bleu violet de la mer Égée.
La place, lieu unique et suffisant de la vie sociale, cerne un platane immense dont l’ombre délicieuse est disputée par deux tavernes qui font également office de pantopoleïon, de « marchand de tout ». Malgré son diamètre gigantesque, le tronc de l’arbre n’est pas assez vaste pour vous soustraire, le soir où vous avez choisi de dîner à la terrasse de Vassili, aux regards de Babis, le concurrent, que vous avez trahi sous prétexte que ses rougets n’avaient pas le regard assez vif. Un équitable partage dans le temps et une diplomatie subtile nous permettaient cependant, non seulement de prendre nos repas en paix, mais de jouir de la part des tenanciers d’une surenchère de bonnes grâces. C’est ainsi que nous avons vu arriver sur nos tables des noix confites à leur naissance avec leur cosse et leur coquille encore tendre. Les karidaki glyko, dont les vertus proclamées étaient innombrables, et l’eau gazeuse que je versais raisonnablement dans mon vin semblaient me vouloir du bien. Le relatif effacement de mes convexités abdominales me susurrait que j’étais sur la voie de la santé.
« Kyrie gallico tilephono ! » Penchée, les mains en portevoix, par-dessus le parapet de la place Panayota, la femme de Babis, tout en proclamant l’importance que confère à son établissement le monopole des télécommunications, ameutait tout le village pour avertir nuit et jour les destinataires des appels que le sommeil ou une activité balnéaire avaient temporairement arrachés à l’ombre du platane géant. C’est ainsi que ma présence était régulièrement portée ou rappelée à la connaissance de la communauté – le « Gaulois », c’était moi. La voix de Panayota, se livrant à l’appel des présents, tenait la chronique du village.
Au pied de son belvédère, les grosses maisons carrées aux toits de lauzes forment un amphithéâtre clairsemé descendant jusqu’au rivage où d’immenses plates-formes de marbre brut, obliques et glissantes, s’enfoncent doucement dans la mer.
Nous partagions le dernier étage de la maison avec Jeannette et Andréas et chacune de nos gigantesques chambres ne comportait pas moins de sept fenêtres qui nous permettaient d’organiser des festivals de courants d’air. À mesure que le soleil tournait, nous fermions les volets du côté exposé et ouvrions largement tout ce qui donnait sur l’ombre. « Ouzo, banio, dodo. » Toutes ces activités s’égrenaient avec une parnassienne légèreté dans l’air brûlant et je trouvais incongrue l’insistance avec laquelle, mon départ approchant, Jeannette et May me harcelaient pour me rappeler, à table ou quand je venais m’allonger sur le marbre en sortant de la mer, ma promesse d’aller subir un check-up dès mon retour à Paris. Rien n’obligeait May à rentrer avec moi et j’avais décidé de retourner seul à Athènes, où j’irais directement à l’aéroport rendre la voiture de location avant de prendre l’avion pour Paris.
La veille de mon départ, nous avons traîné fort tard sous le platane et j’ai estimé que l’imminence de mon cruel arrachement me dispensait d’observer la loi d’airain qui m’imposait de couper et de rationner mes breuvages. En préliminaire aux adieux, nous avons plus que de raison chanté Kaïmos (le « mal du pays ») et lancé avant de vider nos verres la formule Zito i zoï (« Vive la vie »). Jeannette avait bien entendu cru utile de manifester son affection en m’exhortant à plus de modération, mais sa prudence me paraissait très excessive.
Au milieu de la nuit, j’ai été réveillé par un vacarme de déménagement et, quand je suis sorti sur le palier, j’ai trouvé le lit de Jeannette installé en haut de l’escalier. Après avoir déplacé les meubles, elle était occupée à brancher un très savant réseau de rallonges pour installer des lampes qu’elle orientait dans toutes les directions afin d’éclairer le moindre recoin.
« Dominaki, c’est plein de rats ! »
Jugeant inutile de lui faire entendre le langage de la raison ou de lui expliquer simplement que ses rats n’étaient sans doute que d’innocentes musaraignes, je l’ai aidée à brancher la dernière lampe avant de retrouver l’obscurité de ma chambre.
Elle dormait encore sous ses projecteurs dont l’éclat pâlissait dans la lumière du jour naissant quand j’ai dû contourner son lit, qui occupait le centre du palier, pour descendre à la cuisine. Et quand j’ai ouvert la porte du réfrigérateur une chose lourde et sombre a bondi dans le vide en lançant un cri aigu. Un rat, un authentique gaspard noir, entré mystérieusement dans le Frigidaire, s’enfuyait vers la chaleur retrouvée.
Alors je me suis dit qu’après tout les craintes de Jeannette n’étaient pas toujours infondées. Et son inquiétude pour ma santé s’est mise à m’inquiéter.
Ce jour-là, il y eut encore un signe. Un signe tragique et violent.
Je roule sur la route d’Athènes. Un peu avant Aghios Constantinos, la route est à trois voies. Juste devant moi, une Fiat rouge occupe le couloir central. En sens inverse, dans un éclat de lumière qui se reflète sur son pare-brise fonce une autre voiture. À contre-jour, elle me paraît noire. La route rectiligne plonge entre deux collines et la vue est parfaitement dégagée. Un des deux occupants de la voie centrale doit céder la place mais ils continuent à se ruer l’un vers l’autre. Pourtant rien ne les empêche de se rabattre. La distance qui les sépare se raccourcit à une vitesse hallucinante. J’écrase la pédale de mon frein. Devant moi aucun des deux crétins ne veut céder. Et, soudain, le vacarme de mes pneus bloqués est couvert par l’explosion. Je suis arrêté à mi-pente et je vois, à moins de cinquante mètres en contrebas, les deux épaves emmêlées qui escaladent le talus de droite. Et c’est le silence. J’attends des cris, des hurlements, une protestation véhémente de la vie. Mais c’est toujours le silence. Et, après quelques secondes sans souffle et peut-être sans battement de cœur, j’entends seulement, non pas monter, mais ramper des plaintes. Les plaintes atrocement faibles de la connerie et de la vie qui s’en va.
Pour la deuxième fois dans la même journée, je me suis senti fragile.
Un radiologue nommé Michel-Ange
J’avais rendez-vous avec Isabelle pour déjeuner. J’étais passé la prendre à son bureau mais, tandis que nous nous dirigions vers la sortie par le périlleux défilé des couloirs, nous sommes tombés dans l’embuscade. Elle a soudain été happée par une de ces urgences qui éclatent régulièrement dans les journaux au moment où votre couvert a été dressé ailleurs. Comme la loi d’airain de notre aventureuse profession impose de se montrer toujours « disponible » – euphémisme des temps de crise pour exprimer la condition servile –, il se trouve en effet toujours un importun rempli d’importance qui, soit qu’il n’ait rien d’autre à faire, soit le plus souvent qu’il estime du dernier chic de se faire lui-même attendre en ville, vient vous surprendre les pieds dans les starting-blocks. Cette chasse au journaliste en partance s’exerce jusqu’à la porte de l’ascenseur et, dans ces moments de tous les dangers, la dernière broutille peut être promue championne des impératifs catégoriques. Après une nuit de bouclage, j’étais un peu fatigué mais maître de mon temps. J’ai donc décidé sereinement d’attendre que mon infortunée consœur soit rendue à la vie civile et je suis descendu me promener sur l’avenue Charles-de-Gaulle. Je m’apprêtais à traverser pour aller écumer les vitrines plus excitantes du trottoir des numéros pairs quand mon regard s’est arrêté sur une plaque à l’entrée d’un immeuble :
Docteur Michelangeli Antoine, radiologiste.
Je transportais depuis quelques jours dans ma poche une ordonnance m’enjoignant d’aller exposer mes poumons à la pénétrante indiscrétion des rayons X, et voilà que Michel-Ange croisait ma route. Michel-Ange qui n’avait pas hésité à risquer le bûcher pour découvrir les formes enfouies de l’anatomie en disséquant les corps humains. Je jugeai plaisant et flatteur de permettre à son homonyme d’explorer impunément les secrets de mes entrailles.
Cela fait partie des signes qui jalonnent ma route. Le surréalisme m’a appris la magie des rencontres de hasard et, sans la complicité des circonstances, je ne me serais sans doute jamais soumis à cet examen supplémentaire dont je ne percevais ni l’urgence ni même la nécessité.
À mon retour de Grèce, j’avais en effet tenu ma promesse. Je m’étais retrouvé un matin à l’entrée d’une sorte de chaîne de démontage où, à l’aide des instruments les plus divers, j’avais été testé, analysé, ponctionné, écouté, palpé jusqu’à ce qu’un médecin, une dame blonde et timide préposée à l’expédition des produits finis, prononçât un verdict de clémence qui ne me parut pas justifier un appel. Après avoir pris connaissance des résultats des analyses de sang, elle m’avait simplement dit :
« Un peu de trop partout mais rien de particulièrement alarmant. Vous avez une nature pléthorique. »
Je trouvais plutôt heureuse cette définition de mon regrettable manque de mesure et je restais là à me réjouir de l’exactitude du langage médical tandis qu’elle s’attardait, le sourcil froncé, sur les radios qu’elle avait fixées d’un geste sec sur une plaque lumineuse.
« Vous fumez beaucoup ?
— J’ai arrêté il y a deux ans, mais auparavant j’ai beaucoup fumé. Environ trois paquets par jour à la fin, avais-je répondu avec la satisfaction légitime de celui qui a victorieusement mené son combat contre la nicotine.
— Ah bon. »
Ce sobre commentaire n’avait pas de quoi m’inquiéter et nous étions convenus que je devais retourner consulter mon médecin traitant – désormais j’étais « traité » – à la seule fin, pensais-je, d’arrêter définitivement les moyens de domestiquer mon hypertension. J’avais donc revu le docteur Koskas. À son tour, il s’était égaré dans l’observation des clichés que je lui avais apportés et avait exprimé une certaine perplexité quant à la propreté de mes poumons. Il avait donc ajouté à l’ordonnance que j’étais venu chercher celle que je venais de retrouver dans ma poche au moment où je m’arrêtai devant l’enseigne du docteur Michel-Ange.
Depuis que j’utilisais les services de la médecine, c’est-à-dire depuis Spetsai, je n’avais que des raisons d’en être satisfait. Mon hypertension s’était assagie sous l’effet de bêtabloquants qui offraient en outre l’avantage d’étaler les vagues de mon écumante nature et, sur la santé de mes bronches, je m’étais forgé un optimisme de béton. Dans la mesure où j’avais beaucoup fumé, il était normal qu’elles n’offrent pas la transparence des premiers matins du monde et, puisque j’avais renoncé au tabac, les opacités observées ne pouvaient être que les scories en voie de disparition d’une ère révolue. En outre, je ne savais pas où j’en étais de mes relations avec le bacille de Koch et ce flou me fournissait une raison supplémentaire de ne pas m’inquiéter. En effet, aux dernières nouvelles, qui remontaient au début des années soixante, je n’avais pas encore viré ma cuti. Ma génération perdait alors un peu de son honneur et une grande partie de sa jeunesse sous les oriflammes de la guerre d’Algérie. Après avoir multiplié les sursis en me présentant à d’innombrables examens universitaires dont quelques-uns furent réussis, j’avais fini par partir, à vingt-cinq ans, sans fleur au canon, pour trente et un mois d’une servitude dont je n’ai guère perçu la grandeur. Dans cette perspective, je m’étais ménagé une arme secrète : en refusant de me soumettre au vaccin du BCG, je me donnais une chance d’être victime sous les drapeaux d’une primo-infection qui m’eût renvoyé illico aux délices de la vie civile où ma tardive adolescence n’aspirait qu’à retourner marauder ses plaisirs. Il m’en aurait coûté l’absorption de quelques comprimés de Rimifon, un marché des plus raisonnables en échange des deux étés et des trois printemps de liberté qui me furent finalement ravis. Car ma santé exemplaire ne connut pas la moindre faiblesse au service de la patrie. De cette histoire ancienne, il résultait dans mon esprit que je pouvais fort bien avoir plus tard fréquenté furtivement le bacille de Koch lequel, sans me terrasser, aurait laissé des traces dans mes éponges raisonnablement mitées avant de s’armer des défenses appropriées. Vraiment pas de quoi s’inquiéter.
Ainsi donc, ce jour de septembre 1988, c’est d’un cœur léger que je pénétrai dans le cabinet du Michel-Ange de la radiologie avec la plaisante idée d’aller épingler l’ombre incongrue de mes organes au plafond de la Sixtine. Comme on dessine des moustaches à la Joconde.
Et, le hasard étant décidément dans le complot, la réceptionniste m’a annoncé tout de suite qu’un rendez-vous venait de se décommander et que je pouvais sur-le-champ entrer dans la cabine pour m’y déshabiller.
« Le docteur Koskas est installé de l’autre côté de l’avenue. Je pense qu’il pourra mieux vous dire lui-même ce qu’il faut faire. Je l’ai appelé ; il vous attend.
— Vous pourriez peut-être m’expliquer un peu.
— Vraiment, je ne sais pas. Il va falloir pratiquer de nouveaux examens. »
Il n’y avait pas un quart d’heure que j’étais entré dans le cabinet et je sentais que les rouages d’un méchant engrenage venaient de se mettre en mouvement. Je déteste ces lettres de l’administration qui vous réclament toujours une pièce supplémentaire pour compléter un dossier que vous espériez classé. J’étais venu subir cet examen comme une ultime formalité dans l’intention de clore une fois pour toutes l’épisode médical de ma rentrée et je râlais d’avoir encore à remplir des papiers de Sécurité sociale. C’est vraiment le sentiment dominant qui m’animait alors.
Je traversai donc en maugréant l’avenue de Neuilly et me présentai devant le docteur Koskas qui ne me fit pas attendre une seconde. Je lui servis ma théorie des sédiments tabagiques et de la primo-infection furtive. Mais il insista sur la nécessité d’approfondir les examens et me renvoya à sa secrétaire en lui demandant de prendre le plus tôt possible un rendez-vous pour explorer au scanner mes bronches patibulaires. Pendant qu’il retournait vers le client qu’il avait abandonné pour me recevoir entre deux portes, le rendez-vous fut fixé à la semaine suivante.
À la sortie de ce cyclotron dont la réaction en chaîne avait duré en tout un peu plus d’une trentaine de minutes, je devais être assez préoccupé. J’allais m’engager dans la rue Ancelle quand je me suis soudain avisé que ma vigilance s’était dangereusement relâchée : je venais en effet de croiser sans réagir une pervenche qui s’apprêtait à cartonner un véhicule coupable d’inertie abusive sur l’avenue Charles-de-Gaulle. En temps normal, je n’aurais pas manqué une telle occasion. Dieu merci, j’avais le temps de me ressaisir ! Revenant sur mes pas, j’arrivai à la hauteur de l’implacable au moment où son stylo s’abattait sur son carnet de contraventions. C’était l’époque des derniers parcmètres mécaniques et j’ai aussitôt glissé une pièce de un franc dans la fente de la diabolique horlogerie. Le petit signal de stationnement interdit a basculé dans le coin de la fenêtre et la pervenche, levant son stylo, m’a dit :
« Vous avez de la chance. Une seconde de plus et c’était trop tard.
— Ça m’est égal, ce n’est pas ma voiture. Mais, maintenant, c’est pour vous que c’est trop tard. Vous ne pouvez plus verbaliser. »
Je faisais de cette facétie le délice de ma guérilla urbaine personnelle et, cette fois encore, je n’ai pas été déçu par les vitupérations de ma victime.
Après cette roborative et chevaleresque intervention, je retrouvai Isabelle tout juste libérée de son conciliabule. L’épisode de mes poumons avait été mené tambour battant et je ne demandais qu’à changer de registre. Les yeux noisette de ma consœur, l’éloquence de ses longues jambes et la vivacité de ses propos réussirent sur-le-champ leur opération de diversion. Puisque le temps semblait vouloir faire des détours, nous continuâmes sur le registre buissonnier en allant déjeuner au parc de Saint-Cloud qui distillait le parfum lourd et transi des premières feuilles mortes. Isabelle parlait avec une légèreté où je voulais voir une promesse de sa liberté retrouvée après une rupture laborieuse. Elle s’apprêtait à s’installer dans un nouvel appartement et me proposait de venir le visiter le lendemain en fin d’après-midi. Je nourrissais depuis quelque temps derrière ma tête une idée exquise la concernant. La parenthèse médicale était fermée. Du moins j’en étais convaincu.
Mon retour au journal était âprement attendu par Chantal, toujours blessée dans la légitime revendication de prérogatives dont elle ne cessait de dresser l’inventaire. La doléance du jour était des plus classiques. Elle portait sur la taille de sa signature, qui n’était jamais à la mesure de ses mérites. Ma responsabilité dans ce crime de lèse-reporter n’était que tout à fait secondaire, mais il est vrai que j’aurais pu me montrer plus vigilant. Je me préparais à lui répondre aimablement quand mon téléphone a sonné.
« Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? »
La voix de May vibrait d’inquiétude.
« Dis-moi au moins de quoi tu parles.
— Il y a une heure que j’essaie de te joindre. Koskas a téléphoné à la maison. Tu as un rendez-vous ce soir à minuit à la clinique Hartmann pour un scanner. Il m’a expliqué qu’il t’avait demandé de ne pas attendre et il a été furieux quand sa secrétaire lui a appris que le rendez-vous avait été pris pour la semaine prochaine. Tu es fou ou quoi ? Tu aurais pu au moins me prévenir.
— C’est un trouillard. Je t’assure, il n’y a pas de quoi t’inquiéter. Je te rappelle. »
De l’autre côté du bureau, Chantal continuait à me fusiller de ses yeux noirs. J’étais plus ému par l’angoisse de May que par ma propre inquiétude. Je me refusais toujours à envisager la méchante hypothèse, mais mon interlocutrice se mettait soudain à m’exaspérer et je saisissais honteusement, comme une occasion, l’éclair qui avait imperceptiblement rayé mon inaltérable optimisme. Je me suis entendu dire :
« On vient de m’annoncer que j’ai un cancer des poumons. Alors, tu vois, ta signature… ce n’est pas le premier de mes soucis. »
Sans se démonter, elle m’a répondu :
« Et moi, tes problèmes de santé, je m’en fous. Ça n’a rien à voir avec le journal. »
Cette superbe goujaterie opéra comme un baume. Décidément, ni moi ni les autres n’étions décidés à prendre l’affaire au sérieux.
« Respirez profondément… Ne respirez plus… Respirez normalement. » Plus tard, ce sera : « Take a deep breath… Don’t breathe… Breathe normally. » Ce soir a commencé la litanie du suspense. « Take a deep breath, don’t breathe, breathe normally. » Le rythme à trois temps des dérives dans les tunnels des scanners. La métrique des fantasmes chargés de conjurer les mauvais songes. La musique des étreintes rêvées, des images conviées pour faire palpiter la vie sous la pluie des rayons X.
Les injections d’iode dans mes veines et la vague chaude qui traverse mon corps pour venir brûler les muqueuses de mes orifices, la bouche, les narines, l’urètre, l’anus.
À minuit, je fais connaissance avec les mécaniques et la chimie de l’imagerie médicale. Une relation qui ne sera pas une passade.
Ce soir, nous avions des amis à dîner à la maison. Comme je devais me présenter à la clinique à jeun depuis six heures, j’ai regardé mes hôtes boire et grignoter du bout des doigts. Ils ont su faire preuve de toute la désinvolture que je leur demandais tacitement d’afficher. Ils ont décidé qu’ils finiraient leur repas avec moi à mon retour. J’ai refusé de me faire accompagner. Ils ont fait comme s’ils refusaient aussi de prendre au sérieux les craintes du docteur Koskas. Tout le monde a gentiment joué le jeu.
« Vous vous grattez ! décrète-t-elle en pointant son doigt vers ma main, soudain perplexe, qui s’apprêtait à se promener sur mon menton.
— Non, je vous assure.





























