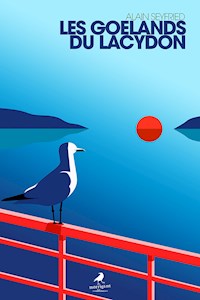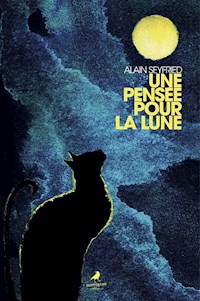Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Morrigane Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alice, la sage Alice, découvre un manuscrit manifestement écrit par un jeune homme. Elle tombe littéralement sous le charme. Qui est-il ? Où se trouve-t-il ? Quel âge peut-il bien avoir aujourd’hui ? Elle se met à enquêter. Opiniâtrement. Passionnément. Et, soudain, ses recherches débouchent sur un ciel serein. La vie lui semble dorénavant parée de mille couleurs. L’avenir l’appelle et, à son grand étonnement, elle se révèle telle qu’elle n’aurait jamais pu rêver d’être. Une véritable éclosion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Alain Seyfried
L’ÉCLOSION
MORRIGANE ÉDITIONS
13 bis, rue Georges Clémenceau - 95440 ECOUEN
(France)Siret : 510 558 679 000
06 85 10 65 87 - [email protected] www.morrigane-editions.fr
http://boutique-en-ligne.morrigane-editions.fr

2
RÉSUMÉ
Alice, la sage Alice, découvre un manuscrit manifestement écrit par un jeune homme. Elle tombe littéralement sous le charme. Qui est-il ? Où se trouve-t-il ? Quel âge peut-il bien avoir aujourd’hui ?
Elle se met à enquêter. Opiniâtrement. Passionnément.Et, soudain, ses recherches débouchent sur un ciel serein. La vie lui semble dorénavant parée de mille couleurs. L’ave- nir l’appelle et, à son grand étonnement, elle se révèle telle qu’elle n’aurait jamais pu rêver d’être.Une véritable éclosion.
3
BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR
Est né en 1947, dans un quartier populaire d'Alger où il a passé son enfance et son adolescence, accomplissant avec gourmandise et application ses études primaires, puis secon- daires.
À l'indépendance de l'Algérie, en 1962, il se retrouve en Région Parisienne et se lance dans des études supérieures. Di- plômé d'HEC, il entre en 1968 à Électricité de France, tout en fréquentant en parallèle l'Université Paris-Dauphine afin d'obtenir « pour l'honneur » un doctorat de Gestion, qu'il décrochera en 1973. Ses responsabilités de cadre, puis de cadre supérieur, il les exercera tour à tour à Paris, à Toulouse, et enfin à Marseille, dans les domaines de l'Informatique, de la Gestion d'Entreprise, et du Management de Projet.Au tournant du siècle, en 2000, il décide de mettre fin àsa carrière, pour se consacrer entièrement à la musique et à l'écriture, qui n'étaient jusque-là pour lui que des violons d'Ingres, et part habiter Rome, en immersion linguistique totale. De retour en France quatre ans plus tard, il installe enfin son refuge d'écrivain à Marseille, sur le rocher du Rou- cas Blanc, à deux pas de cette Méditerranée qui l'a vu naître.
4
Il n’y a que deux conduites avec la vie : Ou on la rêve, ou on l’accomplit.
René Char
5
6
À Julienne
I
— Voyons, ma petite Alice, me souffla Hélio avec une grande douceur, ce n’est pas vous qui allez pleurer, tout de même !
Paralysée par l’émotion, la gorge nouée, j’étais incapable de répondre. Je tentai d’endiguer le flot d’angoisse qui commen- çait à m’étouffer, mais je n’y parvins pas. Les yeux remplis de larmes, je promenai alors le regard tout autour de moi : devant les rayonnages de livres qui semblaient émerger d’un amas de nuages, je distinguai vaguement les deux fauteuils de cuir flot- tant sur un improbable océan... Je m’approchai du halo lumi- neux de la baie vitrée pour observer la placette, en contrebas.
L’arbre était bien là. Mon arbre. En le regardant, je me sentis petit à petit gagnée par une grande paix intérieure et, très vite, mes tensions s’évanouirent. Exactement comme lorsque je le contemple depuis la fenêtre de ma chambre. D’ici, pourtant, on le voit sous son profil gauche, tandis que, de chez moi, c’est son profil droit qu’il me présente. Mais il faut croire que, gauche ou droit, le profil de mon arbre importe peu pour que la magie opère.
— Ma petite Alice, je ne pars pas très loin, vous le savez bien. Juste un peu plus haut. À mi-colline. Dix minutes à pied, à tout casser. Vous viendrez me rendre visite quand vous vou- drez. Ça ne changera strictement rien.
En entendant ces mots, je me vis quittant l’immeuble pour
7
m’engager dans la montée qui mène à l’Institut et cette pers- pective me réconforta. Il avait raison. Pourquoi s’angoisser ? L’instant d’après, hélas, je m’imaginais de nouveau chez moi, par un jour gris et lent comme il y en a tant par ici, avec l’idée de sa porte close et le sentiment qu’il ne serait plus jamais de l’autre côté du couloir, prêt à m’accueillir au moindre pré- texte : « Vous n’auriez pas un brin de persil ? Avez-vous gardé le journal d’hier ? Connaissez-vous un bon plombier ? »
— En plus, poursuivit Hélio comme s’il avait compris que j’allais encore sombrer dans le désespoir, j’ai une surprise pour vous. Une surprise pour nous, devrais-je dire.
Je me tournai vers lui pour lui demander de continuer, mais aucun mot ne sortit de ma bouche.
— ... Là-bas, j’aurai un ordinateur, ajouta-t-il alors.—...— Ça vous étonne, hein ? Oui, un bel ordinateur, moderne
et tout et tout, avec une caméra. Comme ça, quand nous en aurons envie, à tout moment, nous pourrons nous voir et nous parler. Ce sera encore plus rapide que lorsque vous avez à traverser le palier. Qu’est-ce que vous en dites ?
Je ne pus m’empêcher de sourire à travers mon voile de larmes. L’idée que cet homme ait pu imaginer de telles choses pour éviter de me causer du chagrin finit de m’attendrir. Je me retournai. Il me fit signe de m’asseoir sur mon fauteuil, je veux dire sur celui que j’occupe quand je viens converser avec lui. Il approcha le lampadaire et en régla la luminosité. Me faisant comprendre que je devais l’attendre, il disparut ensuite vers la cuisine et revint quelques instants plus tard, une théière posée sur un plateau, accompagnée de deux tasses, d’un sucrier et d’une assiette de gâteaux. Il avait pensé à tout !
Hélio était un être bienveillant.
Toujours souriant, toujours attentif, il était de ceux qui vous apaisent en toutes circonstances et vous font oublier les mille
8
petits ennuis qui, tels des cailloux dans la chaussure, ne cessent de vous gâcher l’existence ; de ceux qui paraissent ne s’intéres- ser qu’à vous, ne s’attacher qu’à la façon de vous rendre insou- ciant, léger, imperméable aux aléas de la vie.
Je l’avais rencontré pour la première fois à la boulangerie du boulevard Crémieux. Je venais à peine d’emménager et je m’étais précipitée pour m’acheter une brioche au raisin, dont je raffole, afin d’apaiser une faim soudaine et impérieuse. Une faim qui ressemblait un peu à une angoisse, d’ailleurs. L’an- goisse que j’avais éprouvée en me retrouvant dans ce quartier inconnu, dans cet appartement impersonnel et nu, au milieu d’un amoncellement de meubles et de cartons qui soudain m’indifféraient, avec pour seul compagnon Voyou, mon fidèle chat roux, apparemment aussi déboussolé que moi et qui fure- tait partout en miaulant d’inquiétude.
L’odeur de pain chaud, les lumières chaleureuses et colo- rées de la boutique, le tintement régulier de la porte d’entrée avaient déjà commencé à me rasséréner et j’attendais mon tour dans la file des clients, en savourant à l’avance la première bouchée qui m’était promise.
— Excusez mon audace, Mademoiselle, mais ne serait-ce pas vous qui venez d’emménager au 3 de la rue Cambon, par hasard ?
L’homme, souriant, amène, s’était retourné et guettait ma réponse avec, dans les yeux, le reflet d’une espérance.
— Oui, c’est bien moi, Monsieur, avais-je répondu, interlo- quée. Que me vaut l’honneur ?
— Rien d’important, rassurez-vous, mais je suis votre voisin de palier. La porte juste en face. Aussi, si vous avez besoin d’une aide quelconque, n’hésitez pas. Je connais la ville par cœur et je pourrai vous indiquer tout ce qui sera de nature à faciliter votre adaptation.
9
— Merci beaucoup, Monsieur, c’est très aimable à vous.
— Alors, peut-être à bientôt ? dit-il en se dégageant rapide- ment, comme pour éviter de m’importuner plus longtemps.
Une fois servi et avant que je ne m’adresse moi-même à la boulangère, il me salua silencieusement et disparut par la porte ouverte sur la rue.
— Vous avez bien de la chance, me glissa la dame qui atten- dait son tour derrière moi. Hélio est un être exquis. Vous pou- vez avoir en lui une confiance aveugle.
Un être exquis. Je ne pensais pas, à ce moment-là, à quel point il méritait ce qualificatif. Je fus très vite amenée à le vérifier, cependant, car, après cette première rencontre, il me prit carrément sous son aile. Il m’indiqua les artisans les plus fiables, me prodigua quantité de précieux conseils et m’offrit, lorsque je le désirais, les charmes de sa conversation dans le décor paisible de son salon. Assise en face de lui, piquant de temps à autre dans l’assiette à gâteaux, avalant une gorgée de thé à la bergamote, mon arôme préféré, je m’évadais, me dis- trayais, m’instruisais alors de mille et une manières, toutes plus agréables les unes que les autres. Hélio était infatigable. Il avait la patience d’un chat. Pas une fois il ne parut las, ou inattentif. Il m’expliquait tout ce que je lui demandais. Le spectre entier de l’expérience humaine y passait. On eût dit que cet homme avait mille ans, qu’il avait tout lu, tout vu, tout entendu, et qu’il vous transmettait sa pensée avec clarté, facilité, plaisir. Jamais il n’était ennuyeux. Jamais il ne se mettait en avant. Tout se déroulait naturellement et vous étiez, en face de lui, la huitième merveille du monde, celle dont on prend le soin le plus jaloux.
— Et vous partez quand ? lui demandai-je soudain lorsque, cessant de laisser mon esprit évoquer à sa guise les temps de notre rencontre, je sortis enfin de ma rêverie.
10
— Oh, je pense que c’est une question de deux ou trois jours, me répondit-il. Je dois juste finir de choisir les affaires à em- porter, ce qui n’est pas une tâche immense, vu que, là-haut, je n’aurai à ma disposition qu’un petit studio avec un coin-cui- sine et une salle de bain. Les repas pourront être pris dans un restaurant commun, le blanchissage, le repassage et le ménage seront assurés par l’Institut, le médecin et les principaux ser- vices seront disponibles sur place... Bref, inutile de m’encom- brer. Des vêtements d’intérieur, des tenues de jardin pour les promenades dans le parc, un smoking pour les conférences, quelques livres de travail personnels qui ne se trouveraient pas à la bibliothèque... C’est l’affaire de deux valises. Trois, tout au plus.
— Ah bon ? Toute une vie dans trois valises ?
— Dans trois valises, oui, mais surtout là-dedans, répondit Hélio en se frappant le front. Et puis, vous oubliez Internet ! On trouve tout, sur Internet. Commerces, spectacles, conver- sations jusqu’au bout du monde...
— Mais, ajoutai-je pour tenter d’avoir le dernier mot, qu’al- lez-vous faire de tout ce qui restera chez vous ? Votre apparte- ment est plein du sol au plafond !
— C’est là que vous intervenez, ma petite Alice. Je vous confierai ma clef. Vous regarderez tout ça tranquillement et vous vous servirez. Lorsque vous aurez pris ce qui vous inté- resse, on fera venir les gars de Plassnett, vous savez, ceux qui débarrassent les vieilles maisons, et le tour sera joué. Une fois qu’ils auront fait le vide, un coup de propre et hop ! Je vends.
— Vous vendez !?
— Bien sûr. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse de cet appartement ?
— Euh, je ne sais pas, mais tout de même ! Toute une vie, vous dis-je !
— Quoi, toute une vie ? Je ne suis pas mort, que diable ! Et
11
je compte bien la continuer, ma vie. Plus légère, voilà tout. Ce n’est pas mieux ? Hein ? Ce n’est pas mieux ?
Paupières mi-closes, ridules à la naissance des tempes, imper- ceptible plissement du nez, bouche exagérément sérieuse, je connaissais la musique par cœur : Hélio riait intérieurement. Comme un fou. Seulement voilà, il ne voulait pas me froisser.
Le jour venu, on sonna à ma porte. C’était lui, en compagnie d’un costaud qui portait ses valises. Il me tendit son trousseau de clefs et se recula dans la pénombre du couloir. Il ne bou- geait pas. Je lui souris et il se détendit. À tel point qu’il fit une chose que, durant toutes ces années, il n’avait jamais faite : il se pencha vers moi, me prit par les épaules et me claqua une bise sur la joue gauche. Puis il éloigna son visage du mien, m’observa deux ou trois secondes et m’appliqua une deuxième bise sur l’autre joue. S’étant retourné, il leva la main droite, l’agita, et disparut au bout du palier. Voyou se frotta à mes jambes en lançant de petits miaulements suraigus. La minute- rie s’éteignit. Je fermai la porte.
Par la baie vitrée du séjour, je le vis monter dans une four- gonnette sur laquelle il était inscrit, en lettres rouges sur fond blanc : « Institut la Mirandole ».
Je ne résistai pas longtemps, bien entendu. Moins d’une heure après le départ d’Hélio, je traversai le palier et m’escri- mai sur sa serrure à l’aide du trousseau qu’il m’avait laissé. La porte était un peu gauchie, si bien qu’il me fallut quelques minutes d’acharnement pour en venir à bout.
Une fois dans l’appartement, je restai immobile dans le ves- tibule, me demandant s’il était bien convenable de me trou- ver là. Après avoir failli faire demi-tour, je pénétrai cependant dans le couloir et me dirigeai vers la salle de séjour en progres- sant lentement et silencieusement, exactement comme l’aurait fait un voleur. La pièce, qui m’était familière, se présenta à
12
moi sans surprise. Tout était en place, les rayonnages garnis de livres, le lampadaire, les deux fauteuils de cuir... Afin de légitimer ma présence, je me hâtai de m’asseoir sur celui que le propriétaire des lieux avait tant de fois désigné comme mien. Là, légèrement avachie entre ses accoudoirs moelleux, je me pris à rêvasser, tout en vérifiant, la main sous le sein gauche, le rythme auquel mon cœur battait, en espérant qu’il se calme au plus vite. Ce qu’il fit après d’interminables minutes.
Je me levai alors et entrepris un tour de l’appartement. La cuisine, silencieuse, paisible, était parfaitement rangée. J’en- trebâillai les placards, ouvris quelques tiroirs, promenai un œil attentif sur les étagères et quittai la pièce en direction de la salle de bains. Là, même atmosphère tranquille, même ordre rigoureux, même propreté. Quant à la chambre, je n’y passai que la tête : le lit paraissait y attendre son maître, les rideaux montaient la garde devant la fenêtre et les tables de nuit, vides, s’étaient endormies.
Dans le bureau, je m’attardai un peu plus : je savais que c’était la pièce qu’Hélio affectionnait le plus. Comme tous les intellectuels, il adorait son espace de travail, ses stylos, ses meubles de rangement et le tic-tac inexorable de la pendule. Là aussi, un ordre impeccable régnait. Sauf peut-être... Oui, je vis dépasser du second tiroir du caisson droit une espèce de carton d’un rouge très vif, violent, presque inquiétant. J’ou- vris : c’était une chemise mal rangée, fermée par une vieille sangle mauvâtre, qui sortait ainsi du strict domaine qui lui était alloué. Elle contenait quelques feuillets jaunis, dactylo- graphiés à l’aide d’une machine à écrire visiblement ancienne. Prise d’un début de vertige, allez savoir pourquoi, je la repous- sai machinalement vers l’intérieur du meuble que je refermai avec précipitation.
Somme toute assez satisfaite de mon inspection, je décidai
13
d’en rester là pour cette fois et regagnai promptement mon appartement où je me jetai sur mon canapé, épuisée. Cou- ché à côté de moi, Voyou daigna ouvrir vaguement un œil et se rendormit aussitôt, tout en se rapprochant subrepticement de mes cuisses. Rassurée par sa respiration régulière, apaisée par sa chaleur, je sentis peu à peu mon esprit reprendre vie et je pus alors évaluer avec calme la tâche qui m’attendait. Il me faudrait procéder avec méthode, me dis-je. Voir dans la cuisine si je trouve des objets qui me seraient utiles et qui, en même temps, entretiendraient fidèlement le souvenir d’Hélio, je veux dire d’Hélio dans son appartement : le plateau sur lequel il m’apportait le thé, la théière, les tasses... Peut-être également quelques bibelots qui étaient dans mon champ de vision, lorsque j’étais assise au salon. Quelques livres, aussi ?
En réalité, je tournais autour du pot et je le savais parfaite- ment. Ce qui m’intéressait, c’était le bureau. Oui, le bureau serait pour moi un lieu à explorer avec minutie. J’y découvri- rais certainement des documents, des archives et, pourquoi pas, des photos qui me révéleraient enfin un peu de la vie d’Hélio. Oh, il ne s’agissait pas de ma part de curiosité mal- saine, ni même de curiosité tout court, mais il se trouve que, durant toutes ces années, j’avais été passablement frustrée de devoir rester à la surface des choses, en ce qui concerne mon aimable voisin. Car, non seulement il ne se livrait jamais à moi directement, mais il ne semblait pas s’être confié davantage à qui que ce soit dans la ville. Toutes les questions que j’avais posées sur son passé, sur sa famille, sur ses proches, s’étaient très vite heurtées à d’infranchissables et invisibles barrières : nul ne paraissait savoir qui était vraiment Hélio Porpora.
Forte de ma résolution et de la méthode que je projetais, j’avalai quelques aliments sur un coin de ma table de cuisine et, après une toilette rapide, me précipitai dans mon lit où, à la douce lueur de la lampe de chevet, j’entrepris de réfléchir. Pas
14
trop longtemps, cependant, car le sommeil me prit très vite. Je fus réveillée en pleine nuit au milieu d’un rêve qui me mettait aux prises avec une langue cramoisie dépassant de la gueule béante d’un fauve, et que j’essayais vainement de faire rentrer dans la bouche d’où elle n’aurait jamais dû sortir. J’eus le temps de me rendre compte qu’il s’agissait sans aucun doute de la fameuse chemise rouge que j’avais trouvée chez Hélio et qui, décidément, me tracassait beaucoup. Mais je n’eus pas le loisir de peser le pourquoi et le comment d’une telle préoc- cupation, car, ayant enfin éteint la veilleuse, je me rendormis
jusqu’au matin.
Mon réveil fut heureux. Un rayon de soleil, qui filtrait à tra- vers les rideaux de la chambre, était venu s’allonger près de moi. Je dépliai le bras pour que ma main se retrouve dans sa chaleur et j’étirai langoureusement mes jambes sous les draps. Mais je ne restai pas couchée bien longtemps. Je ne suis pas fille à me prélasser, le matin. Sitôt éveillée, sitôt levée. Pour- tant, cette fois, j’avoue que les quelques minutes ainsi volées au toboggan de la vie, entre l’inconscience du sommeil et la prosaïque réalité des jours, m’avaient vraiment enchantée. Une allégresse particulière, peut-être ? Toujours est-il que je me retrouvai dans la salle de bain dans une disposition d’esprit inédite. Moi qui, d’habitude, branche tout de suite la radio sur le flot de nouvelles inutiles dont on nous abreuve chaque jour en nous les présentant comme primordiales, voilà que je me douchais dans le silence. Ou plutôt, accompagnée du bruit harmonieux de l’eau, des quelques rires d’enfants qui me parvenaient à travers la fenêtre et du piaillement continu des oiseaux.
Quelle étrange Alice étais-je donc, aujourd’hui ? Je me surpris à chantonner en m’essuyant. Je m’étonnai de trouver moelleux le duvet de ma serviette de bain, agréable le pschitt de mon
15
vaporisateur et surtout, surtout, je fus sidérée de me retrouver debout face à mon armoire, en pleine hésitation devant deux ou trois tenues différentes, moi qui, bien souvent, une fois habillée, ne sais même pas quel vêtement j’ai bien pu passer !
En réalité, ne soyons pas dupes. Ma soudaine joie de vivre et mon entrain inhabituel avaient une cause. Une seule. Et je la connaissais fort bien : l’impatience. J’avais hâte de tester mes rendez-vous virtuels sur l’ordinateur, de me lancer dans des escapades inédites vers l’Institut, et, par-dessus tout, de lever un coin de voile sur le passé d’Hélio...
Enfin les choses allaient bouger un peu, dans ma vie ! Cela ne valait-il pas un petit renouveau vestimentaire ?
J’optai pour une jupe légère dont le tissu dansait autour de mes jambes lorsque je me tournais, et un chemisier pour moi à la limite de l’indécent, c’est-à-dire, en réalité, très légèrement transparent. Ma chevelure, je la fis longuement gonfler pour qu’elle prenne du volume. Une vraie coquette, vous dis-je !
Du coup, avant même de déjeuner, je profitai de cet élan nouveau pour traverser le palier comme dans un rêve et je me retrouvai, comme la veille au soir, dans le bureau d’Hélio. Là, je me saisis du fameux dossier rouge et le rapportai chez moi en courant. L’ayant posé, entre bol et tartines, sur la table de la cuisine, j’eus cent fois la tentation de l’ouvrir. Mais je me contentai de lire et relire son titre laconique, étalé sur toute la largeur de la couverture : « Le journal de Zéphyr ».
Zéphyr ? Qui c’est, ce Zéphyr ? me demandai-je. C’est un ami d’Hélio ? Mon ex-voisin lui aurait piqué son journal ? Non, ça n’est pas de lui. Et si c’était un pseudonyme ? Et si, en réalité c’était tout simplement le journal d’Hélio lui-même ? Mais pourquoi l’attribuer à Zéphyr, dans ce cas ? Par goût du travestissement ?
Tout à coup, je me rendis compte que, si je n’y prenais pas
16
garde, j’étais bonne pour des heures d’interrogations stupides. C’était bien gentil, certes, mais il était déjà huit heures et de- mie passées et je devais absolument me dépêcher si je ne vou- lais pas, pour la première fois de ma vie, être en retard à mon travail. Je me levai donc d’un bond, me brossai les dents en battant le record mondial de la discipline, me parfumai (par bonheur sans me tromper de flacon), remplis à la hâte l’écuelle de Voyou qui me surveillait, à demi caché derrière le cham- branle de la porte du couloir, et sortis comme un ouragan en n’oubliant pas, pour une fois, de décrocher du tableau à clous les clefs de la voiture...
Je serais bien incapable de dire comment, ensuite, se passa ma journée, tant j’avais la tête ailleurs. J’ai certainement dû saisir un à un, dans la corbeille « arrivée », les dossiers rela- tifs aux recherches programmées pour ce jour-là. J’ai dû les poser soigneusement sur ma table de travail et les traiter avec méthode et attention à l’aide de mon ordinateur ou en allant choisir, dans les immenses rayonnages métalliques mobiles, les boites dont les titres me paraissaient les plus en rapport. Il est même vraisemblable qu’à midi quinze précise, je me sois dirigée comme chaque jour vers la cantine en compagnie de mes collègues habituels. Enfin, il est impossible que je n’aie pas passé de nouveau l’après-midi à mon poste, derrière mon écran, à ma place attitrée, à rédiger les comptes-rendus dont j’avais préparé les principaux éléments au cours de la matinée.
Je me souviens cependant que, comme d’habitude, mon es- prit a brusquement réintégré mon corps vers dix-huit heures, heure à laquelle, chaque jour, je range mes stylos dans leur trousse, j’éteins mon ordinateur, je vais me refaire une beauté dans les toilettes du rez-de-chaussée et sors tranquillement en empruntant l’allée centrale qui sépare, exactement en son mi- lieu, la pelouse toujours impeccablement tondue des Archives Départementales, pour regagner ma voiture.
17
Une fois chez moi, je me précipitai sur la chemise rouge, l’ouvris, et décidai d’en parcourir le contenu en diagonale, comme je le fais, au bureau, pour des documents dont je dois absolument prendre connaissance sans avoir le temps d’une lecture exhaustive.
Oui, il s’agissait bien d’un journal intime. À première vue, c’était l’œuvre d’un tout jeune homme. Un jeune homme qui se cherche, explore, connaît l’échec, se relève, retombe, essaie encore et encore, obstinément, crânement... jusqu’à la chute finale.
À la fin de ma lecture, j’étais décontenancée, pantoise, comme partie pour un autre monde. Mes réflexes de documentaliste me lancèrent alors mille questions. Mille questions sans au- cune réponse, bien sûr, mais avec, à chaque fois, ce petit bout de fil sur lequel on peut tirer, délicatement d’abord, puis de plus en plus vite, lorsque, dans mon métier, on est confronté au mystère... Zéphyr et Hélio sont-ils la même personne ? Si ce n’est pas le cas, pour quelle raison a-t-il ce texte en sa pos- session ? Et si c’est le cas, pourquoi avoir laissé ce document intime dans le bureau, au risque que je le découvre ? Est-ce délibéré ? Est-ce fortuit ? Beaucoup de questions incongrues, en vérité, pour un homme comme Hélio, si simple et si clair.
Ou alors, peut-être étais-je complètement à côté de la plaque : rien ni personne n’est jamais aussi simple ni aussi clair qu’on veut bien le croire.
— Alice ! s’écria Hélio en m’accueillant le lendemain sur le seuil de son studio. Quelle joie de vous revoir si vite ! Et vêtue de charmante manière, en plus. Merci. Vous allez éclairer ma soirée. Sans vous, elle n’aurait peut-être pas été très très gaie, continua-t-il en riant.
Je me gardai bien de lui dire que, moi non plus, je n’avais pas
18
été bien fiérote en enfilant les couloirs passablement lugubres de l’Institut. Le hall d’entrée lui-même, à première vue vaste et accueillant, dégageait au bout de quelques minutes un je- ne-sais-quoi de tristounet. C’est ça. Pas d’autre mot. De tris- tounet. Mais que diable était donc allé faire Hélio dans cette galère ?
Pour lui, en tout cas, tout était absolument inchangé. Il avait même anticipé ma première visite avec une rigueur impla- cable : il s’était procuré un plateau, une théière, des gâteaux, sans omettre le thé à la bergamote !
— Alors, ma petite Alice, dit-il en s’asseyant, vous avez déjà eu le temps de regarder ce qui vous intéressait, dans mon royaume ?
— Comme vous y allez, Hélio ! J’ai à peine pu faire un tour rapide. N’oubliez pas tout de même que vous n’êtes parti qu’avant-hier !
— C’est vrai, vous avez raison. Je suis trop impatient. Prenez votre temps. L’essentiel c’est que vous choisissiez vraiment ce qui vous plaît sans aucune retenue. Comme ça, il restera un peu de moi rue Cambon, n’est-ce pas ? On est toujours un peu sentimental, c’est humain.
— C’est tout naturel, Hélio. N’hésitez pas, de votre côté, à me signaler ce que vous auriez pu oublier et dont vous auriez besoin. Des objets, des livres... Des manuscrits, peut-être ?
— Des manuscrits ? Quels manuscrits ? Vous savez, j’ai accu- mulé tant de choses, chez moi, que je ne me souviens pas du dixième de ce qui s’y trouve. À quoi faites-vous allusion ?
— Euh, à rien. J’ai lancé ça comme ça. Vous êtes tellement passionné par tout ce qui est intellectuel, que j’ai imaginé... Mais je dois me tromper. Après tout, je ne sais même pas quel métier vous exerciez.
— Ah bon ? Je ne vous l’ai jamais dit ?Hélio s’abîma dans ses réflexions, la tête légèrement penchée
19
sur la gauche, un vague sourire aux lèvres. Quelques gouttes de pluie frappèrent au carreau. Des bruits de tuyauterie se firent entendre au fin fond du bâtiment. Le temps se mit à s’étirer sans retenue. Je n’osais rien dire. Je n’osais même pas bouger, tant il me semblait avoir été importune, par mes questions.
Lorsque la pendule murale sonna, l’enchantement cessa brusquement et je m’aperçus que la soirée était déjà entamée. C’était l’heure en tout cas de téléphoner à Max qui, comme chaque vendredi, devait m’attendre avec une grande impa- tience.
— Excusez-moi, Hélio, dis-je timidement en me levant, mais il se fait tard et je dois me retirer...
— Bien sûr, ma petite Alice, répondit mon hôte en s’ex- trayant de son fauteuil, nous sommes vendredi, n’est-ce pas ?
Dehors, la nuit était tombée.
En arrivant chez Max, un bon feu de cheminée m’attendait. Sur la table, dressée comme jamais, deux bougeoirs à la lu- mière vacillante faisaient miroiter l’argenterie des couverts et la porcelaine des assiettes. Des serviettes colorées, posées sur la nappe blanche, achevaient de donner à l’ensemble un air de fête inhabituel.
Je m’installai sur le canapé, juste en face des flammes et de leur chaleur dansante, et je m’étirai de toute ma longueur, tout en écoutant mon hôte, dans le lointain de la cuisine, faire tin- tinnabuler casseroles et cocottes.
— Que fête-t-on, Max, que j’aurais oublié ?
— Tu n’as rien oublié. Nous fêtons le vendredi. Ce n’est pas une occasion suffisante ?
— Ah, mais je suis d’accord. C’est une excellente occasion.
J’étais vraiment touchée par cette attention. Je suis souvent touchée par Max, d’ailleurs. Il se met toujours en quatre pour me faire plaisir. Il m’abreuve de compliments, me répète que
20
je suis belle, que je suis gentille, que je suis intelligente... Au début, je prenais ça pour les boniments habituels des hommes, leur subtil ou moins subtil passeport pour le lit, dirons-nous. Ensuite, j’ai bien dû me rendre à l’évidence : il était sincère.
Même si, hélas, il était un peu à côté de la plaque.
Car, qu’on m’estime gentille, passe encore. Je ne vois d’ail- leurs pas en vertu de quoi on pourrait me trouver méchante. Mais qu’on me considère comme jolie, là, ça me paraît vrai- ment étrange. Surtout venant de quelqu’un d’aussi bien fait de sa personne que Max et, qui plus est, de dix ans mon cadet. Il manque d’ambition, ce jeune homme, m’étais-je même dit au début, en guise d’explication. Mais, après tout, pourquoi s’en plaindre ?
Il n’y a que le qualificatif d’intelligente qui me chagrine. Car si Max le pense vraiment, ce dont je n’ai aucune raison de douter, c’est qu’il a une connaissance très limitée de l’intel- ligence. Et ça, ça me gêne et me gênera toujours. Mais com- ment lui en vouloir ? Ce serait injuste de ma part, peut-être même prétentieux et, pour le coup, particulièrement déplacé.
— Au fait, Alice, tu parles de la fête que j’ai préparée, mais on dirait que tu n’as pas oublié que nous étions vendredi, toi non plus ?
— Ah bon ? Qu’est-ce qui te fait penser ça ?— Tu as vu comment tu t’es habillée ?— Comment je...— Mignonne comme un cœur, sexy et tout et tout...
Max se tortillait devant moi comme un garnement qui vient de faire une bonne blague. Ses yeux scintillaient. Son sourire, limite béat, découvrait ses superbes dents. À mon corps défen- dant, je sentis mon visage s’empourprer. Je ne parvenais pas à soutenir son regard. Ah, il est séduisant, le bougre ! Et moi, bien sûr, je marche. S’il avait su que j’étais habillée comme ça
21
depuis la veille et que ce n’était pas spécialement en son hon- neur, il aurait été moins content, évidemment. Mais un petit quiproquo de ce genre n’était pas pour me déplaire et, à cette idée, je dus lui paraître encore plus heureuse et plus désirable. Double bénéfice.
Les samedis, par contre, sont toujours un peu les mêmes. Je me réveille dans un lit qui n’est pas le mien et dans une chambre qui ne manque jamais de me surprendre. La salle de bains, bon, oui, la salle de bains, je m’y trouve un peu sur le bord des choses, mais ça va, je fais avec. Deux jours sur sept, ce n’est pas le bagne non plus.
Vu que Max travaille à Paris, nous mettons à profit l’armis- tice du week-end pour faire les courses. Supermarché, par- king, caddie... la vie, quoi. Je saute sur l’occasion pour acheter aussi pour moi, ça m’évite d’y retourner dans la semaine. Max insiste pour tout payer. Les premiers temps, ça m’a un peu énervée, je n’ai pas l’âme d’une assistée. Mais bof, quand j’ai compris que ça flattait son ego masculin, j’ai laissé faire. En sortant, sur le chemin, je prends tout de même des gâteaux, ou des chocolats. Le superflu, il doit se dire que c’est un peu fémi- nin, alors il accepte. Il faut savoir y faire, avec les hommes.
Au retour, tandis qu’il range méticuleusement le frigo en sé- parant soigneusement ses victuailles des miennes, j’en profite pour regarder à la dérobée le programme des sports dans le magazine de télé. Ça me permet de construire mon emploi du temps pour les deux jours. Si par bonheur il y a du foot, je sais que je pourrai disposer à ma guise des heures correspondantes. À condition de faire preuve d’un minimum d’habileté, bien sûr, car Max est tellement attentionné qu’il se priverait plutôt d’une retransmission pour rester en ma compagnie et, surtout, ne pas risquer de ressembler au macho de base à qui il ne veut surtout pas être assimilé.
22
— Ça t’ennuie si je sors vers quinze heures, Max ? J’ai quelques courses à faire. Pas plus d’une heure ou deux.
— Vers quinze heures ? Euh, pas du tout.— Tu ne t’embêteras pas ?— Penses-tu ! Je trouve toujours à m’occuper, tu sais bien. Et voilà. Léger, discret, mais le tour est joué. J’aime bien m’en
aller seule à pied. Je longe la rivière. Le chemin de halage est beau en toutes saisons. Même noyé d’humidité, même lorsque les peupliers sont déplumés, il communique au promeneur une sérénité sans égale. Et ne parlons pas de son atmosphère flamboyante en automne ou de sa fraîcheur murmurante au printemps. Les premières maisons de Saint-Félix n’appa- raissent qu’après les dernières courbes. On en aperçoit d’abord les toits, fumants l’hiver, ou festonnés, l’été, des plus hautes branches qui dominent le Boulevard de Verdun. J’aime bien prendre la ville à revers. Y surgir là où personne ne m’attend. Exister soudain, sans aucune transition, sans aucune approche préalable, au milieu de la rue piétonne pavée de neuf.
Je chine quelques bricoles au hasard des magasins, histoire de donner une certaine crédibilité à mon escapade, puis je fais mon petit tour habituel au Café des Arts ; en terrasse, si le temps le permet, ou bien à l’intérieur, en cas de froid ou d’intempéries. J’aime entendre les énormes soupirs du perco- lateur, le brouhaha des voix, le raclement des chaises. Je n’ai pas besoin de boire pour me sentir un peu saoule.
Ce samedi-là je n’y suis pas restée bien longtemps. J’étais impatiente d’étrenner la liaison entre mon ordinateur et celui d’Hélio. J’ai donc fait un saut chez moi. Un match de foot, mi-temps comprise, ça dure bien deux heures, sans compter les interminables commentaires d’après-rencontre ; j’avais par conséquent largement le temps. Heureusement, car il m’a bien fallu vingt bonnes minutes pour lancer le programme de télé- conférence et obtenir un résultat.
23
— Alice ! Vous êtes chez vous ?
Apercevoir le visage d’Hélio, même virtuel, même aplati sur un écran, ça vous transporte immédiatement loin de tout. Plus rien ne pèse. Plus rien n’est urgent. Cet être est un magicien ! Dans le petit carré, en bas à droite, l’image de contrôle me permettait de savoir ce qu’il voyait de moi. Quel plaisir peut donc trouver cet homme à me fréquenter ? me demandai-je, l’espace fugitif d’une chute de moral.
— Nous allons en profiter pour prendre un thé ensemble, comme d’habitude, s’écria mon ex-voisin d’un air enjoué.
Sur ce, il se leva et revint face à son ordinateur avec une tasse, une théière et une assiette de gâteaux. Sans un mot, je quittai mon poste de travail pour en faire de même. La veille, avant de partir chez Max, j’étais allé chercher, dans sa cuisine, le service à thé d’Hélio. Je le posai fièrement devant moi tout en surveillant d’une oreille attentive les premiers frémissements de l’eau que j’avais mise à chauffer sur la plaque. Lorsqu’elle fut enfin à température, je sortis remplir la théière et rega- gnai mon poste. Ainsi, Hélio et moi, nous apprêtions-nous à renouer, comme si aucun bouleversement n’était advenu, avec nos bonnes vieilles habitudes.
— Toujours fidèle à la bergamote ? me demanda-t-il.— Bien sûr, lui répondis-je. Plus que jamais !Et, pour lui prouver mes dires, je décrochai la caméra du
socle où elle était installée, en haut de mon écran, et la pro- menai lentement sur la table, tout en contrôlant, sur l’image témoin, ce qu’il voyait.
Soudain, je me rendis compte que j’avais été loin de tout prévoir : au beau milieu de mon opération, je m’aperçus que je cadrais plein champ la couverture rouge que j’avais aban- donnée là. Légèrement décontenancée, je regardai Hélio : il était extrêmement attentif, presque tendu dans la contempla- tion de l’écran, mais il m’était impossible de savoir s’il avait
24
compris ou non ma bévue, tant cet homme avait une maîtrise de soi hors du commun. Je ne fis par conséquent aucun mou- vement brusque ou intempestif et tentai de reposer la caméra de la façon la plus naturelle possible. J’eus toutefois besoin de reprendre une longue lampée de thé, tellement ma gorge, du coup, était devenue sèche.
Hélio ne fit aucune allusion d’aucune sorte à ce qu’il n’avait pu manquer de remarquer et notre tête-à-tête continua sans problème. Le moment venu, nous prîmes donc congé avec un grand naturel. Il était temps pour moi de retourner chez Max : le match devait être en train de se terminer, car j’enten- dais, en provenance du téléviseur des voisins du dessus, des clameurs annonciatrices de son dénouement. Je pris cepen- dant quelques minutes supplémentaires pour dorloter Voyou qui s’était réfugié sur mes genoux dès que j’avais arrêté l’ordi- nateur. Un peu jaloux, peut-être ? Allez savoir. Les chats sont des êtres énigmatiques dont il serait vain de vouloir déchiffrer les pensées...
Le soir tombait déjà lorsque j’arrivai chez Max. Il avait éteint son poste et avait sorti l’apéritif. Je n’eus pas le courage de lui avouer que je venais de boire un thé à la bergamote et je dus me faire violence pour faire honneur à ce qu’il avait préparé. Même si, bien sûr, je réussis à ne pas insister sur les amuse- gueule en prétextant le souci légitimement féminin de veiller sur ma ligne...
J’eus toutes les peines du monde, bien entendu, à domi- ner mon impatience durant les longues heures du dimanche. Quand, enfin, l’heure du train du soir arriva et que, sur le quai de la gare, je fis mes touchants adieux à mon travailleur émigré préféré en partance pour la capitale, je poussai intérieurement le plus énorme soupir de soulagement que j’eusse jamais pous- sé jusque-là et cavalai de toute la vitesse dont j’étais capable
25
vers la rue Cambon. Une fois dans la place, je laissai mon manteau tomber sur le sol et me précipitai sur « Le journal de Zéphyr », bien décidée, cette fois, à en relire attentivement, un à un, chacun des 9 chapitres dont il se composait, en leur ap- pliquant toute la science dont je savais faire preuve quotidien- nement dans l’exercice de mon métier. Disons, pour être tout à fait franche, que j’avais surtout une envie folle de découvrir mon ex-voisin, du temps de sa jeunesse.
Je considérais en effet ce document comme une sorte d’ar- chive vivante et encore toute palpitante de vie, car, j’en étais alors intimement persuadée, Hélio et Zéphyr étaient une seule et même personne.
°
26
II
Le journal de Zéphyr Chapitre 1
— Tu pues l’munster, Pépère, gaffe aux hamsters !— Quoi ?— Du calme, Solis. Cette affirmation bien sentie ne s’adresse pas
à ta face d’abruti constipé, elle aspire au visage serein de la pos- térité : je viens d’écrire la première ligne de mon premier roman. Avec elle le monde étonné découvrira une aube nouvelle et les gé- nérations à venir répèteront d’âge en âge : « Tu pues l’munster... »
— Arrête tes canulars, Zéphyr. Qu’est-ce que tu racontes ?— Je t’ai récité la première phrase de ma première œuvre.— Ah oui ? Et tu as l’intention de continuer dans le même style
pendant deux-cents pages ? Charmant ouvrage ! Parce que j’ose espérer qu’après un tel début, tu ne vas pas traiter la vie de Jeanne d’Arc ou le mystère de la Vraie Croix.
— Et pourquoi pas ? Qui m’en empêcherait ? Moins il y a de liens entre deux idées, plus ce que tu écris est considéré comme génial ; ésotérique et génial.