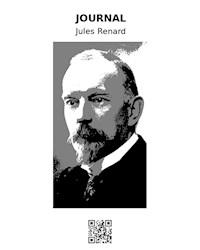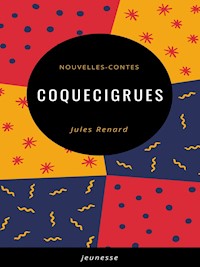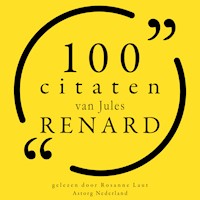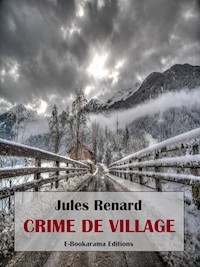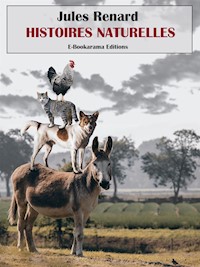Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est un homme de quarante ans, un petit raide et lourd, convenablement vêtu. On devine qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Mme Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. Rarement un jour s'achève sans que la raie, droite et pure, se défasse et que la cravate remonte. Mais M. Vernet est incapable de revenir sur sa toilette et il a l'air, pour cette raison, plus distingué le matin que le soir."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091632
©Ligaran 2015
C’est un homme de quarante ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On devine qu’il n’a pas lui-même soin de sa personne, qu’il ne s’habille pas seul. Mme Vernet le boutonne, l’épingle, le peigne. Rarement un jour s’achève sans que la raie, droite et pure, se défasse, et que la cravate remonte. Mais M. Vernet est incapable de revenir sur sa toilette et il a l’air, pour cette raison, plus distingué le matin que le soir.
Ce qu’il montre de ses yeux est d’un bleu tendre. Ses paupières pesantes jouent mal, constamment presque fermées. Il est obligé de lever la tête, de la pencher en arrière, comme les gens qui regardent par-dessous leurs lunettes, je le dis sans malice, la forme de ces yeux rappelle quelque chose de déjà vu aux yeux des porcs.
Dans l’omnibus que nous prenons le matin, à la même heure, M. Vernet se place de préférence au fond et regarde les derrières des chevaux lourdement secoués. Le pavé de Paris use les meilleures bêtes. Suivant les recommandations du préfet de police, M. Vernet ne descend pas de voiture avant qu’elle ne soit immobile. Mais une fausse honte, bien excusable chez un homme, l’empêche de demander le cordon au conducteur pour lui seul : il attend qu’une dame fasse arrêter, et profite de l’occasion. Sinon, il s’entête, dépasse le but, va jusqu’à la station prochaine et retourne sur ses pas.
Oh ! je me tiens sur mes gardes. Une récente histoire m’a rendu discret. Je viens de « quitter » certaine famille honorable que j’aimais beaucoup, un peu trop, et je frissonne au souvenir de l’outrage. Je ne me livrerai pas sans défiance. Il faut que, plus tard, si l’aventure tourne mal, je puisse dire, hautain et bref, à cet homme :
– Ne vous souvient-il pas, monsieur, que vous avez été le premier à me tendre la main ?
À ses reproches, je répondrai :
– C’est vous qui m’avez cherché !
Dès qu’on nous embrasse, il est bon de prévoir, tout de suite, l’instant où nous serons giflés.
Je l’épie et le vois venir.
Ce n’est d’abord, entre nous, qu’un échange de nos deux cartes :
M. Vernet me regarde :
– Est-ce tout ?
– Oui, dis-je, j’ai jeté négligemment ce prénom à la corne du carton, en signature. Au-dessus je puis écrire quelques lignes, c’est commode.
M. Vernet sourit et dit :
– J’aime tout ce qui est original !
Mais, par politesse ou indifférence, il ne réclame pas d’autre renseignement.
Nous nous saluons et nos chapeaux se bossellent au plafond de l’omnibus.
À chaque rencontre, comme on reprend aux dernières mailles un filet interrompu, la conversation nouvelle se raccroche aux derniers mots de la précédente. Expérimentés, nous n’allons pas vite. Une fois, M. Vernet dit son âge ; une autre fois, le chiffre de ses appointements : 15 000 fr. De plus, il est intéressé dans les affaires. Elles vont bien. Mais, ce qu’il y a de plus agréable, c’est qu’il a droit à deux mois de congé par an.
Lentement, morceau par morceau, je reconstruis sa vie.
Aujourd’hui, il m’apprend le petit nom de sa femme : Blanche. Elle a oublié de lui changer ses manchettes.
Il serait plus expansif si j’étais moins réservé. Mais je n’ai pas l’habitude de me jeter à la tête des gens. Je ne le fais que par exception.
Tantôt je reste silencieux, tantôt j’affecte de ne pas le voir, bien qu’il me fasse signe et je monte sur l’impériale ; et même il m’arrive, pour couper net une confidence, et par une galanterie tout à fait contraire à mes principes, d’offrir ma place d’intérieur à une vieille dame qui chancelle sur la plate-forme.
Si M. Vernet me demande :
– Vous avez sans doute quelque emploi ? je réponds :
– C’est peu de chose ; j’élève trois petits lapins.
M. Vernet feint de comprendre, puisqu’il aime tout ce qui est original.
– Et vos petits lapins vont bien ?
– Ils sont charmants et forment un triple étage. L’aîné a la tête de plus que le cadet, le cadet la tête de plus que le troisième. On me les prête deux heures, tous les matins.
– Je vois, vous êtes professeur libre.
– Oh ! tout à fait libre. Les pauvres petits et moi, nous sommes bien ennuyés ensemble. Mais il faut vivre, ou plutôt aider ma famille à me faire vivre. Voilà qu’ils sont à point pour entrer au lycée. Quel dommage ! J’avais comme vous deux mois de congé, et toutes mes soirées à moi, ce qui me permettait de travailler.
Je répète le mot « travailler » en exagérant la voix et le geste. L’heure est-elle venue de dire à quoi ?
Vraiment, je n’achète le journal que pour ma femme, car je n’ai pas le temps de le lire. Je jette à peine un coup d’œil sur les faits divers et la Bourse.
Et cela suffit, car, le reste, ce que nous écrivons, est-ce intéressant ?
Vous écrivez dans les journaux ?
Des fois.
Lequel ?
Oh ! n’importe lequel. Dans l’un ou dans l’autre. Un peu partout.
Je n’ai jamais vu votre nom.
Cela ne m’étonne pas. J’écris sous des pseudonymes. Je suis jeune et n’ose pas me lancer. Il y a la famille.
Mais quels pseudonymes ?
J’en invente sur-le-champ. Aux premiers, M. Vernet fait des signes d’ignorance. Il reconnaît les derniers :
– Oui, je crois avoir vu celui-là quelque part.
Le coup est porté. Je suis de ceux qui écrivent dans les journaux. M. Vernet se rapproche de moi. La serviette du professeur libre n’est plus à ses yeux banale : il y a peut-être un article dedans. La différence des âges est abolie. Nous nous estimons de pair.
Je voudrais bien lire quelque chose de vous.
Ce que j’ai fait jusqu’ici ne mérite pas d’être offert. Attendez au moins que j’aie terminé mon roman.
Comment ! vous écrivez aussi des livres ?
Des livres, c’est beaucoup dire, je barbouille du papier.
Je serais empêché de soutenir qu’un livre est bon ou mauvais. Je ne m’y connais pas et n’y entends rien. Mais j’affirme que, pour faire un roman, quel qu’il soit d’ailleurs, pour mener à bien l’histoire, pour se retrouver au milieu de tous les personnages et ne pas confondre Pierre avec Paul, il faut avoir de la tête !
Seuls dans l’omnibus, en un coin, bien au fond, tandis que le conducteur, assis à l’autre bout, vérifie ses correspondances, nous sommes graves. Il semble que nous allons, moralement, nous nouer.
Presque sous le manteau, je donne à M. Vernet ma vraie carte, une plaquette d’une centaine de vers, luxueusement éditée aux frais de cette honorable famille que « j’ai quittée ». J’en ai toujours un exemplaire sur moi. C’est un en-cas préparé pour liaison immédiate. M. Vernet l’ouvre, sans un mot. La dédicace est flatteuse, l’hommage empressé. Et puis, il possède maintenant, pour la première fois de sa vie, une chose imprimée qu’il n’a pas achetée. Il m’offre, en échange, une invitation à venir prendre le café, sans cérémonie, dimanche prochain, vers une heure. Mme Vernet y compte fort. On m’attendra.
Notre poignée de main est interminable, se resserre le long des banquettes, tient encore sur la plate-forme, sur le marche-pied, entre les rails.
Je m’attends à du nouveau. Je tombe dans un ménage bourgeois, c’est-à-dire au milieu de gens qui n’ont pas mes idées.
Le bourgeois est celui qui n’a pas mes idées.
J’ai préparé en sot ma première visite aux Vernet. J’allais chez eux avec la certitude d’impressionner et la crainte de n’être pas compris. Je me promettais de faire de l’effet, repassant mes citations, cherchant des noms d’auteurs peu connus et dont la seule étrangeté me ferait honneur. N’avais-je pas aussi, dans la série de mes gestes, quelque écart de bras, un ploiement de genou, un coup de nuque en arrière, qui seraient comme des projetions lumineuses à mes phrases d’élite ?
Ai-je fait mes frais ?
Je ne me rappelle pas avoir été au-dessus de moi-même.
Nous avons pris du café. J’ai déclaré qu’il était bon, mais un peu chaud. M. Vernet m’a parlé de sa cave. J’ai trouvé cela naturel, puisqu’il avait du vin dedans. Inhabile à distinguer la fine champagne de l’eau-de-vie de marc, j’ai cependant affirmé que la liqueur de mon petit verre bleu devait être très vieille, selon moi, du moins.
Au premier engagement entre Mme Vernet et moi, M. Vernet se tut.
– Et vous, madame, à quoi donc passez-vous vos loisirs ?
Je disais « donque », et, en général, j’exagérais les liaisons, le soin avec lequel nous lions nos mots étant le signe certain qu’on nous en impose.
– Je lis un peu, dit-elle.
Aussitôt je prononçai les noms de Baudelaire et de Verlaine. Elle m’avoua qu’elle ne les connaissait pas et, loin de me redresser avec la mine sévère et condoléante du monsieur qui découvre une ignorance, j’eus la lâcheté de dire :
– Tant mieux pour vous !
J’eus la lâcheté de le répéter et de commencer l’éloge de la femme qui ne sait rien.
Mais Mme Vernet :
– Une femme doit avoir au moins quelques notions d’histoire et de géographie.
– Sans doute, dis-je, et d’arithmétique.
– Et de musique, dit-elle.
– Soit, je vous accorde le piano, mais avec un seul doigt.
Bientôt je lui fis toutes les concessions. Elle parlait assez correctement. Elle disait « mélieur » au lieu de meilleur. Elle aimait la peinture-poésie et la poésie-peinture. Elle désirait élever son âme de temps en temps, comme on fait des haltères, par récréation et par hygiène. Aux beaux endroits d’un livre, elle ne s’en cachait pas, ses yeux se mouillaient de larmes. Cependant elle avait vidé bien des coupes, et la façon dont elle parla de l’amertume des choses me fit comparer sa vie à quelque tonneau qui a trop roulé et où la lie se dépose, et cinq minutes après avoir vanté la femme qui ne sait rien, je glorifiais bassement la femme qui sait tout.
Ils n’ont pas d’enfants et s’ennuient. J’arrive au bon moment. Ils gardent à l’endroit du poète des préjugés rectifiés, c’est-à-dire que, ne voyant plus en lui un illuminé, un fou maigre, affamé et grugeur, légendaire et redoutable, ils le traitent pourtant d’être original et exceptionnel.
S’il travaille, ils se signeraient et disent :
– Il travaille !
S’il ne pense à rien, ils disent :
– Laissons-le rêver !
Ou, le doigt tendu vers son front :
– Que peut-il se passer dans cette tête-là ?
Je porte la main à mes cheveux courts, comme pour remettre d’aplomb une auréole.
Mme Vernet coud des boutons aux caleçons de M. Vernet :
– Vous êtes heureux, me dit-elle, de pouvoir consacrer votre vie à l’art !
Elle entend par ces mots que je voue ma vie à l’art, que je la lui dédie et sacrifie. Elle me croit un peu prêtre et me complimente sur ma vocation.
Faut-il lui dire que je n’en ai pas, que je compose des vers aux heures perdues, parce que mon papa me sert provisoirement une petite rente, et que j’entretiens habilement ses illusions ? Il veut taire de moi quelqu’un et se saigne jusqu’à ce qu’il découvre en son fils un paresseux vulgaire et rebouche ses quatre veines une fois pour toutes.
– D’ailleurs, dit M. Vernet, qui suit sa propre pensée et côtoie la mienne, le devoir d’un père n’est-il pas de s’ôter le pain de la bouche pour ses enfants ?
C’est juste, mais répugnant, et si, le mien s’ôtait le pain de la bouche afin de me l’offrir, je le prierais poliment de l’y remettre.
M. Vernet fume une cigarette, las d’avoir travaillé une journée de dix heures à l’usine qu’il dirige. Ses paupières battent comme des volets mal accrochés. Parfois elles se ferment. L’effort qu’il fait pour les relever les plisse à peine. Elles ressemblent à des coquilles de noix. Sa cigarette s’éteint à chaque instant. Il la rallume. Elle se meurt. C’est une lutte.
Il a l’air de manger des allumettes.
MADAME VERNET
Ce n’est pas poétique, de coudre des boutons !
C’est cependant nécessaire pour que les caleçons tiennent. Va-t-elle resservir ses subtilités de l’autre jour ? Elle fait, dans le tas des choses qu’elle accomplit, pense ou exprime, le triage de celles qui sont poétiques et de celles qui ne le sont pas. Manger des huîtres est poétique, mais manger de la soupe ne l’est plus. Dire « Monsieur Vernet » est distingué, et dire « Mon mari », commun. Elle pique, avec l’adresse d’un chiffonnier, le mot « chaise » et le jette là, « côté prose », puis le mot « siège », qu’elle dépose ici, « côté vers ».
Soudain, M. Vernet, du fond de sa somnolence, pareil à un oracle que le suc des lauriers et des vapeurs méphitiques ont engourdi, m’annonce :
– Vous arriverez !
Je l’espère et me laisse aller, et je conte mes rêves, en un bon fauteuil dont je frise les glands entre mes doigts. J’ai bien dîné, et j’éprouve le besoin d’intéresser quelqu’un à mon avenir. Mes jambes s’allongent, prennent possession du parquet, et mes pieds remuent comme la queue d’un chien qu’on flatte.
Je ne fume pas. On me dit que je n’ai point de défauts, et on pense que, si je crains le tabac et l’alcool, c’est non par délicatesse de femmelette, mais par prudence de grand homme qui se ménage. Je lève mes mains blanches pour que le sang n’ait pas la force d’y monter. On me demande des vers.
– Mes vers n’ont que le mérite de s’en aller tout de suite loin de ma mémoire. Ne vaut-il pas mieux causer doucement de choses diverses, en amis vieux déjà qui se pénètrent sans effort ?
Enfin j’ai un idéal : la pâleur de mon teint et ma tristesse en répondent.
Ne pouvant fumer sa cigarette, M. Vernet se décide à la sucer.
– Cher ! cher ! lui dit Mme Vernet.
Il continue. Ses dents mâchent les brins de tabac. Quelques-uns s’échappent, tombent, s’accrochent comme des insectes à son gilet. On ne sait plus s’ils viennent de sa bouche ou de son nez.
– Voyons, monsieur Henri, dites-nous quelque chose !
– Non, pas ce soir. Une autre fois, quand je serai plus en train !
Voilà les boutons du caleçon au complet. Mme Vernet l’agite. Le derrière se gonfle comme s’il y avait quelqu’un. Étourdi par la chaleur et le peu que j’ai bu, je me le figure empli pour de bon. J’y viens d’entrer moi-même. Il est trop large, et Mme Vernet, à genoux, sa tête à hauteur de mes hanches, serre les pattes. Je n’éprouve que l’ennui d’être tripoté, de tourner à droite, à gauche, les mains en l’air, ou croisées sur mon ventre. Vainement je dis :
– C’est bon !
et veux m’en aller à mes affaires. Mme Vernet s’obstine, rentre le caleçon dans les chaussettes, s’écarte un peu pour voir, sans trouble, assise sur ses talons, et pique une épingle à son corsage.
– Je vous demande encore pardon d’avoir terminé ce petit travail devant vous, mais M. Vernet n’a plus rien à se mettre.
Je regarde cet homme, pris de pitié, prêt à lui offrir mon linge. Un grotesque a pris ma place, parle en mon nom, caricaturise mes gestes, digère et s’empâte.
Ils disent l’un :
– Ma femme m’adore !
Et l’autre :
– M. Vernet est le plus honnête des hommes.
Ils n’avoueraient pas que, séparés, ils sont heureux. Pourtant le mari ne vit que dans son usine. L’invention du téléphone lui a paru un évènement extraordinaire. D’abord, il redoutait de s’aboucher avec l’appareil, disant au premier employé venu :
– Téléphonez donc pour moi, je n’ai pas le temps.
Et, tandis que l’employé parlait au loin, M. Vernet fiévreux tournait autour de la cage, ainsi qu’un dompteur déjà mordu. Enfin il s’est risqué, et maintenant voilà qu’il regarde l’appareil comme un confident. Ils sont toujours ensemble. M. Vernet lui parle pour parler et, le soir, l’écho des conversations qu’ils ont eues se répercute à table.
– Imagine-toi, Blanche, que j’ouvre la cage. J’entre, jeudis « Allô » – rien. – « Allô, allô » – rien. – Croirais-tu qu’elle m’a fait attendre la communication vingt-cinq minutes, montre en main !
Elle, l’Ennemie !
Mme Vernet, les coudes sur la table, le nez dans sa tasse de thé, un petit doigt en accent aigu, répond :
– Mâtin !
Elle a couru par les grands magasins toute la soirée et dit à chaque vendeur :
– Oui, je prendrais cela, mais ce n’est pas pour moi, c’est pour une amie qui habite la province !
Parfois elle achète pour rendre, et peut-être parce que ce va-et-vient de paquets fait bien aux yeux de sa concierge. Mais ce qu’elle garde est d’occasion. Le bon marché seul la tente.
– Je puis vous affirmer qu’elle a été rudement bien, me dit à part M. Vernet.
Il s’encourage à l’aimer, fier qu’elle me plaise, et, quand je fais à Mme Vernet l’offre d’une fadeur saupoudrée comme une gaufre, il sourit :
– Ah ! ce monsieur Henri !
Il me croit connaisseur. Mes admirations pour la femme sont un hommage au goût du mari. Si nous étions seuls, je lui taperais sur l’estomac et il me confierait des secrets.
Et Mme Vernet s’excite de son côté.
Elle lui porte une solide et sincère affection. Dans ses moments de « papillons noirs, qui n’en a pas ? » elle s’appuie sur la force et se repose dans le calme de ce brave homme.
Leurs cœurs allaient s’éteindre, ne plus former que des boules de cendres froides. Je suis venu, j’ai soufflé, et voilà qu’à la grande surprise de tous des étincelles s’élancent.
Je me ranime à mon tour.
J’ai été jusqu’à présent un petit monsieur désœuvré, qui se méprisait à outrance, et maintenant je sers à quelque chose : je renoue l’une à l’autre ces deux âmes près de céder comme des cordes usées.
À chacune de mes visites je constate un nouveau progrès. C’est un rapprochement de leurs couverts, une façon délicate de s’offrir du pain, du poivre, hors de propos, un interminable débat anodin pour savoir qui se fatiguera à fatiguer la salade.
M. Vernet vient embrasser sa femme avant même de déposer au vestiaire sa canne et son chapeau.
Si je lui dis :
– Vous avez l’air fatigué !
il me répond :
– C’est que j’ai mal dormi cette nuit.
Il voudrait en conter plus long, et, comme une pomme véreuse tend à tomber de sa branche, une grosse plaisanterie grasse lui pend aux lèvres.
Sa femme l’arrête par un tendre :
– Voyons, chéri !
Elle a posé nonchalamment la main sur le bord de la table, et la tête inclinée, les yeux brillants et clignotants, elle murmure :
– Oh ! vilain !
C’est moi qui rougis. Toutes mes félicitations à moi-même. Je travaille bien.
Et pourquoi ne s’aimeraient-ils pas ? Vais-je m’imaginer que Mme Vernet, en apparence très loin de son ménage, y fait une fausse rentrée par coquetterie ? Il faut que je perde l’habitude de dire, enveloppant, comme une chose à cacher, ma sottise d’une expression dédaigneuse :
– Je connais la femme : c’est un logogriphe, un écheveau !
Mais non : Mme Vernet est une femme simple, qui aime son mari, simplement, à la papa.
M. Vernet a d’énormes biceps, roulants et presque grondants, dès qu’il raidit et reploie son bras comme un animal ennuyé ouvre et referme sa mâchoire.
Il peut, entre ces tenailles de chair, écraser une noix, faire péter une balle élastique, et m’y briserait, si j’avais la maladresse de me laisser pincer.
Il tord une fourchette en tire-bouchon, abat son poing, d’un vigoureux coup, sur l’angle d’une pierre de taille, sans se faire mal. Par envie et par impuissance, je prétends qu’il me trompe avec des trucs.
Pour l’intelligence, M. Vernet en vaut un autre. Il est parti de rien. Il a fait sa situation seul. À quinze ans il gagnait sa vie.
– Et même, dit-il, âgé de dix-huit mois à peine, je venais en aide à ma famille : je remportais un prix de cinq cents francs et une médaille d’argent dans un concours de bébés.
Il sait qu’on peut se vanter, sans ridicule, d’être travailleur. Afin qu’on ne l’accuse pas d’immodestie, il prend les devants. Parle-t-on d’un imbécile, il dit :
– Le pauvre me ressemble ; il est comme moi, sans malice !
On l’entend déclarer :
– Je ne suis qu’une bête, mais j’ai fait ce que j’ai pu, et, quand on fait ce qu’on peut…
Mme Vernet proteste :
– Mon ami, tu as tes mérites. Combien d’autres, à ta place, seraient restés en chemin !
Flattée d’être considérée par son mari comme une femme supérieure, elle ajoute :
– Tu es si bon !
Ah ! la bonté ! la bonne bonté, que c’est bon ! Mme Vernet s’échauffe, fait des gestes comme si, d’un ébauchoir, elle sculptait la statue même de la Bonté, puissante et lourde, écrasant pêle-mêle, sous son séant, le reste des qualités inutiles, la pouillerie des autres petites vertus.
Je m’abandonne aussi, je jette le paradoxe aux orties, et je prie l’excellente femme de vouloir bien accepter mon humble concours et la petite boule de terre glaise que je colle à la statue, en plein milieu de la figure, pour lui faire le nez.
Ainsi, très fort, très bon, et peut-être plus spirituel qu’il ne le croit, tel apparaît M. Vernet.
Toutefois, ce qu’il a contre lui et pour moi, c’est un commencement d’eczéma. Son sang malade, avec une persévérance de taupe, creuse de petits canaux à fleur de peau et, çà et là, pousse dehors ses vésicules rouges, agaçantes et brûlantes.
Le calme appartement des Vernet m’attire. La régularité de leur vie m’engrène, et je ne tente rien pour me ressaisir. Je ne sais pas ce que je vais faire chez eux, et j’y vais presque tous les soirs. Je monte les escaliers lentement, et, quand je pèse sur le bouton du timbre, quelque chose de joyeux répond en moi. On m’attend. Mon couvert est toujours mis, c’est-à-dire qu’on se dépêche de le mettre dès que je sonne. J’ôte mon par-dessus avant de dire bonjour, et je m’arrête un instant afin de m’emplir le nez des odeurs qui viennent de la cuisine, je gagne aussi peu vite que possible la salle à manger. Je me mouche, cherche dans mes poches, feins de m’accrocher au porte-manteau, donne un coup de gant sur la poussière de mes bottines : je laisse à Mme Vernet le temps de faire des signes à sa bonne et de lui dire bas :
– Vite, un gâteau de deux francs, aux amandes !
À la vérité, j’arrive en intrus ; mais, comme on ne me le fait pas sentir et qu’un dîner est toujours bon, je salue d’un air dégagé, et j’essaie de varier mes formules de politesse préparées dans la journée.