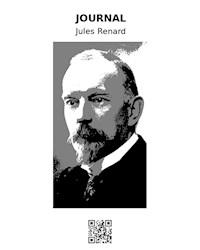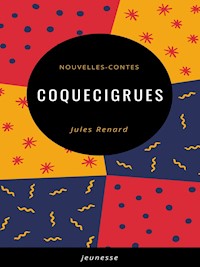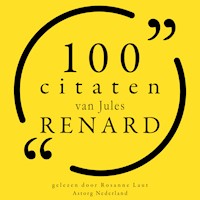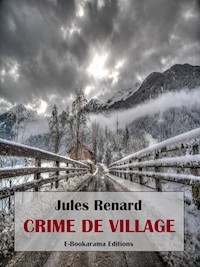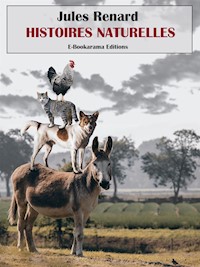Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Comédie parue en plusieurs épisodes dans le Rire, du 16 novembre 1895 au 4 janvier 1896...suivi de Contes pour laisser rêveur.
Das E-Book La Maîtresse wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, Jules Renard, Théâtre, comédie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Maîtresse
La Maîtresse-La MaîtressePour parlerI. RéticencesII. Le nez du gouvernementIII. Phénomènes connusLa veilleI. Le cocherII. Le cocher, le mêmeIII. Échange de petits nomsIV. Avant tout, la paixV. Le passéVI. D’où vient l’argent ?VII. La question des enfantsVIII. ScrupulesIX. L’alerteLe contactI. InventaireII. La patronneIII. La toiletteIV. L’ami OsoirCris dans la nuitLa mise au point de leur amourLes manœuvres du gouvernement dévoiléesL’inévitable lettreDénouement possibleContes pour laisser rêveurL’invité SyllaAller et retourPremières amiesLa filleBlandine et PointuPage de copyrightLa Maîtresse
Jules Renard
-La Maîtresse
Pour parler
I. Réticences
MAURICE : Comme je vous embrasserai !
BLANCHE : Mon pauvre ami, ce qui nous arrive me désole, et je jure que je ne m’y attendais pas. Je ne voyais en vous qu’un garçon bien élevé, bon danseur, causeur agréable, mais sceptique. Je me disais : « Il n’aimera jamais personne. »
Sans penser à mal, je vous demandais de me reconduire et voici que, tout à coup, vous m’aimez, vous souffrez et vous me faites souffrir. Oh ! je m’en veux. J’ai été imprudente. Comment sortir de là ?
MAURICE : Nous sommes à peine entrés. Pourquoi vous débattre ? C’est si simple que vous m’aimiez et que je vous aime.
BLANCHE : D’abord je n’ai pas dit que je vous aimais. Non, je ne l’ai pas dit. J’ai seulement dit que vous me plaisiez autant qu’un autre.
MAURICE : Vous vous reprenez vainement, trop tard. Moi je répète que je vous aime et vous aimerai autant que possible, tout mon saoul, et je vous défierai de rester froide. Comme vous devez être bonne à embrasser !
BLANCHE : Vous arrangez les choses tout seul. Mais rien n’est convenu. Si, pour ne point vous peiner, j’ai dit un mot de trop, je le regrette et vous fais mes excuses.
MAURICE : Je n’en veux pas. Je garde le mot de trop. Ne vous défendez donc plus. Ça froisse et on perd du temps.
BLANCHE : Je lutte encore. J’ai mes raisons. Vous êtes tellement jeune ! plus jeune que moi. Quel âge avez-vous, au juste ?
MAURICE : Un homme est toujours plus vieux qu’une femme.
BLANCHE : Vous m’aimez maintenant. Je le crois. J’admets que je vous aime. Ce sera sans doute un caprice pour vous, et pour moi toute une affaire grave. Combien de temps ça durera-t-il ?
MAURICE : Vous désirez le savoir exactement, à une heure près ?
BLANCHE : Plaisantez. Je ne ris pas. Il s’agit peut-être de ma dernière passion. J’ai le droit de réfléchir.
MAURICE : On dirait que vous parlez d’un embarquement. Chère belle femme, je vous aimerai dix ans ou dix jours, sans tenir compte des promesses. Certes, j’ai l’intention de vous aimer toute votre vie. Mais ça dépend beaucoup de vous. Rendez-moi heureux, au plus vite, tout de suite, et si vous me rendez bien, bien heureux, je me laisserai retenir, et je prolongerai volontiers mon bonheur jusqu’à la mort.
BLANCHE : Quel malheur ! Vous m’effrayez et vous m’attirez. J’en pleurerais. Qu’avais-je besoin de vous connaître ? J’étais tranquille. Me voilà brisée.
MAURICE : Voulez-vous vous asseoir un peu ?
BLANCHE : Croyez-vous qu’on puisse s’asseoir sans danger, sur un banc, à une heure du matin ?
MAURICE : Nous ne ferons pas de bruit.
II. Le nez du gouvernement
Blanche s’assied, inquiète, et regarde autour d’elle. Personne. À peine assis, ils se sentent gênés. Maurice n’ose pas « toucher » déjà, en le faisant exprès. Les branches minces remuent dans l’air doux. On distingue là-bas des monuments de Paris.
BLANCHE : Oh ! ces deux ombres ! Allons-nous-en. Si elles nous attaquaient.
MAURICE : Ce sont deux sergents de ville.
BLANCHE : Pourquoi s’approchent-ils ?
MAURICE : Pour voir si nous nous endormons sur le banc.
BLANCHE : On n’a donc pas le droit de dormir sur un banc ?
MAURICE : Non, ça fait du tort aux hôtels meublés et ça encourage l’assassinat.
BLANCHE : Marchons. Les deux ombres nous suivent-elles ? J’ai peur du gouvernement.
MAURICE : Quelle idée ! Vous connaissez le gouvernement ?
BLANCHE : Qui sait ? J’ai, comme tout le monde, des ennemis. L’un d’eux peut être intime avec le préfet de police et me faire espionner.
MAURICE : Vous dites cela sans rire. Vous n’êtes donc pas libre ?
BLANCHE : Si, de cœur, mais ne m’aliénez point le gouvernement.
MAURICE : Entendu. Je comprends toutes les faiblesses. Où faut-il que je vous ramène ?
BLANCHE : À ma porte, s’il vous plaît.
MAURICE : Encore un bout de promenade ?
Blanche veut bien ; et ils tournent une fois de plus autour de la maison où elle habite. La régularité de leur marche permet à Maurice de « toucher » maintenant, sans qu’il y ait effronterie de sa part. Ils vont au pas, la jambe droite de Blanche collée à la jambe gauche de Maurice, au point qu’un instant elles font frein, et qu’ils s’arrêtent, souriants, les yeux dans les yeux, serrés, en effervescence, tout raides.
III. Phénomènes connus
MAURICE : Dites-moi que vous m’aimez.
BLANCHE : Oui, là, êtes-vous content ?
MAURICE : Absolument, oh ! absolument !
Maurice accablé, soudain pressé d’être seul avec sa joie, conduit Blanche en hâte vers la porte et tire violemment la sonnette.
MAURICE : Quand vous reverrai-je ?
BLANCHE : Je suis une femme franche, incapable de vous tourmenter par coquetterie. Ces promenades de nuit m’énervent et vous fatiguent. Accordez-m’en une dernière demain soir et nous les supprimerons.
MAURICE : Vous tenez beaucoup à la dernière ?
BLANCHE : Beaucoup. J’ai plusieurs questions à vous poser et quelques petites confidences à vous faire.
MAURICE : Si elles doivent m’attrister, j’aimerais autant ne rien savoir. Vous seriez vilaine de me chagriner pour votre plaisir. Les ennuis m’assomment. Épargnez-moi le plus de peine possible.
BLANCHE : Rassurez-vous. Je ne désire qu’une seule causerie amicale où s’allégeront votre cœur et le mien.
MAURICE : Ainsi on se promènera encore demain soir. Et après ?
BLANCHE : Après ! vous êtes homme, mon ami ; remplissez le rôle d’un homme. Je m’en rapporte à votre galanterie. Achevez discrètement les préparatifs suprêmes.
À ces mots la porte s’ouvre, puis se ferme et Maurice reste dans la rue. Quand son amie est là, il l’aime sans pouvoir préciser de quelle sorte d’amour. Il la voit de trop près, et se cogne, aveuglé, contre elle.
Mais quand elle n’est pas là, il sait comment il l’aime.
Il meut, à sa volonté, l’image nette et pleine de Blanche qui, docile, recule, avance, et tourne, et luit d’un tel éclat que murs et trottoirs s’en illuminent.
Tandis qu’il s’éloigne, Blanche, qui glisse à son côté, embellit, devient meilleure et plus tendre. Ses yeux ne regardent que lui. Elle lui parle sans cesse, avec des mots également sonores, dont aucun ne choque, et ses lèvres ne font que sourire.
Pourtant, malgré le plaisir de goûter seul son sentiment, d’en jouir avec égoïsme, Maurice préférerait que son amie fût toujours là, à cause des légers profits.
La veille
I. Le cocher
Blanche et Maurice ont pris une voiture pour aller au bois. Le cocher suit ses rues à lui. Fréquemment il descend de son siège, entre chez un marchand de vin et boit quelque chose sur le comptoir, sans se presser. Pleins d’indulgence, les amoureux l’attendent et Blanche lui trouve une bonne tête. Qu’il ait sa joie ! Ils en ont tant !
Brusquement le cocher sangle de coups de fouet son cheval qui part, tête baissée, comme si la voiture courait à la bataille, culbuter des voitures ennemies.
MAURICE : Allez, cocher, renversez, tuez des gens. Mon amie ne crie point. Elle m’a saisi la main, et si nous nous appuyons du dos au fiacre pour le retenir, c’est machinalement, sans épouvante, car, à cette heure de notre vie, un accident ne peut pas, n’a pas le droit d’arriver.
Le fiacre franchit des obstacles, disperse des piétons aux épaules rondes, et les lumières, lancées comme des boules de feu, éclatent sur ses vitres et s’éteignent.
MAURICE : Qu’est-ce que cela nous fait ? nous en verrions d’autres.
Mais tout s’arrête. Le cocher ouvre la portière et dit : « Descendez. »
MAURICE : Vous voulez que nous descendions ?
LE COCHER : Oui, j’en ai assez, moi ; je ne bouge plus.
MAURICE : À la bonne heure ! vous parlez clair. Mais où sommes-nous ?
LE COCHER : Dans du bois.
MAURICE : Dans le bois de Boulogne, sans doute ?
LE COCHER : Ça se peut. Je m’en fiche. Videz les lieux.
BLANCHE : Ne le contrariez pas.
MAURICE : Je m’en garderais.
Il me plaît, ce cocher carré. Homme d’action, veuillez accepter le prix mérité de votre course, avec ce modeste pourboire. Je vous gâte selon mes moyens. Éloignez-vous en paix et au plaisir de recourir ensemble.
BLANCHE : Avez-vous retenu son numéro ?
MAURICE : À quoi me servirait-il ? Me croyez-vous offensé ? Près de vous, je supporterais toute injure et demain j’aurai oublié. On respire.
BLANCHE : Oui, il fait léger. Mais où sommes-nous donc ? Je ne me reconnais pas. On n’aperçoit que de rares lanternes.
MAURICE : Elles me semblent trop nombreuses. Je voudrais autour de vous une nuit sans étoiles où je ne verrais pas plus loin que votre profil.
BLANCHE : Je frissonne !
MAURICE : Ah ! vous hésiteriez encore à me suivre au bout du monde. Mais Paris est là, derrière, distant d’une enjambée. Notre cocher délicat nous a posés dans un endroit choisi. Les cochers parisiens savent quel décor plaît aux amants.
II. Le cocher, le même
BLANCHE : Qu’est-ce qu’on entend ? Entendez-vous ? On dirait un bœuf échappé ?
En effet, un galop lourd frappe la terre. Leur cocher surgit devant eux et droit sur ses sabots, vilain à voir, il brandit son fouet et hurle : « Il me faut encore vingt sous. »
MAURICE : Il vous les faut absolument ? Pourquoi ?
LE COCHER : Fortifications.
MAURICE : C’est une raison. Je m’incline.
LE COCHER : Point de raisons. Dépêchons.
MAURICE : Et si je ne donne rien ?
LE COCHER : Je tape.
MAURICE : Parfait. Les voilà, mon brave. Je n’ai rien à vous refuser. Vous ne m’ennuyez pas comme vous l’espérez. Je jure qu’aujourd’hui personne ne se vantera de me démonter.
BLANCHE : Il s’éloigne en ricanant. Vrai ! quelle succession d’incidents ridicules. J’ai le cœur à l’envers. Dieu, que cet homme est bête !
MAURICE : Pas si bête. Plutôt sûr de ses droits et un peu vif. Je lui pardonne. Je pardonnerais au criminel rouge de mon sang. Une bonté intarissable ne vous gonfle-t-elle pas comme moi ?
BLANCHE : Ma foi non. Ma promenade est gâtée.