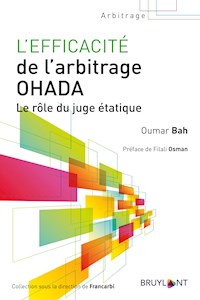
129,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Arbitrage
- Sprache: Französisch
Considéré comme une révolution juridique en Afrique francophone, l’espace de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est depuis sa création, un terrain propice à la collaboration entre le juge étatique et l’arbitre. Cependant, si dans l’arbitrage spécifique de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le service après-vente durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge national dans l’arbitrage de droit commun est une opération complexe. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge étatique, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Selon que l’on se trouve dans la phase préparatoire à l’arbitrage ou durant la phase arbitrale et post-arbitrale, le juge national n’est pas toujours le même. Suivant l’organisation judiciaire propre à chacun des États parties, il pourra s’agir des juridictions d’instances dans le cadre d’une compétence exclusive ou des juridictions d’appels dans le cadre d’une compétence partagée avec les juridictions d’instances avant tout pourvoi en cassation devant la CCJA. Cela dit, qu’il s’agisse de l’arbitrage spécifique de la CCJA ou de l’arbitrage de droit commun, le juge étatique joue d’abord un rôle d’assistance en cas de difficultés. Pour ce faire, il aide les parties et les arbitres lors de la constitution du tribunal arbitral, l’administration des pièces et la prorogation du délai de l’arbitrage. De même, si les parties en expriment le besoin, le juge étatique en cas d’urgence reconnue et motivée ordonne des mesures provisoires ou conservatoires. Enfin, lorsque l’arbitre prononce la sentence, il reviendra encore au juge étatique le soin de veiller à son exequatur effectif après l’épuisement des voies de recours devant son office.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cet ouvrage bénéficie du soutien financier de L’École Doctorale DGEP (Droit, Gestion, Économie et Politique) et du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC EA 3225).
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour Larcier.
Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.
Le «photoco-pillage» menace l’avenir du livre.
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larcier.com.
© Lefebvre Sarrut Belgium s.a., 2020
Éditions Bruylant
Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
978-2-8027-6656-8
La collection Arbitrage traite de l’arbitrage au sens large comme mode alternatif de résolution des conflits, mode de nature hybride, à la fois juridictionnel et conventionnel, qui s’est progressivement imposé comme une voie usuelle de règlement des litiges dans le droit du commerce international mais également en matière interne dans les domaines commerciaux et professionnels.
Parus précédemment dans la même collection :
1. Répertoire pratique de l’arbitrage commercial international, 2011.
2. L’éthique dans l’arbitrage, 2012.
3. La compétence en arbitrage international relatif aux investissements, Dieudonné Édouard Onguene Onana, 2012.
4. Les principes fondamentaux de l’arbitrage, Laure Bernheim Van De Casteele, 2012.
5. L’arbitre international et l’urgence, Stefano Azzali, Sébastien Besson, Andrea Carlevaris, Cécile Chainais, Charles Jarrosson, Guy Keutgen, Didier Matray, Dr. Andreas Reiner, Pierre Tercier, Françoise Vidts, 2014.
6. Procédures parallèles et décisions contradictoires, Basile Darmois et Éloïse Gluksmann (coord.), 2015.
7. L’arbitrage institutionnel en France, Bertrand Moreau (dir.), 2016.
8. Le principe du contradictoire en arbitrage, Sylvain Bollée, Hakim Boularbah, Nadia Darwazeh, Elliott Geisinger, Laurent Jaeger, Charles Jarrosson, Detlev Kühner, Didier Matray, Gautier Matray, Justine Touzet, 2016.
9. Le devoir de l’arbitre de se conformer à sa mission, Paul Giraud, 2017.
10. L’autorité de la chose jugée devant l’arbitre du commerce international, Basile Zajdela, 2018.
11. Les modes de règlement des différends dans les contrats internationaux de construction, Gustavo Scheffer da Silveira, 2019.
12. Arbitrage international et intérêts publics, Hakim Boularbah, Andrea Carlevaris, Teresa Giovannini, Laurent Jaeger, Charles Jarrosson, Ismail Selim, 2019.
13. Arbitrage international. Droit et pratique (2 volumes), Mauro Rubino-Sammartano, 2019.
Le présent ouvrage est issu de la thèse pour le doctorat en droit privé et sciences criminelles intituléeL’efficacité de l’arbitrage OHADA : le rôle du juge étatiqueprésentée et soutenue publiquement le 11 janvier 2019 par Oumar Bah
Université de Bourgogne Franche-ComtéÉcole doctorale droit, gestion, sciences économiques et politiques
Directeur de recherches
Monsieur Filali Osman
Professeur à l’Université de Franche-Comté
Membres du Jury
Monsieur Éric Loquin
Professeur émérite à l’Université de Bourgogne
Monsieur Denis Mouralis
Professeur agrégé à l’Université d’Aix-Marseille
Monsieur Gérard Anou
Professeur agrégé à l’Université de Perpignan
Monsieur Cyril Nourissat
Professeur agrégé à l’Université Jean Moulin, Lyon III
À toi la reine du royaume de mes espérances et à toutes celles qui nourrissent, soignent et éduquent les peuples.
Remerciements
Ma reconnaissance et mes sincères remerciements s’adressent à Monsieur le Professeur Osman Filali qui a accepté de diriger cette présente étude. Tout au long de ces années de dur labeur, il a été un guide éclairé et particulièrement exigeant.
Je remercie également mes parents et mon épouse. Sans vous ces années m’auraient paru bien plus longues et difficiles. Vos petites attentions, votre écoute, votre humour à toute épreuve ont été les ingrédients indispensables à l’aboutissement de ce travail.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à leur manière à la réalisation de ce travail, en prêtant de leur temps, de leur savoir-faire, ou simplement de leur savoir-être.
Principales abréviations
AFDI
Annuaire français de droit international.
AJ
Actualités juridiques.
AUA
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
AUDCG
Acte uniforme portant droit commercial général.
BEPP
Bulletin ERSUMA de pratique professionnelle.
Bull. ASA
Bulletin de l’Association suisse de l’arbitrage.
Bull. CCI
Bulletin de la cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale.
Bull. civ.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation française (chambres civiles).
Bull. Joly Sté.
Bulletin Joly Société.
CA
Cour d’appel.
Cah. arb.
Cahiers de l’arbitrage.
Cass. ass. plen.
Assemblée plénière de la Cour de cassation française.
Cass. civ.
Chambre civile de la Cour de cassation française.
Cass. com.
Chambre commerciale de la Cour de cassation française.
CCI
Chambre de commerce internationale.
CCJA
Cour commune de justice et d’arbitrage.
CEDH
Cour européenne des droits de l’homme.
CIRDI
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
CNUDCI
Commission des Nations unies pour le droit commercial international.
D.
Recueil Dalloz.
ERSUMA
École régionale supérieure de la Magistrature.
Gaz. Pal.
Gazette du Palais.
JADA
Journal africain du droit des affaires.
Janus
Revue camerounaise de droit et de science politiques.
JCP
Juris-Classeur Périodique (Semaine juridique), édition générale.
JDI-Clunet
Journal du droit international – Clunet.
LDIP
Loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.
Le Juris-Ohada
Bulletin trimestriel de l’information en jurisprudence OHADA.
LEDAF
L’essentiel – Droits africains des affaires.
LPA
Les Petites affiches.
OHADA
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Procédures
Revue Procédures.
RA – CCJA
Règlement d’arbitrage de la CCJA.
RADED
Revue africaine de droit, d’économie et de développement.
RASJ
Revue africaine des sciences juridiques.
RBD
Revue burkinabé de droit.
RCDA
Revue congolaise de droit et des affaires.
RDAI
Revue de droit des affaires internationales.
RDIDC
Revue de droit international et de droit comparé.
RDUA
Revue de droit uniforme africain.
Rec. CCJA
Recueil de jurisprudence de la CCJA.
Rec. cours La Haye
Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye.
Rec. Penant
Revue trimestrielle de droit africain.
REMASJUPE
Revue malienne des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako.
Rev. arb.
Revue de l’arbitrage.
Rev. cam. arb.
Revue camerounaise de l’arbitrage.
Rev. crit. DIP
Revue critique de droit international privé.
Rev. Ersuma
Revue de l’ERSUMA.
Rev. Jurifis info
Revue d’information juridique du cabinet d’avocats Jurifis Concult.
RIDC
Revue internationale de droit comparé.
RIDE
Revue internationale de droit économique.
RJC
Revue de jurisprudence commerciale.
RJDA
Revue de jurisprudence de droit des affaires.
RJO
Revue judiciaire de l’Ouest.
RJSP
Revues des juristes de sciences Po.
RLDC
Revue Lamy, droit civil.
RP – CCJA
Règlement de procédure de la CCJA.
RTD civ.
Revue trimestrielle de droit civil.
RTD com.
Revue trimestrielle de droit commercial.
RTD eur.
Revue trimestrielle de droit européen.
Sommaire
Remerciements
Principales abréviations
Préface
Introduction générale
Première partieL’efficacité incomplète du système d’identification du juge étatique
Titre I. – La délicate identification et l’accès laborieux au juge national
Chapitre I. – Les obstacles susceptibles de troubler l’identification et l’accès au juge national
Chapitre II. – Les améliorations tendant à faciliter l’identification et l’accès au juge national
Conclusion Titre I
Titre II. – La répartition hétéroclite des attributions du juge communautaire de la CCJA
Chapitre I. – La compétence exclusive du juge communautaire dans l’arbitrage spécifique de la CCJA
Chapitre II. – La compétence en dernier ressort du juge communautaire de la CCJA dans le cadre du pourvoi en cassation
Conclusion Titre II
Conclusion Première Partie
Deuxième partieL’efficacité renforcée des attributions du juge étatique
Titre I. – Des attributions renforcées avant le prononcé de la sentence arbitrale
Chapitre I. – L’obligation de neutralité du juge étatique en présence d’une convention d’arbitrage
Chapitre II. – L’obligation d’assistance du juge étatique lors de la mise en œuvre et pendant le déroulement de l’arbitrage
Conclusion Titre I
Titre II. – Des attributions renforcées après le prononcé de la sentence arbitrale
Chapitre I. – Le pouvoir de contrôle du juge étatique au stade de la reconnaissance et de l’exequatur de la sentence arbitrale
Chapitre II. – Le pouvoir de contrôle du juge étatique au stade du recours en annulation contre la sentence arbitrale
Conclusion Titre II
Conclusion Deuxième Partie
Conclusion générale
Bibliographie générale
Index alphabétique
Table des matières
Préface
Filali Osman
Professeur à l’Université de Franche-Comté – CRJFCAncien conseiller de GouvernementChercheur associé au centre de droit des affaireset du commerce international de l’Université de Montréal –CDACI – et au CREDIMI
Cet ouvrage que nous avons l’honneur de préfacer est le fruit de la thèse de doctorat soutenue le 11 janvier 2019 par Monsieur Oumar Bah à l’Université de Bourgogne Franche-Comté devant un jury constitué par Messieurs Éric Loquin, Professeur émérite à l’Université de Bourgogne, Denis Mouralis, Professeur agrégé à l’Université d’Aix-Marseille, Gérard Anou, Professeur agrégé à l’Université de Perpignan, Cyril Nourissat, Professeur agrégé à l’Université Jean Moulin, Lyon 3 et moi-même.
Choisir L’efficacité de l’arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique comme thème de recherche et l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires – OHADA – comme aire géographique, est très certainement une bonne idée. En effet, compte tenu de la diversité des systèmes juridiques des 17 États membres, seul un développement harmonisé et/ou unifié de l’arbitrage, commercial ou d’investissement, est susceptible de créer de manière satisfaisante un espace extra-judiciaire et judicaire africain performant, assurant à l’ensemble des opérateurs économiques de ces 17 États, mais également aux investisseurs étrangers, la garantie d’une justice rapide, fiable et pérenne. Bref, il s’agit d’offrir aux parties à un arbitrage ayant un lien avec des pays membres de l’OHADA « un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté ».
Le rôle du juge étatique s’inscrit essentiellement dans une démarche légistique d’harmonisation du droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA et de sa contribution à l’amélioration du climat des affaires. Pour cela, Monsieur Oumar Bah a défini la notion d’efficacité et sa proximité avec des notions voisines comme celle de sécurité juridique ou économique. Cela dit, Monsieur Oumar Bah rappelle constamment la problématique qui a guidé son travail de recherche. En effet, comme l’indique le titre, l’objet de sa thèse vise à évaluer les apports du juge étatique à l’efficacité de l’arbitrage OHADA. Pour ce faire, afin d’appréhender ce sujet, il lui fallait d’abord dans une première partie mettre l’accent sur les conditions d’identification du juge étatique. Ensuite, dans une deuxième partie, étudier les attributions du juge étatique dans le système dualiste de l’arbitrage OHADA.
S’agissant de la première partie de la thèse, l’examen des textes communautaires indique que la mise en application du système dualiste de l’arbitrage OHADA est conjointement confiée aux juridictions nationales des États parties et à la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA. Sur ce point, il ressort du Traité de l’OHADA que le juge national a vocation à intervenir dès les premiers incidents liés à l’introduction de la demande d’arbitrage jusqu’à l’épuisement du recours en annulation contre la sentence. Une fois cette étape franchie, il passe le relais au juge communautaire de la CCJA qui dispose du monopole en matière de pourvoi en cassation formulé contre la sentence arbitrale de droit commun. Quant à l’arbitrage spécifique de l’OHADA, le juge communautaire de la CCJA exerce toutes les prérogatives administratives et juridictionnelles normalement dévolues au juge national.
Toutefois, s’agissant de l’arbitrage de droit commun, de nombreuses carences normatives sont susceptibles de rendre impossible ou du moins trop contraignante la possibilité pour les plaideurs de saisir le juge étatique. Parmi elles, Monsieur Oumar Bah cite entre autres, la formulation imprécise de l’expression générique « juridiction compétente dans l’État partie », les effets négatifs du renvoi aux droits internes disparates et l’apport déficitaire des législateurs nationaux à compléter l’acte uniforme. Nul doute que cette situation entraîne, selon Monsieur Oumar Bah, des conflits de compétence entre les juridictions internes, des errements de certaines juridictions internes et une répartition hétéroclite des attributions du juge national dans l’arbitrage de droit commun. Néanmoins, dans ses analyses, Monsieur Oumar Bah souligne, que malgré l’existence de quelques particularités, il se dégage au sein des États parties une constante qui confère aux juridictions d’instances la mission d’appui et de contrôle et aux juridictions d’appels, la mission de statuer sur le recours en annulation. Quant au Règlement d’arbitrage de la CCJA, il indique que l’identification du juge étatique se fait sans difficulté. Néanmoins, la juxtaposition ambiguë de ses attributions risque de conduire à une lenteur de la procédure, à la confusion entre les fonctions administratives et juridictionnelles. Enfin, les pressions politiques des États qui succombent et les interférences de la CCJA dans l’activité du tribunal arbitral ne sont pas à exclure. À cela s’ajoutent les contraintes de distance et de coûts qui amenuisement l’efficacité de l’intervention du juge communautaire de la CCJA.
Pour surmonter l’ensemble de ces difficultés, Monsieur Oumar Bah fait des suggestions. Il souligne, par exemple, la nécessité de clarifier l’expression désignant le juge étatique compétent à l’arbitrage de droit commun, la mise à niveau du système judiciaire des États parties, la nécessité pour les États de compléter l’acte uniforme, la création d’un guichet unique en matière d’appui et de contrôle et le renforcement de la formation des magistrats. À défaut d’un tel travail de fond, Monsieur Oumar Bah propose à l’attention des plaideurs des solutions d’évitement du juge étatique. Celles-ci se déclinent en l’élection d’une autorité de désignation, au choix stratégique du siège du tribunal arbitral, la prévision d’une solution punitive à arbitre unique, le prononcé par l’arbitre des mesures assorties d’une astreinte, la prévision des mesures de sûretés, d’une garantie documentaire et la renonciation au recours en annulation au bénéfice d’une exécution spontanée de la sentence arbitrale. Le lecteur prendra grand plaisir à découvrir combien la lecture des instruments juridiques de l’OHADA sur l’arbitrage est sujette à interprétation que Monsieur Oumar Bah maîtrise à merveille.
Quant à la seconde partie de la thèse, Monsieur Oumar Bah a abordé les différentes attributions du juge étatique qu’il regroupe en deux volets selon que la sentence arbitrale a été rendue ou non. Avant que l’arbitre ne rende sa sentence, le juge étatique est contraint d’adopter deux postures allant de la neutralité à l’obligation d’assistance. En sa qualité de coopérant naturel de l’arbitrage, le juge étatique assistera les parties et le tribunal arbitral en cas de difficultés avant la formation du tribunal arbitral ou en cours de procédure arbitrale. En tout état de cause, il exerce ces compétences sous le sceau de la force obligatoire de la clause compromissoire et de son indépendance à l’égard du contrat principal.
Mais, abordant les attributions dévolues du juge étatique après le prononcé de la sentence arbitrale, Monsieur Oumar Bah n’a pas manqué d’indiquer que le rôle du juge étatique se limite ici à un simple contrôle en vue de la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales et à l’examen du recours en annulation. Rappelant ainsi les dispositions des articles 30 et 31 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le juge étatique procédera sous un délai de quinze jours à compter de sa saisine à un contrôle formel sur la validité de la sentence et sa conformité avec l’ordre public international de l’État partie requis. À défaut, la sentence arbitrale est réputée avoir acquis tacitement le quitus nécessaire à son exécution forcée. Pour ce qui est des sentences arbitrales de la CCJA qui présentent la particularité d’acquérir l’exequatur communautaire, Monsieur Oumar Bah indique que la requête doit être adressée au président de la Cour. La reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales étrangères se font selon les dispositions de l’article 34 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Ledit texte règle la question en prévoyant une application de principe du droit international et une application subsidiaire du droit national. Enfin, Monsieur Oumar Bah indique que la sentence ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation soit devant le juge national soit devant la CCJA. Il s’agit pour le juge d’annulation de s’assurer que la sentence arbitrale a été rendue conformément aux principes directeurs du procès arbitral et de l’ordre public international. Le refus d’exequatur est susceptible d’un recours en cassation devant la CCJA.
Pour conclure sa démonstration rigoureuse, Monsieur Oumar Bah est arrivé au constat, très convaincant, selon lequel même si la configuration actuelle de la CCJA soulève encore des inquiétudes, celle-ci contraste avec la cacophonie qui règne dans l’arbitrage de droit commun lorsqu’il s’agit d’identifier et d’accéder au prétoire au juge étatique. En effet, les justiciables s’interrogent aujourd’hui sur l’intérêt de recourir à l’arbitrage de droit commun. Dans ce type d’arbitrage, la thèse démontre qu’il est souvent délicat d’obtenir l’aide du juge étatique en cas de difficultés. D’ailleurs à supposer que celle-ci soit obtenue, elle ne répond pas efficacement aux préoccupations des parties. En partant de ce postulat, Monsieur Oumar Bah affirme que les lacunes du système dualiste de l’arbitrage OHADA résident davantage dans les conditions de détermination et d’accès au juge étatique que dans le corps de règles mis en place par le législateur communautaire.
Qu’il s’agisse de l’arbitrage de droit commun ou de l’arbitrage spécifique de la CCJA, les textes communautaires, pour perfectibles qu’ils soient, constituent une avancée significative dans un espace économique qui a longtemps souffert d’une fragmentation juridique et judiciaire. Ainsi, malgré quelques lacunes, Monsieur Oumar Bah s’interroge sur le fait qu’une imperfection juridique est (n’était-elle pas) préférable au vide juridique qui existait dans les États parties avant l’avènement de l’arbitrage OHADA ? À cette interrogation il apporte une réponse affirmative compte tenu des résultats déjà enregistrés au sein de l’OHADA en matière d’investissement.
Pour l’ensemble des qualités dont a témoigné Monsieur Oumar Bah, la thèse arrive à point nommé car la littérature n’est pas si abondante que cela en cette matière. C’est très justement que le jury l’a trouvée originale dans les droits nationaux, Monsieur Oumar Bah ayant pris le sujet au-dessus des simples problèmes techniques pour une approche globale, riche, originale que le lecteur prendra plaisir à découvrir. Qu’il en soit remercié.
Villeurbanne, le 15 octobre 2019
Introduction générale
« À l’image du soufflet du forgeron, l’histoire de la justice étatique et de l’arbitrage a, de tout temps, été rythmée par un incessant mouvement d’impulsion – expulsion. En effet, sur l’autonomie développée par l’une et l’autre, se greffent de ponctuels passages de coopération, même s’il faut reconnaître que cette coopération se réalise en des termes et des finalités différentes : tandis que la seconde ne peut prêter à la première que sa contribution alternative à l’atteinte de l’idéal de justice, la première œuvre, par moments, à appuyer ou à sanctionner la seconde »(1).
1. En 1982, dans une étude parue à la Revue de l’arbitrage, le Juge Philippe Bertin observait l’étonnant paradoxe qui résulte de la réintroduction du juge étatique dans un processus dont il est a priori exclu(2). Droit commun de résolution des différends contractuels(3), l’orthodoxie en matière d’arbitrage commercial nous enseigne que de tout temps, les plaideurs, par souci d’économie procédurale, choisissent volontairement de se passer des services du juge public au profit d’un juge privé. Il se dégage ainsi de la compréhension de la justice arbitrale, une idée forte qui s’articule autour de la faculté offerte aux parties de soustraire conventionnellement leur différend au jugement des tribunaux donnés par la loi, pour le soumettre à une personnalité de leur choix : l’arbitre(4).
2. Cependant, cela permet-il d’en conclure que les juridictions étatiques doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de la procédure d’arbitrage ? De prime abord, il est presque permis de répondre de manière univoque à la question posée : oui, l’arbitrage est une justice privée conçue comme une technique d’évitement du juge étatique rendue possible par la seule volonté des plaideurs(5). Néanmoins, la particularité d’une justice qui se déroule en dehors de tout cadre étatique nous oblige à tempérer notre affirmation. En effet, étant une institution typiquement conventionnelle, la justice arbitrale dispose de la juridiction c’est-à-dire l’office de dire le droit, mais pas d’imperium pour accorder une protection adéquate à ses utilisateurs en conférant une force exécutoire aux sentences arbitrales rendues(6).
3. Autrement dit, même si l’arbitre dispose d’un véritable pouvoir juridictionnel, il n’a d’autorité que celle que les parties auront bien voulu lui donner contractuellement(7). Et, en tout état de cause, même si elle n’est pas directement exécutoire, la décision de l’arbitre aura l’autorité de la chose jugée, car elle interdit aux parties de présenter postérieurement toute demande fondée sur la même cause(8). L’impossibilité d’exécuter directement la sentence arbitrale s’explique sans nul doute par le fait que le règlement des litiges de tous ordres relève de la fonction régalienne de l’État à travers son appareil judiciaire. Dans ce contexte, une justice privée rendue par des juges privésdemeure incompatible avec le pouvoir de juger du juge étatique dépositaire du verbe divin et disposant d’une délégation officielle et permanente à cet effet(9).
4. À l’instar des autres modes extrajudiciaires de règlement des différends contractuels, l’arbitre n’a en sa possession aucun moyen coercitif contre les parties ou un tiers détenant, par exemple, une pièce essentielle à l’aboutissement du procès. Par ailleurs, une fois rendue, sa décision requiert nécessairement l’aval du juge étatique dépositaire de la contrainte légale afin de connaître un exequatur forcé. De ce fait, se trouvant dans l’impossibilité juridique de régler directement les difficultés procédurales, les acteurs de l’arbitrage solliciteront naturellement la coopération du juge étatiquequ’ils voulaient au préalable écarter de leur différend. Il est donc tout à fait normal de réintroduire dans le processus juridictionnel celui qui a été volontairement exclu afin qu’il assiste celui qui lui a été substitué pour dire le droit(10). C’est là que prend forme toute la schizophrénie qui caractérise la justice arbitrale.
5. Ce constat nous amène à dire que la justice arbitrale en dépit de son autonomie acquise au fil des années ne saurait totalement se soustraire de l’emprise de la justice étatique(11). Toutefois, l’attraction qu’exerce la justice étatique sur la justice arbitrale ne saurait être absolue(12). En dehors de la phase d’exequatur, le défaut d’imperium qui affecte l’arbitre est sans conséquence majeure sur son autorité, et tout particulièrement sur le caractère obligatoire de la sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dans la pratique, avant de rendre sa sentence, l’arbitre prend généralement en compte le comportement hostile des parties durant la procédure. Parfois, la seule crainte de s’attirer l’inimitié de l’arbitre suffit à garantir la coopération des parties alors moins enclines à prendre le chemin de l’arbitrage.
6. Nous regrettons cependant que cet aspect psychologique qui guide la posture des parties récalcitrantes ne soit pas toujours suffisant en présence d’un plaideur qui rechigne à mettre en œuvre la clause d’arbitrage. Ne pouvant pas se suffire à elle-même, l’efficacité de la justice arbitrale suppose l’existence d’une autorité permanente dotée d’imperium pour servir de relais afin de surmonter les embûches qui jalonnent le processus(13). Ainsi, bien avant le recours à son imperium, il peut être nécessaire de faire appel à son appui en phase de constitution du tribunal arbitral ou pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
7. Néanmoins, cet aspect particulier de la justice arbitrale ne doit pas nous conduire à conclure que le recours au juge étatique est systématique dans le déroulement de l’arbitrage. Le Professeur Philippe Fouchard, dans son étude sur l’arbitrage, rappelle que « l’immense majorité des arbitrages n’est jamais en relation avec le juge étatique. Lorsqu’un tribunal judiciaire est saisi d’un arbitrage, à quelque niveau de la procédure que ce soit, c’est que l’arbitrage n’a pas pu fonctionner correctement, naturellement »(14). Cela étant précisé, l’intervention du juge étatique dans le déroulement de l’arbitrage doit revêtir un caractère exceptionnel. Saisie pour donner « un coup de main », l’intervention du juge étatique dans le déroulement de l’arbitrage trouve véritablement son fondement dans la défaillance même des parties ou dans celui de l’appui de l’arbitre aux parties.
8. Théoriquement, si les parties s’engagent résolument sur le chemin de l’arbitrage tout en s’exécutant spontanément, le rôle du juge étatique n’en sera qu’anecdotique. Son intervention dans l’arbitrage se limitera à une simple vérification formelle de la conformité de la sentence aux standards de justice ou principes directeurs du procès. Dans le même ordre d’idées, lorsque l’arbitre tranche le litige conformément à la convention des parties et des standards de la justice arbitrale, sa sentence ne fera l’objet d’aucune contestation sérieuse(15). Par contre, lorsqu’une des parties à la convention d’arbitrage, à travers des manœuvres dilatoires, entrave la mise en œuvre de l’arbitrage, ou lorsque l’arbitre s’écarte de sa mission, le juge étatique sera susceptible d’intervenir pour résoudre les différents incidents qui jalonnent la conduite sereine du procès arbitral. De même, lorsqu’une partie oppose un refus d’exécuter spontanément la sentence arbitrale en mettant en œuvre les différentes voies de recours, le juge étatique sera à nouveau sollicité en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier.
9. Même si les différentes limites auxquelles l’arbitre est confronté peuvent être source de frustration pour les parties, ces considérations liminaires ne font pas de lui un subordonné du juge judiciaire(16). Au contraire, il s’agit d’une relation de coopération dont le rapprochement entre l’arbitre et le juge a largement contribué à décloisonner les deux institutions(17). Ainsi, en matière commerciale, l’arbitrage et la justice étatique même en étant deux institutions distinctes poursuivent tout de même but : celui du règlement effectif des différends relatifs à l’exécution des obligations contractuelles. D’un certain point de vue, si nous reprenons à notre compte la formule allégorique du Juge Roger Sockeng nous dirons en somme que « la justice étatique et la justice arbitrale sont deux coépouses qui s’épient, se rapprochent et se soutiennent parfois, sous le ciel d’un époux commun : la justice »(18).
10. Au regard de toutes ces considérations, l’espace de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est un terrain propice à la collaboration entre le juge étatique et l’arbitrage(19). Instituée par le Traité de Port Louis (Île Maurice) du 17 octobre 1993 et révisé le 17 octobre 2008 au Québec (Canada), l’OHADA est une organisation communautaire qui a été créée pour répondre aux besoins d’accessibilité à l’information juridique, d’uniformisation, de modernisation et d’harmonisation du droit des affaires en Afrique(20). Pour se faire, l’OHADA s’est doté depuis sa création, d’une Conférence des chefs d’État et de gouvernement(21), d’un Conseil des ministres(22), d’un Secrétariat permanent, d’une Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) et d’une École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA).
11. Considérée comme une révolution juridique en Afrique francophone(23), la création de l’OHADA « n’est pas […] de la seule initiative des seuls Chefs d’État africains de la zone franc ; elle est surtout une idée, voire une exigence, des opérateurs économiques qui revendiquent l’amélioration de l’environnement juridique et judiciaire des entreprises afin de sécuriser les investissements »(24). C’est la raison pour laquelle, afin de répondre efficacement à ce besoin, les décideurs politiques sous l’impulsion des intellectuels africains(25), « ont entendu remédier à un certain nombre de non-conformités liées à la présence massive de lois nationales contradictoires, au contenu souvent obsolète »(26). D’où la création de l’OHADA pour harmoniser l’ensemble des règles réputées favorables à la sécurité juridique et judiciaire indispensable à tout projet de développement économique. Les États parties au Traité de l’OHADA(27) visent ainsi au travers des règles uniformes qu’ils adoptent(28), à donner aux investisseurs étrangers et domestiques, une image globale de leur capacité à favoriser à la fois l’accueil, la rentabilité, l’exploitation et la protection de leur investissement.
12. Par ailleurs, à défaut d’une régulation de l’ensemble du système judiciaire des États parties destinés à satisfaire l’obligation de sécurité judiciaire, les concepteurs de l’OHADA ont porté leur choix sur un mode alternatif de règlement des différends commerciaux et d’investissements. Système délocalisé de la justice économique, l’ordre arbitral communautaire comporte des règles de procédures spécifiques susceptibles de jouer le rôle de justice alternative. Celles-ci visent à satisfaire les craintes d’illisibilités des procédures contentieuses dans les États parties et la mauvaise presse des autorités judiciaires exprimées par les acteurs du commerce international.
13. En plus de ces règles de procédure, l’OHADA a mis en place la CCJA qui fait office de Centre d’arbitrage international et de Cour de justice communautaire. La création de la CCJA constitue l’une des réponses fortes apportées pour contrer les dangers qui planent sur toute quête d’intégration juridique en l’absence d’une institution judiciaire régulatrice. Gardienne de l’application uniforme du droit communautaire, la CCJA joue au sein de l’OHADA une double fonction judiciaire et arbitrale. La mise en place d’une juridiction supranationale contribue incontestablement à la promotion de la sécurité judiciaire dans l’espace de l’OHADA(29). Pour cette raison, en dépit des nombreux défis qui jalonnent la vie de la CCJA, elle participe indiscutablement au rayonnement du droit des affaires de l’OHADA. L’attractivité de son modèle d’arbitrage et l’intégration judiciaire recherchée à travers l’instauration d’une compétence unique en matière de cassation font d’elle le « fer de lance » de l’OHADA. Dans l’attente d’une véritable réforme du système judiciaire communautaire, la CCJA présente aujourd’hui « l’avantage, d’une part, d’uniformiser dans l’espace OHADA la conduite du contentieux devant le tribunal arbitral, et d’autre part d’assister la sauvegarde et la protection de l’orthodoxie de Droit communautaire OHADA »(30).
14. Pour garantir la paix dans la pratique des affaires, l’arbitrage occupe une place singulière dans la trame des grands travaux de l’OHADA. À l’instar de la médiation, elle est la clé de voute de l’organisation dans sa quête d’un espace économique fiable et protecteur de l’investissement(31). À ce titre, conçu pour être un instrument libéralisé de règlement des différends contractuels(32), le cadre législatif international organisant le recours à l’arbitrage dans l’espace de l’OHADA n’altère pas la coopération entre le juge et l’arbitre. À l’instar de la plupart de ses homologues, le législateur communautaire a prévu à tous les niveaux de son modèle d’arbitrage, un mécanisme d’intervention du juge étatique. Réputé pour être le coopérant naturel de l’arbitrage, le juge étatique de par ses interventions ponctuelles confère à l’institution arbitrale de l’OHADA un « caractère mi-privé, mi-public »(33). Néanmoins, l’OHADA étant une organisation qui est construite autour d’un traité multilatéral impliquant des organisations judiciaires disparates, quel est le juge étatique véritablement compétent pour garantir l’efficacité de l’arbitrage ? En outre quels sont les voies et moyens qui permettraient une participation efficace du juge étatique à l’arbitrage OHADA ?
15. La réponse à ces questions nécessite que l’on passe au crible du raisonnement juridique, les instruments communautaires et nationaux relatifs au mécanisme de coopération inédit entre la justice étatique et la justice arbitrale. Mais, avant tout développement au fond, l’étude du rôle dévolu aux juridictions étatiques exige de s’entendre sur le sens de la notion de « juge étatique » dans le système dualiste de l’arbitrage OHADA. D’un point de vue d’ensemble, le modèle d’arbitrage en vigueur dans l’espace de l’OHADA présente la particularité d’être construit à la fois autour de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la CCJA(34). Le premier texte encadre la pratique du droit commun de l’arbitrage. Le second texte, quant à lui, réglemente un arbitrage institutionnel spécifique se déroulant sous l’autorité de la CCJA. Malgré les avantages qui résultent de la distinction formelle entre l’arbitrage de droit commun et l’arbitrage institutionnel de la CCJA, cette dualité arbitrale rend délicate l’appréhension de la notion de « juge étatique ».
16. Selon l’organisation judiciaire de l’OHADA, l’Acte uniforme désigne le juge national de l’État partie pour assister et contrôler l’arbitrage de droit commun. Le Règlement d’arbitrage de la CCJA confie quant à lui ces mêmes missions au juge communautaire de la CCJA. Ce dernier est dépositaire de toutes les prérogatives classiquement dévolues aux juridictions nationales pour assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales de la CCJA. De même, le juge communautaire de la CCJA est exclusivement compétent pour connaître du pourvoi en cassation formé contre la sentence arbitrale de droit commun. Ce faisant, la CCJA bénéficie d’un mécanisme de substitution innovant qui fait d’elle l’organe de régulation du droit communautaire à la place du juge de cassation national auquel elle se substitue.
17. De ce fait, il ne semble pas abusif d’attribuer au juge communautaire de la CCJA la qualité de juge étatique. Notre raisonnement analogique trouve son fondement dans le fait que le système d’arbitrage de la CCJA est le fruit d’une construction arbitrale nouvelle. Elle constitue en quelque sorte le prolongement de la justice étatique. En effet, à travers un mécanisme conventionnel, la CCJA est délégataire d’une part de la souveraineté judiciaire de ses États membres. À ce titre, elle est l’émanation de la volonté commune des États parties qui ont fait le choix de confier à la Cour commune de justice une primauté sur les juridictions nationales. Toutefois, cette primauté est circonscrite au seul droit des affaires de l’OHADA. Pour toutes les questions relatives à l’application du droit uniforme de l’OHADA, le juge communautaire se substitue aux cours suprêmes nationales. Partant de ce postulat, l’expression « juge étatique » semble rendre parfaitement compte de la mission assignée à la CCJA dans l’unification de la jurisprudence au sein de l’espace de l’OHADA.
18. Étant dorénavant entendu que l’appellation « juge étatique » englobe à la fois les juridictions nationales et la CCJA, la rigueur de l’analyse juridique nous impose de choisir un angle d’étude. À cette fin, même si notre démarche intellectuelle implique un regard panoramique sur la pratique de l’arbitrage OHADA, elle sera toutefois orientée sur les aspects essentiels de l’intervention du juge étatique pour garantir son efficacité. Cela dit, afin de permettre au lecteur de mieux comprendre et de critiquer plus aisément ce travail, il nous semble indispensable d’en décrire le contexte et les antécédents. Ainsi, quel est le bien-fondé de consacrer une étude entière sur le rôle du juge étatique dans l’arbitrage OHADA ? Pour rappel, notre sujet de recherche n’a pas été à l’abri du phénomène d’« asphyxie doctrinale » déjà évoqué par les Professeurs Nicolas Molfessis et Dominique Bureau(35). Qu’il s’agisse de la doctrine étrangère ou communautaire, de nombreuses études scientifiques ont été dédiées aux rapports qui existent entre le juge et l’arbitre(36). Même si ces travaux ne s’intéressent pas sérieusement aux particularités de l’arbitrage OHADA, l’entreprise fait tout de même apparaître de prime abord un intérêt scientifique limité.
19. Pourtant à y regarder de plus près, sous l’apparente simplicité, notre sujet de thèse renvoie à un aspect essentiel du droit des affaires de l’OHADA : celui de l’efficacité des normes communautaires au service du développement économique des États parties(37). C’est la raison pour laquelle, notre travail ne se limitera pas à la présentation d’une simple grille de lecture permettant d’assimiler le rôle joué par le juge étatique dans l’arbitrage. Nous ambitionnons donc à travers cette étude, la mise en exergue des apports du juge étatique dans la recherche de l’efficacité de l’arbitrage OHADA.
20. Cependant, que mesure-t-on véritablement sous le terme « efficacité » ? Dans le langage courant, l’adjectif efficax, désigne ce « qui produit l’effet qu’on en attend »(38). Apparu au début du XXe siècle sous l’impulsion du Taylorisme, le concept « efficacité » vise à évaluer la capacité d’un système à satisfaire ses objectifs c’est-à-dire les raisons même de sa création(39). Transposée dans la sphère juridique, l’analyse économique du droit conduit à un changement des paradigmes de la rationalité juridique(40). Si pendant longtemps, la raison d’être de la règle de droit était à rechercher dans le critère de légitimité tenant à sa création, aujourd’hui, cela n’en est rien. Sous l’influence croissante du droit économique, l’existence d’une norme juridique s’appréhende sous l’angle des effets qu’elle est susceptible de produire(41). Par ailleurs, l’efficacité d’une entité juridique étant purement relative, son appréciation se fait nécessairement selon un référentiel bien déterminé en amont. Au regard du résultat escompté, cela rendrait donc aléatoire l’analyse de l’impact liée à l’intervention du juge étatique dans l’arbitrage OHADA sans faire un bref aperçu sur les pratiques en vigueur dans d’autres systèmes juridiques. Ainsi, par commodité intellectuelle, le modèle français semble pour nous être un référentiel pertinent pour vérifier si l’intervention du juge étatique dans l’arbitrage OHADA produit les objectifs attendus.
21. Mais, conceptuellement, l’efficacité n’est pas une notion unitaire. Il s’agit plutôt d’une catégorie polysémique susceptible d’être confondue avec l’effectivité ou l’efficience(42). En effet, l’effectivité signifie qu’une règle ne doit pas seulement prescrire ou proscrire un comportement. Pour être effective, la règle doit véritablement être respectée que ce soit par une véritable application des sanctions ou une adhésion à son contenu de la part de ses destinateurs. C’est ainsi que la doctrine, pour justifier le respect spontané des codes de bonne conduite de nature recommandatoire relève que « c’est sans doute que l’effectivité des règles de conduite sociale […] ne réside pas nécessairement dans la juridicité originelle de celles-ci, mais bien plutôt dans l’adhésion dont elles sont l’objet par le corps social destinataire »(43).
22. Par la même occasion une fois que les objectifs voulus ont été atteints, la question sera alors de savoir quelles ont été les ressources utilisées pour y parvenir au résultat recherché. Dans ce cas précis, le droit étant profondément marqué par l’esprit de performance nous parlerons bien volontiers de l’efficience, terme d’origine anglaise. Il s’agit d’un indicateur qui permet de mesurer l’impact économique d’une législation(44). Sur ce dernier point, les économistes s’accordent sur l’idée d’une optimisation des ressources utilisées pour atteindre le résultat voulu tout en minimisant les effets négatifs induits(45). Économiquement, une chose est donc considérée comme efficiente lorsqu’elle permet d’atteindre un objectif avec le minimum de moyens(46). En résumé, pris dans sa composante étymologique, l’efficacité ne s’intéresse qu’au résultat attendu sans prendre en compte les moyens et la rentabilité. Néanmoins, du point de vue du droit, la distinction entre ces trois concepts de x, y, z manque quelque peu de pertinence puisque l’efficacité d’une institution ou d’une règle renvoie à la fois à son effectivité et à son efficience(47).
23. De ces quelques observations liminaires, sur la notion d’efficacité, l’intervention du juge étatique dans l’arbitrage OHADA vise à la fois à satisfaire un objectif d’efficacité économique et d’efficacité juridique. En effet, sur le plan économique, pour mieux appréhender l’efficacité inhérente à l’intervention du juge étatique dans l’arbitrage, il convient de préciser les raisons qui ont justifié la création de l’OHADA. L’arbitrage à l’instar des autres instruments communautaires, concourt à faire de l’OHADA un espace économique propice aux investissements. L’observation devient encore plus pertinente si l’on prend en compte le fait qu’avant l’avènement de l’OHADA, « le droit des affaires se présente dans les pays africains de la zone franc en habit d’arlequin fait de pièce et de morceau »(48). Cette situation a longtemps entretenu au sein des États parties, le risque d’une insécurité juridique, mais surtout judiciaire(49). Le dilettantisme juridico-judiciaire dans lequel baignaient les économies de la sous-région paralysait tout élan de prospérité économique.
24. Fort de ce constat, « le droit OHADA est conçu comme une lumière venue sortir l’économie africaine de son marasme et de la léthargie dans laquelle elle s’est trouvée plongée durant de longues années »(50). À l’instar des autres instruments juridiques dérivés du Traité de l’OHADA, l’arbitrage s’inscrit dans le cadre de la quête d’une justice économique favorable à l’investissement. L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la CCJA contribuent tous au développement économique dans des États dont les législations, en l’espèce, ont longtemps été marquées par la « loi de la jungle »(51). À ce titre, le modèle d’arbitrage de l’OHADA est un formidable levier pour garantir la stimulation et la sécurisation des investissements domestiques et étrangers(52). Les règles sécrétées par l’OHADA en matière d’arbitrage comportent en elles une dose de suprématie sur le droit interne existant. De ce fait, elles présentent intrinsèquement la vocation à connaître une application immédiate. En outre, elles constituent des instruments idoines de transposition d’un corps de règles simple et moderne dans la mosaïque des ordres juridiques qui constituent l’OHADA(53). En se substituant à l’ancien droit, l’Acte uniforme souffle un vent de fraîcheur sur l’arsenal juridique des États parties disposant d’une loi sur l’arbitrage. Par la même occasion, il comble le vide juridique existant dans certains États parties(54).
25. Ainsi, en dépit de la critique doctrinale sur la crédibilitédes réformes économiques unilatérales(55), l’œuvre d’harmonisation entreprise par le Conseil des ministres de l’OHADA était plus que nécessaire. La création des richesses par le droit économique se matérialise donc au sein de l’OHADA, par l’adoption d’un ensemble d’actes uniformes applicables dans les dix-sept économies qui composent l’organisation. Son objectif premier vise à promouvoir le développement économique de ses États membres sous le prisme d’une intégration juridique dans l’objectif d’aboutir à une véritable intégration africaine(56). Misant ainsi sur la capacité du droit à engendrer de la croissance économique, les concepteurs de l’OHADA ont conçu le droit uniforme dans l’optique de « créer un nouveau pôle de développement en Afrique et de […] garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l’essor de celle-ci et d’encourager les investissements »(57).
26. Formée d’un ensemble de règles économiques souples et modernes, la contribution de l’OHADA au développement des États parties entre en résonnance avec le schéma décrit par le Professeur Maurice Allais, prix Nobel en sciences économiques. Selon ce dernier, « la véritable réforme économique, c’est la réforme du cadre juridique de l’économie »(58). Nous retrouvons le même fil conducteur dans l’odyssée normative de l’OHADA. La démarche du droit communautaire s’inscrit en effet dans le cadre d’une politique d’harmonisation ambitieuse. Celle-ci vise à doter ses États membres d’un cadre juridique attrayant et d’un cadre judiciaire sûr qui sous-tend l’exigence de sécurité juridique, postulant intelligibilité de la règle, mais aussi prévisibilité dans son application et ses effets. D’ailleurs, on sait à quel point le principe de sécurité juridique est si fondamental pour tout ordre au point que le Conseil constitutionnel français en fait un principe général à valeur constitutionnelle. La combinaison de ces deux éléments que sont la sécurité juridique et la sécurité judiciaire est susceptible d’inciter à l’investissement, vecteur du développement économique et social.
27. À travers une approche différente, le choix de l’OHADA contraste avec la démarche classique en matière d’investissement qui consiste d’abord à créer sous l’impulsion des flux de capitaux des normes régulatrices plus ou moins contraignantes. L’idée motrice découle ici d’une vision théorique simpliste, mais dont la mise en œuvre pratique produit à ce jour des résultats miraculeux dans certains États parties. Le deuxième Forum annuel de la bonne gouvernance et de la vérification des données clientèle qui s’est tenu à l’Île de Mahé (Seychelles) du 29 au 30 octobre 2015 a été l’occasion pour le secrétaire permanent de l’OHADA, le Professeur Dorothé Sossa, de dresser l’impact du droit de l’OHADA sur les économies des États parties. Dans sa communication, il souligne avec justesse que « l’espace OHADA, constitue actuellement un marché d’environ 225 millions de consommateurs et représente un produit intérieur brut de 275 milliards de dollars américains, connaît une croissance soutenue en dépit des soubresauts de l’économie mondiale, avec un taux de croissance moyen annuel passant de 2,74 % entre 1985 et 1997, à 4,2 % entre 1998 et 2011. Il convient de se féliciter, en outre, de l’amélioration des inducteurs de création d’entreprises, de l’évolution positive des crédits à l’économie et de l’importante progression du niveau des investissements directs étrangers qui se situe entre 5,19 et 6,38 % du PIB pour l’espace OHADA, contre des valeurs comprises entre 3,90 et 4,27 % pour l’Afrique subsaharienne ». De même, le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2015 classe les États membres de l’OHADA parmi les dix pays les plus dynamiques(59).
28. Néanmoins, l’embellie économique tirée des effets bénéfiques des actes uniformes doit être relativisée. En effet, cette réalité n’est pas palpable dans tous les États parties. À titre illustratif, si la Côte d’Ivoire affiche en 2017 une croissance de son PIB de 8,4 %, la République de Guinée, le Sénégal, le Mali, ou le Burkina Faso caracolent quant à eux en tête du palmarès des pays les plus pauvres du monde avec un PIB ne dépassant pas la barre des 5 %. Au-delà des inégalités en termes de potentialités économiques, cette réalité s’explique en partie par le degré d’application des normes communes qui varie d’un État partie à un autre. Néanmoins, si le droit constitue un vecteur de développement économique, l’espoir est alors permis de voir les autres États parties réalisés dans les années à venir, les mêmes performances économiques enregistrées par les locomotives de l’OHADA.
29. La démarche atypique de l’OHADA qui consiste à « mettre la charrue avant les bœufs » est largement reprise dans d’autres grands ensembles économiques. Nous assistons aujourd’hui à un vaste mouvement d’uniformisation normative dans certaines régions du monde pauvre en investissements étrangers directs. À titre illustratif, il convient de souligner le travail du Professeur Filali Osman dans le cadre de la future lex mediterranea des investissements qu’il appelle de tous ses vœux. En effet, nonobstant la mise à jour des instruments juridiques favorables à l’accueil des investissements déjà amorcé dans certains États du sud de la méditerranée, l’objectif est d’aboutir à terme à la création d’un droit économique unifié au sein de l’UpM(60). Outre l’UpM,d’autres organisations d’intégration régionale comme l’OHADAC(61) ou l’EAC(62) emboîtent le pas à l’OHADA sur le chemin de l’intégration juridique au service du développement économique.
30. In fine, malgré un bilan quelque peu mitigé, l’OHADA s’inscrit indéniablement dans la logique d’une unification juridique à vocation purement économique. La volonté de stimuler la croissance économique dans le cadre d’une intégration juridique au sein d’un espace régional de libre-échange guide à tout instant l’action de l’OHADA(63). Par conséquent, ses instruments répondent à la nécessité de créer un espace économique propice à la circulation des capitaux suivant des normes simples et modernes. Gage d’une justice équitable et protectrice des investissements, l’orientation économique des règles communautaires traduit une réelle volonté de faire de l’OHADA un partenaire de choix dans les échanges commerciaux entre les économies du Nord et celles du Sud.
31. À partir de ces considérations liminaires, l’accomplissement de cet objectif sera d’autant plus facilité puisque, « de toutes les réalisations de l’OHADA, celles qui portent sur l’arbitrage sont à coup sûr les plus originales et les plus audacieuses »(64). L’œuvre d’unification portant sur la thématique de l’arbitrage constitue une réponse adéquate aux critiques formulées par les investisseurs sur la subordination des institutions judiciaires aux pouvoirs politiques et économiques(65). Répondant à des impératifs d’unité, d’uniformité et d’efficacité, le droit OHADA de l’arbitrage constitue indéniablement un pas de plus vers une meilleure sécurité juridique dans les échanges de biens et de services en Afrique subsaharienne.
32. Cela est d’autant plus vrai que les investisseurs qui s’intéressent à l’OHADA relèvent avec beaucoup de satisfaction l’existence d’une justice économique spécifiquement dédiée à l’investissement. Cette satisfaction est encore décuplée depuis l’entrée en vigueur du tout nouvel Acte uniforme relatif à la médiation(66). Aujourd’hui, avec l’adoption en 2017 du nouvel Acte uniforme relatif à la médiation, celui-ci est de moins en moins le parent pauvre, comparé à l’arbitrage qui a longtemps été l’enfant gâté des décideurs OHADA. De ce fait, même si la portée économique de l’arbitrage et de la médiation est encore difficilement appréciable du fait de l’absence de données statistiques fiables, l’idée d’une résolution du différend en dehors de l’appareil judiciaire fait de l’espace OHADA une destination de confiance pour les investisseurs.
33. Sur le plan juridique, traiter de l’efficacité de l’intervention du juge étatique dans l’arbitrage OHADA revient à prendre en compte son rôle dans la sécurisation de la convention d’arbitrage. À cette fin, la proximité entre le juge et l’arbitre se traduit par l’existence d’une dose de coopération qui se situe à la frontière entre la liberté de l’arbitrage et la contrainte qui caractérise la justice étatique(67). Plus précisément, les pouvoirs réservés au juge étatique ne sont pas concurrents de ceux de l’institution d’arbitrage, mais subsidiaires(68). Par conséquent, face à l’incapacité congénitale de l’arbitre de prendre certaines mesures susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, la participation du juge étatique à l’arbitrage est une véritable soupape de sûretécontre les justiciables récalcitrants(69). L’efficacité du système dualiste de l’arbitrage OHADA à travers l’intervention du juge étatique s’appréhende donc selon son degré d’insertion dans les systèmes juridiques nationaux disparates et pour certains fortement lacunaire. Pour ainsi dire, le juge étatique ne doit plus porter « sur l’arbitre ni le regard condescendant que l’on observe parfois sur un être inférieur ni le regard concupiscent porté sur celui dont on convoite le titre ou la fonction, mais simplement le regard fraternel de celui qui est son égal »(70).
34. Malgré la suprématie du droit communautaire des affaires sur le droit national, l’OHADA ne dispose pas d’outils propres à garantir son application. L’insertion du droit commun de l’arbitrage dans les États parties nécessite le concours des instruments juridiques du droit national(71). Pour rendre effectif le droit commun de l’arbitrage, le juge étatique doit pouvoir parfaitement coordonner la norme communautaire avec sa norme nationale. Il joue ainsi le rôle de passerelle entre le droit communautaire et le droit national. Ce faisant, avant le prononcé de la sentence arbitrale, le juge étatique est en quelque sorte le prolongement du Service public communautaire dans les États parties. En clair, en cas de difficultés, il revient au juge étatique la responsabilité de former le tribunal arbitral, de procéder à la récusation et au remplacement des arbitres défaillants, de statuer sur la demande de prolongation du délai d’arbitrage, l’administration des preuves et octroyer si nécessaire des mesures provisoires ou conservatoires.
35. L’efficacité juridique traduit aussi la volonté de faciliter l’insertion de la sentence arbitrale dans l’ordre juridique des États parties au Traité de l’OHADA(72). L’objectif est de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des sentences arbitrales par la CCJA ou le juge national de l’État partie. À ce titre, lorsque la sentence arbitrale est prononcée, l’intervention du juge étatique s’affranchit du cadre ordinaire d’une simple assistance subsidiaire pour prendre la forme d’une véritable mission de contrôle. L’examen qu’exerce le juge étatique sera l’occasion pour lui de vérifier que la sentence arbitrale, objet de la demande d’exequatur est le fruit d’un arbitrage mené dans le respect de la volonté des parties et des principes fondamentaux de la justice.
36. De la même manière, dans le prolongement de sa mission de contrôle, le juge de l’annulation veille à ce que la sentence soit l’œuvre d’un tribunal arbitral normalement constitué. En plus d’être assortie d’une motivation pour être valablement exécutoire, la sentence arbitrale se doit aussi être en conformité avec le principe du contradictoire et l’ordre public international de l’État requis. Reflet d’« une méfiance des parties contre elles-mêmes, en supposant l’incompétence ou des négligences dans l’organisation de leur propre juridiction »(73), une fois saisie d’un recours en annulation, le juge du contrôle sanctionne les comportements relatifs à la violation des droits fondamentaux comme le principe du contradictoire, le principe d’impartialité et d’indépendance de l’arbitre, le principe de confidentialité, etc. Plus précisément, le recours en annulation vise à rectifier les erreurs et injustices les plus grossières. De cette manière, le juge du contrôle s’assure ainsi du respect par le tribunal arbitral des deux composantes juridictionnelle et contractuelle sur lesquelles a été construit tout l’ordre juridique arbitral(74).
37. De même, lorsque la sentence arbitrale comporte des carences, le juge étatique dispose du pouvoir d’interpréter ou de rectifier les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent. Cela dit, en optant pour un arbitrage, les plaideurs font en principe le choix d’une procédure rapide sanctionnée par une décision de justice susceptible d’exequatur. Toutefois, il arrive que celle-ci soit obscure ou entachée de certaines irrégularités empêchant sa mise en application. Conscient de cette réalité, le législateur communautaire organise en amont un mécanisme de contrôle curatif destiné à débarrasser la sentence de tous les handicaps susceptibles d’entacher sa régularité et par conséquent hypothéquer sa bonne exécution. Il s’agit en effet, des procédures de contrôle curatives prévues au sein du droit communautaire de l’arbitrage qui ne feront toutefois pas partir de notre étude. Néanmoins, on en distingue principalement deux : la demande d’interprétation de la sentence et la demande en rectification des erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent. À cette fin, les articles 22 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 26 du Règlement d’arbitrage de la CCJA organisent la procédure à suivre pour présenter l’une quelconque de ces deux procédures devant le juge étatique en cas d’indisponibilité du tribunal arbitral.
38. Pour atteindre l’efficacité économique en se servant de l’efficacité juridique, la mise en application des instruments relatifs à l’arbitrage dans les officines internes constitue un réel enjeu pour les États de l’OHADA(75). Comme indiqué précédemment, « la sécurité juridique procurée par l’uniformisation du droit ne suffit pas. Encore faut-il assurer la sécurité judiciaire de leur application »(76).Autrement dit, pour rendre les économies de l’OHADA beaucoup plus attrayantes, l’adoption d’un corpus de règles uniformes et modernes ne suffira pas(77).Les investisseurs sont aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain, particulièrement sensibles à la manière dont ce droit sera appliqué au sein des États parties(78). Il s’agit là de tout l’enjeu qui se dresse sur le chemin de l’OHADA, car « les investisseurs ne viendront pas en Afrique du seul fait de l’existence d’un droit des affaires moderne et harmonisé. La façon dont les juridictions appliquent ce droit incitera ces investisseurs soit à venir, soit à se détourner de l’espace OHADA »(79).
39. Pour ainsi dire, la recherche de la compétitivité économique suppose en somme, l’assurance d’une justice arbitrale dont les décisions seront rendues sur la base d’un mécanisme juridictionnel lisible et prévisible pour l’ensemble des utilisateurs. L’arbitrage étant le mode privilégié de résolution des différends au sein de l’espace de l’OHADA, il existe une certaine convergence entre l’efficacité économique et l’efficacité juridique. En assurant l’efficacité juridique de la convention d’arbitrage, le juge étatique se fait l’auxiliaire du droit communautaire. En raison de son action, il contribuera à lever tous les obstacles à la résolution des différends commerciaux en dehors des appareils judiciaires. Ainsi, l’existence d’une justice arbitrale forte participe à l’attractivité économique de l’espace de l’OHADA. Les investisseurs ne craindront pas en cas de différend de devoir faire face à l’insécurité judiciaire qui « se manifeste de façons très diverses : décisions contestables, décisions en délibérés depuis plusieurs années, exécutions impossibles, négligences diverses, méconnaissance des règles de déontologie, accueil des moyens dilatoires les plus évidents et renvois à répétition qui finissent par décourager les demandeurs de bonne foi »(80). Par conséquent, la sentence arbitrale qui constate l’existence d’une créance, laquelle constitue un investissement comme l’ont déjà consacré les tribunaux arbitraux en matière d’investissement connaîtra un exequatur effectif. L’efficacité juridique tirée de l’assistance du juge étatique pour la consolidation de l’arbitrage OHADA devrait mécaniquement conduire à l’augmentation du niveau des investissements étrangers direct.
40. Malheureusement,dans la pratique les parties à un arbitrage de l’OHADA sont souvent démunies lorsqu’elles sollicitent le soutien du juge étatique. Contrairement aux autres systèmes juridiques organisant l’intervention du juge étatique dans l’arbitrage, celui de l’OHADA souffre de nombreuses imperfections. En prenant en compte les difficultés qui se posent lors de sa détermination et les contraintes inhérentes aux conditions d’accès à son prétoire, le recours au juge étatique pour la consolidation de l’arbitrage OHADA n’est pas une chose aisée. En matière d’organisation judiciaire, le tour d’horizon détaillé des règles attributives de compétence au sein du droit communautaire nous permet de constater que le Traité de l’OHADA procède à une sorte d’imbrication de plusieurs ordres judiciaires étatiques agissant sous l’autorité d’une Cour supranationale de cassation.
41. Dans cette configuration, si l’on se trouve dans un arbitrage de droit commun, le juge national aura vocation à intervenir dès les premiers incidents liés à l’introduction de la demande d’arbitrage jusqu’à l’épuisement du recours en annulation contre la sentence. Une fois cette étape franchie, il s’efface naturellement au profit du juge communautaire de la CCJA. Ce dernier, en plus d’une compétence quasi exclusive dans le cadre de l’arbitrage spécifique, dispose aussi du monopole en matière de pourvoi en cassation formulé contre la sentence arbitrale de droit commun. Sur ce dernier point, il s’agit d’une règle d’ordre public, car aucun différend relatif à l’application du droit communautaire ne saurait prospérer directement devant la CCJA sans avoir préalablement été porté à l’appréciation du juge national(81).
42. Schématiquement, on remarque qu’en fonction des différentes phases du contentieux et surtout selon le type d’arbitrage, le législateur communautaire fixe une nette démarcation du temps d’action et du domaine d’intervention propre à chacune des juridictions. En première et en seconde instance, la mise en application du droit commun de l’arbitrage relève spécifiquement de la compétence des « juridictions d’instances »(82) et d’appels(83). La gestion de l’arbitrage institutionnel et le contentieux en dernier ressort en matière d’arbitrage de droit commun sont confiés aux juges communautaires de la CCJA. Plus précisément, dans le système dualiste de l’arbitrage OHADA les juridictions internes jouent en amont le rôle de juge du fond dans l’application du droit commun de l’arbitrage. La CCJA, quant à elle, concomitamment au fait d’être son propre juge d’appui et de contrôle fait également office en aval de juge de cassation communautaire pour les sentences arbitrales de droit commun.
43. La création au niveau communautaire d’une hiérarchie juridictionnelle présuppose naturellement une application facilitée des textes communautaires relatifs à l’arbitrage. Pourtant, dans la pratique, force est de constater qu’il est particulièrement périlleux pour un plaideur professionnel ou non, de s’aventurer dans les méandres du système dualiste de l’arbitrage OHADA lorsqu’il est question pour lui d’identifier et d’accéder au prétoire du juge étatique garant de l’efficacité de son application. Se trouvant en terrain miné, il sera d’une part, confronté à un acte uniforme imprécis dans sa formulation et dont l’application est tributaire d’une ribambelle de textes pour la plupart vétustes et largement contradictoires. D’autre part, il n’échappera pas non plus au Règlement d’arbitrage de la CCJA dont le contenu est certes relativement précis, mais susceptible tout de même d’engendrer de nombreuses difficultés eu égard à la juxtaposition de compétences antinomiques au bénéfice d’une seule et même juridiction.
44. Premièrement, si l’on se réfère à l’Acte uniforme qui organise la pratique de l’arbitrage de droit commun, on constate un usage rentamé de l’expression générique juridiction compétente dans l’État pour désigner le juge d’appui et de contrôle. Aussi bien au niveau de l’appui nécessaire avant et pendant l’arbitrage qu’à l’exécution de la sentence, l’Acte uniforme n’apporte aucune précision sur l’identité de l’autorité étatique devant coopérer avec les parties et le tribunal arbitral. Dans ces conditions, l’identification du juge d’appui et de contrôle de l’arbitrage de droit commun demeure une tâche laborieuse. D’autant que, sur le plan processuel chaque État partie dispose d’une organisation judiciaire et des règles de procédures qui lui sont propres. Cette situation entretient, à n’en pas douter, l’existence d’une multitude d’acteurs locaux susceptibles de connaître du contentieux arbitral en première et seconde instances.
45. Toutefois, l’usage de l’expression générique juridiction compétente dans l’État partie en matière d’arbitrage de droit commun, quoiqu’imprécise dans sa formulation, se justifie d’abord par l’absence d’un cadre processuel commun découlant de la conception restrictive du périmètre d’uniformisation. Ensuite, guidé par l’impérieuse volonté d’alléger les règles applicables à l’arbitrage, le législateur communautaire a jugé nécessaire de maintenir les dispositions non contraires des codes de procédure civile et commerciale en vigueur dans les États parties. Enfin, même si cela n’est pas sans conséquence sur une entité juridique construite autour d’un traité multilatéral impliquant des systèmes judiciaires disparates, l’action normative des États constitue a priori le remède idéal pour juguler les effets négatifs du terme générique.
46. Néanmoins, quoique justifiées, ces différentes imprécisions sont d’une part de nature à phagocyter l’intervention du juge national dans la procédure arbitrale de droit commun et d’autre part, rendent inefficace son intervention. Ainsi, lorsqu’un plaideur manifeste le désir dans ces États de porter son action devant l’office du juge national, plusieurs questions relatives à la compétence ratione materiae et à la compétence ratione loci dudit magistrat demeureront un véritable casse-tête pour lui. Tout d’abord, il sera légitime qu’il se demande si « la juridiction compétente » visée dans l’État partiepar l’Acte uniforme est celle du domicile respectif des parties ou a contrario s’agit-il de celle du lieu où siège le tribunal arbitral ou bien celle du lieu où l’exécution de la sentence sera sollicitée. Ensuite, une fois cette question réglée, devra-t-il saisir une juridiction d’instance, un tribunal de commerce, ou simplement une cour d’appel ?
47. Pour répondre à toutes ces questions, il nous a été loisible de procéder par un raisonnement juridique analogique. En effet, conformément au critère de rattachement retenu par l’Acte uniforme, la notion de juridiction compétente dans l’État partie fait référence à l’autorité judiciaire du lieu où siège le tribunal arbitral. Par conséquent, cela nous autorise à écarter d’office les juridictions respectives du lieu de résidence des parties au profit de celles du lieu du siège du tribunal arbitral pour toutes les questions relatives à l’assistance. Cette solution se justifie par le fait que le siège du tribunal arbitral constitue le domicile conventionnel des parties.Ramassant notre pensée en une formule brève, nous dirons que la compétence territoriale du juge d’assistance ne dépendra pas du domicile respectif des plaideurs, mais de « sa proximité avec le lieu où se déroule l’arbitrage »(84). De plus, lorsqu’une partie entend faire exécuter une sentence arbitrale, le juge d’exequatur





























