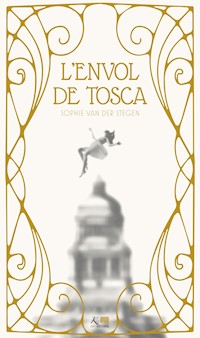
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Lorsqu’Alina, adolescente désabusée, accepte un petit boulot à l’opéra à l’occasion d’une première de Tosca, elle est loin d’imaginer que cette soirée bouleversera sa vie.
Comme par un jeu de dominos, ce même soir, Anita, veuve richissime et solitaire, replonge brutalement dans les brumes d’une passion ancienne.
Quant à Hélène, sous-directrice du théâtre et jeune mère au bord du burn-out, elle se trouve contrainte à une enquête qui est bien au-dessus de ses forces.
Pour elles, comme pour Tosca, leurs choix auront des conséquences dramatiques et la liberté se paiera au prix fort.
Trois destins s’entremêlent dans ce roman choral où plane l’ombre de Puccini, compositeur génial et criminel.
Prix du roman noir de la Foire du livre de Bruxelles 2023.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Quand l’autrice nous rappelle qu’un livret d’opéra n’est qu’un roman noir chanté, et nous fait passer de la fosse d’orchestre à la fosse aux lions." - Michel Claise
"Une autrice qui fait ses gammes et nous livre un premier roman sans fausse note !" - Michel Dufranne (RTBF)
"Tout ce qui brille n’est pas or : l’adage se décline de multiples façons dans ce roman noir en forme d’Opéra de quat’ sous finement ciselé." - Jacques de Pierpont
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née à Bruxelles, Sophie van der Stegen est dramaturge. Elle a fondé la compagnie théâtrale Artichoke dans le but d'ouvrir la musique classique à tous les publics, à commencer par les plus jeunes. Né de sa passion pour l'opéra, L'envol de Tosca est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ouverture
Au moment où son corps a basculé dans le vide, un cri de mouette a transpercé le ciel, comme un long point d’interrogation. Ensuite, il s’est transformé en séquences plus courtes, pareilles à des protestations, pour finir en ricanements saccadés, presque convulsifs.
À croire qu’un metteur en scène avait accordé à son âme de s’évader au moment où elle tombait et de migrer dans l’oiseau. Dans une sorte de métempsycose in extremis, à l’instant où son enveloppe humaine s’écrasait sur le sol, elle-même étendait ses ailes au-dessus des toits, libre et stupéfaite.
Peut-être, entre le haut de la tour et le sol, dans l’arc de ces secondes finies et infinies à la fois, a-t-elle compris que sa mort serait l’étincelle susceptible de mettre le feu aux poudres. Peut-être cette prise de conscience l’a-t-elle soulagée. Peut-être a-t-elle même provoqué cette crise de rire nerveux.
Sa voix s’est tue et l’obscurité s’est soudain emplie de clameurs.
Car le cri de la mouette qui ponctue le dernier acte de son histoire, en inaugure également le récit.
Acte I
septembre 2019
1
Depuis quelques minutes, Alina, le dos raide, fixe l’affiche accrochée au mur. Une blonde y sourit toutes dents dehors. Osez croire en vos rêves ! Elle tient les bras croisés, un foulard jaune vif lui garrotte le cou. Ses pupilles brillent d’une joie hypocrite. Join the Promogirls team! ajoute-t-elle dans un anglais commercial aussi laid qu’universel.
Osez croire en vos rêves… Qui a inventé ce slogan débile ? Alina reporte son attention sur le formulaire qu’elle a reçu en arrivant : trois dizaines de questions pour mieux cerner le profil du candidat. Alina ricane. Comme s’ils avaient besoin d’autres qualités que celle de potiche.
Son regard dérive vers ses chaussures, des copies de Converse offertes par sa mère. Les pluies des derniers jours ont eu raison de leur plastique. L’été se termine comme il a commencé : en apocalypse. Les extrêmes de la météo surprennent, dans un pays habitué à la monotonie d’un ciel terne et bas. La mère d’Alina répète qu’elle n’a jamais vu ça. À qui la faute ? rétorque sa fille. Née au tournant du millénaire, Alina impute à la génération précédente la responsabilité du mal qui mènera la sienne dans le mur.
Comme pour le travail. Ou plutôt, le manque de travail.
Alina examine les baskets sales, son jean délavé, son pull noir… Pas terrible pour une première interview. Une soudaine envie de fuir l’envahit. Puis une vague de haine. Elle relève les yeux. Deux rangées de chaises orange sont alignées le long des murs blancs. Au centre, une table basse couverte de magazines avec leurs promesses de vie réussie. « Comment construire une carrière au féminin ? », « Les dix bonnes pratiques du manager empathique », « Concilier travail et famille : le défi d’aujourd’hui ! »
Une porte sépare la salle d’attente du bureau de l’employée qui lui a ouvert. Au mur, la fille continue de sourire dans sa pose inquiétante.
Bon. D’abord, les questions basiques.
Nom : Mertens – Prénom : Alina – Date de naissance : 11/09/2001
Comment avez-vous eu connaissance de notre entreprise ?
Des voix proviennent de l’autre côté de la porte. Alina jette un coup d’œil à son téléphone. Ça fait vingt minutes qu’elle attend. Ah, si on pouvait l’oublier ! Mais que dirait sa mère ? C’est elle qui l’a incitée à se présenter – elle complète : « ma mère ».
C’était le soir de son anniversaire, deux semaines plus tôt, alors qu’elles entamaient le gâteau au chocolat que Stefania lui infligeait chaque année, depuis dix-huit ans.
– Quand je pense que tu es née le onze septembre ! Le jour des attentats ! répétait-elle en retirant une à une les bougies qui fumaient encore. Je regardais la télévision entre deux contractions ! Je voyais les tours s’écrouler et je me disais : mais dans quel monde elle arrive, ma fille ?
Stefania avait tendance à devenir sentimentale chaque fois qu’elle évoquait cette date. Pendant qu’elle parlait, Alina déballait ses Converse et exécutait son numéro de fille reconnaissante. Stefania lui avait alors tendu un prospectus brillant.
– Tiens, regarde !
Elle avait décelé une pointe d’appréhension chez sa mère et s’était mise sur la défensive, par réflexe, avant de prendre le papier du bout des doigts.
« Tu es dynamique, organisée, motivée ? Alors, rejoins nos équipes ! Événements, promotion, marketing : il y en a pour tous les goûts ! Vitamin, un vrai coup de jeune à l’événement ! Osez croire en vos rêves ! »
Tous ces points d’exclamation.
Sa mère fixait sur elle des yeux suppliants.
– C’est un collègue qui m’en a parlé. Micka. Mickaël, je veux dire. Sa fille y travaille régulièrement. Il dit que c’est une boîte sérieuse, idéale pour un job d’étudiant. En attendant de trouver ta voie…
Et ces points de suspension.
Depuis quelque temps, leur relation s’était mise à ressembler à un jeu de l’oie, où chaque case formait une étape de dispute : reproche, colère, rancœur, bouderie. Elles passaient de l’une à l’autre dans le désordre, quel que soit le résultat des dés, pipés dès le début.
Alina s’était resservie d’une deuxième tranche de gâteau brûlé, par pur masochisme. Nul, cet anniversaire. Les autres avaient des amis. Elle n’avait que Stefania et ses ratages au fourneau comme en amour.
– Il suffit d’envoyer ton curriculum vitæ.
Alina avait éclaté d’un rire méprisant. Qui utilise encore ce mot ? D’ailleurs : de quel curriculum vitæ parlait-on ? L’école ?
Sa mère s’était vexée. La phase suivante pouvait s’amorcer.
– Tu dois quand même savoir ce que tu veux faire de ta vie !
Alina pouvait anticiper chaque réplique. Une bouchée après l’autre, les yeux dans le vague, elle s’efforçait d’avaler l’amas de crème et de biscuit. Quelle absurdité de parler de tout cela autour d’un gâteau, parce qu’on estime qu’il est temps de gagner sa vie en la perdant. La seule chose dont elle était convaincue, à ce stade, c’est qu’elle voulait bien tout faire, sauf bosser chez les flics.
Elle avait crié cette dernière phrase sans s’en rendre compte. Stefania l’avait fixée, la bouche ouverte.
– Comment oses-tu dire ça ? Après tout ce que j’ai fait ? Toute seule.
La voix de Stefania tremblait. Son pion avait atterri sur une nouvelle case. Culpabilisation. Alina avait craché :
– T’avais qu’à pas me faire avec un connard !
Elles s’étaient toisées au-dessus des ruines de la fête. Stefania avait détourné les yeux la première, enfilé sa veste et quitté l’appartement. L’absence de père était le tabou qui cimentait leur relation. Alina ne savait pas grand-chose de lui. Sa mère l’avait rencontré pendant des vacances au Maroc, il l’avait suivie en Belgique et larguée avant la naissance. Il était devenu chauffeur de tram. C’était du moins ce qu’elle avait compris.
Une fois seule, Alina avait jeté les restes de gâteau dans la poubelle, mais pas le dépliant. Puis l’idée avait fait son chemin. Gagner de l’argent, ce ne serait pas mal. Elle pourrait déménager. Voyager ! Voilà comment elle avait fini par l’envoyer, ce foutu CV. Et voilà comment elle sèche à présent sur ce maudit formulaire – le genre de document qui essaie d’enfermer les gens dans des cases dont, par définition, ils débordent.
À cet instant, la porte du bureau s’ouvre. Une fille s’en échappe, silhouette diaphane. Alina se sent par contraste dotée du charme d’un crapaud. L’employée surgit à sa suite. Sa voix chantonne comme une annonce d’aéroport.
– Alina Mertens ?
Elle l’introduit dans son bureau, éclairé de sa petite lampe. Le halo terne accentue les cernes de la jeune femme, non seulement blonde, mais également enceinte jusqu’au cou.
– Pardon pour le manque de lumière, dit-elle. Je déteste les néons. Installe-toi.
Elle contourne la table et se laisse tomber en soutenant son ventre.
– Ouf, fait-elle en soufflant. Bon, je suis Adèle, le point de contact des intérimaires chez Vitamin. C’est moi qui gère les plannings. Entre autres.
Alina lui tend sa feuille.
– J’ai pas vraiment fini…
Adèle esquisse un sourire, où Alina croit percevoir une pointe de condescendance.
– Nous allons continuer ensemble. Tu parles néerlandais ? Anglais ?
– Heu, pas très bien.
Suffisamment pour indiquer l’emplacement des chiottes, pense la jeune femme, mais elle garde ses sarcasmes pour elle. Adèle se contente de cocher la case correspondante.
– Permis de conduire ? Voiture ?
Alina secoue la tête.
– Je roule à vélo.
Dans la pénombre, le ronron des questions l’engourdit peu à peu. Les ongles roses d’Adèle claquent sur son clavier à mesure qu’elle note les réponses.
– Donc, si je résume, tu viens de finir l’école et tu n’as aucune expérience, récapitule-t-elle. Mais tu es motivée. C’est bien ça ?
– Oui, oui, hyper motivée.
Adèle repousse sa chaise et s’écarte de son bureau. Elle caresse son immense ventre comme par mégarde. Son regard paraît tourné vers l’intérieur.
– Voilà comment ça marche, dit-elle. J’envoie des propositions par SMS. First arrived first served. L’intérimaire vient chercher son uniforme ici et le rapporte après. Parfois, le client le fournit sur place.
Adèle dévisage Alina et s’interrompt. Elle hésite.
– À ce sujet… Tu portes toujours le… foulard ?
Alina sursaute. Elle ne s’attendait pas à cette question.
– Ce métier implique un contact visuel constant avec le client, précise Adèle en détachant chaque mot. Les signes religieux ostentatoires ne sont pas souhaités. Ni souhaitables, d’ailleurs. Il ne faut pas heurter les sensibilités.
– Ce n’est pas un signe religieux. Pas pour moi, en tout cas. Je ne suis pas musulmane.
– Ah ?
La réponse déroute Adèle. Impossible de lui exposer en deux minutes les raisons pour lesquelles Alina a choisi de porter le foulard dès l’âge de quinze ans. Par exemple, l’impression que ce bout de tissu lui permet de disparaître, comme un vêtement magique. Sous son voile, la vraie Alina est libre de devenir invisible.
Une autre raison – et non des moindres – est que sa mère déteste ce choix.
– Bon, c’est mieux, dit Adèle, en plissant des yeux. Enfin, je veux dire, moi, ça ne me dérange pas. Je n’ai rien contre. Mais il vaut mieux l’enlever quand tu travailles.
Adèle est sauvée par le téléphone qui sonne à ce moment précis.
– Allo ? (…) À l’opéra Belvédère ? (…) Une dame de cour ?
Ses ongles claquent – elle grimace.
– Une seule ? Attendez une seconde !
Elle couvre le combiné et s’adresse à Alina :
– Tu es libre ce soir ?
*
Hélène Jolly consulte son téléphone. Il est dix-huit heures, et c’est l’ouverture de saison. Autant dire qu’elle va être en retard si François Leloup la laisse encore poireauter longtemps. De la pointe de sa chaussure, elle suit les lignes du parquet. Il y a un nom pour ce type de motif, mais lequel ? Pourvu que personne ne la voie. On penserait qu’elle écoute aux portes. La lumière du couloir s’éteint, la sort de sa torpeur. Elle frappe un peu plus fort. Hélène soupçonne le directeur de la faire lanterner à dessein. Avec son classeur pressé contre la poitrine, sa jupe plissée et son foulard autour du cou, on dirait une lycéenne convoquée chez le préfet. Elle inspire un grand coup, se convainc qu’elle a entendu la permission et pousse la porte.
Leloup est au téléphone : il la regarde comme s’il avait oublié qui elle était. Il arbore sa pose préférée : une main de fer dans un gant de velours. Alangui dans son fauteuil dont il fait rebondir le dossier avec nonchalance, il tient une jambe croisée sur l’autre, à angle droit. Il serre le combiné contre son début de barbe et plonge les doigts dans sa chevelure.
– Le gala d’ouverture… minaude-t-il. Ce soir, oui. En présence de Sa Majesté ! Je compte sur vous, donc ? Vous ne pouvez pas manquer cela !
Il plisse les lèvres et inspecte ses ongles bien taillés. Hélène s’approche et se pose au bord du fauteuil qui lui fait face. À soixante ans, François Leloup est ce qu’on appelle un homme dans la force de l’âge, expression qui semble faite pour décrire ce type de personnalités masculines à qui on reconnaît encore un certain capital de séduction, malgré le début de bedon éventuel. Ses traits sont fins et sa bouche dessine un arc légèrement dédaigneux, en écho à ses sourcils noirs. Hélène le soupçonne de les épiler pour qu’ils aient cet aspect net, alors que ses cheveux virent au poivre et sel – autre formule qui flatte cette catégorie d’hommes, parce qu’elle présuppose qu’ils en sont encore pourvus.
La conversation tire en longueur. Hélène se sent prise en otage dans une sorte d’intimité faussement consentie, comme si c’était un traitement de faveur. Tandis qu’il décrit à son interlocuteur invisible les multiples projets auxquels son argent pourrait contribuer, elle observe les murs, tapissés d’affiches de productions passées. Près de quinze années de carrière dans cette maison la contemplent, avec ses bons et moins bons souvenirs. Ses instants vécus avec dévouement. Avec passion.
Où est-elle, aujourd’hui, cette passion ?
Ces derniers temps, elle éprouve souvent la sensation de relever la tête pour la première fois depuis des années. Un temps fou s’est écoulé et tout a changé, sans elle. Pareille à la princesse de Grimm, restée emmurée pendant sept années qui ne reconnaît plus rien à sa sortie. Hélène se sent ensevelie sous les grains d’un sablier qu’on aurait retourné sans la prévenir.
Lorsqu’on l’a engagée, ce poste lui paraissait inespéré, comme taillé sur mesure. Une maison d’opéra consacrée à l’œuvre de Puccini, alors qu’elle venait de finir un mémoire consacré au compositeur ! C’était presque trop beau pour être vrai. Dans le milieu de la culture, il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Elle s’est démenée pour prouver qu’on avait eu raison de lui faire confiance. Le développement impressionnant de l’institution est en grande partie dû à ses efforts, pense-t-elle secrètement. L’opéra Belvédère, inauguré en 2001 après des décennies de fermeture, est devenu en très peu d’années un théâtre de référence sur la scène internationale, non seulement grâce à la qualité des choix artistiques, mais aussi au dynamisme et à l’originalité des initiatives culturelles portées par François Leloup et son équipe.
Arrivée à ce stade, au moment d’aborder la saison 2019-2020, Hélène a tout, en théorie, pour se réjouir avec son directeur. Mais ce qu’elle ressent est nettement plus ambigu. Il lui semble que les choses patiemment construites se délitent et qu’elle n’a aucun pouvoir pour les retenir. Elle ne sait pas si cette crise est externe à elle ou interne, et se demande si le titre de son mémoire n’annonçait pas déjà l’éloignement que lui impose François Leloup depuis quelque temps. « Sacrifice de femmes ou femmes sacrifiées ? L’image de la femme forte dans l’œuvre de Giacomo Puccini à l’exemple de Tosca. »
Quelle ironie.
Elle contemple le bureau, les affiches, les moulures, et la fenêtre qui découpe la silhouette de Leloup en contre-jour. À quel moment le décalage s’est-il opéré ? Cette impression de vivre à l’extérieur de sa propre peau ?
François raccroche violemment. Hélène tressaille.
– Quelle vieille chieuse, celle-là ! Hélène, à l’avenir, il est indispensable d’envoyer l’invitation à toutes ses adresses : même sur l’île Maurice s’il le faut ! Nous ne pouvons nous permettre de perdre une seule donatrice lors de notre collecte de fonds. Ce n’est pas à toi que je dois l’expliquer !
Hélène hoche la tête. La pression que François Leloup subit lors de cette première soirée ferait perdre patience aux meilleurs. Le budget de l’opéra Belvédère repose en grande partie sur le soutien privé, ce qui force à certaines concessions. Par exemple : se farcir Puccini saison après saison – ce compositeur qu’il trouve atrocement bourgeois (ainsi qu’il le lui a avoué, un jour où il avait trop bu). Après tant d’années dans la même maison, François Leloup rêve d’évasion. Il se verrait bien à la direction d’une maison plus prestigieuse. Plus audacieuse. Avec davantage de subventions publiques aussi. Hélène sait qu’il y travaille, en secret. Sans résultat jusqu’à présent.
François l’observe en dessous de ses sourcils touffus. Son regard bleu la transperce :
– Tout est en ordre pour ce soir ?
Hélène se sent rougir et baisse les yeux vers ses documents pour y trouver un réconfort, ou une béquille.
– Je pense, oui.
– Comment ça : je pense ? ironise-t-il. C’est en ordre ou pas ? Revoyons ensemble le déroulé. Sept heures cinquante : arrivée de la reine. A-t-on bien spécifié de libérer le parking devant l’esplanade ? Bien entendu, j’accueille Sa Majesté et je la conduis vers sa loge. As-tu prévu une coupe de champagne pour la détendre ? Je monte sur scène pour mon discours à huit heures pile. Ensuite, Tosca, première partie, entracte, Tosca, deuxième partie, puis gala de charité et tombola. Fin des festivités vers une heure du matin.
Il est satisfait de sa soirée, qu’il envisage comme une succession d’événements s’enchaînant sans accroc, par la force de son bon vouloir.
– Essayons cette fois de ne pas prendre de retard, ajoute-t-il avec un sourire narquois.
Pas besoin de rappeler le chaos humiliant de la dernière ouverture de saison, parce qu’on avait perdu le ténor chinois deux minutes avant le lever de rideau.
Le téléphone sonne à nouveau et François décroche sans attendre. Hélène se met à observer les gouttes de pluie sur la fenêtre, qui atterrissent et se traînent en diagonale, pour finir par une pointe qui tremble. Elle aurait voulu les suivre du doigt, comme dans son enfance, lors des trajets en voiture interminables.
Le directeur raccroche, surprend son regard.
– Tu as prévu des parapluies pour les invités ?
– Je vérifie.
– Heureusement que je suis là pour réfléchir ! sourit-il.
Hélène hoche la tête en silence et fait mine de consigner ce qu’il dit. Ce n’est pas nécessaire, car elle possède une bonne mémoire, mais elle veut donner l’image d’une collaboratrice efficace. Une fois de plus, elle est étourdie par la sensation de se réveiller d’un long sommeil. Toutes ces années, elle a cru qu’elle était trop jeune ; à présent, elle a l’impression d’être trop vieille. La frontière qu’elle a franchie sans s’en rendre compte constitue une ligne de démarcation infime entre deux états opposés : immature – périmé. Comme un avocat trop vert qui soudain pourrit.
– Repassons dans mon discours, dit alors Leloup en se levant.
Homme très mobile, il ne tient jamais en place plus de quelques minutes. Hélène plonge dans son dossier, en tire la feuille qu’elle a imprimée, qu’elle tend à son supérieur.
– Lis-le plutôt, dit celui-ci en regardant par la fenêtre.
Hélène s’éclaircit la gorge.
– L’opéra, un monde de rêves ! Elle s’interrompt. Je pourrais essayer un slogan en anglais ? A dream to share, par exemple ?
Il secoue la main.
– Nous devons rester compréhensibles pour notre public.
– OK, répond Hélène en biffant la proposition. Le petit théâtre Belvédère est né du rêve d’une femme visionnaire après sa rencontre avec Puccini Aujourd’hui, près de cent ans plus tard, le rêve de cette généreuse bienfaitrice se renouvelle encore. Cette saison en est le témoin. Le rêve continue… comme le désirait notre fondatrice.
– Prune de Bouteye.
– Pardon ?
– Prune de Bouteye. Il faut énoncer son nom en entier. Tout le monde ne la connaît pas forcément. D’ailleurs, tant que j’y pense : a-t-on de potentiels donateurs dans la salle, ce soir ?
– Anita van Dornen vient avec une amie, Léa Quelquechose, une Française qui habite à Bruxelles depuis peu. Je les ai placées pas très loin de la loge royale.
– C’est très bien, continue.
Hélène reprend sa lecture :
– Floria Tosca, seule artiste authentique dans cet opéra, succombe à cause d’un pouvoir politique tyrannique. Preuve, s’il en faut, que les rêves d’artistes ont besoin d’être soutenus. Ainsi, chers amis, le Théâtre ne peut survivre sans vous !
François Leloup l’interrompt.
– Qui a dit que Tosca était la seule artiste dans cette histoire ?
Hélène est surprise par l’objection de son supérieur. D’habitude, il lui laisse carte blanche.
– Elle est la seule à proclamer ne vivre que pour son art. C’est pour ça qu’elle meurt, explique Hélène, la bouche sèche.
– Elle meurt par amour.
– À cause du patriarcat, rétorque-t-elle.
– Soit, soupire François Leloup. Mais penses-tu vraiment que la reine vienne pour un débat féministe ? Et nos mécènes ? Personne ne connaît l’histoire, de toute façon. On n’est pas là pour donner des leçons. Je ne parle même pas du metteur en scène qui a transposé l’action dans une banlieue américaine. Trouve une formule sobre, comme : Rejoignez-nous et soutenez le projet de notre théâtre pour que la musique de Puccini continue de résonner dans la ville où il mourut, il y a presque cent ans.
Hélène griffonne rapidement quelques notes fictives sur son document. Il y a un silence.
– Tu as encore besoin de moi ?
– Oui, une dernière chose.
Il contourne son bureau jusqu’à elle. De la poche de sa veste, il tire un morceau de tissu.
– Peux-tu m’aider à nouer ma cravate ? Je ne m’en sors pas.
Hélène avale sa salive. Elle se lève pour se mettre au même niveau que lui, mais son front arrive à ses épaules. François penche la tête tandis qu’elle passe le bout de ruban autour de son cou et s’applique à effectuer le nœud. L’haleine du directeur sent le chewing-gum.
– Voilà. Hélène a un petit rire nerveux. On forme un puits, le serpent tourne autour de l’arbre et il pénètre dans le puits.
Elle répète le moyen mnémotechnique qu’on lui a appris. Les mots lui semblent soudain obscènes et elle rougit.
– Hum. Le serpent ressort du puits, on serre, et c’est fait !
– Merci, dit François d’un air goguenard. Ça devrait entrer dans mon cerveau, avec cette parabole biblique !
Son souffle effleure le visage d’Hélène. La situation se prolonge, la gêne devient insoutenable. À cet instant, il lui décoche un sourire, se détourne et contourne son bureau.
– Allez, dépêche-toi ! Tu ne vas quand même pas accueillir la reine dans cette tenue ! Et enlève-moi ce foulard, tu es beaucoup trop jeune pour ça !
Il s’assied et se plonge dans ses e-mails.
Hélène se retrouve dans le couloir sans savoir comment. Il lui semble que la vraie Hélène s’est évaporéeet que seule subsiste cette jupe affreuse qu’elle lisse avec rage. Son regard tombe à nouveau sur le parquet. À bâtons rompus ! Voilà comment on appelle ce motif. Elle hausse les épaules. Il est presque dix-neuf heures. Elle doit encore corriger le discours, briefer les équipes et rafraîchir son maquillage.
*
L’horloge du tableau de bord brille en rouge dans la pénombre de la voiture. Assise sur la banquette, Anita van Dornen tremble d’une émotion qu’elle éprouve si rarement qu’elle en est elle-même surprise : la colère. D’ordinaire, elle est le genre de femme qu’on qualifie de « charmante », parce qu’on pense que l’argent rend son existence douce et qu’elle se comporte ainsi par habitude. C’est sûr, je vais manquer le premier acte à cause de cette égoïste de Léa. C’est la dernière fois qu’elle invite quiconque à l’opéra. Elle avait agi par pur esprit de corps ; Léa était Française et venait de s’installer à Bruxelles. Elle ne connaissait personne. Anita avait proposé de l’introduire.
Elle aurait mieux fait de s’abstenir.
Malgré une vie de mondanités, il lui arrive encore de souffrir de trac à l’idée de sortir seule, maintenant qu’elle doit se débrouiller sans Gérald. Léa avait accepté ce rôle pour un soir. Et c’était une belle invitation : un gala de première ! Tosca ! En présence de la reine !
La voiture ralentit, bloque dans les bouchons.
L’ingrate avait annulé moins d’une heure avant, alors qu’elle l’attendait pour partir ! Et par SMS ! Anita aurait dû la rappeler et lui hurler dessus. Au moins, répondre par un message sec. Mais non. Pas de problème, avait-elle écrit. Repose-toi bien.
Anita serre les dents et regarde par la fenêtre. Elle est le fruit d’une époque où on élevait les filles comme des chiots. On l’a domestiquée : pas d’esclandre. Que peut-elle contre ces habitudes ? Les feux rouges brillent dans l’obscurité, se reflètent dans les vitres et sur le profil de son chauffeur. Tous ces embouteillages ! Dès qu’il y a trois gouttes, c’est l’apocalypse ! Pourtant, ce n’est pas comme si ça arrivait rarement. Et puis, tous ces chantiers… Comment est-il possible que le gouvernement ait laissé la situation péricliter ? En plus, la reine sera là ! C’est la soirée de la rentrée !
Anita referme son manteau autour des jambes. Le cuir des sièges caresse ses cuisses à travers l’étoffe. Un nouveau tremblement la saisit. Elle serre les poings. Au dos, ses veines sont telles à des ramures empoisonnées de sève bleue. Ses doigts ressemblent à l’œuvre d’un sculpteur sadique. Polyarthrite rhumatoïde, ont dit les médecins quand la douleur est apparue il y a quelques années. Une maladie auto-immune et dégénérative. Il n’y a rien à faire, sinon se gaver de cortisone en cas de crise aiguë. Son corps s’est peu à peu déformé en excroissances absurdes avec une bosse ici, un creux là. Quand Gérald est mort, Anita a tenu à se débarrasser de son alliance. Il a fallu la scier pour l’enlever. Elle ne porte désormais plus qu’une seule bague : la verte, à laquelle elle ne veut pas renoncer.
– Je vous dépose devant l’entrée ?
Le chauffeur la regarde dans le rétroviseur.
– Oui, évidemment, Julien.
La reine est déjà arrivée. Les voitures de police sont garées dans la rue, le long de la grille qui entoure le théâtre. Les gyrophares intriguent les passants. Une troupe d’hommes chaussés de bottillons noirs et leurs chiens muselés tenus en laisse contrôlent l’accès. Julien baisse la vitre. Il montre l’invitation. À travers la fenêtre, Anita ne peut distinguer que la braguette du policier : c’est d’elle que semble jaillir l’autorisation. « Passez ! » La voiture s’engage dans l’allée. Si elle n’était en retard, Anita aurait pris le temps d’admirer le tapis rouge, les flambeaux, les projections sur la façade et les spots qui mettent en valeur le dôme. Elle consulte ce qu’elle nomme encore sa « montre-bracelet ». Il est exactement vingt heures. Elle peut encore y arriver, si elle se dépêche.
Mais il y a un autre problème.
Anita aurait préféré l’ignorer, mais même elle doit s’incliner devant les besoins physiologiques. Elle sait que l’erreur serait fatale : la musique la plus divine peut se changer en torture lorsque chaque trémolo tire sur les muscles intimes comme sur les cordes d’une harpe. Le tout, à quelques mètres de la reine ! C’est impensable.
La voiture s’immobilise enfin. Anita bondit malgré ses articulations. Elle sautille entre les flaques vers les portes vitrées, sans ajuster le foulard qui protège sa coiffure. Dans le hall, de hautes gerbes de lys blanc se détachent sur le rouge des tapis et se reflètent dans les miroirs piqués de noir. Anita a un accès de fierté : c’est grâce à elle que cet endroit existe toujours.
Le carillon annonce le début imminent du spectacle. Elle se rue vers le vestiaire, récupère son numéro et prend le chemin du sous-sol, où se trouvent les toilettes. Brusquement, la sonnerie se tait. Du silence émane un sentiment d’urgence encore plus oppressant.
*
Elle a été placée avec une table devant les w.-c.
– Si tu prévois une coupelle, les gens donnent parfois un pourboire, a dit la cheffe des hôtesses en l’abandonnant à son sort. Alina est restée bouche bée. On la prenait pour qui ? Une mendiante ? Soirée prestigieuse à l’opéra. Le gratin bruxellois.En présence de la reine. La reine !Tout ce qu’elle en a vu depuis ce trou au sous-sol, c’est la lueur des gyrophares. Non qu’elle en ait quoi que ce soit à foutre des têtes couronnées. Mais bon ! Si elle avait su que « dame de cour » voulait dire « madame pipi », jamais elle n’aurait accepté le job.
On lui a assuré qu’elle aurait la paix pendant le spectacle. Tout juste si on ne lui a pas reproché ces heures payées à ne rien faire. Alina s’est installée à sa table. Elle a sorti son smartphone, mais il n’y a pas de réseau au sous-sol et le wifi est protégé par un mot de passe.
Putain.
Un bruit dans l’escalier : Alina lève la tête. Une dame âgée déboule en claudiquant. Elle grogne sans la regarder : En retard, en retard, et s’engouffre dans les toilettes. Son parfum luxueux subsiste derrière elle. Les narines d’Alina frémissent. Elle se replonge dans son téléphone inutile. Deux minutes plus tard, la femme ressort et jette une pièce dans sa direction.
La monnaie roule et tombe par terre. 20 centimes. L’aumône est minable. Alina saisit le seau qu’elle a reçu au briefing, avec le tablier rose, et pousse la porte. L’odeur du parfum est encore dans l’air et se mêle à celle, antinomique, de pipi.
Osez croire en vos rêves !
Alina ricane et entre dans le cabinet. Prise d’une rage jouissive, elle se met à frotter la lunette, consciente du plaisir masochiste de s’infliger une soirée de merde. Elle se redresse et va vers l’évier. Dans la glace, son reflet la toise avec dégoût.
Pauvre conne, tu t’es bien fait avoir.
D’ordinaire, Alina esquive les miroirs – elle préfère croire qu’elle n’a pas de corps. Juste un cerveau doté de capteurs à sensations. Parfois, elle se sent comme quelqu’un qui habite une maison avec une moche façade : c’est surtout un problème pour les voisins. Mais ce soir, devant l’uniforme ridicule et la barrette qui retient ses cheveux sans foulard, elle est traversée d’un doute.
Je suis qui, moi ?
La minuscule poubelle à droite de l’évier déborde de serviettes de papier. En se penchant pour la vider, Alina remarque quelque chose qui brille dans le coin. Un éclat insolite à cet endroit. Une bague. Elle se revoit petite, devant la machine à chewing-gums à l’entrée du supermarché. Certaines boules contenaient des bagues en plastique grosses comme celle-ci. Alina tourne le bijou dans le creux de sa paume. L’émeraude taillée en carré est entourée de brillants, sans doute des diamants, montés sur un anneau doré un peu usé. Cette bague n’y était pas la dernière fois qu’elle a nettoyé la pièce. Elle doit appartenir à la dame au parfum, qui vient de partir. Alina peut la rattraper si elle se dépêche.
Elle s’élance dans les escaliers vers le rez-de-chaussée. À l’autre bout du hall, l’ouvreuse introduit l’inconnue dans la salle.
Alina traverse la distance en trois enjambées et s’engouffre derrière elle.
À cet instant, le lustre s’éteint. Alina recule dans un renfoncement. Dans l’obscurité, des applaudissements, et une musique éclate, soudain, venue de nulle part.
Alina n’est allée qu’une seule fois au théâtre. Une activité organisée par le prof de français. La Mouette de Tchekhov. Comme les autres, Alina avait dissimulé son excitation sous des plaintes convenues. C’est au programme pour les examens ? Le soir de la représentation, elle avait pris place au bout de la rangée, loin du groupe de filles bruyantes. Alina se souvient de l’odeur de poussière et des toussotements dans l’obscurité. Le rideau s’était levé sur un décor de maisons en rondins et d’arbres de carton-pâte. Les acteurs gesticulaient beaucoup. Leurs pas résonnaient sur la scène en bois. Tout paraissait factice et kitsch.
Révoltant.
– Par exemple, expliqua-t-elle le lendemain devant la classe : un acteur sert du thé. Il bouge la théière au-dessus d’une tasse de bas en haut comme s’il versait vraiment quelque chose – mais rien ne coule. Ça ne va pas ! Il en fait trop, ou pas assez ! Soit on fait l’impasse sur la théière et la tasse, soit on doit voir couler le thé. Comment susciter des émotions authentiques avec des demi-mesures ? À ce tarif, mieux vaut le cinéma.
La prof avait souri devant cette véhémence inhabituelle.
– Suspension volontaire de l’incrédulité, avait-elle lâché à la fin de la diatribe.
– Hein ?
– C’est ce que tu viens de décrire. L’idée que le spectateur doit jouer le jeu, accepter les conventions de la narration. Si tu veux que ça marche, il faut partir du principe que le vraisemblable suffit : ce qui apparaît possible est possible.
– Mais… avait objecté Alina. Ce n’est pas honnête !
– Une chose peut être honnête sans être vraie, avait répondu la prof, visiblement amusée par ce paradoxe.
Alina n’était jamais retournée au théâtre.
Mais ce qu’elle éprouve à l’instant où l’orchestre se met à jouer n’a rien à voir avec les souvenirs de cette expérience ratée. Le choc englobe tout : les décors, les couleurs et, dans la salle, la chaleur des corps qui respirent à l’unisson et les parfums, ce qu’ils évoquent de l’assemblée, du luxe et de la beauté réservée à ce luxe. La musique enveloppe chaque élément et le transfigure. Elle rend obsolète toute idée de réalisme. Alina en a la chair de poule. Un fou rire la prend lorsqu’elle entend les chanteurs pour la première fois. Les dialogues sont surtitrés au-dessus de la scène. Elle ne voit pas le temps passer, ni les coups d’œil insistants de l’ouvreuse. Ni ses larmes quand elles se mettent à couler.
Osez croire en vos rêves…
Une vague la soulève vers des mondes étrangers, qu’elle a pourtant l’impression de connaître. Elle se fait alors une promesse. Dans la paume de sa main, la bague brûle. Les doigts d’Alina se referment autour – comme pour imprimer ce serment dans sa peau.
2
Le lendemain de sa soirée à l’opéra, Anita se réveille tard. Elle prend lentement conscience de la pièce qui l’entoure. Cette chambre, si familière, blanche et calme. Paisible. Oppressante. Anita referme les yeux. Elle a mal à la tête, comme si une pensée cherchait à percer le sommet de son crâne et cognait de l’intérieur. L’opéra provoque souvent chez elle des effets secondaires de ce type. Comme une descente après l’alcool, ou la drogue, à ce qu’on dit. Anita se tourne dans son lit – ce grand lit choisi par son mari. Ils étaient certains de ne jamais s’y croiser, ni même s’effleurer s’ils n’en avaient pas envie, ce qui avait été le cas ces dernières années. Anita fixe le mur où se reflète le rond lumineux et tremblant du verre à eau posé sur sa table de nuit. Le soleil brille à travers les rideaux. Anita retire les boules Quies qu’elle met encore par habitude, bien que la cause de ses insomnies ait disparu à la mort de son époux : quarante-cinq années de ronflements laissent des traces.
Outre le lit, tout dans la chambre reflète les choix de Gérald, jusqu’à la maison elle-même. C’est lui qui a engagé l’architecte à la mode pour dessiner la villa dont il rêvait, qu’il imaginait comme un ensemble de grandes pièces sans portes, percées de larges baies vitrées. Il l’avait conçue comme un écrin pour ses œuvres d’art plutôt que pour une vie de famille. Ironie du sort, il en était sorti une bâtisse biscornue qui ne correspondait pas du tout à son caractère, lui qui était carré et droit dans ses bottes.
Anita soupire et se lève. Ses articulations la font souffrir le matin, le temps de dérouiller la machine. Sa maladie lui a fait prendre quinze ans, pense-t-elle parfois. Alors qu’elle longe le couloir, le bruit de ses pas résonne sur le plancher lisse et ponctue en contrepoint les battements de son cœur qu’elle ressent dans les tempes. Elle ferait bien d’avaler une aspirine. Malgré ses problèmes de santé, Anita se déplace encore en déposant la pointe des pieds puis le talon. C’est une habitude qu’elle a prise lors des leçons de ballet de son enfance, auprès d’une ancienne danseuse. Elle se souvient de ces heures de discipline en tutu. Au son d’une valse de Chopin bâclée par un pianiste dépressif, ellealignait les petites filles en peloton d’exécution. Plié, jeté, jeté. Il faut souffrir pour être belle !
Anita se dit qu’elle pourrait mettre cette maison en vente, maintenant que Christine est partie vivre à New York. Tout cet espace pour son petit mètre soixante et ses cinquante kilos… Quelques années plus tôt, Gérald a tenu à moderniser la cuisine. Ses meubles de style cottage ont fait place à un bloc central de marbre noir où se dressent poivrier et salière comme deux phallus surdimensionnés. Devant la baie vitrée qui donne sur la terrasse et le jardin, il a disposé une longue table signée par un designer célèbre. À l’une des extrémités, Danaé, sa dame de compagnie, a préparé son couvert. Sur un set de table avec une scène de chasse : une petite assiette, une sous-tasse, une tasse, une cuillère, un couteau brillant à bout rond. Comme le reste de l’existence d’Anita, la disposition du couvert est ordonnée selon une logique immuable qu’elle a enseignée à Danaé. Ce matin-là, il résume l’état d’esprit de sa destinataire : un mélange de confort et de jouissance solitaire, à la fois appréciable et infiniment triste.
Anita s’approche de la table et saisit le courrier que Danaé a relevé. Des factures, pour la plupart. Quelques invitations aussi. Des galas, des soirées de charité, comme celle d’hier soir. La saison reprend. Elle se sert une tasse de café et la boit debout, face au jardin. Elle a une pensée émue pour Gérald qui a découvert ce grain. C’est le meilleur souvenir de son mariage. Trouver le bonheur pourrait être simple, si elle arrivait à se satisfaire de tout ça.
Une boule de poils surgit sur la terrasse et aboie contre la vitre extérieure. Tous les matins, en arrivant, Danaé sort le chien avant le lever d’Anita. Foufou, qui éprouve pour la domestique une détestation réciproque, s’échappe dès que cette dernière a le dos tourné, ou les yeux rivés sur son téléphone, peste Anita.
– Viens là ! dit Anita en ouvrant la porte coulissante.
Elle se penche pour lui caresser le museau. Ce chien, elle en est venue à le préférer à sa propre fille.
C’est à ce moment-là, tandis que Foufou lui fait la fête en se couchant sur le dos, qu’Anita remarque l’absence de la bague.
– Bonjour, Madame ? Foufou enfui ? demande Danaé, qui apparaît à cet instant. Danaé a la manie de finir ses phrases en l’air, comme par un point d’interrogation, de sorte qu’elle donne toujours l’impression d’être noyée sous des doutes existentiels.
– Danaé, tu aurais vu ma bague ?
– Votre bague ?
– Oui, ma bague verte ! Celle que je porte d’habitude !
Anita n’attend rien de cet échange. Danaé ne parle pas bien le français, et Anita la suspecte de simuler une barrière linguistique pour s’esquiver plus aisément. Elle remonte dans sa chambre et regarde sous la table, le lit et le tapis. La décoration minimaliste facilite les recherches, mais la bague reste introuvable.
Dans la poche de son peignoir, son portable vibre. C’est l’heure du traditionnel appel de New York. Christine est très ponctuelle. Anita ne décroche pas. Quelques secondes plus tard, dans le hall d’entrée, c’est le fixe qui se met à sonner.
– Danaé ? crie-t-elle. Si c’est Christine, dis-lui que je ne suis pas là !
Danaé marmonne au téléphone. Anita se laisse retomber sur le matelas qui rebondit. Et soudain, le souvenir lui revient.
– Danaé ! Je sais où je l’ai perdue !
Danaé tourne vers elle des sourcils interrogateurs, pour une fois en accord avec son intonation.
– Tu peux reprendre le nettoyage, je vais les appeler ! dit Anita, avec un esprit de décision inhabituel. Mais apporte-moi juste une aspirine, pour l’amour de Dieu !
*
L’appel survient à 11 h 30, au moment où la réunion de débriefing se termine. Sur sa chaise, Hélène a le dos un peu courbé. Elle a tenu à signaler quelques couacs de la soirée d’hier, croyant bien faire, mais personne n’a envie d’entendre ça, même pas Leloup. Les résultats sont bons, c’est ce qui importe. Pourquoi jouer les Cassandre ? Elle jette un coup d’œil au résumé de la réunion. Les tirets lui semblent autant d’épines dans le pied. Le dernier porte sur le remplacement d’une des femmes de ménage en burn-out. Comme il n’y a pas de département Ressources humaines, ce dossier lui a été confié.
Vite : conclure ce PV, l’envoyer et refermer l’ordinateur. La salle s’est emplie de rires et de bavardages. Les collègues se lèvent en désordre et repoussent leur chaise. C’est une petite équipe : une vingtaine de personnes, sans compter le personnel technique et les régisseurs. Ce qui frappe Hélène ce matin-là, c’est l’atmosphère de séduction qui règne toujours autour de la table lorsque François Leloup la préside. Elle ne peut s’empêcher d’admirer sa façon d’utiliser son charme pour gagner l’adhésion du groupe, des mécènes, des sponsors, des journalistes. Est-il impossible de diriger autrement ? Hélène repense à la scène de la cravate et rougit. Elle avait été flattée par la demande de François, et c’est ce qui la trouble le plus : la servilité heureuse dont elle fait preuve dès qu’il claque des doigts.
– Hélène !
Lola, une des filles du département communication, tient le téléphone.
– C’est Anita van Dornen ! Elle veut te parler !
Ses yeux brillent d’excitation. Nul n’ignore dans la maison l’importance de la baronne et de sa fondation.
Hélène saisit le combiné. Depuis le temps qu’elle travaille au Belvédère, elle en est venue à apprécier la mécène. Elles se tutoient. Leloup ne se risque pas à autant de familiarité. Anita lui donne du « ma chère » et, dans quelques années, probablement, elle lui dira





























