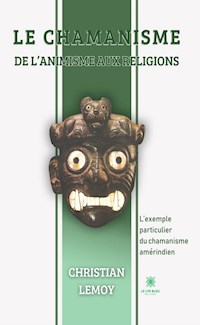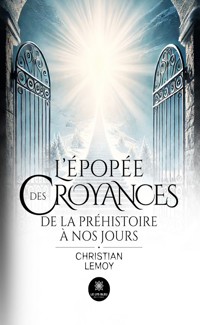
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Comment l’humanité est-elle passée des rituels des chamans aux temples des dieux, puis aux religions d’un seul Dieu, avant de remettre tout cela en question avec l’athéisme ? Suivre cette incroyable évolution, c’est embarquer pour un voyage passionnant à travers le temps, les continents et les civilisations. Des chamanismes anciens aux idéologies modernes, les croyances humaines changent de visage, mais poursuivent toujours la même quête : comprendre le monde et donner un sens à la vie. Un périple aussi ancien que l’humanité elle-même, revisité avec force et clarté dans "L’épopée des croyances – De la préhistoire à nos jours".
À PROPOS DE L'AUTRICE
Titulaire d’un doctorat en géologie après des études en Sciences de la Terre et de la Nature, Christian Lemoy a mené une longue carrière internationale, riche en découvertes et en expériences de terrain. Ses missions l’ont conduit sur tous les continents : en Afrique, en Amérique latine, en Australie, dans les îles du Pacifique, ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment en Indonésie et en Birmanie. Auteur de nombreux ouvrages mêlant savoir, réflexion et ouverture sur le monde, il poursuit un parcours d’écriture engagé et fait partie du cercle des Écrivains du Sud.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christian Lemoy
L’épopée des croyances
De la préhistoire à nos jours
Essai
© Lys Bleu Éditions – Christian Lemoy
ISBN : 979-10-422-7869-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
– De l’Asie antique à l’Amérique précolombienne, essai, 2006, Éd. Amalthée (Coup de cœur de M. Claude Allègre, ancien ministre de l’Éducation nationale, dans l’émission « Chez FOG » sur TV5) ;
– À travers le Pacifique, essai historique, 2009, Éd. Amalthée ;
– Across the Pacific, from Ancient Asia to Precolumbian America, history, 2011, Universal-Publishers (USA) ;
– Le Mystère du dieu à crocs, roman d’aventures, 2011, Éd. Amalthée ;
– L’étrange paradoxe, roman d’aventures, 2015, Éd. Amalthée ;
– L’erreur était juste, nouvelle, 2020, Le Lys Bleu Éditions ;
– Le chamanisme – De l’animisme aux religions : l’exemple particulier du chamanisme amérindien, essai, 2022, Le Lys Bleu Éditions.
Prologue
L’écriture de ce dernier ouvrage relève un peu du hasard ! En effet, il y a de nombreuses années, après avoir été investi des pouvoirs de marabout en Afrique et en avoir oublié jusqu’au sens, c’est la rencontre plus récente d’une chamane colombienne qui m’a suggéré l’écriture de cet essai. Au cours d’un de mes voyages en Amérique latine, j’avais eu l’occasion de rencontrer une femme qui avait passé plusieurs années de sa vie parmi des tribus amazoniennes. Elle m’avait raconté son histoire et son initiation au chamanisme par de véritables chamanes amazoniens. Son passionnant témoignage, quant aux pratiques chamaniques, réveilla ma curiosité de chercheur. C’est alors que j’ai voulu tout connaître du chamanisme et de ses pratiques, savoir la part de Vérité qui se cachait derrière toutes ces croyances que l’on m’avait inculquées dans ma jeunesse ou que j’avais découvertes au cours de ma vie. En d’autres termes, je souhaitais découvrir ce qu’il y avait de l’autre côté du miroir et qui n’était pas accessible à notre perception !
Pour ce faire, je me suis tout d’abord intéressé aux chamanismes, puis aux religions qui en découlaient, ce qui revenait à pénétrer par effraction dans un univers symbolique à la fois mystérieux et magique, peuplé des esprits de la Nature, de ses éléments et de ceux de nos Ancêtres, mais aussi de divinités souvent fantastiques, fruits de l’imagination humaine. C’était aussi entreprendre un fabuleux voyage qui, de pays en pays, de continent en continent, de chamanisme en chamanisme ou de religion en religion, se présente sous un jour chaque fois différent et pourtant immuable. C’est cette épopée inscrite dans un dynamique espace-temps de croyances qui remontent à la préhistoire que je veux partager avec vous, chers amis lecteurs.
Si le chamanisme classique décrit le chamane comme un être particulier ne pouvant agir qu’en état de transe, il nous est alors permis de généraliser ce phénomène comme ayant une très large extension.En effet, les anthropologues se sont très vite aperçus que nombre de pratiques chamaniques ou de religions traditionnelles existaient depuis la nuit des temps parmi les peuples les plus anciens de notre monde, que ce soit en Eurasie, en Amérique, en Océanie (incluant l’Australie et l’Indonésie) ou encore en Afrique. Suivant en cela l’hypothèse de Jean Clottes et James David Lewis-Williams (1996), nous pouvons considérer qu’à partir du moment où nos ancêtres préhistoriques ont pu dessiner ou graver, c’est-à-dire transposer ce qu’ils voyaient – ou imaginaient percevoir – lors de leurs transes et ainsi d’exprimer leurs sentiments, leurs pensées, leurs rêves, leurs désirs et finalement leurs croyances sur un support, quel qu’il soit, l’existence du chamanisme, et donc celle des chamanes, est indiscutable. C’est pour ces raisons que nous nous intéresserons à l’art pariétal (glyphes et peintures) et à la présence de statuettes votives appelées « Vénus » qui témoignent d’un probable culte de la fertilité. Ce culte féminin ainsi que celui des ancêtres et des esprits de la Nature seraient les premières expressions artistiques de l’animisme et du chamanisme qui lui est consubstantiel et qui précéda l’apparition des religions polythéistes.
Aujourd’hui, il nous est difficile d’imaginer les peurs et de comprendre les superstitions de nos ancêtres préhistoriques qui vivaient dans un monde sans lumières autres que celle du soleil diurne où celles de la lueur blafarde des torches, la nuit venue. Le soleil disparu, ce monde n’était plus que pénombre et obscurité d’où pouvait surgir n’importe quel danger ! Alors, pour mieux comprendre les croyances du passé, il est important de nous projeter mentalement dans un tel contexte. Tout ce que nos ancêtres ne connaissaient pas ou ne pouvaient expliquer dans la nature et ses phénomènes était objet de craintes ou de peurs profondes. Il leur fallait donc respecter cette Nature et se protéger des dangers qui les menaçaient lors de leurs activités, comme la chasse, la guerre ou encore contre les maladies physiques ou mentales. Il leur fallait aussi tenter d’expliquer les phénomènes incontrôlés de cette nature, comme les aléas climatiques, tels que la sécheresse, les incendies de forêt engendrés par la foudre, les tornades de vent et les inondations dues aux crues dévastatrices des cours d’eau, ou encore les épidémies dues aux maladies et la mortalité infantile. Ils étaient aussi curieux et cherchaient des explications aux événements cosmiques, comme les éclipses de lune ou de soleil, la course des astres dans le ciel, qui était une des préoccupations des bergers du Moyen-Orient, ou encore la connaissance des marées et des vents contraires, qui était fondamentale chez les marins, etc. C’est probablement ainsi que les chamanes sont apparus pour conjurer les peurs ancestrales de leurs congénères, les exorciser contre les sortilèges lancés par leurs ennemis… ou plus positivement lutter contre les maladies et les soigner, quelles que soient les méthodes employées. De plus, la naissance de la croyance en une vie après la mort les a conduits à respecter et honorer leurs ancêtres en les enterrant et, de ce fait, soustraire leurs dépouilles aux animaux carnivores.
Dans son ouvrage The Golden Bough (1890), l’anthropologue écossais James G. Frazer observait à juste titre que les peuples anciens étaient naturellement préoccupés par les forces qui pouvaient leur faire le plus de mal, comme les animaux dangereux. Ces peuples imaginaient des dieux sombres et dangereux, dont il fallait apaiser les colères par des exorcismes de type chamanique ou par certains rituels sacrificiels, et là, nous touchons aux prémices des religions polythéistes. Toujours selon ce dernier, la justification de ces affirmations résidait dans l’apparition de personnages mythologiques tels qu’Erra, la force destructrice de la mythologie mésopotamienne, ou celle de Seth dans la religion de l’Égypte ancienne. La notion de bienveillance n’apparut que plus tard avec des divinités protectrices auxquelles il fallait faire des sacrifices rituels. Ces rites étaient dédiés aux dieux qui contrôlaient le temps et le destin des hommes et qui minimisaient l’action nocive des forces obscures. Finalement, cette bienveillance doublée de compassion connut son apogée dans les religions monothéistes, comme le Christianisme en Orient et en Europe ou dans des philosophies religieuses, comme le Bouddhisme en Asie.
Mircéa Eliade avait traité ce sujet du chamanisme dans son ouvrage Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase (1983, Édition Payot). Depuis, la multiplication des découvertes et la qualité des études des cinquante dernières années nous permettent d’apporter un nouvel éclairage sur ce sujet, sans pour autant viser à l’exhaustivité. En effet, nous ne prétendons pas couvrir l’ensemble des chamanismes ni surtout des sectes ou des religions polythéistes qui en sont issues. Pour ce faire, nous n’avons sélectionné que quelques cultures ou civilisations clés pour illustrer chacune de ces grandes voies de migration qui ont permis aux chamanismes ou aux religions de devenir universels. D’autre part, en ce qui concerne les religions, qu’elles soient polythéistes ou monothéistes, plus qu’aux noms des dieux dont l’énumération peut vite devenir fastidieuse, il est préférable de s’intéresser à leurs fonctions et surtout à celles qui les rapprochent de l’animisme. Ces qualités qui leur sont attribuées nous éclairent également sur les questionnements métaphysiques de ces peuples, de leurs cultures et de leurs liens éventuels avec d’autres cultures ou religions voisines… ou plus lointaines.
À une époque où les hommes ne se déplaçaient qu’à pied ou à cheval – lorsque ce dernier fut domestiqué – les effets des variations climatiques dans le temps et l’espace se sont fait sentir non seulement en fonction de la latitude, mais aussi de la géomorphologie des continents avec leurs reliefs montagneux, barrières qui jouaient un rôle majeur en balisant des voies préférentielles de migrations.
L’aspect climatique est bien sûr fondamental ! Depuis la fin de la dernière glaciation et, malgré des variations séculaires et souvent imprévisibles, le climat s’est globalement réchauffé. Avec le dégel, la frange nord des continents eurasiatique et américain, autrefois recouverte de glaces, s’est ouverte à de vastes espaces aujourd’hui transformés en toundras (steppes à pergélisol) accessibles au pâturage d’été des troupeaux ou encore en taïga (forêt boréale), offrant ainsi d’immenses zones de chasse. Dans ce même temps, en Afrique, la zone saharienne qui était autrefois une savane arborée et verdoyante n’est plus aujourd’hui qu’un désert minéral brûlé par le soleil.
La géomorphologie (Figure 1) et la topographie furent également d’une importance capitale à l’intérieur des continents. Ainsi, les migrations eurasiatiques ont fréquemment suivi les grands corridors naturels, que ce soit ceux des grandes plaines, comme celles d’Ukraine ou les vallées des grands fleuves, comme celle du Danube ou encore de vastes espaces de steppes qui furent de tout temps des voies privilégiées de passages des peuples migrants et conquérants. En Eurasie, ces couloirs étaient limités par des reliefs dont certains difficiles à franchir, comme les chaînes de montagnes sensiblement orientées est-ouest (l’Himalaya, entre la Chine et l’Inde, ou les Alpes entre l’Europe centrale et l’Europe méditerranéenne), ou encore celles orientées nord-ouest sud-est (Caucase et Zagros entre l’Iran et la Mésopotamie). D’autres orientés nord-sud, comme l’Oural, faisait office de barrière entre l’Europe et l’Asie et furent contournées d’abord par le sud, puis plus tard par le nord. En Amérique, les principaux reliefs montagneux qui bordent le Pacifique et qui sont sensiblement orientés nord-sud, ont également joué un rôle prépondérant dans la répartition des civilisations et des cultures.
Figure 1 – Carte physique de l’Eurasie
À partir de l’Asie centrale, l’ensemble des croyances et des pratiques du chamanisme, originaire d’une région située entre la Mongolie et le nord de la Chine, se propagea telle une onde magique dans tous les azimuts… Aussi, avant de nous embarquer pour cette longue et fascinante histoire et par souci didactique, ce livre est organisé à partir de l’Asie centrale, considérée comme le cœur du chamanisme. C’est la région où sont nées les anciennes religions du feu et c’est aussi à partir de là qu’est apparue une importante dichotomie culturelle et surtout religieuse entre :
– Une zone orientale englobant d’une part, les religions de la Perse et de l’Inde (incluant la vallée de l’Indus et l’Inde du Nord) et d’autre part les philosophies religieuses issues de la Chine, du Sud-Est asiatique, de l’Océanie (Australie comprise) puis de l’Amérique dans son entité.
– Une zone occidentale avec l’apparition très tôt dans l’histoire des religions polythéistes au Moyen-Orient, puis successivement celles de l’Europe et enfin de l’Afrique.
Cette dichotomie nous amènera donc à considérer l’évolution du chamanisme, à commencer par sa région de naissance, puis ses mutations en religions au fur et à mesure de ses cheminements dans le reste du monde :
De la Sibérie et de la Mongolie, le chamanisme gagna tout d’abord le Kazakhstan, le Kirghistan l’Ouzbékistan et le Turkménistan, puis il divergea vers l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan (vallée de l’Indus) et l’Inde du Nord. Il se transforma en religions, comme le Zoroastrisme ou le Mazdéisme en Iran et le Védisme en Inde.
Vers l’Est et le Sud-Est, à partir du nord de la Chine, laquelle faisait partie intégrante des lieux où le chamanisme plongeait ses racines, il se propagea à l’ensemble de la Chine, de la Corée et du Japon, et gagna le Sud-Est asiatique…
Cependant, en Océanie, ce beau schéma continental de propagation du chamanisme fut brouillé très tôt par des migrations maritimes favorisées par les courants et les vents qui affectaient (et affectent toujours) l’océan Pacifique, comme ceux de Coriolis et surtout d’El Niño. L’Australie demeura relativement isolée et développa une religion animiste basée sur « le temps du rêve », laquelle se retrouve en Mélanésie, Papouasie-Nouvelle Guinée et Nouvelle-Calédonie. Ultérieurement, la Nouvelle-Zélande, puis les îles de la Micronésie et de la Polynésie ont développé des croyances influencées par celles de l’Asie de l’Est (Chine, Corée, Japon).
En Amérique, en reprenant le fil des migrations continentales vers le Nord-Est, en Sibérie orientale des groupes nomades de chasseurs-cueilleurs auraient peuplé cet immense espace et franchi à pied le détroit de Béring qui, il y aurait 30 000 ans ou plus, était en partie émergé ou alors, plus probablement, longé en pirogue le sud des îles Aléoutiennes ou la calotte glaciaire pour arriver en Alaska et occuper progressivement tout l’espace nord du continent américain, puis progresser vers le sud, jusqu’au Chili où ils seraient parvenus il y aurait 33 000 ans (?). Là encore, les courants de l’Océan Pacifique brouillèrent ce beau schéma continental. En effet, il y aurait 5 600 ans – et peut-être même bien avant - sous l’influence du courant d’El Niño, la voie de migration maritime venue du Sud-Est asiatique à travers le Pacifique central devint très active. Cette dernière voie aurait permis le peuplement des îles du Pacifique central et oriental… et plus encore de l’Amérique dans une zone équatoriale allant du Mexique au Pérou, laquelle est appelée « Amérique nucléaire ».
Pour en revenir au continent eurasiatique :
Vers le Sud-Ouest, le chamanisme finit par gagner le Moyen-Orient (Irak, Syrie et Anatolie turque) et le Proche-Orient (Palestine, Israël, Liban, Jordanie…) où il se transforma très tôt en proto-religions, puis en religions polythéistes comme en Mésopotamie. Du Proche-Orient, ces religions polythéistes se propagèrent aux rivages et aux îles de la Méditerranée orientale, puis aux côtes européennes (de la Grèce à l’Espagne et au Portugal) avec les civilisations grecques et romaines… mais aussi, et, comme nous le verrons, sur les côtes africaines (de l’Égypte au Maroc).
Vers l’Ouest, la diffusion du chamanisme en Europe continentale coïncide avec l’expansion des groupes de chasseurs-cueilleurs, de leurs cultures et de leurs croyances. Les diverses migrations venues de Sibérie furent grandement canalisées par la géomorphologie du continent. Cependant, après le réchauffement brutal qui marqua la fin de la dernière grande glaciation en Amérique du Nord, il y a 8 500 ans, la fonte des glaces du pôle provoqua la rupture du barrage glaciaire du lac Agassiz, lequel se déversa dans l’Atlantique nord par la baie d’Hudson entraînant une modification de la circulation thermohaline de l’Atlantique nord. Ceci entraîna un nouvel épisode de froid suivi d’un réchauffement qui se traduisit par une forte montée du niveau moyen des mers, de plus de 10 mètres en 1 000 ans. Par souci de simplification, dans cet espace européen, nous avons considéré trois grandes voies de migrations :
– Celles du nord et du nord-ouest. Ce furent les hordes nomades de cavaliers, pasteurs et chasseurs qui propagèrent le chamanisme à tambour issu d’Asie centrale. Cette migration est sans doute la plus récente, puisqu’elle est une conséquence du réchauffement climatique qui permit aux peuples d’Asie centrale de se diriger vers le nord-ouest de la Russie (Carélie), puis, de là, vers la Scandinavie et le nord de l’Europe.
– Celles de l’Europe moyenne venue de l’Asie centrale qui passèrent au nord de la mer d’Aral, de la mer Caspienne et de la mer Noire, puis s’engouffrèrent dans les grandes plaines européennes en suivant les vallées des grands fleuves (Danube…) menant ainsi vers l’Europe occidentale.
– Celles du sud du continent européen. Ces migrations suivirent les rives de la Méditerranée, qui fut à la fois une limite naturelle entre l’Europe et l’Afrique, mais aussi, par ses rivages et le cabotage, une importante voie de propagation des cultures et des croyances issues des Proche- et Moyen-Orient.
En Afrique, continent considéré comme berceau d’Homo sapiens, un animisme authentique et le chamanisme qui lui est lié auraient existé depuis longtemps, comme en témoignent les peintures et gravures rupestres découvertes sur ce continent. Dès 4 000 av. J.-C., les migrations venues de l’Asie centrale à travers le Moyen-Orient seraient à l’origine de la brillante civilisation égyptienne de la vallée du Nil et donc de la religion égyptienne qui, avec le temps, se propagea dans deux directions :
– Vers l’ouest jusqu’en Lybie, Tunisie, puis en Algérie et au Maroc.
– Vers le sud jusqu’au Soudan puis, poursuivant sa conquête par la vallée du « Grand Rift Est-Africain », elle aurait pu atteindre l’Afrique du Sud.
L’Afrique Équatoriale n’a été affectée par les religions monothéistes qu’à la marge et encore est-ce récent. Cette zone a poursuivi jusqu’à ce jour la pratique de ses « religions traditionnelles » qui étaient une forme de chamanisme.
Le cadre général étant posé, il est important, sinon fondamental, de suivre ces mouvements de populations dans l’espace et le temps, puisque l’expansion du chamanisme dans le monde est précisément liée aux déplacements de ces groupes humains de nomades chasseurs-cueilleurs.
Puis, comme nous le verrons, dès que la sédentarisation s’est installée dans des populations d’éleveurs et d’agriculteurs regroupés en villages, puis en cités plus importantes avec l’apparition concomitante de dirigeants politiques, le rôle des chamanes s’est amenuisé au profit des prêtres liés au pouvoir. Ces derniers n’ont fait qu’institutionnaliser les croyances animistes et les pratiques des chamanes, mais sans jamais les effacer complètement. Ils étaient d’ailleurs recrutés selon les mêmes critères que les chamanes, puis éduqués et formés selon les mêmes règles, comme le démontrent les exemples anciens issus de la Mésopotamie et de l’Égypte. Les esprits de la nature issus de l’animisme sont alors devenus les premières divinités des religions polythéistes, puis ces proto-religions ont évolué en même temps que les sociétés (tribus ou clans) pour devenir le reflet de leurs préoccupations à une époque donnée.
Chapitre 1
Chamanismes et religions de l’Asie centrale
La Sibérie et l’Asie centrale sont aujourd’hui considérées comme le lieu privilégié de naissance (et/ou de renaissance ?) du chamanisme, de ses croyances et de ses pratiques. En réalité, si nous considérons qu’un proto chamanisme existait dans l’art pariétal – dont la répartition est mondiale – alors l’apparition du chamanisme dans cette région ne serait qu’une consolidation de croyances et de principes qui préexistaient chez nos ancêtres préhistoriques.
Naissance et expansion des chamanismes en Asie centrale
Dès la fin de la dernière période glaciaire, un chamanisme issu d’un animisme paléolithique serait né dans la région altaïque et aurait été codifié plus tard à partir de rites préexistants. Il était basé sur la croyance en l’omniprésence des esprits de la nature ou de ceux des ancêtres et de leurs interactions sur la vie des hommes. Cette doctrine aurait conquis non seulement l’Asie centrale, mais aussi l’Est et le Sud-Est asiatique. De là, grâce à des courants favorables au sein du Pacifique équatorial, elle se serait propagée sur les côtes ouest de l’Amérique. Elle se serait aussi propagée vers l’Europe occidentale et en même temps vers le Sud-Ouest, au Moyen-Orient et en Afrique… c’est-à-dire dans le monde entier !
1.1. Chamanisme mongol
Si le chamanisme existait depuis des temps immémoriaux chez les peuples primitifs, ne serait-ce que dans leur art pariétal dont les prémices remonteraient à plus de 30 000 ans, le concept de chamanisme – et donc de chamane – élaboré dans la zone altaïque gagna pratiquement le monde entier et son expansion revient à suivre les grandes voies de migration de l’humanité dans l’espace et le temps. Les traces les plus anciennes de traditions chamaniques seraient à rechercher dans les sites préhistoriques, tels que les grottes ayant des peintures pariétales, les sites ayant des pétroglyphes ou les objets de culte, comme des statuettes parfois qualifiées de « Vénus » ou de tout autre objet pouvant se rapporter à la pratique d’un culte chamanique.
C’est en fait l’art rupestre du massif montagneux de l’Altaï, situé aux confins de la Mongolie, de la Sibérie russe et de la Chine, qui nous fournit les traces les plus anciennes du chamanisme de l’Asie centrale, de ses concepts et de ses pratiques. Sur ces sites rupestres de Mongolie et de Russie, les archéologues ont découvert des pétroglyphes assez frustes représentant de grands animaux aujourd’hui disparus et datant, pour les plus anciens, de 11 000 ans. Si l’on considère que cela correspondait à un culte animalier, alors il est possible d’affirmer que les tribus du Paléolithique supérieur mongoles possédaient déjà ce type de culte chamanique. Plus proche de nous, au Néolithique, des sites pétroglyphiques issus de la même zone et correspondant à des âges compris entre 4 000 et 2 800 ans, révèlent de véritables scènes de chasses, de transhumances de bétail et de nomades qui possédaient des chars à roues et un armement d’arcs et de flèches en silex. Pour certains archéologues, ces scènes pourraient même évoquer des récits mythiques d’exode et, dans un cas bien précis, l’image d’un être cornu, mais sans visage pourrait évoquer une déité ?
Dès la culture de Botaï (3 800 à 3 100 av. J.-C.), le cheval domestiqué supplanta le cerf et l’univers forestier de ces nomades passa à celui de la steppe avec une affirmation de cultes chamaniques. Les hommes devinrent cavaliers et l’élevage changea la nature du nomadisme. Le culte des ancêtres se développa avec l’apparition des « khirisüür » ou alignements de structures funéraires en pierre où le défunt était accompagné de chevaux sacrifiés en même temps. Finalement, cette culture pastorale s’affirma dès le second millénaire avant notre ère avec l’apparition de nombreuses stèles gravées, souvent à proximité de tumulus et comportant des images de cerfs, d’où leur nom de « pierres de cerfs ».
Ces stèles gravées sont aujourd’hui considérées comme des motifs chamaniques, invocations à l’esprit du cerf, lequel était censé assister l’âme du défunt dans son voyage vers l’autre monde. En effet, ces chasseurs des zones boréales considéraient les cerfs comme des êtres habités par les esprits des forêts, car ils perdaient leur ramure en fonction du cycle des saisons et, selon leurs croyances animistes, ces animaux ne pouvaient qu’être liés aux esprits de la nature.
Selon la mythologie mongole, le chamanisme aurait été introduit par Tarvaa, un jeune garçon arrivé au royaume des morts par erreur et redescendu sur terre avec des connaissances appartenant non seulement à celles de l’au-delà, mais aussi à celles de l’avenir, car, pour les anciens Mongols, le monde n’était constitué que de deux niveaux :
– Le ciel (ou paradis) où vivaient les esprits de la nature et ceux des ancêtres.
– La terre composée de 99 (ou 77) royaumes reliés entre eux par les branches de l’arbre cosmique et, parmi ces branches, des « trous » étaient supposés permettre au chamane de passer à travers les ramures et ainsi d’aller consulter les esprits lorsqu’il entrait en transe.
Notons au passage que ces deux niveaux passeront à trois dans presque toutes les autres cosmologies que nous verrons par la suite et rappelons-nous également que les chiffres 9 et 7 étaient (et sont toujours) considérés comme sacrés par les Chinois.
Si les ancêtres des Mongols étaient animistes, c’est-à-dire adorateurs de tous les éléments et esprits de la nature appelés « tengris », ils pratiquaient aussi le totémisme où le totem qui protégeait la tribu était considéré comme le symbole d’un ancêtre, plus ou moins déifié, lequel pouvait être représenté par un animal comme un cerf, un loup, un ours ou un aigle… La présence de nombreux tumulus funéraires retrouvés dans cet espace sibérien signifie que le culte des ancêtres était une pratique commune. D’autre part, l’existence d’autels de pierre assez frustes indiquait probablement l’existence d’un culte lié à des déités animistes dont nous ignorons les noms et les attributions… ou alors à un ancien culte du feu prenant ses racines dans le Paléolithique ?
Pour les Mongols, les « ovoos » étaient des lieux sacrés, généralement élevés (collines ou montagnes), où les hommes se rapprochaient des dieux et pouvaient communiquer avec le monde des esprits qui régnaient dans les cieux. Ces lieux pouvaient aussi être représentés par un tas de pierres où par un tumulus funéraire devant lequel on devait faire une offrande lorsque l’on passait à proximité… comme il y en a encore tant au Tibet.
Au Ve siècle avant notre ère, Hérodote décrivait ainsi les Mongols : barbares nomades aux cheveux roux et aux yeux gris, vivants dans des chars à bœufs conduits par des femmes alors que les hommes chevauchent aux côtés des troupeaux.
Selon les chroniqueurs chinois de l’époque Han, les Xiongnu (cavaliers des steppes) auraient commencé leur expansion sous le règne de Modu Chanyu (234 à 174 av. J.-C.), lequel développa la manière de se servir des chevaux et ainsi d’équiper des caravanes qui s’égrèneront le long des routes de la soie, transportant des marchandises et diffusant aussi de nouvelles croyances ou religions. Au XIIIe siècle de notre ère, l’incroyable histoire de l’expansion des Mongols se poursuivit sous le règne de Genghis Khan, qui conquit et dirigea le plus vaste empire d’Eurasie. Il s’étendait vers l’est, en Chine et en Corée, vers l’ouest, en Russie, en Pologne et même jusqu’à l’est de la France (avec l’invasion des Huns) et vers le sud jusqu’en Iran et en Turquie.
Plus tard, malgré les conquêtes territoriales de l’Islam, les Mongols demeurèrent profondément animistes et tolérants. Ils croient à présent que le but de l’existence de l’homme est la vie en harmonie avec la nature et prétendent que celui qui partage une telle vision du monde y puise une grande vitalité, car il se trouve placé au centre de son propre monde avec, au-dessus le Ciel-Père qui veille sur lui et, en dessous, la Terre-Mère qui le soutient et le nourrit. Le ciel, la terre, ainsi que les esprits de la nature et ceux de leurs ancêtres satisferont leurs moindres besoins… et protégeront l’humanité. Ainsi, en menant une vie pure et digne, l’être humain peut maintenir l’équilibre de son monde et augmenter au maximum sa force personnelle. Cependant, si l’équilibre dans la vie de l’homme est rompu à cause d’une maladie physique ou mentale ou encore par l’intervention des esprits malins, alors il ne pourra pas se passer de l’aide d’un chaman pour rétablir cet équilibre perdu.
Selon l’anthropologue Laetitia Merli, le « chamanisme à tambour » qui est celui des Mongols s’explique par le fait que le chamane utilise son tambour pour appeler les esprits à descendre dans l’espace sacré figuré par l’autel au préalable recouvert d’offrandes : chevauchant son tambour comme une monture, le chamane va au ciel à la rencontre des esprits avec lesquels il va négocier la chance, la santé et la prospérité de ses clients.En Mongolie, ce type de chamane confirmé est appelé « chamane à cheval ». C’est celui qui chevauche un tambour (lequel est une version avancée du « chamane qui marche à pied ») c’est-à-dire celui qui joue de la « guimbarde » en attendant de recevoir officiellement son tambour des mains de son maître initiateur. C’est dire l’importance que tient cet instrument dans cette civilisation. De plus, elle explique que « ce praticien a pour particularité de se mettre en contact avec le monde invisible où l’on trouve les entités comme les esprits de la nature : des règnes animal, végétal, minéral, et d’autres entités, comme ceux des ancêtres ou des divinités. Autour du chamane, on a construit un système de croyances, de représentations, de pratiques, qui sont en lien avec sa capacité d’entrer en communication ».
De nos jours, ce chamanisme mongol revêt plusieurs formes : celle du chamanisme ancien qui est pratiquée par les anciens peuples turcs sous la forme du « tengrisme » et sur laquelle nous reviendrons ou encore celle du chamanisme noir qui a été influencé par le Bouddhisme tibétain et finalement celle du chamanisme jaune que nous verrons ultérieurement.
1.2. Chamanismes sibériens
Les chamanismes sibériens, comme ceux des Républiques Bouriates, de Touva et de la Khakassie ou ceux de l’Asie centrale, comme le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan ou le Turkménistan, pays voisins ou proches de la Mongolie, sont dénommés « chamanisme à tambour ». Cette vision du monde des peuples autochtones de Sibérie et d’Asie centrale a donné naissance, au sein des tribus vivant dans cet espace, à des modes de vie remplis de respect pour les forces de la nature et incitant fortement l’Homme à éviter de nuire à cette nature qui l’environne.
Si le monde mongol n’avait que deux niveaux, pour les chamanes du sud de la Sibérie, l’univers était composé des trois niveaux, mondes classiques des futures religions du Moyen-Orient, tous peuplés d’esprits invisibles.
– Le monde supérieur était celui où régnaient les dieux et les esprits. Tout en haut de ce panthéon trônait le dieu créateur Ehé Khaïran, qui était entouré d’esprits appelés « Tenguéris ». Les enfants des Tenguéris seraient devenus les intermédiaires obligés entre les esprits et les hommes. Les petits-enfants de ces Tenguéris appelés « Egines », ainsi que les esprits des chamans morts, seraient devenus des « Zaïanis », esprits qui peuplaient certains lieux sacrés et, comme nous venons de le voir, il était nécessaire de leur faire des offrandes lorsque l’on passait en ces lieux.
– Le monde du milieu était celui de la terre où vivaient les hommes avec leurs propres problèmes… que les chamanes, en tant qu’intercesseurs, étaient supposés régler.
– L’inframonde ou monde souterrain était considéré comme recelant les enfers, c’est-à-dire un lieu où vivaient des esprits malins, ceux qui décidaient si les hommes qui y arrivaient et y étaient jugés méritaient une punition ou une récompense.
Selon les croyances Bouriates à la mort et selon ses mérites, l’âme humaine se transformait soit en un oiseau céleste, soit en un animal, une plante ou un rocher… ou alors elle allait en enfer et rejoignait le monde inférieur qui était peuplé d’âmes de toutes sortes, comme celles de femmes pécheresses qui n’avaient jamais eu d’enfant ou celles de filles qui n’avaient jamais connu l’amour, ou encore les âmes de personnes décédées de mort violente (mais hors de la guerre).
Caractéristiques des chamanes sibériens
Même si les définitions du terme chamane varient selon les auteurs et le point de vue sur lequel ils se placent, nous pouvons tenter de définir plus précisément quelles étaient les qualités requises dans ces pays pour devenir chamanes :
– Si l’un des devoirs du chamane était la transmission des croyances ancestrales, il devait aussi se poser en intercesseur ou médiateur entre les hommes et les forces incontrôlées de la nature. Grâce à ses pouvoirs spirituels et à ses dons de guérisseurs, il pouvait entrer en transe, quitter son corps et voyager en esprit dans les trois mondes que nous avons définis précédemment en cherchant des réponses aux questions que lui posait celui, celle ou ceux qui le consultaient, leur permettant ainsi de résoudre des problèmes très humains comme la maladie, la mort, les querelles familiales ou claniques, etc. Pour ce faire, il devait « s’animaliser » en s’affublant d’accoutrements magiques et de divers attributs, comme des amulettes et des miroirs ou des clochettes, et surtout d’un tambour pour « appeler » les esprits.
– Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, le prétendant devait obligatoirement hériter ce don de l’un de ses ancêtres et pas seulement grâce à ses qualités intrinsèques. Contrairement à ce que nous verrons plus tard dans le chamanisme américain (chamanisme à psychotropes) ici, ce sont les esprits qui viennent d’eux-mêmes à celui (ou à celle) qu’ils ont choisi.
– Selon ses propres capacités, mais aussi en fonction de la difficulté des cultes exercés, durant sa vie, le chaman peut se perfectionner et passer neuf degrés d’initiation, mais cette neuvième initiation est rarement atteinte. Chaque degré est alors distingué par un tambour particulier et une tenue spéciale.
– Il existe des lieux rituels d’offrandes aux esprits locaux, toujours au bord des routes où des chemins passagers, là où les esprits ont fait leur apparition ou encore là où un ancien chamane était décédé. Ces lieux peuvent être figurés par des poteaux en bois, par de petits tertres de pierres ou encore par des arbres caractéristiques, mais ils sont toujours pourvus de rubans colorés, ce qui rappelle d’une certaine manière un rite que l’on retrouve dans l’espace tibétain.
À présent, les Bouriates du lac Baïkal s’arrêtent toujours sur ces lieux pour faire une petite prière et partager avec l’esprit du lieu ce qu’ils ont sur eux ou encore, pour les nomades gardiens de troupeaux, ils arrosent avec une cuillère de lait ce lieu sacré… avant de boire le reste.
Aujourd’hui, ces territoires que sont devenus la Mongolie, la Bouriatie et Touva ont connu plusieurs vagues d’expansion du Bouddhisme tibétain, pendant lesquelles les chamanes autochtones et les populations locales ont fait l’objet de pressions. Ces stratégies ont évolué de différentes façons au fil des siècles, conduisant, dans certains cas, à des situations de cohabitation pacifique marquée par une influence réciproque des pratiques rituelles ou dans d’autres cas, à des conflits entre le chamanisme et le Bouddhisme.
À l’époque de l’URSS, les chamanes étaient vus comme des alliés de la classe dominante et des forces anti-progrès et de nombreux chamanes furent exilés ou exécutés. Si certains de ces chamanes avaient tenu à rester fidèles aux traditions perpétuées dans le secret pendant la période soviétique, d’autres choisirent de s’adapter au monde urbanisé et moderne en vendant leurs services dans le cadre d’associations.
Au début des années 1990, lorsque les pratiques chamaniques réapparurent au grand jour, ce fut dans un monde nouveau où ces pratiques retrouvèrent leur lustre. Si ces chamanismes de Sibérie (Yakoutes, Toungouses, Bouriates), d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan) sont voisins de celui de la Mongolie, c’est grâce à leur adaptabilité qu’ils ont su résister aux diverses influences des idéologies athées (communisme) ou des religions qui se sont succédé dans ces pays, mais dans ce cas, le chamanisme s’est teinté de préceptes religieux provenant soit du Taoïsme comme au Kirghizstan, pays voisin de la Chine, soit du Soufisme comme au Turkménistan qui est voisin de la Turquie (sous l’influence prépondérante de l’Islam)… et, dans une moindre mesure, du Bouddhisme, de l’Hindouisme ou du Christianisme.
Chapitre 2
Chamanismes et religions du feu
(de l’Iran au Pakistan et au nord de l’Inde)
Avant de poursuivre, il est nécessaire de rappeler l’importance cruciale du feu pour nos lointains ancêtres préhistoriques. Ce feu qui tombait du ciel avec la foudre était ambivalent et possédait donc des effets à la fois bénéfiques et maléfiques. Il fut alors déifié et devint l’objet des premiers cultes.
– Au titre des effets bénéfiques, il procurait lumière et chaleur. En d’autres termes, il offrait un « éclairage » dans l’obscurité des nuits et permettait de se réchauffer lorsque le froid était trop intense. En outre, il protégeait les hommes de nombreux prédateurs et leur permettait de cuire leurs aliments.
– Quant aux effets maléfiques, ils résidaient dans son côté destructeur lorsqu’il causait des incendies qui détruisaient les constructions de bois… ou brûlait ceux qui voulaient le toucher ou s’en approcher de près.
Comme nous le verrons tout au long de ce chapitre, la géomorphologie et le climat ont joué un rôle majeur dans la répartition géographique des grands courants religieux issus des migrations. Ainsi, le Zagros, chaîne de montagnes séparant le plateau iranien de la vaste plaine mésopotamienne, mais aussi le Caucase qui séparait l’Asie de l’Anatolie, auraient joué en quelque sorte le rôle de barrière – ou tout au moins d’obstacle – entre :
d’une part, les religions du feu qui se sont développé au Nord-Est de ces barrières, c’est-à-dire de l’Iran à la vallée de l’Indus.
d’autre part, les religions polythéistes qui se sont développées au Sud-Ouest en Mésopotamie c’est-à-dire en Irak et en Syrie… et qui continueront de se propager dans tout le Moyen-Orient (Figure 2).
Figure 2 – Localisation de la Mésopotamie (Irak)
et de la vallée de l’Indus (Pakistan)
2.1. Ancienne religion de l’Iran – les Perses et les Mèdes
Les débuts de la sédentarisation seraient attestés entre 7 500 et 6 000 av. J.-C. dans la culture iranienne d’Ali Kosh, laquelle est connue par ses constructions de briques d’argile crues et moulées.
N.B.1 : c’est ce type de matériau moulé et standardisé qui a servi aux constructions des palais et des temples de la vallée de l’Indus. Cette importante caractéristique se retrouvera dans certaines cultures et civilisations du Sud-Est asiatique… mais aussi de l’Amérique précolombienne et surtout andine (nord du Pérou).
Cette culture était aussi connue par ses rites d’inhumations des morts dont les crânes étaient conservés sous les demeures, indiquant par là un probable culte domestique des ancêtres. Certains crânes avaient même été déformés intentionnellement, pratique rituelle, généralement réservée aux élites.
N.B.2 : la déformation crânienne, attribuée aux Chinois, pourrait fort bien être d’origine mongole. Elle s’est également transmise à certaines cultures d’Asie du Sud-Est et d’Amérique… mais n’anticipons pas !
Plus proches de nous, si les cultes du feu ont été identifiés dans une aire géographique comprenant l’Iran, l’Afghanistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, ces mêmes cultes existaient également dans la culture Bactrio-Margienne (2 300 à 1 700 av. J.-C.) que l’on retrouve tout au long du fleuve Amou-Daria.
Ces cultes préfigurant le zoroastrisme se développeront un peu plus tard en Perse (Iran), en Inde du Nord et plus particulièrement dans la vallée de l’Indus (aujourd’hui au Pakistan).
Ainsi, dans l’actuel Turkménistan, l’archéologue russe Viktor Sarianidi a découvert un temple appelé Togolock 21, lequel n’était qu’une construction fruste comportant un réduit obscur abritant un autel dédié au culte du feu. C’était aussi un lieu où se préparait l’haoma, boisson hallucinogène qui permettait au célébrant d’accéder à un monde divin et d’atteindre ainsi un état d’immortalité provisoire, caractéristique propre à la transe chamanique.
Détail intéressant : de nombreuses amulettes y furent découvertes. Elles représentaient la lutte entre serpents et dragons, symbole de la lutte entre la vie et la mort… que nous retrouverons dans le zoroastrisme.
En Perse, les historiens ne sont pas très sûrs de l’ancienneté de la religion du feu et chez les Mèdes, à défaut d’écriture, elle est essentiellement connue par l’archéologie. Ainsi, le site de Nush-i Jan, situé à l’ouest de l’Iran, possédait un temple du feu daté de 3 500 à 3 100 av. J.-C. Un autre site, comme celui de Godin Tepe, situé au centre ouest de l’Iran, dans la vallée de Kangavar, aurait été utilisé comme temple du feu dès 3 100 av. J.-C.
Vers 1 500 av. J.-C., certaines tribus nomades d’éleveurs établies sur le haut plateau du Pamir (allant de l’est du Tadjikistan, en Afghanistan, au Kirghizstan et en Chine) commencèrent à envahir un vaste territoire s’étendant de l’Iran actuel aux vallées du Gange et de l’Indus. Seuls les livres religieux retracent la marche errante de ces Aryas, ancêtres des Perses, depuis le plateau du Pamir jusqu’au lac Hamoun où ils s’étaient séparés en deux grandes tribus :
Les Perses, qui s’établiront aux confins de l’Elam(sud-ouest du plateau iranien), dans une région qu’ils appelèrent Parça.
Les Mèdes, qui se fixèrent plus au nord, entre le Zagros et l’Elbourz.
Entre 1 500 et 1 000 av. J.-C., ces mêmes Aryas déferlèrent en vagues successives sur la vallée de l’Indus et le nord de l’Inde, y introduisant leur culture, leur religion avec ses croyances et ses rites…
C’est en Persequ’apparut une doctrine philosophique fondée par Zurvan Akarana, le dieu du temps infini. Ce dernier faisait aussi partie d’une tétrade qui regroupait les trois âges de la vie humaine, figurés par des êtres de nature divine :
Ashögär, qui représentait la jeunesse, la puberté et la virilité Frashögär représentant l’éclatante maturité.
Zarögär était le dieu de la vieillesse, c’est-à-dire de la longévité.
Selon la mythologie, le dieu Zurvan Akarana n’ayant pas de fils, offrit un sacrifice au dieu créateur qui l’écouta et lui permit d’avoir des jumeaux qui se seraient matérialisés par deux dieux antagonistes :
Ahura Mazda (Ohrmazd ou Ormuz), le dieu de la vérité et de la lumière qui devint le puissant dieu créateur du ciel et de la terre… et celui du Bien.
Ahriman (Angara Mainyu), son contraire et ennemi, devint le dieu destructeur, celui des ténèbres… et du Mal.
À son tour, Ahura Mazda eut des descendants :
Atar, le dieu du feu, combattant les forces du mal et des ténèbres.
Rapithwin, dieu associé à la renaissance et à la chaleur du soleil.
Verethragna, dieu de la guerre (équivalent de Vishnou).
Anâhita (ou Ahurani), la déesse de la fécondité qui était censée procurer l’immortalité par l’absorption de l’haoma (boisson équivalente au soma indien).
Vers 650 av. J.-C., sous l’égide de Zoroastre, prêtre réformateur du culte d’Ahura Mazda, le panthéon initial des divinités se restructura avec ce dernier comme dieu suprême. Toutes les anciennes divinités, issues de l’animisme et du zurvanisme, devinrent alors des « émanations » d’Ahura Mazda et douze de ces divinités qui possédaient leurs propres mythologies continuèrent à être vénérées par les croyants. Zoroastre eut aussi la mission de préserver le principe fondamental du mazdéisme, c’est-à-dire celui du choix primordial entre le Bien et le Mal, mais aussi de rénover l’ancienne religion en modifiant des éléments du livre sacré et en supprimant les sacrifices humains ainsi que ceux du taureau qui étaient l’animal le plus sacré… et le plus utile.
Ces douze divinités issues du zurvanisme pourraient rappeler les douze apôtres qui auraient suivi Jésus Christ lorsqu’il prêchait… mais peut-être n’est-ce que pure coïncidence ?
Pour Georges Dumezil, la société zoroastrienne se subdivisait en trois classes (rappelant les castes de l’Hindouisme), lesquelles étaient basées sur les fonctions exercées dont celle des prêtres était primordiale :
– Les prêtres qui remplaçaient les anciens chamanes étaient devenus les officiants du culte du feu.
– Les guerriers pami lesquels étaient choisis les rois ou plus généralement les gouvernants.
– Les agriculteurs qui formaient la grande majorité du peuple. Ils étaient chargés de la production des biens de consommation nécessaires à leur survie… et à celle des deux castes précédentes.
La philosophie religieuse du zoroastrisme était teintée de mythes et de légendes qui tentaient d’expliquer le fonctionnement du monde et de ses phénomènes naturels en s’appuyant sur les notions de Bien et de Mal, mais aussi sur celle du libre arbitre de l’Homme. Parmi les mythes essentiels, celui de la création est intéressant, car il se retrouvera sous une forme voisine dans un certain nombre de religions ultérieures.
Selon la mythologie perse, Ahura Mazda créa d’abord le ciel, puis l’eau, la terre, la végétation, les animaux, les êtres humains… et le feu. Après avoir façonné ces éléments et recouvert cette terre de plantes et de fleurs, il créa le taureau primordial : Gavaevodata, qui était si beau qu’il attira l’attention d’Angara Mainyule destructeur, qui le tua. Affligé, Ahura Mazda emmena le corps du taureau sur la lune où il fut purifié et, de sa semence, naquirent tous les autres animaux. Il créa ensuite le premier être humain : Gayomoartan, qui fut également tué par Angara Mainyu, mais de sa semence naquit le premier couple de mortels – Mashya et Mashyanag – qui vécurent dans la félicité jusqu’à ce qu’ils soient corrompus par les mensonges d’Angara Mainyu. Ils perdirent alors le paradis terrestre, mais leurs descendants héritèrent du don du libre arbitre et purent ainsi choisir eux-mêmes de suivre le Bien ou d’embrasser le Mal. Ahura Mazda défendait aussi tout ce qui était noble et juste et encourageait les gens à devenir la meilleure version d’eux-mêmes.
Comment ne pas penser au « paradis terrestre » perdu par ses deux premiers habitants, Adam et Eve, tel qu’évoqué dans la Bible. Les notions de libre arbitre et de sanctification figurent également dans certaines religions monothéistes !
Le corpus sacré de cette religion fut résumé dans l’Avesta, dont les hymnes – qui auraient été consignés vers 1 000 av. J.-C. – seraient en réalité très proches des textes védiques du Rig Veda. Ces hymnes évoquaient les relations entre Ahura Mazdā et six catégories divines indissociables les unes des autres et figurées par les « Immortels bénéfiques » dont les pouvoirs et les fonctions sont énumérés ci-dessous :
Vohu Manō, le principe de la bonne pensée ou pensée juste.
Asha Vahishta, la vérité et l’incarnation de ce qui est « vrai, bon et juste » c’est-à-dire la loi.
Xshathra Varya, le pouvoir et le royaume d’Ahura Mazdā. Il est aussi le gardien des métaux.
Spenta Armaiti, la pensée sacrée et l’immortelle incarnation de la Terre.
Haurvatāt, l’intégrité et la perfection.
Ameretāt représentait l’immortalité. Il est devenu le gardien de la nourriture et des plantes.
Le zoroastrisme incluait aussi deux aspects du temps :
– l’un illimité et linéaire qui se terminerait par la victoire finale du Bien ;
– l’autre fini et cyclique comportant des périodes de douze mille ans.
Nous découvrons ici la notion de temps cyclique qui se retrouvera dans le Védisme… mais aussi dans certaines religions de Mésoamérique et plus particulièrement chez les Mayas et leurs descendants.
Les principales divinités du zoroastrisme se multiplièrent ensuite avec :
Mithra, qui devint le puissant dieu du soleil levant, c’est-à-dire de la lumière. En tant qu’agent d’illumination, il était aussi associé à la plante haoma et à son dieu éponyme.
Cela nous ramène en quelque sorte aux pratiques du chamanisme, puisque cette plante psychotrope servait fréquemment à la fabrication d’une boisson qui permettait l’entrée en transes des chamanes. À noter également que le Mithra perse/iranien n’a rien à voir avec le Mithra du culte romain, qui était considéré comme une divinité astrologique.
Hvar Ksata, qui était le dieu du soleil radieux, lequel était responsable de la vie sur terre et souvent associé à Mangha (ou Mah), la déesse de la lune.
Ceci pourrait aussi préfigurer l’origine des cultes du soleil et de la lune des religions précolombiennes d’Amérique… si toutefois nous adhérons à l’idée d’un rapport direct et ancien entre l’Asie de l’Est et l’Amérique andine à travers le Pacifique, ainsi que nous le verrons ultérieurement.
Anahita était la déesse de la sagesse, de la fertilité, de la santé et de la guérison. Elle était aussi considérée comme la source de toute vie sur terre.
Rashnu devint le juge des morts. Il lisait les actes du défunt durant sa vie et l’envoyait soit au paradis (Maison du chant et de l’allégresse) soit en enfer (Maison du mensonge et des tourments).
Avec la réforme de Zoroastre, Rashnu semble avoir été ultérieurement remplacé par Mithra en tant que juge des morts et une balance à deux fléaux fut alors utilisée au lieu d’un parchemin sur lequel étaient inscrits les actes du défunt.
Verethragna était le dieu de la guerre, principal ennemi d’AngraMainyu, dont il combattait les légions du mal et du chaos.
Tishtrya était le dieu des pluies et des récoltes… auquel on associait parfois son jumeau Tiri, le dieu de l’agriculture.
Atar, le fils d’Ahura Mazda, était le puissant dieu du feu. Il était représenté sous la forme d’une flamme et suivait toujours le char de Mithra dans la bataille. Selon la légende, il constitua un facteur décisif dans le combat d’Ahura Mazda contre le dragon Azhi Dahaka, qui avait volé la « Grâce divine ».
Haoma était le dieu de la santé, de la force et de la vitalité. Il personnifiait aussi la plante du même nom qui, lorsqu’elle était pressée, donnait un jus consommé pour produire, sous certaines doses, un état de conscience altéré (ou illumination) qui permettait à l’utilisateur d’appréhender le divin… mais aussi de décupler sa vigueur.
Ce dieu ne semble pas avoir été vénéré par un rituel spécifique, mais il participait plutôt à tout rituel dans lequel le jus de la plante haoma était utilisé. Il était également le dieu de la récolte et, en tant que tel, associé à Anahita, Mithra et Atar.
Vayu-Vatu était le dieu ambigu du vent qui vivait entre les royaumes d’Ahura Mazda et celui d’Angra Mainyu et qui pouvait être bon et chasser les mauvais esprits… ou mauvais et provoquer des catastrophes météorologiques.
Ce dieu était aussi associé à l’espace et au temps terrestres replacés dans l’immensité de l’espace et du temps infinis.
Selon l’Avesta, les rites consistaient en une commémoration de l’action du dieu, mais ils étaient aussi une nécessité pour atteindre le paradis. Dès lors, ce qui attendait le croyant dans l’au-delà (la Maison d’Accueil d’Ahura Mazda ou la demeure maléfique d’Angra Mainyu) ne dépendait pas que de sa conduite éthique, mais aussi et surtout de sa capacité à bien suivre les rites et faire des sacrifices ou des offrandes qui plaisaient aux dieux… et à leurs représentants.
Dans l’Avesta, certains ont voulu voir l’origine du christianisme avec la triade des dieux du Védisme et du Christianisme, mais aussi l’opposition du diable, esprit du mal et de Dieu, esprit du bien, introduisant la notion de bienveillance dans cette dernière religion !
Des sources historiques viendraient même confirmer le lien entre la religion mazdéenne et le christianisme. Dans son ouvrage « Iran, une histoire de 4 000 ans », l’historien Yves Bomati mentionne qu’à la naissance du Christ, « Les trois rois étaient des mages zoroastriens qui seraient partis de territoire de Saveh, ville iranienne située à 140 kilomètres au sud-ouest de Téhéran… où se trouveraient leurs tombes. Alorsi, il semble bien que la jonction entre l’antique religion mazdéenne de l’Iran et le christianisme ait été faite et, que de ce fait, un héritage spirituel ancestral ait été ancré à la nouvelle religion ».
N.B. Paradoxalement, des éléments de cette même doctrine ont aussi nourri l’athéisme de l’œuvre du philosophe Friedrich Nietzsche.
La particularité du culte zoroastriste provient surtout de ses rites mortuaires. La terre et le feu étant perçus comme sacrés par les croyants, le cadavre du défunt ne devait pas entrer en contact avec eux sous peine de les souiller. Dès lors, les morts n’étaient ni enterrés ni incinérés, mais déposés au de « tours du silence » où ils étaient dévorés par les vautours ou autres charognards. Les prêtres venaient alors récupérer leurs sommet os nettoyés et les jetaient pêle-mêle dans un puits.
Cette dernière tradition funéraire rappelle celle des Incas qui déposaient leurs morts au sommet de tours (chulpas) comme à Silustani, non loin du lac Titicaca, pour les laisser dévorer par les vautours.
Si les comparaisons avec le christianisme sont nombreuses, les points communs entre l’Avesta et le Veda ne le sont pas moins. Certaines divinités indiennes ont ainsi leurs équivalents iraniens, ainsi :
Manah, la pensée correcte, correspond à Mitra.
Kshathra, représentant de la caste indienne des Kshatriya (guerriers), correspond à Indra.
D’autre part, la liqueur indienne, Soma, fait écho à la boisson sacrificielle mazdéenne Haoma, et les trois classes sociales (ou castes) se correspondent (prêtres, guerriers, éleveurs). Cependant, ces deux livres sacrés ne sont pas exempts de différences. Ainsi, la transformation de la mythologie de chacune de ces religions est allée de pair avec celle des deux sociétés. Par exemple, si « deva » désigne un dieu en sanskrit, il désigne un démon en avestique, etc.
Si l’Avesta et le Veda ont une même source et se sont mutuellement influencés, la doctrine mazdéenne a également inspiré la naissance de nouvelles religions, comme le Manichéisme et le Mazdakisme.Mani, le fondateur du Manichéisme, serait né au début du IIIe siècle après J.-C. et aurait été éduqué à Babylone au sein des « elkasaïtes », mouvement syncrétique situé entre Judaïsme et Christianisme. Se proclamant l’héritier de Zarathoustra, du Bouddha et de Jésus, Mani déclara que chaque être humain est habité à la fois par le Bien et le Mal. Utilisant une métaphore, il affirmait qu’avant la création de l’univers, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres coexistaient, jusqu’au jour où les ténèbres envahirent la lumière. Ainsi, l’objectif du Manichéisme était donc de rétablir la lumière. Cette religion ne demeura pas longtemps tolérée par les Perses, et Mani, emprisonné, mourut de privations. Désigné comme hérétique par le Christianisme qu’il concurrençait et plus tard par l’Islam, le Manichéisme parviendra toutefois à se maintenir quelques siècles en Chine.
Au cours des siècles, le Mazdéisme et le Védisme ont cheminé côte à côte jusqu’à aujourd’hui. Le Védisme s’est réformé avec l’Hindouisme, le Bouddhisme et le Jaïnisme, et les derniers mazdéens ont trouvé refuge en Inde sous le nom de « parsis ».
2.2. Anciennes religions de la Vallée de l’Indus, du nord de l’Inde et du Népal