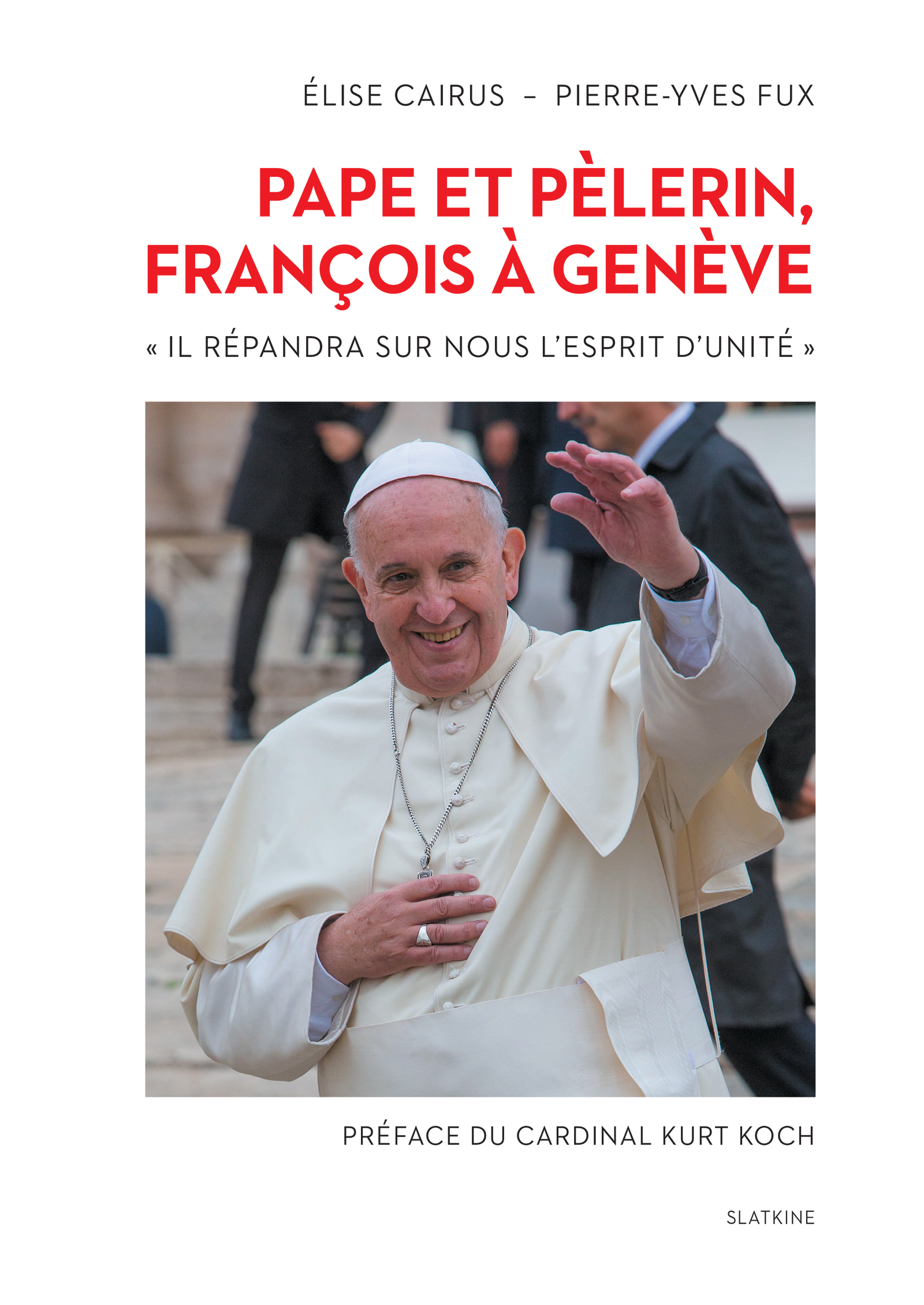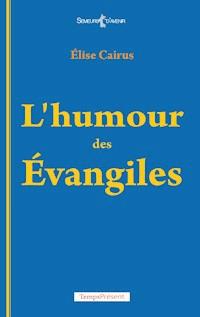
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Temps Présent éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Parce que spiritualité et humour ne sont pas forcément incompatibles.
Dans une période où religion et humour ne font pas toujours bon ménage, Élise Cairus propose une lecture apaisée du
Nouveau Testament, à travers ses traces d'humour.
Un humour qui est avant tout source de joie. Sa profondeur et sa subtilité aident à aller vers l'Autre et à se retrouver.
Cette recherche s'est faite dans le cadre plus général de son travail sur l'accompagnement spirituel de la naissance.
Une analyse de 15 passages humoristiques du Nouveau Testament !
EXTRAIT
Pour beaucoup de personnes, la religion apparaît comme une somme de contraintes et un catalogue de morale qui enferme, ne donnant matière ni à sourire ni à se réjouir. Sans parler des célébrations, jugées souvent tristes et ennuyeuses. Quant aux catastrophes que nous rapportent quotidiennement les médias, elles contiennent de plus en plus souvent leur lot d’attentats revendiqués par des fondamentalistes, ou de crimes pédophiles perpétrés par tel ou tel religieux. Églises et croyants semblent bien plus participer à la tristesse de l’époque qu’à ses bonheurs et à ses rires. Et pourtant, à y regarder de près, le christianisme - pour ne parler ici que de lui - est depuis son origine une religion de la joie. Et cela jusque dans les situations les plus désespérées.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Élise Cairus est doctorante en théologie à l’Université de Genève. Son travail de recherche, sous la direction de Lytta Basset, porte sur l’accompagnement spirituel de la naissance.
L’humour des Évangiles est son premier livre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introduction
Pour beaucoup de personnes, la religion apparaît comme une somme de contraintes et un catalogue de morale qui enferme, ne donnant matière ni à sourire ni à se réjouir. Sans parler des célébrations, jugées souvent tristes et ennuyeuses. Quant aux catastrophes que nous rapportent quotidiennement les médias, elles contiennent de plus en plus souvent leur lot d’attentats revendiqués par des fondamentalistes, ou de crimes pédophiles perpétrés par tel ou tel religieux. Églises et croyants semblent bien plus participer à la tristesse de l’époque qu’à ses bonheurs et à ses rires. Et pourtant, à y regarder de près, le christianisme - pour ne parler ici que de lui - est depuis son origine une religion de la joie. Et cela jusque dans les situations les plus désespérées.
Jésus, la veille de sa mort, après avoir annoncé à ses disciples qu’il quittait cette vie pour aller vers son Père, ne leur déclarait-il pas : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »1 ? Bien sûr, toute joie ne débouche pas forcément sur un grand éclat de rire, mais elle suscite le sourire et un visage ouvert sur ce qui l’entoure et l’émerveille. L’humour chrétien dont il sera question dans ce livre est un humour de résurrection, de victoire de la vie sur la mort, de remise en route après un temps d’arrêt plus ou moins long. C’est aussi un humour d’irrévérence et de saine provocation. Il est arrivé que Jésus use de l’ironie ou du sarcasme, notamment pour dénoncer le fondamentalisme religieux de son époque, incarné par les Pharisiens. Le chapitre 23 de l’Évangile de Matthieu, par exemple, est rempli de petites piques à leur encontre, toutes plus explicites et véhémentes les unes que les autres.
Un choix de passages extraits des quatre Évangiles nous emmènera dans les strates cachées pour en extraire l’humour qui donne cet éclat particulier aux histoires mettant en scène Jésus et différents personnages. Jamais plus vous ne les lirez ou les écouterez de la même façon et sans doute parviendrez-vous ensuite à en détecter d’autres au fil de votre découverte biblique ! Même en lisant pour la cinquantième fois un passage que l’on croit bien connaître, un détail peut tout à coup nous sauter aux yeux lorsqu’on se place avec les personnages dans la scène pour goûter soi-même les cinq pains et les deux poissons, le vin de Cana ou l’eau du puits de Jacob, pour admirer le coucher de soleil à Emmaüs ou encore pour se hisser dans le sycomore avec Zachée !
Au fil de ces différents passages, nous nous glisserons dans les pas de Jésus, au milieu des foules qui le suivaient, nous l’écouterons expliciter à l’aide d’une image ou d’une parabole, mêlant le ton grave au mot d’esprit, faisant passer son message en termes simples et directs. Il cherchait toujours à rejoindre son auditoire, à lui expliquer les desseins de son Père, en étant sûr que les gens auraient compris. Il ne connaissait ni la langue de bois, ni les tournures dogmatiques réservées à une élite. Il cherchait à provoquer chez son interlocuteur une sorte de décharge électrique le motivant à chercher toujours au-delà de son enseignement, à poursuivre la quête initiée par la rencontre.
L’Église et l’humour
Pour les chrétiens, la Bonne nouvelle de la Résurrection du Christ devrait ouvrir sur la joie. Force est de constater que ce n’est pas assez proclamé dans les paroisses, dans les Églises, ni dans les facultés de théologie. Le pape François s’emploie heureusement à retourner la tendance depuis le début de son pontificat, à travers ses homélies, ses prises de parole et son exhortation apostolique Evangelii gaudium, La joie de l’Évangile.
En 2015, lors du 500e anniversaire de la naissance de Philippe Néri, le saint de la joie et patron des humoristes, le pape a exhorté les chrétiens à rechercher cette joie qui a inspiré ce personnage au sein même du message de l’Évangile. « Sa vision du prochain ainsi que sa manière de témoigner à tous l’amour et la miséricorde du Seigneur peuvent constituer un bon exemple pour les évêques, les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs », a-t-il écrit à cette occasion. Il en a aussi profité pour mettre en garde les croyants à « ne pas proclamer l’évangile avec une tête d’enterrement ». Philippe Néri « était profondément convaincu que le chemin de la sainteté se fonde sur la grâce d’une rencontre - celle avec le Seigneur -, accessible à toute personne, de n’importe quelle condition ou état, qui l’accueillerait avec l’étonnement d’un enfant », écrit-il encore dans ce message à l’occasion de cet anniversaire. Les propos du pape rejoignent cet apophtegme2 d’Abba Euloge, un des Pères du désert : « Ne me parlez pas des moines qui ne rient jamais. Ils ne sont pas sérieux. » Et cette phrase célèbre de saint François de Sales : « Un saint triste est un triste saint. » Jusqu’à l’Ecclésiaste, qui nous rappelle, dans une formule restée célèbre, qu’il y a « un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser »3.
Dans la tradition de l’Église, à Pâques, le prêtre ou le pasteur était tenu de faire rire son auditoire avec une prédication aussi percutante qu’inattendue, voire en racontant une blague ou deux, se moquant du diable et de sa cohorte mortifère désormais vaincus et accentuant son message sur la proclamation de la joie de la Résurrection du Christ. Le rire symbolisait en effet, surtout au Moyen-Âge, la joie de la Résurrection. Force est de constater que de nos jours, rares sont les échos d’éclats de rires sous les voûtes de nos églises, même à Pâques... Le rire, à l’église, nuirait, selon certains, au sérieux de la foi. Or un chrétien n’est jamais triste, rappelle souvent le pape François. Sa joie réside dans le fait d’avoir rencontré le Christ, Dieu qui se manifeste dans une folie, celle de la croix où il affirme sa puissance dans la faiblesse4. Lorsqu’on les regarde de plus près, les récits de la Résurrection, dans les quatre Évangiles, sont truffés d’effets que l’on pourrait qualifier de « spéciaux », comme par exemple l’arrivée surprise d’anges ou de messagers de Dieu dans un tremblement de terre ou portant des vêtements éblouissants5, qui peuvent aussi bien provoquer la fascination, l’effroi qu’un grand éclat de rire ou de joie. Le message de Pâques est assez énorme pour susciter soit des moqueries, chez les sceptiques, soit un surcroît de joie, chez les croyants.
Même le réformateur Jean Calvin, au XVIe siècle, qui avait la réputation d’être un être terne, sévère et rigoriste, n’interdisait pas le rire. « ll n’est en aucun lieu défendu ou de rire, ou de se rassasier, ou d’acquérir nouvelles possessions, ou de se délecter avec des instruments de musique, ou de boire du vin »6, écrit-il dans l’Institution de la religion chrétienne. Usant de l’ironie et du sarcasme, il n’était pas toujours tendre, en particulier lorsqu’il abordait des questions polémiques et des disputes théologiques. À l’instar de son Traité des reliques, petit ouvrage ouvertement satirique s’adressant à un large public, écrit à cette fin directement en français - il est même considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature francophone - dans lequel il condamne avec verve certaines pratiques de l’Église catholique autour du culte des reliques. À propos de morceaux de la « vraie » croix du Christ épars dans divers endroits, il écrit ceci : « Quelle audace donc a-ce été de remplir la terre de pièces de bois en telle quantité que trois cents hommes ne le sauraient porter ? Et de fait, ils ont forgé cette excuse que, quelque chose qu’on en coupe, jamais elle n’en décroît. Mais c’est une bourde si sotte et lourde que même les superstitieux la connaissent. »7 Son ton ironique peut paraître méprisant, mais il donne une autre facette du réformateur et de l’homme de loi qu’il était, fin rhéteur défendant la cause de l’Évangile.
L’humour thérapeutique
En organisant un colloque sur le thème de l’humour et de la spiritualité, en avril 2015 à l’Université de Neuchâtel en Suisse, je me suis demandé quel angle j’allais choisir pour ma communication, qui devait être en lien avec le sujet de ma thèse de doctorat sur « l’accompagnement spirituel de la naissance ». Ce dernier n’étant pas spécialement drôle, je ne voyais pas bien quel rapport établir avec l’humour... Dans le cadre de ce travail de longue haleine, j’ai demandé à des parents ce qu’ils avaient vécu au moment de la naissance d’un enfant afin d’explorer des pistes d’accompagnement spirituel là où ils avaient ressenti un manque ou une lacune. Je me trouvais alors face à des situations qui ne prêtaient vraiment pas à rire, telles que l’infertilité, la mort in utero, le deuil périnatal, l’avortement, l’interruption médicale de grossesse ou encore l’accueil d’un enfant handicapé. Mais à bien y réfléchir, j’ai réalisé que lors de l’accompagnement de ces personnes traversant ou ayant traversé de telles expériences, quelque chose d’imperceptible et de fort se produisait, qui se glissait dans l’entre-deux de la relation, presque à l’insu de l’accompagnant et de l’accompagné, et qui ne les quittait pas. Et pour instiller ce « quelque chose », en puisant notamment dans la lecture de la Bible, il peut y avoir plusieurs chemins, plusieurs recours, dont celui de l’humour, bien présent, quoique subtil, dans les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Il n’est pas rare alors, au cœur d’une situation dramatique, en évoquant tel ou tel passage non exempt de situations étonnantes, rocambolesques ou de propos provocateurs, de voir soudain s’illuminer un visage, s’afficher un sourire, et d’être le témoin d’une lueur d’espérance. Utilisé à des fins « thérapeutiques », l’humour crée ou maintient le lien, suscite la distance nécessaire, interpelle, questionne, conforte et réconforte.
Humour et second degré
L’humour que l’on trouve dans les Évangiles, c’est en partie de l’humour juif. Jésus est un Juif qui s’adresse à des Juifs. « Le rire, dans l’humour juif, est un mécanisme de défense ; il a un effet thérapeutique (...) ; il est proche des larmes (“rire entre les larmes” (...)) ; parfois, l’histoire juive ne fait même pas rire, mais provoque plutôt un soupir. (...) Certains auteurs évoquent le rôle pédagogique de l’humour juif, l’“enseignement par l’humour” »8, et c’est exactement ce qui se produit dans les Évangiles pour « éduquer » le lecteur ou l’auditeur, au sens étymologique du terme, c’est-à-dire pour le faire sortir de ses préjugés et le mener le plus près possible de Dieu, c’est-à-dire, pour un chrétien, de l’intérieur de lui-même. L’humour aide à s’émanciper, voire à rendre la vie plus légère. Souvenons-nous que le peuple juif garde en lui les cicatrices des temps passés, où, d’exode en exode, il dut apprendre à vivre en diaspora et à éponger les larmes dues aux violences faites à son encontre.
L’humour juif implique une capacité à comprendre le second degré. La Bible demande cette exigence d’interprétation, empêchant de s’arrêter au seuil des textes mais invitant à entrer dedans, à en approfondir le sens caché, à empoigner ses dictionnaires d’hébreu et de grec et ses commentaires pour cheminer dans les méandres du texte qui recèle tellement plus que ce qui se voit.