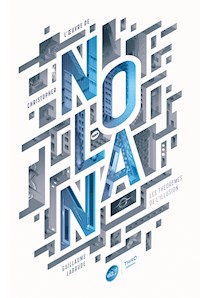11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Comment le cinéma de Quentin Tarantino a-t-il évolué de films nerveux et provocateurs à un cinéma plus posé et réfléchi?
Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, le cinéma de Quentin Tarantino ne laisse pas indifférent. Depuis la sortie de Reservoir Dogs, les critiques n’ont eu de cesse de fustiger certains aspects de ses films, tels que les dialogues à rallonge et les hectolitres de sang déversés à l’écran. Pourtant, derrière ces éléments si caractéristiques se terre avant tout la passion intense de Tarantino pour le septième art. Dans cet ouvrage unique, le docteur en études culturelles Guillaume Labrude rend hommage au réalisateur en revenant sur sa carrière et en décryptant ses longs-métrages par le biais de leur scénario, leur esthétique et leurs multiples références. Qu’il s’agisse de la violence, du rôle des personnages féminins ou, tout simplement, de la grande histoire du cinéma, tous les thèmes chers au cinéaste sont ici analysés en profondeur.
Retrouvez dans cet ouvrage le plaisir de l'analyse des thèmes chers à Tarantino, de sa fascination pour les gangsters, en passant par les dialogues absurdes et passionnés sur la nourriture, aux multiples chorégraphies de la violence.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Avant-propos
IL ÉTAIT UNE FOIS… EN 1994. Du haut de mes quatre ans, j’entrais pour la première fois dans un cinéma. Une petite salle de quartier, aujourd’hui détruite et remplacée par un multiplex. Le film projeté venait de sortir et s’apprêtait à devenir l’une des œuvres les plus célèbres du studio Disney : Le Roi lion, un improbable mélange animalier entre Hamlet de William Shakespeare et Le Roi Léo d’Osamu Tezuka. Après avoir séché les larmes provoquées par la mort de Mufasa, je repris ma petite vie, alternant entre l’école, les longues sessions de dessin, les matinées et les après-midis en compagnie du Club Dorothée. Pour moi, le cinéma, c’était avant tout les dessins animés. Ce que j’ignorais, c’est que cette année-là, un jeune réalisateur recevait des mains de son idole Clint Eastwood la précieuse Palme d’or du Festival de Cannes (dont j’ignorais aussi l’existence) avant de déclarer à une salle comble, divisée entre applaudissements et huées : « Je ne me suis jamais attendu à gagner quoi que ce soit dans un festival où un jury décerne des prix, car je ne fais pas le genre de film qui rapproche les gens. Et il faut trouver des films comme ça. Moi, je fais des films qui divisent l’opinion. »
Quelques années plus tard, mes parents me faisaient découvrir, à la télévision, mon premier film en prises de vue réelles : Jurassic Park, de Steven Spielberg. Le choc fut évident, la magie surpuissante, les yeux pleins d’étoiles, de gelée qui tremble et de vélociraptors. La fin de mon enfance et le début de mon adolescence furent ensuite rythmés par les films d’action : Bruce Lee et Jackie Chan comme ambassadeurs orientaux, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger et surtout Bruce Willis/John McClane pour les productions occidentales. Entre-temps, mon frère et ma sœur se prêtaient des CD, et l’un d’eux était tombé sous mes yeux. Sa jaquette m’avait interpellé : une jeune femme portant un carré noir me regardait, une cigarette à la main. Au-dessus d’elle était écrit, en grosses lettres jaunes, Pulp Fiction. Je ne savais pas qu’il s’agissait d’Uma Thurman, dont je tomberais presque amoureux en la découvrant en tant que Poison Ivy (alors mon antagoniste favorite dans la série animée de Paul Dini et Bruce Timm) dans le bigarré Batman et Robin (1997) de Joel Schumacher. C’est lorsque mon frère commença à me traîner de salle obscure en salle obscure que je fis une découverte importante par le biais d’un fascicule annonçant les films à venir. Je reconnus Uma Thurman sur une affiche qui, par sa couleur jaune monochrome, me tapa inévitablement dans l’œil ; elle tenait un katana et me regardait une fois de plus dans les yeux. Une bande noire et une tache de sang stylisée derrière elle et, à sa droite, le titre : Kill Bill : Volume 1. « Tarantino fait un nouveau film ? », s’était étonné mon frère en jetant un œil au petit livret. Tarantino ? C’est qui, Tarantino ?
Un an plus tard, le réalisateur serait président du jury au Festival de Cannes. Remarquant sans doute que le septième art m’interpellait de plus en plus, mes parents enregistrèrent la cérémonie d’ouverture sur Canal + en clair pour que je puisse la regarder. J’avais ma réponse : en plus d’être un énergumène hyperactif dont le débit de parole s’avère comparable à celui d’une mitraillette, Quentin Tarantino était accessoirement l’auteur de ce fameux Pulp Fiction dont j’ignorais encore tout. Les signalétiques de l’époque indiquaient en bas de l’écran à quel public étaient destinés les films du cinéaste, dont certains extraits diffusés servaient à retracer sa carrière. Je découvris alors que Kill Bill était déconseillé aux moins de 16 ans et, comme je n’en avais que treize ou quatorze, je ressentis forcément l’irrémédiable envie de le voir.
Sans Internet à la maison, je passai mes heures d’étude au collège à monopoliser un ordinateur du centre de documentation et d’information, recherchant avidement ce qui pouvait bien se passer dans Kill Bill pour que ce dernier mérite une telle interdiction au jeune public. Lorsque mon frère parvint à mettre la main sur le long-métrage, je découvris une œuvre que je pensais connaître par cœur avant même de l’avoir vue. C’est là qu’un détail, qui n’en est finalement pas un, m’a sauté aux yeux : beaucoup de questions supplémentaires s’imposaient à moi, alors que j’avais pourtant bossé mon sujet des mois en amont. Pourquoi la Mariée est-elle habillée en jaune ? Pourquoi O-Ren porte-t-elle un kimono blanc ? Pourquoi le shérif a-t-il une collection de lunettes dans sa voiture ? Pourquoi le split screen ? Pourquoi Elle Driver siffle-t-elle dans les couloirs de l’hôpital ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Mes recherches reprirent de plus belle et je découvris, ébahi, que chacun des films de Tarantino possédait suffisamment de clins d’œil et de références pour me faire vider des cartouches d’encre entières à force de tirer des listes d’œuvres, parfois obscures, à découvrir. En 2009, un mois avant les épreuves du bac, ma boulimie cinéphile atteignit des sommets. En quatre semaines, je regardai soixante-treize longs-métrages, en avalant souvent l’intégralité des filmographies des réalisateurs nouveaux pour moi : Martin Scorsese, Akira Kurosawa, David Lynch, Kathryn Bigelow, Jean-Luc Godard, David Cronenberg, Paul Verhoeven, Lars von Trier, François Truffaut, Park Chan-wook, Wilhelm Friedrich Murnau… Sans surprise, je me retrouvai quelques années plus tard à étudier le cinéma à l’IECA de Nancy, côtoyant des personnes qui avaient vécu sensiblement la même chose. Plus tard encore, je me lançai dans la grande aventure du doctorat en mettant à profit mon goût prononcé pour la recherche, la découverte et l’analyse. Tout ça grâce au regard d’Uma Thurman sur papier glacé, et l’œuvre d’un artiste désireux de partager ses passions à travers ses films.
En 2019, seul dans une salle au petit matin, j’ai découvert Once Upon a Time… in Hollywood. Passé le choc du premier visionnage, avec l’envie d’en parler à tout le monde, je retournai le voir le lendemain. Au sortir de cette seconde séance, ma décision était prise : la fin de mon doctorat consacré à Batman approchant, Tarantino deviendrait mon prochain sujet d’étude. Le cycle arrivait à son terme : étant grâce à lui devenu cinéphage et avide de culture populaire, lui dédier une analyse était le meilleur moyen de boucler la boucle et, qui sait, entrer enfin dans l’âge adulte.
Le soir de mes trente ans, nous étions tous costumés en personnages de Tarantino. Grimé en Calvin Candie, je bus du saké en compagnie d’Elle Driver, Jackie Brown et même Lance, le dealer de Vincent Vega, avec son t-shirt Speed Racer et son peignoir beige, tandis que des amies s’affrontaient avec leurs fléaux improvisés dans le couloir, habillées en Gogo Yubari. Un ami, qui passe sa vie sur les plateaux de tournage, s’est carrément déguisé en Donny Donowitz (l’Ours juif d’Inglourious Basterds) en empruntant à l’un des accessoiristes du film la fameuse batte de baseball dont il se sert pour éclater les crânes des officiers nazis. Nous avions même poussé le perfectionnisme jusqu’à inventer des marques et des étiquettes pour les bouteilles de cocktails préparées en amont1. En 1994, Quentin Tarantino déclarait qu’il voulait diviser… Force est de constater qu’il nous avait un peu plus réunis ce soir-là.
Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, son nom parle à n’importe qui s’intéressant un minimum au septième art. Chose rare pour un cinéaste, bien qu’il n’ait pas des dizaines de longs-métrages à son actif, il est possible de trouver des communautés de fans autour de chacun de ses films. Les cinéphiles de la vieille école argueront que Reservoir Dogs est son chef-d’œuvre, car c’est un film coup de poing qui fleure bon la fougue du débutant. D’autres érigeront Django Unchained comme sa plus éminente production, car c’est un grand film d’aventure sans temps mort, aussi grave que jouissif. Vous pourrez même trouver des spectateurs pour qui Boulevard de la mort, son plus grand échec commercial, est la quintessence de son œuvre. Avec une filmographie sans concessions, diversifiée, mais toujours empreinte de son style identifiable à la première réplique, Quentin Tarantino n’a pas démérité son statut d’auteur culte, et la passion qui transpire de chacun de ses films a aussi parfois créé des vocations.
1. Le gin-fizz était rebaptisé Cliff-Booze et le gin-tonic Drink-Dalton, des jeux de mots sur la boisson (fins comme du gros sel) en référence aux deux protagonistes de Once Upon a Time… in Hollywood.
L’auteur
Né en 1990, Guillaume Labrude n’en est pas moins un enfant des années 1980. Grâce à deux aînés qui lui ont transmis leurs cultures, il se passionne rapidement pour la bande dessinée, le cinéma et le jeu vidéo tout en gardant toujours un œil dans le rétroviseur.
Diplômé de l’Institut européen du Cinéma et de l’Audiovisuel de Nancy, il rédige ensuite une thèse sur les représentations de la famille dans Batman de 1939 à 2016. Pendant cinq ans, il enseigne l’analyse filmique, la bande dessinée et le jeu vidéo à l’université de Lorraine, validant au passage son doctorat en langues, littératures et civilisations. En 2020, il intègre l’école supérieure d’arts de Condé en tant que professeur de culture visuelle.
En parallèle de ses activités professionnelles, il donne de nombreuses conférences dans divers colloques, notamment à Montréal et à Cerisy où il s’est penché sur les jeux du studio FromSoftware. Il est également illustrateur et auteur de bande dessinée pour la revue Fantasy Arts and Studies et réalise des webcomics depuis 2010.
Chapitre 1 :Il était une fois… au vidéoclub
Un homme sous influence
Quentin Tarantino voit le jour le 27 mars 1963 à Knoxville, Tennessee. Sa mère, Connie McHugh, est infirmière et son père, Tony Tarantino, un comédien amateur italo-américain, doublé d’un musicien. Dès sa naissance, la vie du futur cinéaste est déjà placée sous le signe de la référence : le prénom Quentin provient de Quint Asper, le personnage interprété par Burt Reynolds dans la série Gunsmoke (CBS, 1955-1975). Ce type de clin d’œil deviendra l’une des nombreuses marques de fabrique de sa filmographie. Avant même que l’enfant ne vienne au monde, Tony quitte le domicile familial, laissant Connie seule. Lorsqu’en 1965, cette dernière déménage à Torrance, dans la banlieue sud de Los Angeles, elle se remarie avec un certain Curtis Zastoupil, pianiste de bar, qui deviendra l’initiateur du jeune Quentin au septième art. Loin du cinéma social et intellectuel new-yorkais dont Woody Allen se fera progressivement l’un des fers de lance, Tarantino va trouver en Californie – terre nourricière des grands studios et des films d’exploitation – un lieu d’apprentissage et de jeu qui forgera sa cinéphilie.
Boulevard du crépuscule
Comme une drôle de coïncidence, ou au moins une étrange prémonition, le futur réalisateur vient au monde au moment où se constitue le Nouvel Hollywood. Ce mouvement cinématographique – porté, entre autres, par Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian De Palma et bien évidemment Martin Scorsese – s’inspire de la Nouvelle Vague française et marque une rupture avec l’âge d’or hollywoodien de la première moitié du XXe siècle. Ce dernier se caractérisait par la toute-puissance des studios, qui enchaînaient les productions adaptées d’œuvres généralement littéraires, le tout sous la pression du code de censure édicté par William Hays. C’est en 1967 que le Nouvel Hollywood est définitivement instauré par le film Bonnie et Clyde d’Arthur Penn, un road movie mettant en scène le célèbre couple de braqueurs qui sévit durant la Grande Dépression. Violence graphique et verbale, morale ambiguë… les amants criminels incarnés par Faye Dunaway et Warren Beatty deviennent des icônes, des symboles de rébellion pour l’industrie dans son ensemble. Les cinéastes ne sont plus de simples employés de studio, qui filment leurs commandes – aussi grandioses soient-elles – dans des décors montés de toutes pièces. Non, il s’agit bien d’auteurs qui descendent dans la rue et filment ce qui leur plaît, ou ce qui les intéresse, caméra à l’épaule, dans des décors naturels et réalistes.
Les décennies qui suivront seront marquées par ce vent de liberté, et ce sont ces œuvres que le petit Quentin dévorera dans les cinémas de quartier. Des films de gangsters aux productions horrifiques, en passant par le cinéma d’exploitation hongkongais et sans exclure les genres plus classiques comme le western (néanmoins révolutionné par les Italiens), Tarantino sera bercé par des figures qui n’ont plus rien des héros sans peur et sans reproche de l’âge d’or. Un pour tous et tous pourris : ces mercenaires de l’Ouest, ces yakuzas découpeurs de petits doigts et ces héroïnes afro-américaines qui laissent davantage parler la poudre que ceux qui les persécutaient autrefois deviendront autant de figures de contestation venant nourrir l’imaginaire du jeune cinéphile.
La Cité des enfants perdus
L’enfance des grands auteurs est généralement sujette à débats. Non pas qu’elle comporte des éléments qui s’inscrivent dans des problématiques de leur époque, mais davantage parce qu’elle semble souvent romancée : une appétence étrange pour le septième art en réponse à une vie de misère, des problèmes sociaux ou d’intégration, une rencontre décisive au hasard d’un plateau de tournage… Prenez Martin Scorsese, par exemple, ce petit asthmatique qui ne pouvait jouer avec ses camarades dans les rues de New York sous peine de se voir pris d’une violente quinte de toux. L’histoire raconte qu’il passait l’essentiel de ses après-midis dans les salles obscures, à découvrir les chefs-d’œuvre qui ont forgé la culture cinématographique qu’on lui connaît. Une cinéphilie qui l’a par ailleurs poussé à réaliser un documentaire sur le sujet : Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain (1995).
En 2011, Alberto Morsiani est revenu sur la jeunesse du cinéaste qui nous intéresse, dans son ouvrage Quentin Tarantino : film après film, scène par scène, une incursion dans les intrigues violentes du réalisateur le plus transgressif du jeune cinéma américain. Pendant ses jeunes années, l’artiste en devenir est essentiellement bringuebalé entre petits délits et visionnages de films d’exploitation, en salles ou à la télévision. Car si le réalisateur est célèbre pour son amour et son respect le plus total du cinéma et de la pellicule, il demeure en partie un enfant de la télévision, pour laquelle il œuvrera à plusieurs reprises.
C’est à l’âge de 15 ans que Tarantino abandonne les études pour courir les rues à la recherche de jobs alimentaires, recherches qui débouchent sur un poste de projectionniste dans un cinéma pornographique de Los Angeles. Une fois de plus, la vie du cinéaste rejoint l’histoire de son art : là où le Nouvel Hollywood déporte les tournages des plateaux de grands studios jusque dans les rues poisseuses, le jeune Quentin délaisse l’institution scolaire pour se former en arpentant le sol goudronné de la Cité des Anges. Il prend alors contact avec le cinéma de mauvais genre : l’horreur, la violence, l’érotisme et la pornographie. À cette période, Curtis Zastoupil, initiateur de Tarantino au cinéma, n’est plus présent et sa mère, Connie, se retrouve seule avec son rejeton, fournissant à ce dernier un exemple d’indépendance féminine, une caractéristique que l’on retrouvera plus tard dans la filmographie du réalisateur.
The King of Comedy
Comme le précise Jerome Charyn dans son ouvrage sobrement intitulé Tarantino (2009), c’est en 1981, à l’approche de sa majorité, que l’artiste s’inscrit à la James Best Theatre Company, située dans le quartier de Toluca Lake, dans la vallée de San Fernando – la patrie californienne du porno. Mais les difficultés d’intégration du jeune homme le poussent à quitter l’institution pour s’orienter vers des cours d’art dramatique auprès d’Allen Garfield, un acteur qui, comme Tarantino, a largement vagabondé. Celui-ci est en effet passé du statut de journaliste sportif au Golden Gloves à celui de boxeur, avant d’intégrer le prestigieux Actors Studio de New York. À l’époque, cette institution se trouve sous la houlette du cinéaste Elia Kazan, à qui l’on doit notamment Un tramway nommé Désir (1951) ou Sur les quais (1954), deux chefs-d’œuvre ayant fait connaître un certain Marlon Brando. Ce dernier était d’ailleurs reconnu pour l’intériorisation extrême de ses rôles, une méthode d’apprentissage du jeu que l’on doit à la tête pensante de l’Actors Studio, Lee Strasberg.
Allen Garfield est alors lui-même l’héritier de « la méthode », un principe de jeu que l’on doit à Constantin Stanislavski et qui fut là encore démocratisé par Strasberg. Ce principe, également appelé « méthode Stanislavski », consiste pour le comédien à puiser dans son histoire personnelle pour y trouver les éléments qui le rapprochent du personnage qu’il doit incarner. Ceci afin de le comprendre psychologiquement et émotionnellement, et ainsi le rendre plus crédible.
Quentin Tarantino se forme en tant qu’interprète dans cette longue tradition d’acteurs investis corps et âme dans leur exécution, une qualité fondamentale vis-à-vis de ce qui fera le sel de son cinéma : des personnages parfaitement caractérisés, à la personnalité plus qu’imposante. L’habitude de jouer certaines scènes tirées de grands classiques avec ses collègues, tout en réécrivant certaines répliques qu’ils ont oubliées, constitue alors un exercice formateur pour Tarantino, notamment par rapport à l’un des aspects les plus identifiables de son cinéma : les dialogues à rallonge et les conversations sur des sujets anodins au cours de situations qui le sont bien moins. Le jeune disciple prend peu à peu conscience de ses talents de scénariste, lui qui n’a jamais fréquenté d’école de cinéma.
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
S’il s’est fait pour spécialité, dans ses premiers films, de dépeindre avec humour et violence les affres de la vie de petits malfrats, Tarantino emploie involontairement une certaine partie de ses jeunes années à leur ressembler. Encore une fois, l’histoire du cinéaste est liée à son œuvre, et les coïncidences semblent bien trop nombreuses pour n’être, justement, que de simples coïncidences. À la fin des années 1970, l’adolescent arpente de nuit les rues de Los Angeles pour récupérer la monnaie des magazines pornographiques restée dans les kiosques. À 18 ans, il est arrêté pour le vol d’un roman noir d’Elmore Leonard, auteur spécialiste du genre qui signera Rum Punch en 19921, lequel sera adapté en 1997 par Tarantino lui-même avec son troisième film, Jackie Brown2. Pendant plusieurs années, Tarantino cumule les contraventions non payées pour un total de sept mille dollars, soit deux mille de plus que le budget de son premier film amateur réalisé en 1987. Dans l’incapacité de fournir la somme réclamée par les autorités, le futur réalisateur – qui se rêvait gangster – se voit contraint d’effectuer quelques séjours en prison, de dix à trente jours, pour faire amende honorable. Peut-être prend-il alors contact avec la faune carcérale qui inspirera ses personnages en devenir.
Vidéodrome
Comme le souligne Jacky Goldberg dans son article « Mystère T. » (Vanity Fair no 31, 2016), c’est après quelques années de petits boulots, notamment en tant qu’ouvreur et placeur dans le cinéma pornographique Pussycat3, que Tarantino intègre en 1983 la boutique de location Video Archives, située sur Hermosa Beach en Californie. Il y découvre des artistes fondamentaux à son futur style cinématographique, comme John Woo qui lui donnera le goût pour une violence esthétisée, Shohei Imamura et ses thrillers sombres et psychologiques, Eric Rohmer et l’écriture ciselée de ses personnages qui prédominent sur l’intrigue de ses films, Jean-Pierre Melville et son art du polar musclé, ainsi qu’un certain Jean-Luc Godard4, qui influencera grandement la rédaction du scénario de Reservoir Dogs, en mettant notamment en scène un groupe de braqueurs dont les noms de code correspondent à des couleurs. L’appétit vorace de Tarantino le pousse petit à petit à consommer l’intégralité du catalogue Video Archives et à le connaître sur le bout des doigts. Il devient dès lors un conseiller de choix pour les clients de la boutique, dans laquelle il dort pendant plus de cinq ans. Lorsqu’elle ferme ses portes en 1994, Tarantino rachète d’ailleurs l’intégralité du stock de VHS – qui s’élève à plus de huit mille titres – afin de les conserver et leur offrir une seconde vie, en organisant notamment des soirées de projection.
Jusqu’en 1989, le futur cinéaste travaille dans le magasin aux côtés, entre autres, d’un certain Roger Avary, avec qui il partage sa passion du cinéma. Tous deux se mettent alors à écrire des scénarios, les prémices de ceux de True Romance et de Pulp Fiction. À noter qu’Avary est lui-même devenu réalisateur en signant Killing Zoe en 1994, un film de braquage dans lequel se ressentent les personnages et thématiques développés avec Tarantino lors de leurs séances d’écriture.
Dog Day Afternoon
En 1987, lors des Mardis de la fondation5, Gilles Deleuze évoque sa vision de l’art et, plus précisément, de la création : « Tout le monde sait bien qu’avoir une idée, c’est un événement rare, […] avoir une idée, c’est une espèce de fête. […] Et d’autre part, avoir une idée, ce n’est pas quelque chose de général, on n’a pas une idée en général. Une idée est déjà vouée, tout comme celui qui a l’idée est déjà voué, à tel ou tel domaine. […] Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d’expression. […] »
Cette même année, le créateur Tarantino travaille activement sur son premier long-métrage, avec comme idée inamovible d’en être certes scénariste, mais aussi, et surtout, réalisateur ! Le tout conformément à la pensée propre à la Nouvelle Vague et, par extension, au Nouvel Hollywood qui a bercé ses jeunes années : une idée, un médium et une œuvre en devenir. Il est clair que Los Angeles est alors l’une des villes privilégiées pour entrer en contact avec le milieu du cinéma. Son industrie comporte tous les éléments pour mettre en œuvre la réalisation du projet artistique de Tarantino. Pourtant, c’est dans un tout autre registre que celui-ci va pour la première fois communier avec le milieu cinématographique.
Cette année-là, l’acteur suédois Dolph Lundgren, rendu célèbre pour son rôle d’Ivan Drago dans Rocky IV (Sylvester Stallone, 1985), tourne à Los Angeles une vidéo explicative de musculation nommée Maximum Potential sous la direction de John Langley. Ni scénariste ni cadreur, le rôle de Tarantino consiste avant tout à ramasser les déjections du chien de l’acteur. Une tâche ingrate parmi tant d’autres finalement, vu que certains grands cinéastes ont également débuté au bas de l’échelle pour mieux la gravir, à l’instar de William Friedkin, qui était coursier et balayeur pour la chaîne WGN-TV avant de devenir l’un des chantres du Nouvel Hollywood avec des films acclamés comme French Connection en 1971 ou L’Exorciste en 1973.
Pour Tarantino, les années 1980 sont marquées par son rapprochement avec le milieu de l’audiovisuel, quelle que soit la nature de ce pas en avant. Si la destinée de l’œuvre prédite par Gilles Deleuze semble encore lointaine, elle n’en demeure pas moins palpable. En 1988, alors qu’il a déjà réalisé son premier film amateur, Tarantino incarne un sosie d’Elvis Presley dans le sixième épisode de la quatrième saison de la série Les Craquantes de Susan Harris (NBC, 1985-1992). Pas besoin de se déguiser : avec sa coupe de cheveux atypique et son costard, qu’il apporte lui-même sur le plateau de tournage, Tarantino s’en donne à cœur joie ! Le King, figure légendaire du rock’n’roll, hantera d’ailleurs une certaine partie de sa filmographie, entre le look de son personnage dans My Best Friend’s Birthday et les hallucinations du protagoniste de True Romance, qui se voit conseillé par un fantôme d’Elvis incarné par Val Kilmer6.
My Best Friend’s Birthday
Dès 1984, Craig Hamann, un autre employé de Video Archives, rédige un premier scénario de quelques dizaines de pages intitulé My Best Friend’s Birthday. C’est avec le concours de Quentin Tarantino qu’il réécrit son texte pour aboutir à une nouvelle version de quatre-vingts pages. Les deux compères du vidéoclub partent ensuite à la chasse au budget pour finalement dégoter cinq mille dollars, une cagnotte absolument dérisoire, même pour l’époque. À l’aide d’une caméra de location 16 millimètres, les cinéastes en herbe se lancent dans le tournage, à raison d’une partie de leurs vendredis et de la totalité de leurs week-ends, le tout étalé sur trois longues années. My Best Friend’s Birthday sera mis en boîte, mais le résultat, une fois monté, n’égalera pas les espérances de l’équipe, et encore moins celles de son réalisateur.
Le film reste inachevé à ce jour, puisque l’essentiel de la pellicule a péri dans l’incendie du laboratoire de développement7. Une fin tragique qui a sans doute servi d’inspiration à Tarantino pour le final d’Inglourious Basterds (2009), dans lequel d’innombrables bobines sont embrasées par Marcel, le projectionniste, afin d’incendier le cinéma où sont réunis tous les hauts dignitaires nazis.
Pourtant, l’œuvre en question demeure fondamentale dans la filmographie de son auteur qui reconnaît lui-même avoir énormément appris lors de sa production. On peut notamment trouver, çà et là, divers éléments qui préfigurent certains tics d’écriture et de réalisation du cinéaste. My Best Friend’s Birthday, c’est l’histoire de Mickey (Craig Hamann), un jeune homme quitté par sa fiancée le jour de son anniversaire. Son meilleur ami, Clarence (Quentin Tarantino), va donc se faire un devoir de sauver la mise pour le jour le plus important de son existence. Les prénoms des deux personnages préfigurent évidemment ceux des films Tueurs nés (Mickey Knox, incarné par Woody Harrelson) et True Romance (Clarence Worley, incarné par Christian Slater). Plus encore, le pitch même de My Best Friend’s Birthday servira de base au scénario de True Romance, dans lequel Clarence, incapable de séduire une jeune femme, se fera payer une call-girl (Patricia Arquette) par son patron afin de lui changer les idées le jour de son anniversaire. Le prototype du personnage de la call-girl apparaissait déjà dans My Best Friend’s Birthday, et était alors joué par Crystal Shaw.
D’autres éléments qui relèvent du détail se retrouveront dans d’autres longs-métrages du réalisateur : la première mention de la radio K-Billy’s, ou encore une scène d’overdose qui constituera l’un des principaux nœuds dramatiques de Pulp Fiction. My Best Friend’s Birthday ne sortira jamais en salles, mais une cassette VHS pirate sera distribuée par la société Super Happy Fun en format DVD, au début des années 2000, après l’exploitation de plusieurs extraits du film dans différents festivals.
My Movie Project
Le premier film de Tarantino est révélateur de ce qui deviendra par la suite sa marque de fabrique. Il débute en effet par un long monologue de Clarence lors de sa participation à une émission de K-Billy’s, et contient des échanges passionnés et encyclopédiques sur la nourriture, des musiques diégétiques, ou encore un enchaînement de plans fixes où l’occupation de l’espace filmique se veut plus esthétique que réaliste (comme en témoignent les vinyles étalés sur le bureau du DJ).
Force est de constater qu’il existe dans My Best Friend’s Birthday un sous-texte particulièrement grinçant. Dans la seconde séquence du film, Mickey se voit abandonné par sa petite amie qui lui préfère Brandon, un collègue de théâtre. Là où le premier arbore les codes capillaire et vestimentaire d’Elvis dans Le Rock du bagne (Richard Thorpe, 1957), soulignant son côté rebelle et anticonformiste malgré sa nature douce et soumise, le second correspond aux archétypes du gentil fils à papa bourgeois et cultivé, entre moustache finement taillée, brushing parfait et pull-over noué sur les épaules. Tarantino met ici en opposition la culture transgressive des rebelles du cinéma et du rock face à l’Américain moyen, féru de culture supposément légitime. L’ex-petite amie de Mickey le quitte non seulement pour le bellâtre insipide, mais aussi parce qu’elle se fait une joie d’avoir obtenu un rôle dans un spectacle de gospel, loin des préoccupations rock’n’roll de celui qui partageait jusque-là sa vie. D’ailleurs, l’un des vinyles du King trône fièrement au second plan de la scène. Les troisième et quatrième séquences sont particulièrement évocatrices de ce qui fera le style Tarantino à venir, tout du moins vis-à-vis de sa gourmandise en matière de références culturelles. Lorsque Clarence négocie avec la call-girl, Misty, pour décider d’un prix pour la soirée avec son ami Mickey, la scène est filmée par le biais d’un travelling circulaire autour des deux personnages, préfigurant la scène d’ouverture de Reservoir Dogs quelques années plus tard. « Je ne suis pas une pute, je suis une call-girl ! », déclame Misty, de la même façon que le fera Patricia Arquette dans True Romance quand le Clarence de Christian Slater emploiera un vocabulaire quelque peu hasardeux vis-à-vis de sa profession. Lorsque la jeune femme surprend Mickey sous la douche, dans un découpage champ/contre-champ rappelant le Psychose d’Alfred Hitchcock (1960), un échange entre le barman et Clarence donne lieu à une conversation autour d’Elvis que l’on retrouve, presque mot pour mot, dans True Romance : « J’aimerais tellement être lui. […] Si je devais coucher avec un mec, et je ne dis pas que j’ai envie de le faire, ce serait forcément Elvis », déclame Tarantino sur le même ton que Christian Slater en 1993. La citation visuelle de Hitchcock dans la scène de la douche montée en parallèle n’a rien d’innocent étant donné que la dernière séquence disponible de My Best Friend’s Birthday est un dialogue entre Clarence et Misty faisant l’éloge de Pulsions de Brian De Palma (1980), un film éminemment inspiré de Psychose, mais dans lequel les pulsions meurtrières et le travestissement sont repris de façon bien plus explicite. Quand le mac de Misty déboule dans l’appartement de Mickey, le réalisateur s’en donne à cœur joie pour citer à tout va. Le fait que le proxénète soit afro-américain renvoie clairement au film Le Mac (Michael Campus, 1973), l’un des titres les plus célèbres et estimés de la blaxploitation8, qui se retrouve par ailleurs cité visuellement dans True Romance quand Clarence se confronte au mac d’Alabama incarné par Gary Oldman. Au moment où Mickey se voit contraint d’affronter le gaillard au corps à corps, tous deux se mettent en position de kung-fu et poussent de grands cris, ce qui renvoie au style de combat aussi crispé que spectaculaire de Sonny Chiba dans la trilogie des Street Fighter (Shigehiro Ozawa, 1974). Cet interprète légendaire se voit d’ailleurs cité dans True Romance, lorsque Clarence rencontre sa future fiancée dans un cinéma diffusant les trois premiers épisodes de la saga, et apparaîtra dans Kill Bill : Volume 1, dans le rôle du forgeron non moins légendaire Hattori Hanzo.
Clarence, joué par Quentin Tarantino, est le protagoniste de My Best Friend’s Birthday, non seulement parce qu’il est l’instigateur des intrigues du film et qu’il se retrouve dans presque toutes les séquences, mais aussi et surtout parce que le titre de l’œuvre est inscrit en son nom : L’Anniversaire de mon meilleur ami. Cet élément est sans doute le plus révélateur du reste de la filmographie de Tarantino : le cinéphile devenu cinéaste écrit, réalise et produit en son nom. Ses films comportent avant tout les références et les récits qu’il veut personnellement voir portés à l’écran. Que le public et la critique le suivent ou non, Tarantino fait du cinéma dans un premier temps pour lui-même, et dans un second pour qu’on lui emboîte le pas. Pourtant, le réalisateur n’a pas hésité à travailler sur les projets de ses confrères, leur fournissant à la fois des scénarios et des relectures de leurs personnages. Par ailleurs, s’il s’est fait travailleur de l’ombre pour Tony Scott ou Michael Bay, l’empreinte qu’il a laissée dans leurs œuvres semble tout à fait identifiable.
The Ghost Writer
True Romance et Tueurs nés mettent en scène des amants criminels. Les deux longs-métrages dont Tarantino a vendu les scénarios pour pouvoir en partie financer la production de Reservoir Dogs se bâtissent sur le même schéma relationnel au niveau de ses protagonistes. Clarence (Christian Slater) et Alabama (Patricia Arquette) traversent les États-Unis pour écouler plusieurs kilos de cocaïne dérobés par erreur à un maquereau. Mickey (Woody Harrelson) et Mallory (Juliette Lewis) forment quant à eux un couple de tueurs en série commettant divers meurtres et tueries de masse à travers plusieurs États afin de devenir célèbres. Bonnie et Clyde, film fondateur du Nouvel Hollywood cher à la construction culturelle de Tarantino, a définitivement marqué son imaginaire au fer rouge. Si les deux longs-métrages sortent respectivement un et deux ans après la première réalisation de Tarantino exploitée en salle, ils constituent avant tout les tremplins qui serviront à son intronisation dans l’industrie cinématographique. Une fois n’est pas coutume : la machine se met en marche au cœur même de Video Archives.
En 1987, décidément une année charnière, Roger Avary propose à Tarantino un nouveau scénario, baptisé The Open Road, qu’il a commencé à rédiger dès 1985, alors que les deux scénaristes sont colocataires. Le documentaire de la version DVD de True Romance, qui relate les origines du récit, indique par ailleurs que le script de base narrait les mésaventures d’un vendeur de comics, Clarence Worley, rédigeant lui-même un scénario consacré à un couple de tueurs en série, Mickey et Mallory, les deux antihéros du futur Tueurs nés. Tarantino réécrit le script de fond en comble et l’étire davantage, donnant ainsi naissance à la structure narrative de ce qui deviendra True Romance. Il y intègre par ailleurs des éléments scénaristiques qu’il transposera par la suite dans les trames de Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Tueurs nés.
En 2011, Alberto Morsiani relate l’échec des deux compères dans la production du film, qu’ils tentèrent vainement de produire eux-mêmes avant de le céder pour la coquette somme de 40 000 dollars en 1990 – Tarantino injectant ensuite sa part dans la production de son premier long-métrage en solo. La destinée de Tueurs nés sera similaire puisque le cinéaste essayera tout aussi vainement de le produire, avant de se décider à vendre le projet pour financer son film au budget moins imposant. Dans son ouvrage Killer Instinct : How Two Young Producers Took on Hollywood and Made the Most Controversial Film of the Decade (1997), qui revient sur la conception du très controversé Tueurs nés, la productrice Jane Hamsher précise que c’est pour seulement 10 000 dollars que le script du film, réalisé par Oliver Stone, fut cédé à son collègue Don Murphy et elle par un Tarantino désireux de renflouer les caisses.
Pour ce qui est de True Romance, c’est donc Tony Scott, un ami du futur cinéaste rencontré sur le tournage du Dernier Samaritain (1991), qui se voit confier les rênes du récit le plus autobiographique de son auteur. Scott recolle les séquences dans l’ordre chronologique, la narration éclatée si chère à l’auteur s’avérant d’ores et déjà présente. À noter que le premier réalisateur envisagé pour tourner le film n’était autre que William Lustig, grand artisan du thriller gore à qui l’on doit notamment Maniac (1980) ainsi que la trilogie des Maniac Cop de 1988 à 1993. S’il est débouté du projet, c’est parce qu’un certain Harvey Weinstein – qui se liera par la suite à Tarantino pour produire ses longs-métrages – ne voulait pas de lui, ni de Scott d’ailleurs. Les mésententes de production conduisent à ce que Samuel Hadida produise lui-même le film alors que Weinstein s’était préalablement engagé à apporter 50 % du budget. Le scénario est quelque peu modifié par Tony Scott, alors que le passage de Tarantino avait déjà considérablement changé la première vision de Roger Avary. La fin, notamment, est totalement remaniée. Dans les commentaires audio du film, Tarantino précise que cela n’a rien à voir avec une quelconque logique commerciale, mais bien avec le fait que Tony Scott était très attaché aux personnages de Clarence et Alabama. Avant ces changements, True Romance finissait de façon particulièrement dramatique, dans la longue tradition des romances complexes dont l’issue ne peut que se révéler fatidique.
True Romance
En 2003, pour le dixième anniversaire du film, Metropolitan commercialise une édition DVD Collector de True Romance. Le nom de Quentin Tarantino est inscrit sur la jaquette aux côtés de ceux du producteur Samuel Hadida et du réalisateur Tony Scott, là où il figurait à sa sortie en petits caractères, noyé parmi les mentions de l’équipe technique, sur l’affiche publicitaire du film. En à peine une décennie, Tarantino est devenu un nom, une marque déposée, un argument commercial. Au dos du coffret figurent les propos du scénariste revenant sur son œuvre et quelques critiques qui lui furent adressées : « On m’a souvent demandé : “Pourriez-vous un jour écrire un film romantique ?”, comme si une telle chose était absolument inconcevable de ma part. “Mais j’ai déjà écrit un film romantique – True Romance !” “Non, non je voulais dire un vrai film romantique.” “Mais c’est un vrai film romantique.” “Non, un film dans lequel il n’y aurait pas de violence.” “Écoutez, il y a sans doute des tas de choses contradictoires dans les films que je fais, mais n’importe quel fan du film vous le dira, le titre ‘True Romance’ n’est pas ironique. C’est une True Romance – une histoire vraiment romantique.” »
Si les propos de Tarantino peuvent sembler quelque peu provocateurs, ils n’en demeurent pas moins réalistes vis-à-vis de la longue tradition dramatique des histoires de cœur aussi bien portées sur scène qu’à l’écran. Du Roméo et Juliette de William Shakespeare (1597) au Titanic de James Cameron (1997), les amants ont bien souvent eu la vie dure, et la violence fait partie intégrante du registre romantique. True Romance ne fait pas exception. La happy end signée Tony Scott montre un Clarence éborgné par la fusillade finale, le cache-œil servant de référence au personnage de Snake Plissken (Kurt Russell) dans le New York 1997 de John Carpenter (1981) – l’un des films de chevet de Tarantino. Pourtant, la fin imaginée initialement par ce dernier était bien moins heureuse : Clarence mourait dans l’affrontement et Alabama finissait par s’enfuir. La dernière séquence nous montrait la jeune femme au volant d’une Cadillac rose, sa voix en off indiquant qu’elle s’en remettrait et que, finalement, son bien-aimé n’était qu’un homme de passage dans sa vie et qu’il y en aurait d’autres.
Au nom du père
Au-delà de la dimension romantique du film réalisé par un homme à qui l’on doit quelques belles envolées contemporaines dans le genre9, c’est à une grille de lecture métaleptique que Tarantino consacre quelques dialogues devenus aujourd’hui cultes. Dans le dernier acte de True Romance, Clarence s’adresse au producteur Lee Donowitz (Saul Rubinek), auquel il vient vendre son stock de cocaïne volé, pour lui confier sa vision de l’industrie cinématographique en même temps que lui soumettre quelques projets de films. Pour le personnage campé par Christian Slater, il n’existe pas de hiérarchie entre les œuvres d’exploitation vouées au marché de la vidéo et ces films considérés comme des chefs-d’œuvre, aussi bien par la critique que par le public. Mad Max (George Miller, 1979) n’a rien à envier à Autant en emporte le vent (Victor Fleming, 1939). Les deux films sont pour lui aussi légitimes l’un que l’autre, bien qu’il caractérise les productions validées par l’intelligentsia élitiste comme « des films nuls adaptés de bouquins nuls » (encore un pied de nez à l’âge d’or hollywoodien). Et à Quentin Tarantino d’assumer le fait que Clarence est sa propre voix à l’intérieur d’une fiction qui parle clairement de lui : « Ce que dit Clarence, c’est exactement ce que je pensais des films à l’époque. En tant que cinéphile opiniâtre, avoir un avis à Hollywood et s’y tenir, c’est une espèce de superpouvoir dont tout un chacun ne dispose pas forcément. On m’a rapporté un adage à ce sujet : quand tu assistes à une réunion hollywoodienne, celui qui paraît le plus sûr de lui dans la pièce finit par gagner. En général, ce type, c’est moi. Dans cette scène, c’est exactement ce que fait Clarence. »
La pensée tarantinienne est officiellement lancée et, une fois de plus, le film se fait l’extension de son propre esprit, même s’il ne le réalise pas lui-même. La signature de Tarantino est visible à chaque instant, et bien au-delà de quelques éléments de dialogue particulièrement identifiables. S’il est un artiste de cinéma, il n’en demeure pas moins l’un de ses critiques les plus virulents et engagés. True Romance peut ainsi être vu comme un contrat signé non seulement avec le public, mais aussi avec l’industrie : tout ce que Tarantino voudra dire, il le dira, par un moyen ou un autre.
De plus, le long-métrage met également en exergue la vie privée du cinéaste, notamment son histoire familiale. La scène de retrouvailles entre Clarence et son père Clifford (Dennis Hopper), où le jeune homme demande à celui qu’il n’a finalement que très peu connu de les aider, Alabama et lui, s’avère pour Tarantino la séquence la plus autobiographique du film. Il revendiquera la scène de dispute comme un renvoi à l’une de ses explications avec Curtis Zastoupil, son beau-père et initiateur au cinéma, qui l’a selon lui abandonné sans crier gare en quittant sa mère, alors que le petit Quentin était le seul à prendre systématiquement la défense de Curtis en toute situation. True Romance est Tarantino, et cette mise à nu quelque peu déguisée est une façon pour lui de devenir un personnage de cinéma, voire un film tout entier.
The Nightmare Before Christmas
La première projection de True Romance se déroule en grande pompe au Westwood Village Theater, lieu mythique du cinéma construit en 1931, que la commission de l’héritage culturel de Los Angeles a placé monument historique en 1988. Le multiplex d’architecture hispanique, qui a accueilli de grandes premières tout au long de l’histoire, voit débouler le casting du film ainsi que celui de Pulp Fiction, second long-métrage de Tarantino alors en plein tournage dans la Cité des Anges. Le lieu est parfait pour le cinéaste qui va finalement se voir à l’écran sous les traits de Christian Slater. Bien que l’accueil soit fiévreux et les retours plutôt positifs, True Romance se révèle un véritable échec commercial et ne sera réhabilité que lorsque son auteur sera adoubé un an plus tard par la récompense suprême du Festival de Cannes. Avec un budget de 13 millions de dollars, le film réalisé par Tony Scott cumule seulement 12 281 551 dollars sur le sol étasunien, ce qui n’a même pas pour effet de rembourser ses coûts de production. Au Royaume-Uni, il n’en rapporte qu’un peu plus de deux millions selon le site de référencement Box Office Mojo. Tarantino prend un coup au moral, persuadé de demeurer à tout jamais un outsider ne se rassasiant que de quelques succès d’estime. Loin d’imaginer qu’il sera lauréat de la Palme d’or un an plus tard, le jeune scénariste ne sait pas non plus que la prestigieuse Mostra de Venise décernera le Grand Prix spécial de son jury, alors sous la présidence du surréaliste David Lynch, à cet autre film dont il a vendu le script. Un récit qui était, à la base, une histoire de meurtriers rédigée par le personnage de Clarence Worley.
Tueurs nés
Avec des droits négociés aux producteurs Jane Hamsher et Don Murphy pour la modique somme de 10 000 dollars, Tarantino s’essaye à la réalisation de Tueurs nés avec en tête un budget de 500 000 dollars, avant d’abandonner l’idée et de voir son œuvre partir pour les studios de la Warner. C’est alors que le projet tombe entre les mains d’Oliver Stone, reconnu à Hollywood pour ses talents d’écriture viscérale sur Midnight Express (Alan Parker, 1978) ou encore Scarface (Brian De Palma, 1983). Le film de gangsters emblématique des années 1980 est d’ailleurs cité dans Tueurs nés : les deux antihéros visionnent la fameuse scène de la tronçonneuse sur leur poste cathodique alors qu’ils séjournent dans un motel. Une façon pour Oliver Stone de souligner son passé de scénariste et d’éviter que la mémoire collective ne considère Tueurs nés comme une œuvre intégralement due à l’esprit de Tarantino. Car s’il conserve l’essence des dialogues du script de base, Stone réécrit intégralement le film avec l’appui de Richard Rutowski et David Veloz.
Le projet passe de film d’action à satire des médias américains, le réalisateur de Platoon (1986), Wall Street (1987) ou encore Né un 4 juillet (1989) s’étant fait pour spécialité de sonder l’âme des États-Unis à travers le rapport de ses citoyens à son histoire et le fonctionnement de sa société, en partie sur le plan politique. Les deux premiers rôles reviennent alors à Mickey et Mallory Knox, respectivement interprétés par Woody Harrelson et Juliette Lewis. Le personnage qui devait à la base être mis en avant, le scandaleux journaliste Wayne Gale interprété par Robert Downey Jr., est conservé, mais sa partition demeure secondaire face au couple de tueurs. Lors d’une interview accordée à Graham Fuller (Quentin Tarantino : Interviews, 1998), le scénariste à l’origine du projet met en avant les différences notables entre le film qu’il a pensé et celui que s’est approprié Oliver Stone avant de le réaliser, soulignant que son attachement sentimental à son propre travail l’empêche d’apprécier pleinement Tueurs nés : « Si vous aimez ce que je fais, vous pourriez ne pas aimer ce film. Mais si vous aimez ce qu’il fait, vous allez probablement l’aimer. Cela pourrait être la meilleure chose qu’il ait jamais faite, mais en aucun cas faite avec moi. » Tarantino demande ainsi à ce que son nom ne soit pas mentionné au générique en tant que scénariste, mais simplement comme auteur de l’histoire originale.
Monster
Tueurs nés est, dans la forme, à l’image des esprits dérangés de ses deux protagonistes : un maelstrom de couleurs, un enchaînement frénétique d’icônes saturées dans un montage supercut (c’est-à-dire rapide, nerveux, et composé d’un grand nombre de plans qui défilent à un rythme effréné), des bandes-son qui se superposent, des projections d’images sur les décors, des incrustations d’archives historiques et publicitaires… Le déluge visuel a de quoi décontenancer et donne au film les allures d’un clip MTV monté par des énergumènes sous acide. En définitive, ce long-métrage est un ovni cinématographique, un film expérimental nihiliste, moqueur et transgressif. Sa séquence d’introduction, un massacre dans un diner aux abords d’une autoroute déserte, représente à elle seule tout son côté frankensteinien. Si le cadre de l’action n’est pas sans rappeler ceux de Reservoir Dogs ou de Pulp Fiction, la patte narrative de Tarantino laisse rapidement la place à la folie formelle d’Oliver Stone qui, dans les années 1990, se faisait remarquer par le montage et l’étalonnage psychédéliques de ses films traitant de l’histoire contemporaine des États-Unis, comme JFK (1991) ou Nixon (1995). Des plans en noir et blanc, d’autres en couleurs naturelles et d’autres encore passés aux filtres bleu ou rouge, le tout entrecoupé d’images documentaires mettant en scène des animaux sauvages en pleine chasse et leurs proies en train d’agoniser. Le résultat est un véritable monstre pour l’œil fragile du spectateur. Le réalisateur se permet même quelques percées dans le fantastique en glissant un élément proleptique : lorsque Mallory se rend au jukebox, elle croise un homme assis à une table qui disparaît à mesure que le travelling progresse vers le fond de la pièce. Incarné par Arliss Howard – non crédité au générique final –, ce personnage réapparaît dans le dernier acte du film en tant que prisonnier lors de l’émeute du pénitencier. Il se révèle la dernière main secourable pour le couple en fuite, qu’il débarrasse de leurs derniers adversaires. Une sorte d’ange gardien qui veille sur eux depuis le début, un élément annonciateur du chaos à venir, mais dont la présence se veut avant tout rassurante.
Malgré son montage linéaire en matière de chronologie du récit, True Romance se rapproche davantage d’un film classique de Tarantino dans sa réalisation, que ce soit dans l’utilisation d’une caméra généralement fixe pour sublimer les longues séquences de dialogue, ou l’éclairage et le traitement des couleurs plus naturalistes. Bien qu’il reprenne une narration à la chronologie éclatée, Tueurs nés en est l’exact opposé : une caméra portée et tremblante dans le plus pur style des journalistes de terrain bazardés en plein champ de bataille, un jeu presque théâtral sur la lumière, des hurlements, des répliques courtes mais cinglantes beuglées çà et là, un enchevêtrement musical criard et des images subliminales parfois totalement horrifiques. Malgré la violence de ses thématiques et de ses personnages, Tarantino a souvent insufflé une certaine douceur mélancolique à ses récits, alors qu’il est ici avant tout question de pulsions et de passions dévorantes. Tueurs nés est lui aussi un grand film romantique, mais bien plus cinglant et énervé que celui de Tony Scott, sorti un an auparavant.
American Psycho
Dans True Romance, Clarence et Alabama partagent une forme d’innocence, de candeur, et se font dealers et meurtriers malgré eux. Ce sont des personnes ordinaires contraintes de vivre des mésaventures extraordinaires, défiant la loi pour survivre, souvent par légitime défense, mais demeurant généralement morales. Dans Tueurs nés, Mickey et Mallory ne respectent ni loi ni morale : ils tuent pour le plaisir, pour la célébrité, et voient le territoire américain comme un gigantesque stand de tir. Un défouloir pour déverser leur haine envers le monde, envers la vie, celle qui ne les a pas épargnés. « Je suis un tueur né », dont se fend le jeune meurtrier à la fin de son interview face à Wayne Gale, provoquant ainsi la folie destructrice des autres détenus de la prison de Batango, au cœur de laquelle une émeute d’une violence surnaturelle – prenant des allures de guerre civile – finit par éclater. Le couple maudit légitime sa soif de sang par des enfances et des adolescences traumatisées au sein de familles dysfonctionnelles, un schéma que l’on retrouve bien souvent chez les tueurs en série. Mickey a vu son père alcoolique et violent tuer sa mère et se griller la cervelle au fusil de chasse alors qu’il n’était qu’un bambin. Mallory, elle, a subi les agressions sexuelles d’un père dégénéré et colérique devant une mère rendue coupable par son incapacité à réagir. La première rencontre entre les deux tourtereaux est réalisée sous la forme d’une sitcom, au sein même du foyer parental de Mallory, avec décors factices et rires préenregistrés qui se déclenchent chaque fois que le patriarche se montre violent. Oliver Stone critique ouvertement la soif macabre des téléspectateurs américains en transformant le premier contact des deux assassins en un pastiche d’épisode particulièrement sordide de Marié, deux enfants (FOX, 1987-1997). Cette célèbre sitcom hautement satirique est alors bien souvent critiquée pour ses thématiques sulfureuses, sa vulgarité et son personnage principal de père indigne, Al Bundy (Ed O’Neill), dont le patronyme n’est pas sans rappeler celui de Ted Bundy, l’un des plus effroyables et prolifiques tueurs en série américains.
Dans les prémices de l’acte final, Mickey se lance dans une longue diatribe philosophique au micro de son intervieweur, arguant que c’est la volonté de Dieu qui a fait de lui un prédateur et que seul l’amour peut le guérir du démon qui le possède. Un spot publicitaire Coca-Cola marque la fin de son entretien avec Wayne Gale, diffusé à la mi-temps du Super Bowl, soit la plage horaire la plus prisée des médias américains. En invoquant aussi bien la religion que les grandes enseignes commerciales en l’espace de quelques secondes, Oliver Stone tire à boulets rouges sur l’hypocrisie de la société du spectacle étasunienne et de sa culture de masse en règle générale. « Face à moi, vous êtes un singe. Pire que ça : vous êtes une créature des médias », assène un Woody Harrelson laconique au personnage de Robert Downey Jr. qui, à plusieurs reprises durant le film, est représenté dans le costume d’un diable couvert de sang hurlant à la mort, personnification cinglante de ces médias tout-puissants. Cette dernière approche rejoint le scénario de base de Quentin Tarantino dans lequel la vedette de télévision devait être le personnage principal, et non Mickey et Mallory, qui demeuraient aussi secondaires que dans le script de True Romance, où ils sont présentés comme les personnages d’une fiction écrite par Clarence. Mais, du scénario original à la nouvelle mouture d’Oliver Stone désavouée par Tarantino, le couple de meurtriers conserve sa dimension de bêtes de foire opposées au reste du monde. À la fin du XXe siècle, les tueurs en série fascinent presque davantage le public que les superhéros, et Tueurs nés dépeint une Amérique où ceux qui veulent se nourrir de la célébrité d’un couple de criminels sont presque plus dégénérés qu’eux, alors qu’ils représentent de grandes institutions sociales, légales et culturelles. Le policier Jack Scagnetti (Tom Sizemore) est un pervers meurtrier qui se rêve tueur en série, Dwight McClusky (Tommy Lee Jones), le directeur de la prison, est l’incarnation vivante de la répression et de sa brutalité et, bien évidemment, le journaliste Wayne Gale est un égocentrique avide de spectacles et de gloire.
Celebrity
Les comédiens incarnant les personnages écrits par Quentin Tarantino semblent généralement voués à une destinée médiatique particulière, voire cyclique. Sous sa direction en tant que réalisateur, on compte bien sûr certaines idoles de sa jeunesse qu’il remet sous le feu des projecteurs, comme l’icône de la blaxploitation Pam Grier (Jackie Brown, 1997) ou Don Johnson (Django Unchained, 2012), rendu célèbre par son rôle de Sonny Crockett dans la série Deux Flics à Miami (NBC, 1984-1989). Lorsqu’il est question des interprètes que l’on retrouve dans les films adaptés de ses deux scénarios, True Romance et Tueurs nés, il est possible d’y voir, non pas un effet inverse, mais davantage une forme de révélation pour des visages que l’on retrouvera bien souvent en tête d’affiche dans les années à venir. Dans True Romance, bien qu’on ne l’aperçoive que quelques minutes à l’écran, on remarque la présence d’un certain Samuel L. Jackson – à l’affiche la même année dans Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993) –, peu connu à l’aube des années 1990, bien qu’ayant quelques collaborations à son actif, notamment avec Spike Lee (Mo’ Better Blues, 1990) et Martin Scorsese (Les Affranchis, 1990). James Gandolfini, six ans avant de devenir le Tony Soprano de la série culte de HBO (Les Soprano, 1999-2007), apparaît dans le film comme un exécutant de la mafia, mais c’est aussi et surtout Brad Pitt, après une brève apparition chez Ridley Scott (Thelma et Louise, 1991), qui crève l’écran en colocataire complètement défoncé passant l’essentiel de son existence scotché à un canapé et à son bong. Dans Tueurs nés, ce sont avant tout Woody Harrelson et Robert Downey Jr. qui se font remarquer dans leurs rôles de tueur en série taciturne et de vedette télévisuelle déjantée et mégalomane. Si le premier s’était déjà distingué dans Les Blancs ne savent pas sauter (Ron Shelton, 1992) et le second, la même année, dans le rôle-titre du Chaplin de Richard Attenborough, force est de constater que le meilleur reste à venir pour les deux comédiens. Harrelson deviendra par la suite, pour le cinéma, le chasseur de zombies Tallahassee de Bienvenue à Zombieland (Ruben Fleischer, 2009) et, pour la télévision, l’officier de police Martin Hart dans la première saison de True Detective (HBO, 2014). Quant à Robert Downey Jr., impossible de le dissocier de son rôle de Tony Stark dans Iron Man (Jon Favreau, 2008) ou de Sherlock Holmes dans le film du même nom de Guy Ritchie en 2009.
Les accusés
Le sous-titre de l’ouvrage de Jane Hamsher consacré à la production de Tueurs nés – How Two Young Producers Took on Hollywood and Made the Most Controversial Film of the Decade – souligne tout particulièrement la controverse suscitée par l’œuvre lors de sa sortie. Les médias, principale cible de la satire du film, l’ont notamment taxé d’avoir inspiré des tueries de masse comme la fusillade du 20 avril 1999 à la Columbine High School, un événement tragique au cœur du documentaire farouchement opposé aux armes à feu Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002). Il semble ironique de constater qu’en 2003, le réalisateur Gus Van Sant gagne la Palme d’or cannoise avec Elephant, un long-métrage composé de plans-séquences revenant sur cet épisode douloureux de la fin du XXe siècle, alors même que celui-ci s’est principalement inspiré d’un court-métrage réalisé par le Britannique Alan Clarke pour la BBC (Elephant, 1989), qui mettait en scène, avec le même procédé, une succession de meurtres sans véritable ligne narrative rappelant la première moitié de Tueurs nés. En France, c’est l’affaire Rey-Maupin que les médias relient immanquablement au film d’Oliver Stone, arguant qu’une affiche du film était présente au domicile de Florence Rey et Audry Maupin, un couple de jeunes anarchistes d’à peine vingt ans responsable de deux fusillades ayant coûté la vie à quatre personnes. Dans sa pastille Café crime consacrée aux deux criminels – devenus aujourd’hui des icônes de la pop culture à l’instar de Mickey et Mallory –, Patricia Tourancheau assure cependant que l’affiche de Tueurs nés ne se trouvait pas dans leur appartement quand la police a fouillé les lieux, mais qu’elle y fut sciemment placée par un journaliste peu de temps après la perquisition, et ce afin de prendre une photo équivoque. Si cette affaire a relancé le débat sur la peine de mort en France en 1994, elle a également remis sur le devant de la scène celui concernant la violence au cinéma et son potentiel impact sur le public. Construit sur le même schéma scénaristique qu’Orange mécanique (Stanley Kubrick, 1971), avec une première partie consacrée aux crimes, puis une seconde sur l’enfermement puis la libération, Tueurs nés semble avoir marqué les esprits échaudés de la même façon. Le long-métrage d’Oliver Stone a débordé de la sphère uniquement cinématographique pour devenir un véritable sujet de société. Ce film est le seul de l’écurie Tarantino à déchaîner les passions durant la décennie que le cinéaste traverse sereinement, en passant de ses propres œuvres à celles de ses confrères et amis, dont le jeune réalisateur mexicain Robert Rodriguez.
El Mariachi
En 1992, le premier film de Rodriguez fait sensation : avec un budget de seulement 7000 dollars, El Mariachi en rapporte plus de deux millions sur le sol américain. À l’époque, c’est le meilleur rapport financier pour un film, des années avant Le Projet Blair Witch (Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, 1999). C’est en 1995, avec 7 millions en poche et la confiance des producteurs, que Robert Rodriguez en propose une version améliorée, Desperado, mettant en scène Antonio Banderas et Salma Hayek. Le casting de ce western Zapata – un sous-genre du western se déroulant au Mexique et mettant en scène sa culture et ses problématiques historiques – comprend, entre autres, Quentin Tarantino. La courte scène où il apparaît en tant que client d’un bar racontant une blague est parfaitement révélatrice de ses propres sources d’inspiration. Le contexte de la séquence renvoie évidemment aux westerns spaghettis qu’il affectionne, avec son ambiance tamisée et les quelques malfrats aux visages burinés qui l’entourent au comptoir. Mais la narration qu’il propose lors de son monologue est une référence au rakugo, une tradition humoristique japonaise développée lors de la période Edo (1603-1868), qui prend la forme d’un one man show et peut se traduire par « l’art de raconter une histoire drôle ». Avec son récit mettant en scène le pari entre un barman et son client persuadé qu’il peut uriner dans un shot de tequila sans mettre une goutte à côté, Tarantino prend le temps de poser l’ambiance, de développer ses personnages, de mimer chaque geste avant la chute, sous le regard amusé de son audience. En somme, le jeune cinéaste s’approprie totalement la scène, anecdotique vis-à-vis du reste du film, mais devenue l’une des plus célèbres de Desperado. Par la suite, il collaborera à plusieurs reprises avec son désormais ami Robert Rodriguez, dont l’un des plus célèbres longs-métrages débarquera dans les salles obscures seulement un an après Desperado.
Une nuit en enfer