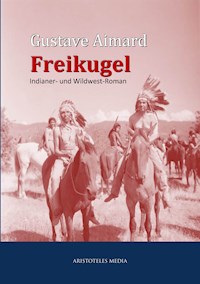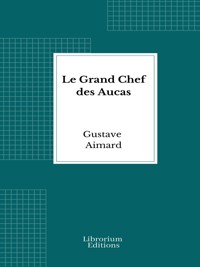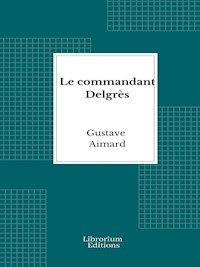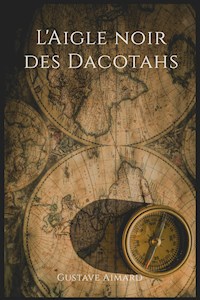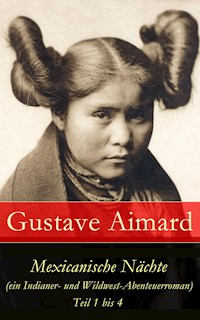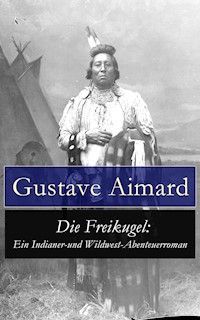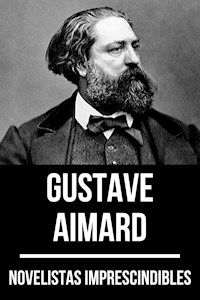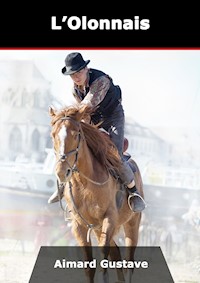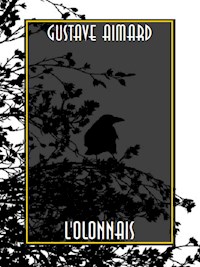
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Ces cavaliers, au nombre de six, montés sur des chevaux de race, mais semblant avoir fourni une longue course, étaient armés jusqu'aux dents, et portaient de riches et élégants costumes de gentilshommes ; ils paraissaient peu soucieux d'être reconnus, car, bien que les larges ailes de leurs chapeaux fussent soigneusement rabaissées sur leurs yeux et qu'il régnât une obscurité profonde, par surcroît de précaution, ils avaient tous des masques de velours noir appliqués sur le visage. En apercevant ces sinistres fantômes, aux allures étranges, le pauvre diable de veilleur fut saisi de crainte~; il laissa choir sa lanterne qui, heureusement ou malheureusement, ne s'éteignit point, et se mit à trembler de tous ses membres en jetant autour de lui des regards effarés, comme pour demander un secours sur lequel cependant il n'était guère en droit de compter ; seul, de toute la population, il était éveillé à cette heure avancée de la nuit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gustave Aimard
L'Olonnais
table des matières
Prologue
Chapitre 1 Les masques noirs
Chapitre 2 Où les explications du docteur sont brusquement interrompues
Chapitre 3 De quelle façon le comte de Manfredi-Labaume comprenait la vengeance
Chapitre 4 La loi du talion
FIN DU PROLOGUE
Chapitre 1 Comment un fantôme apparut à l’équipage de la pirogue espagnole le « San Juan de Dios » et ce qui en advint
Chapitre 2 De quelle façon le capitaine Vent-en-Panne se présenta à M. de Lartigues, commandant le vaisseau de S. M. Louis XIV, le Robuste.
Chapitre 3 Comment et pourquoi l’Olonnais s’embarqua pour la côte.
Chapitre 4 Comme quoi le comte Horace tomba de fièvre en chaud mal et se vit contraint de quitter le navire le Coq d’une façon très désagréable.
Chapitre 5 Comment la justice était rendue à bord des vaisseaux de guerre de S. M. de France et de Navarre en l’an de grâce 1674.
Chapitre 6 Ou l’Olonnais et Pitrians, après avoir refusé les présents d’Artaxercès, sont comblés d’honneurs par les plus célèbres flibustiers.
Chapitre 7 Ce que les Frères de la Côte nommaient l’amatelotage ; en quoi il consistait.
Chapitre 8 Détails rétrospectifs sur le duc de la Torre et sa famille.
Chapitre 9 Dans lequel reparaissent d’anciens personnages.
Chapitre 10 Plusieurs physionomies de démons complétées par une tête d’ange.
Chapitre 11 Quel fut le résultat de la conversation de Bothwell avec les deux boucaniers espagnols.
Chapitre 12 Quelles étaient les lois du duel chez Les Frères de la Côte de Saint-Domingue.
Chapitre 13 Dans lequel l’Olonnais raconte son histoire à son matelot Vent-en-Panne.
Chapitre 14 Comment Vent-en-Panne et l’Olonnais eurent une explication et ce qui s’en suivit.
Chapitre 15 Comment Vent-en-Panne et le Chat-Tigre se trouvèrent en présence et ce qui se passa entre eux.
Chapitre 16 Ou tout en se promenant au clair de lune, Vent-en-Panne apprend certaines choses fort intéressantes.
A M. Victor Azam Cher ami, Je te dédie cet ouvrage en souvenir de notre vieille et constante amitié. GUSTAVE AIMARD.
Prologue
Chapitre 1 Les masques noirs
Chapitre 1Les masques noirs
Le 24 mars de l’an de grâce 1648, le veilleur de nuit, après avoir agité sa crécelle, achevait d’annoncer, d’une voix enrouée et chevrotante, aux bons bourgeois de la petite ville des Sables-d’Olonne, qu’il était dix heures du soir, que le vent soufflait en foudre, que la mer était grosse, qu’il gelait à pierre fendre, mais que tout était tranquille, et que, par conséquent, ils pouvaient continuer à reposer plus ou moins paisiblement jusqu’au matin, auprès de leurs femmes ; renseignements au reste d’une exactitude rigoureuse, lorsque tout à coup un grand bruit s’éleva du côté de la porte de Talmont, et une troupe de cavaliers fit à l’improviste irruption dans la ville, et se dirigea, avec la rapidité d’une trombe, vers la plage.
Ces cavaliers, au nombre de six, montés sur des chevaux de race, mais semblant avoir fourni une longue course, étaient armés jusqu’aux dents, et portaient de riches et élégants costumes de gentilshommes ; ils paraissaient peu soucieux d’être reconnus, car, bien que les larges ailes de leurs chapeaux fussent soigneusement rabaissées sur leurs yeux et qu’il régnât une obscurité profonde, par surcroît de précaution, ils avaient tous des masques de velours noir appliqués sur le visage.
En apercevant ces sinistres fantômes, aux allures étranges, le pauvre diable de veilleur fut saisi de crainte ; il laissa choir sa lanterne qui, heureusement ou malheureusement, ne s’éteignit point, et se mit à trembler de tous ses membres en jetant autour de lui des regards effarés, comme pour demander un secours sur lequel cependant il n’était guère en droit de compter ; seul, de toute la population, il était éveillé à cette heure avancée de la nuit.
Mais sans lui laisser le temps de faire un geste ou de pousser un cri, les inconnus s’emparèrent de lui, le roulèrent dans un manteau, et, après l’avoir solidement ficelé, ils le jetèrent, sans plus de cérémonie, dans l’allée d’une maison, dont la porte était ouverte par hasard ; puis, après avoir relevé la lanterne, ils continuèrent à se diriger vers la plage.
L’enlèvement du veilleur de nuit avait été exécuté avec une adresse et une rapidité réellement prodigieuses, sans qu’un mot fût prononcé.
À la même heure, presque à la même minute où ceci se passait à l’entrée de la ville, une embarcation de vingt-cinq à trente tonneaux, pontée et gréée en lougre, sans tenir compte de l’état de la mer, de l’obscurité et de la force du vent qui la faisait se balancer comme une plume au sommet de vagues monstrueuses, doublait résolument la pointe de la petite baie au fond de laquelle la ville s’abrite, et mettait le cap sur la plage, au risque de se briser contre les rochers, que la mer balayait sans cesse avec furie.
Cette barque portait un fanal allumé à son avant ; rougeâtre étoile qui s’élevait et s’abaissait à chaque seconde, pour échanger des signaux mystérieux avec une maison isolée, derrière les fenêtres de laquelle brillaient et s’éteignaient tour à tour, des lumières de différentes couleurs.
Malgré les difficultés presque insurmontables d’un atterrissage de nuit dans des conditions aussi mauvaises, le lougre, manœuvré sans doute par un marin intrépide et surtout habile, réussit à atteindre une espèce de quai de quelques toises de long, construit en pierres sèches et en quartiers de roches, servant de débarcadère ; il l’élongea doucement, s’y amarra, et demeura enfin immobile dans ce refuge où il ne courait plus aucun danger.
L’équipage du lougre paraissait être assez nombreux ; il achevait cette manœuvre délicate au moment où les cavaliers dont nous avons parlé plus haut débouchaient sur la plage.
Les cavaliers s’arrêtèrent à portée de pistolet du quai ; celui qui avait ramassé la lanterne l’éleva deux fois au-dessus de sa tête ; une lanterne fut aussitôt levée deux fois sur le pont du lougre ; le même signal fut répété par les fenêtres de la maison isolée.
Alors, sur un geste muet de celui qui semblait être leur chef, quatre des cavaliers tournèrent bride ; ils allèrent le pistolet au poing, se placer à l’entrée des deux rues qui, à cette époque, débouchaient sur la plage.
Les deux derniers mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux aux contrevents d’une maison qui se trouvait à leur portée, puis ils se dirigèrent à grands pas vers le navire mystérieux.
Les gens de l’équipage du lougre avaient, eux aussi, des masques sur le visage, et la ceinture garnie d’armes.
Deux hommes quittèrent le navire et firent quelques pas à la rencontre des cavaliers, qu’ils saluèrent silencieusement.
— Avez-vous la femme ? demanda un des cavaliers à demi-voix.
— Avez-vous le médecin ? répondit un des marins sur le même ton.
— Voici le médecin, reprit le cavalier en désignant son compagnon.
— Bien ! tout est fait, alors ?
— Tout ; il accepte nos conditions.
— Est-ce vrai, monsieur ?
— C’est vrai, répondit le médecin en s’inclinant.
— Songez qu’il ne s’agit pas ici d’un jeu d’enfant ; dès ce moment, vous nous appartenez.
— Je le sais.
— Vous acceptez la responsabilité du secret dont vous allez bientôt porter une partie ?
— Je l’accepte.
— Vous avez bien calculé les terribles conséquences qu’une trahison aurait pour vous ?
— J’ai tout calculé, monsieur.
— Et vous persistez à nous servir ?
— Je persiste.
— C’est bien, docteur, je n’insisterai pas davantage ; j’ai confiance en votre loyauté ; soyez-nous fidèle, et votre fortune est faite dès ce moment.
Le médecin s’inclina silencieusement.
— Entrez dans la maison, voyez si tout est convenablement préparé, reprit le marin ; dans quelques minutes, je vous rejoindrai. Allez, messieurs !
Les deux hommes saluèrent, et, sans échanger un mot entre eux, ils se dirigèrent vers la maison isolée, dont la porte s’ouvrit à leur approche, comme s’ils eussent été attendus. Ils entrèrent ; la porte se referma aussitôt derrière eux.
Cette maison n’avait, à l’extérieur, rien qui la distinguât de ses voisines, dont l’apparence était assez misérable ; à l’intérieur, il n’en était pas ainsi : la disposition des appartements avait été faite avec un luxe de précautions tel, que si grand bruit qu’on y menât, rien ne s’entendait au dehors ; quant à l’ameublement, il était somptueux.
Isolée sur le bord de la mer, cette maison, qui presque toujours était close, dont on ne connaissait pas les habitants, inspirait un effroi instinctif à ses voisins ; sans pouvoir articuler des griefs certains, on racontait tout bas de sinistres histoires sur cette demeure, dont parfois on voyait dans la nuit flamboyer les fenêtres comme de lugubres phares ; aussitôt le soleil couché, les passants attardés s’en écartaient avec terreur ; même pendant le jour, hommes ou femmes, ceux contraints de s’en approcher doublaient le pas et se signaient craintivement, en frôlant ces murailles redoutées.
La porte, mue sans doute par un ressort secret, s’était ouverte, puis refermée sur les visiteurs sans que personne se présentât pour les recevoir.
Ceux-ci probablement s’y attendaient, car ils ne témoignèrent aucune surprise ; après avoir traversé un long corridor, bien éclairé, et dont le sol était garni d’un tapis moelleux étouffant complètement le bruit des pas, ils se trouvèrent devant un escalier de pierre, à rampe de fer ciselé, sur les marches duquel se continuait le tapis du corridor ; une lampe, à globe dépoli, placée dans une niche, éclairait suffisamment, bien que d’une lumière assez faible ; les deux hommes gravirent l’escalier, et, arrivés au premier étage, le cavalier poussa une porte, souleva une lourde portière en tapisserie, et introduisit son compagnon dans une espèce d’antichambre où, pour tous meubles, il n’y avait que des bancs en chêne, sans dossiers.
Ils traversèrent sans s’arrêter plusieurs pièces meublées avec la plus grande recherche et un luxe du meilleur goût ; ils parvinrent enfin à une chambre à coucher, à droite et à gauche de laquelle se trouvaient des cabinets da toilette, paraissant préparée pour recevoir un malade.
Un bon feu brûlait dans l’âtre et répandait une douce chaleur dans toute la pièce ; les lumières étaient voilées de façon ce que leur éclat ne blessât pas la vue ; sur une table se groupaient des bouteilles de formes étranges, des instruments de chirurgie à demi dissimulées sous une serviette ; enfin on avait réuni là, avec une prévoyance témoignant d’un vif intérêt ou d’une prudence très inquiète, ces mille objets indispensables pour hâter la guérison d’une personne atteinte par une maladie sérieuse.
— Voyez, docteur ! dit laconiquement le cavalier, en indiquant la table d’un geste.
Le médecin examina alors les fioles et les instruments de chirurgie avec une sérieuse attention, puis il se tourna vers son compagnon, qui le suivait du regard.
— Tout est parfait, rien ne manque, dit-il, avec un accent de satisfaction auquel il était impossible de se tromper ; je n’ai plus qu’une observation à faire.
— Voyons l’observation.
— Peut-être aurai-je besoin d’un aide.
— Le cas est prévu, docteur ; si vous en reconnaissez la nécessité, sur un mot, un signe de vous, cet aide paraîtra aussitôt. Avez-vous autre chose à demander ?
— Non, monsieur, rien absolument.
— Alors, je vous laisse ; souvenez-vous de ce que l’on vous a dit, et ayez bon courage, docteur ; la personne en question ne tardera pas à arriver ; surtout, ne quittez pas cette chambre.
— Je vous le promets, monsieur.
Le cavalier fit un léger salut et se retira.
Demeuré seul, le médecin resta un moment immobile, le corps jeté en avant et les regards fixés sur la porte, en proie en apparence à une sérieuse préoccupation ; mais, au bout de quelques secondes, n’entendant aucun bruit, il se redressa, jeta un regard interrogateur autour de lui, et, certain que nul n’épiait ses mouvements :
— Il le faut ! murmura-t-il ; il n’y a pas à hésiter plus longtemps !
Il marcha alors droit à la table sur laquelle se trouvaient entassées les fioles remplies de médicaments de toutes sortes et de toutes couleurs, feignit d’examiner minutieusement les diverses étiquettes de ces fioles, promena un dernier regard autour de lui, et, retirant doucement une petite bouteille en cristal de la poche de côté de son habit, il la glissa au milieu des autres.
Au même moment, un léger bruit se fit entendre au dehors.
— Il était temps ! grommela le médecin à part lui.
Sans autrement s’émouvoir, et surtout sans retourner la tête, ce qui aurait pu donner des soupçons, le médecin prit une tasse et commença à préparer une potion avec tout le soin et toute l’attention que les médecins de cette époque, qui ressemblaient beaucoup à ceux de la nôtre, apportaient à cette délicate opération, afin de bien doser les drogues et les substances dont ils faisaient la mixtion.
En ce moment la portière fut soulevée par le marin qui, précédemment, avait procédé à l’interrogatoire du docteur, lors de leur rencontre sur le quai ; cet homme inspecta la chambre d’un coup d’œil, puis il fit un geste de la main, et quatre matelots entrèrent, portant sur une civière une femme enveloppée dans des mantes et des couvertures, pour la garantir du froid, car elle était en costume de nuit.
Autant qu’il était possible d’en juger à cause du loup de velours noir qui couvrait son visage et faisait ressortir le blancheur laiteuse de sa peau, d’une finesse et d’une transparence remarquables, cette femme devait être fort jeune ; une forêt de cheveux blonds et soyeux inondaient en boucles parfumées ses épaules et sa poitrine qu’ils voilaient complètement ; ses mains, d’un modèle exquis, d’une blancheur éclatante, sur lesquelles couraient des réseaux de veines bleues, étaient nonchalamment posées sur les bords de la civière ; cette femme semblait être évanouie ; aucun souffle perceptible ne s’échappait de sa bouche mignonne, dont les lèvres pâlies, légèrement entrouvertes, laissaient apercevoir une double rangée de dents d’une blancheur nacrée.
Sur un geste du marin, les quatre porteurs s’arrêtèrent près de la cheminée, posèrent doucement la civière sur le tapis ; puis ils sortirent sans prononcer une parole ; derrière eux la porte se referma.
Alors, le marin enleva, comme une enfant, la femme dans ses bras nerveux, et il la plaça dans le lit, où il la coucha avec les plus grandes précautions ; ce devoir accompli, il se chargea de la civière, ouvrit la porte, la remit à un individu qui, sans doute, attendait au dehors ; puis il revint auprès du médecin.
Celui-ci était occupé à donner des soins à la malade.
— Eh bien ? lui demanda le marin au bout d’un instant, avec une anxiété qu’il essayait vainement de dissimuler.
— Eh bien ! elle dort, répondit la médecin, en le regardant fixement.
— Elle dort ?… elle n’est donc pas évanouie ?
— Pas le moins du monde ; vous devez le savoir mieux que personne, je suppose ?
— Pourquoi supposez-vous cela ?
— Parce que c’est vous probablement qui lui avez fait boire le breuvage qui la devait endormir.
Le marin secoua négativement la tête.
— Non, ce n’est pas moi, dit-il ; cela a été fait à mon insu ; si l’on m’en avait parlé, je ne l’aurais pas souffert ; y a-t-il du danger ?
— Aucun, quoique la dose soit forte… Vous avez des amis zélés : ils savent prévenir vos désirs.
— Je ne vous comprends pas, docteur ; veuillez vous expliquer, je vous prie ! je ne suis pas accoutumé à deviner des énigmes, répondit le marin, avec un accent de hauteur, peu en rapport avec le costume qu’il portait.
— Il n’y a pas la moindre énigme dans mes paroles ; l’explication sera brève, dit froidement le médecin. Pour certaines raisons, vous avez sans doute intérêt à ce que cette jeune femme donne le jour à un enfant sans qu’elle-même puisse le savoir positivement. Eh bien ! soyez satisfait, monsieur, elle accouchera pendant son sommeil ; de ce côté-là, du moins, ajouta-t-il d’une voix légèrement railleuse, votre secret sera bien gardé.
Le marin, ou soi-disant tel, était en proie à une trop vive préoccupation intérieure, pour remarquer le ton dont ces dernières paroles furent prononcées.
— Ainsi, vous croyez, docteur ?… murmura-t-il, sans même savoir ce qu’il disait.
— Je ne crois pas, monsieur, je suis certain de ce que j’avance, répondit sévèrement le médecin. Du reste, voici ce qui s’est passé : la grossesse de cette jeune femme est parvenue à sa dernière période ; les douleurs l’ont prise, ce soir, vers sept heures environ ; le roulis et le tangage du léger bâtiment sur lequel elle se trouvait, l’ont beaucoup fatiguée, et ont hâté l’instant de sa délivrance ; les douleurs ont commencé à se succéder avec des redoublements terribles et des crises effrayantes ; alors, un de vos amis, qui probablement s’occupe de médecine, a déclaré que la malade ne pourrait pas résister à ses souffrances, si l’on ne lui procurait pas un peu de repos ; en conséquence, cet ami lui fit prendre une liqueur que, sans doute, il s’était procurée à l’avance, et il la lui versa, par cuillerées, dans la bouche ; la malade se calma en effet, car elle tomba aussitôt dans un sommeil, ou plutôt dans une léthargie si profonde, que tout autre qu’un médecin expérimenté s’y tromperait et la croirait morte.
— C’est vrai ! murmura le marin avec accablement, tout cela est vrai ; je chercherais vainement à le nier ; votre science me confond… Ainsi, la pauvre enfant ?…
— Elle accouchera pendant sa léthargie.
— Cette nuit même ?
— Avant une heure.
— Et elle ne court aucun danger sérieux ?
— Aucun, je vous l’affirme ; seulement, croyez-moi, réprimez le zèle de vos amis, et ne recommencez pas une semblable expérience, elle pourrait être mortelle.
— Ainsi, vous supposez ?
— Je ne suppose rien, Dieu m’en garde ! je ne connais pas vos amis, moi ! Vous seul pouvez savoir si quelques-uns d’entre eux ont intérêt à faire disparaître du même coup la mère et l’enfant. Quelques gouttes de plus de cette liqueur, la chose était faite aujourd’hui. Vous voilà averti ; c’est à vous à faire bonne garde, si vous voulez éviter un malheur.
— Oh ! c’est affreux ! murmura le marin, en cachant son visage dans ses mains.
Il y eut un assez long silence.
Le médecin était retourné au chevet de la malade, dont il interrogeait le pouls avec anxiété.
Le marin, en proie à une vive agitation, marchait de long en large dans la chambre.
— Monsieur, dit-il enfin, en s’approchant du médecin, voulez-vous m’accorder quelques minutes d’entretien ?
— Je suis à vos ordres, monsieur ; la délivrance n’aura pas lieu avant minuit, et il est à peine onze heures.
Ils prirent des sièges, le médecin se plaça de façon à pouvoir surveiller constamment la malade.
— Parlez, je vous écoute, monsieur, dit-il en s’inclinant devant son interlocuteur.
— Monsieur, répondit celui-ci avec une nuance d’hésitation dans la voix, vous savez, n’est-ce pas, que les médecins sont comme les confesseurs ?
— Je le sais, oui, monsieur ; comme eux, nous exerçons un sacerdoce ; nous guérissons autant de plaies morales que d’affections physiques ; aussi peut-on tout confier à notre honneur.
— Eh bien ! docteur, puisque nous avons une heure devant nous, ainsi que vous me l’avez affirmé…
— Je vous l’affirme encore, monsieur.
— Soit, je profiterai de ce répit qui m’est accordé, pour avoir avec vous, si vous y consentez, une explication franche et loyale.
— À votre aise, monsieur ; je vous ferai remarquer cependant que je ne vous demande rien ; que je ne cherche en aucune façon à provoquer vos confidences.
— Je le reconnais et je vous en remercie, monsieur ; mais mon cœur se brise, les remords me poignent ; je veux tout vous dire. Ma conscience me reproche non seulement les fautes que j’ai commises ; mais, vous le dirai-je, les crimes que peut-être je me laisserai entraîner à commettre.
— Prenez garde, monsieur, ces dernières paroles sont graves ; je ne sais si je dois vous laisser aller plus loin.
— Que voulez-vous dire, monsieur ?
— Cette confidence que vous vous préparez à me faire me constituera presque votre complice.
— Ne l’êtes-vous pas déjà, monsieur ?
— Nullement, monsieur.
— Comment, nullement ? N’avez-vous pas accepté toutes les conditions que nous vous avons posées ?
— Certes, mais permettez, monsieur ; ces conditions n’ont rien que de très honorable pour moi ; si vous les avez oubliées, je vous les rappellerai en deux mots : un homme masqué m’est venu trouver à Talmont, au milieu de la nuit ; il m’a proposé de donner mes soins à une jeune femme sur le point d’accoucher, m’avertissant que, pour des raisons intéressant l’honneur de deux familles, cet accouchement devait demeurer ignoré de tout le monde, me promettant, si je consentais à le suivre et à garder un secret inviolable, qu’une somme considérable me serait comptée.
— Vous avez accepté et vous êtes venu.
— J’ai accepté et je suis venu, oui, monsieur, parce que nous autres, médecins, nous nous devons à l’humanité, notre profession nous en fait un devoir. Souvent on requiert notre secours dans des cas semblables à celui-ci ; nous nous rendons sans hésiter à l’appel qui nous est fait, parce que notre présence est non seulement une garantie, mais encore une consolation pour la malheureuse femme à laquelle nous donnons nos soins ; elle sait que nous protégerons l’enfant qu’elle aura mis au monde ; aussi, je vous le répète, avec ou sans récompense, n’hésitons-nous jamais à nous dévouer.
— Que prétendez-vous conclure de tout ceci, monsieur, s’il vous plaît ? dit le marin d’une voix nerveuse.
— Ma conclusion, la voici, monsieur ; elle est nette et claire : jamais un crime ne sera commis sur une femme à laquelle j’aurai, dans une pareille circonstance, donné mes soins ; son enfant, si son père l’abandonne, sera par moi enlevé et mis en lieu sûr ; voici, monsieur, ce que j’avais, et surtout ce que je tenais à vous dire, afin de vous faire bien comprendre que je ne suis pas et que je ne serai jamais votre complice.
Le marin se leva et fit deux ou trois tours avec agitation à travers la chambre.
— Enfin, monsieur, dit-il en revenant prendre sa place sur le fauteuil, qui vous fait supposer qu’on veut vous proposer un crime ?
— Je ne suppose rien, monsieur ; j’établis nettement ma position vis-à-vis de vous, afin que, plus tard, il n’y ait pas de malentendus entre nous ; voilà tout ; maintenant, j’attends votre confidence.
— Je n’en ai plus à vous faire ! s’écria-t-il avec violence.
— Comme il vous plaira, monsieur, cela m’est indifférent ; mais, comme il nous reste encore environ une demi-heure, si vous me le permettez, je vous raconterai, moi, une anecdote à l’appui de ce que je vous ai dit ; cette anecdote est courte ; elle vous intéressera, j’en suis convaincu.
— Pourquoi cette anecdote, ainsi que vous la nommez, m’intéresserait-elle, monsieur ?
— Tout simplement parce qu’elle a un rapport singulier avec ce qui se passe en ce moment ici.
— Ah ! fit le marin, en lançant à travers les trous de son masque un regard étincelant au médecin ; une histoire faite à plaisir, sans doute ?
— Pas le moins du monde, monsieur ; elle est vraie, au contraire, depuis A jusqu’à Z ; d’ailleurs, vous en jugerez si vous me permettez de vous la narrer, d’autant plus qu’elle a le grand avantage d’être courte.
— Parlez, si cela vous plaît, monsieur, je ne vous en empêche pas, puisque nous n’avons rien de mieux à faire.
— Je profite de votre gracieuse autorisation, monsieur, et je commence mon récit.
— Comme vous voudrez, fit le marin, en se renversant sur le dossier du fauteuil et en fermant les yeux.
— Bon ! reprit le médecin, d’un ton légèrement goguenard, avant cinq minutes, vous serez si intéressé que vous ouvrirez, malgré vous, les yeux.
— Je ne le crois pas.
— Moi, j’en suis certain ; donc, je commence…
Le marin haussa légèrement les épaules, mais ses yeux restèrent fermés.
Chapitre 2 Où les explications du docteur sont brusquement interrompues
Chapitre 2Où les explications du docteur sont brusquement interrompues
La situation dans laquelle se trouvaient placés ces deux hommes, inconnus peut-être l’un à l’autre, dissimulant leurs traits sous un masque et échangeant de mordantes railleries au chevet de cette malade, plongée dans un sommeil si profond qu’il ressemblait presque à la mort, avait quelque chose d’étrange et de sinistre, qui aurait fait courir un frisson de terreur dans les veines de quiconque aurait pu les voir.
Non seulement ils se sentaient adversaires, mais ils se pressentaient ennemis.
Tous deux, sans doute, avaient pris leur parti, peut-être même leurs précautions à l’avance ; dans leur for intérieur, ils se croyaient, l’un et l’autre, certains de sortir à leur avantage de ce singulier tournoi.
Mais cette lutte ne pouvait se prolonger encore longtemps ; l’heure approchait où le médecin se verrait contraint de donner tous ses soins à la malade ; de son côté, le marin, sous son apparente indifférence, cachait un effroi réel. Comment se débarrasser de ce témoin incommode qui semblait avoir percé à jour son incognito et être le maître de son secret ?
Rompre brusquement l’entretien ? passer de la parole aux actes ? obtenir par la force ce que son adversaire n’avait pas voulu accorder à la conciliation et aux offres brillantes qui lui avaient été faites ?
Le marin roulait toutes ces pensées dans sa tête avec une ardeur fébrile, attendant, pour prendre une décision, que son adversaire se fût enfin résolu à lui donner le mot de cette énigme indéchiffrable, et à laisser échapper sa pensée tout entière.
Alors, connaissant la portée du danger dont, jusque-là, il n’avait été menacé que d’une façon ambiguë, il pourrait prendre d’énergiques dispositions et employer même, s’il le fallait, les moyens les plus extrêmes pour échapper à ce danger.
Arrivé à un certain degré de surexcitation morale, l’homme ne recule plus devant rien ; quelles que soient les barrières qu’on lui oppose, il les brise, ou meurt.
Telle était, en ce moment, la situation d’esprit du marin ; cependant par un effort suprême de volonté, il renfermait toute émotion en lui-même ; avant tout, il voulait savoir ; cette raison suffisait pour maintenir sa colère et l’empêcher d’éclater au dehors.
Le médecin semblait être très sérieusement occupé à tisonner ; après s’être acquitté, à sa satisfaction, de cet important devoir, il se redressa, consulta sa montre, jeta un regard sur la malade, se tourna vers le marin, toujours renversé, les yeux fermés, sur le dossier de son fauteuil, dans la position d’un homme endormi, toussota deux ou trois fois, sans doute afin de s’éclaircir la voix, et, tous ces préliminaires terminés, il entama enfin son récit :
— Monsieur, dit-il d’une voix mielleuse, dans laquelle cependant perçait une fine pointe d’ironie, je n’abuserai pas longtemps de votre patience. Pour qu’une anecdote soit bonne, elle doit, avant tout, être courte ; celle que vous allez entendre remplit complètement cette condition : en apparence, ce n’est que l’histoire assez vulgaire d’une jeune fille séduite, trompée et peut-être pis, par l’homme auquel elle avait donné son cœur ; événement ordinaire, presque banal, tant il est fréquent de nos jours, et dont je ne voudrais pas vous ennuyer, si l’histoire dont il est question ne sortait pas de la vulgarité de toutes ces intrigues de ruelles, à cause de la sagesse, du dévouement de la pauvre enfant, d’une part, et de l’autre, par la déloyauté de son lâche séducteur.
— Hein ? qu’avez-vous dit ? s’écria le marin d’une voix menaçante, en se redressant brusquement.
— J’ai dit la déloyauté de son lâche séducteur, reprit le médecin d’un ton paterne.
— Continuez.
— Cela vous intéresse déjà ?
— Peut-être ; vous avez un but, en me racontant cette soi-disant histoire…
— Pardon, monsieur, véridique histoire, s’il vous plaît.
— Soit ! je vous le répète, vous avez un but ?
— Oui, monsieur.
— Quel est-il ?
— Je vous laisse, monsieur, le soin de le comprendre ; du reste, voici le fait en deux mots : vous m’arrêterez, lorsque vous le jugerez à propos.
— Pourquoi supposez-vous que je puisse vous interrompre ?
— Qui sait ? Peut-être ce récit n’aura-t-il pas le bonheur de vous plaire ; d’ailleurs, rien ne m’est plus facile que de me taire.
— Pardon, monsieur, vous avez voulu parler, malgré mon désir de ne pas entendre ce récit ; vous avez commencé, il faut finir ; c’est moi, maintenant, qui exige que vous terminiez cette histoire ; vous avez prononcé deux mots dont je veux avoir l’explication.
— J’y consens, monsieur, d’autant plus que ces deux mots qui vous semblent si forts, me paraissent trop doux, à moi, pour qualifier le crime dont le héros de cette malheureuse histoire s’est rendu coupable. Un jeune homme vivement poursuivi par la maréchaussée, blessé de deux coups de feu, n’ayant plus à la main que le tronçon de son épée, sentant ses forces l’abandonner, car tout son sang s’échappe en bouillonnant de ses blessures ; près de succomber ; sans autre espoir que la mort, s’il tombe aux mains de ceux qui le pressent et qui ne lui feront pas grâce, car, tout en fuyant, il a tué trois des leurs, et grièvement blessé un quatrième ; cet homme est providentiellement sauvé par un inconnu qui s’élance d’un taillis, bondit sur les archers et les met en fuite, après une lutte opiniâtre qui ne dure pas moins d’un quart d’heure, et dont il ne sort vainqueur qu’au prix d’une blessure profonde au bras droit ; ce jeune homme, étendu sur la route, presque sans vie, est relevé par l’inconnu qui, malgré sa blessure, le charge sur ses épaules, et, après avoir fait des efforts gigantesques, et failli tomber épuisé lui aussi, le transporte dans un château voisin, château habité par sa mère, sa jeune sœur et quelques domestiques. Là, les soins les plus délicats sont prodigués au jeune homme ; on lui offre l’hospitalité la plus grande, et pour le soustraire aux recherches, on l’établit dans la chambre secrète du château. Deux jours après ces événements, la maréchaussée se présente. Le jeune homme si noblement recueilli est un criminel d’État ; sa tête est mise à prix. Son sauveur apprend alors son nom, qu’il n’a pas voulu lui demander ; une haine implacable sépare les deux familles ; elles sont ennemies irréconciliables. La pensée d’une vengeance facile et d’une trahison ne traverse pas, une seconde, l’esprit de l’homme qui a reçu son ennemi sous son toit. Les archers fouillent le château du haut en bas, et se retirent enfin désappointés parce qu’ils n’ont rien découvert. Comment le héros de cette histoire a-t-il reconnu la grandeur d’âme de son sauveur ? Par une lâche et infâme trahison, en séduisant la sœur de l’homme auquel il devait la vie. Cette jeune fille pure, innocente, dévouée, était chargée, avec sa mère, de veiller sur le blessé, de le soigner. Car on n’osait mettre personne dans la confidence. Tour à tour, jamais ensemble, de crainte d’éveiller les soupçons, la mère ou la fille se rendaient dans la chambre secrète, et portaient des consolations au blessé. Ce fut pendant ces entrevues que cet homme, dont l’âme, flétrie par la débauche, ne possède plus un sentiment généreux, s’empara traîtreusement du cœur de la jeune fille, et lui fit oublier ce qu’elle se devait à elle-même et à ceux dont elle porte le nom, jusque-là sans tache. Cette action fut d’autant plus lâche, ce crime plus infâme, que la malheureuse enfant était seule avec sa mère, sans protecteur, sans appui. Son frère avait été contraint de quitter la France à l’improviste, douze jours à peine après avoir donné l’hospitalité à l’homme qui devait porter la honte et le déshonneur sous son toit ; et il le savait, le misérable, car, avant de partir, son généreux sauveur avait pris congé de lui en lui disant ces nobles paroles : « Nos familles ont été longtemps ennemies ; après ce qui s’est passé, nous ne pouvons plus nous haïr, nous sommes frères ; je vous confie ma mère et ma sœur. Adieu ! »
— Monsieur ! s’écria le marin avec violence, en se levant brusquement, prenez garde !
— Que je prenne garde !… à quoi, s’il vous plaît, monsieur ? répondit paisiblement le médecin. Douteriez-vous, par hasard, de l’authenticité de cette histoire ? Cela vous serait difficile, monsieur, car toutes les preuves sont entre mes mains, ou à peu près, ajouta-t-il d’un ton sarcastique.
Le marin se dressa, comme poussé par un ressort ; il lança un regard étincelant à son impassible interlocuteur, et, mettant sa main sous sa jaquette comme pour y prendre une arme cachée :
— Non, monsieur, dit-il avec un accent glacé, je n’ai pas le plus léger doute sur l’authenticité de l’histoire qu’il vous a plu de me raconter, et la preuve…
— C’est que si je n’y prends pas garde, interrompit froidement le médecin, vous allez m’assassiner.
— Monsieur ! fit le marin, avec un geste de dénégation indignée.
— Pas de cris, monsieur ; songez à l’infortunée qui repose sur ce lit de douleur, reprit le docteur toujours ironiquement bonhomme ; cessez de tourmenter votre poignard dont vous ne vous servirez pas contre moi ; reprenez votre place sur ce fauteuil, et écoutez-moi. Croyez-moi, cela avancera plus vos affaires que le sanguinaire projet qu’en ce moment vous roulez dans votre tête.
— Assez d’insultes comme cela, monsieur ! Je n’ai qu’un mot à dire, qu’un geste à faire…
— Je le sais ; mais ce mot, vous ne le direz pas ; ce geste, vous n’oserez point le faire.
— Vive Dieu ! c’est ce que nous allons voir !
Il se détourna et s’élança vers la porte.
— Vous préférez que, devant vos complices, j’enlève mon masque ? À votre aise, monsieur.
— Que m’importe que vous enleviez votre masque devant mes gens ? Avez-vous la prétention de m’effrayer par cette sotte menace ?
— Non, certes ; mais peut-être regretterez-vous bientôt d’avoir mis vos gens, ainsi que vous les nommez, dans le secret d’une affaire que, par considération pour deux nobles races, par amitié pour votre père, j’aurais voulu terminer sans éclat et avec vous seul.
— Mon père ! vous me parlez de mon père, vous, monsieur !
— Pourquoi ne vous en parlerais-je pas, puisque je suis un de ses plus anciens et de ses plus fidèles amis ? répondit le médecin avec une nuance de tristesse.
— Monsieur, dit le marin d’une voix que la colère faisait trembler, je vous somme de me montrer votre visage, afin que je sache qui vous êtes. Oh ! vous ne vous jouerez pas plus longtemps de moi !
— Ce n’est pas mon intention, et la preuve, la voici ! ajouta-t-il, en ôtant vivement son masque. Maintenant, regardez-moi, monsieur le prince de Montlaur !
— Le docteur Quénaud, le médecin de la reine mère et de monsieur le cardinal ! s’écria avec épouvante celui auquel on venait de donner le titre de prince.
— Oui, monsieur, reprit le médecin, un peu pâle peut-être, car l’assaut avait été rude, mais toujours froid et digne.
— Vous ici ! vous ! oh ! mon Dieu ! s’écria-t-il en se laissant tomber avec abattement sur son siège ; que venez-vous faire dans cet antre ?
— Vous empêcher de commettre un crime.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! répétait-il, sans même savoir ce qu’il disait, je suis perdu !
— Non, vous êtes sauvé, au contraire. Suis-je donc votre ennemi, moi qui vous ai vu naître, qui vous ai reçu dans mes bras, quand votre mère vous mit au monde ?
— Que faire ?… reprit-il en arrachant violemment son masque et recommençant à marcher avec égarement à travers la chambre.
— M’écouter, et surtout vous calmer, mon enfant, répondit le médecin avec une indicible expression de bonté.
— Que pourrez-vous me dire, docteur ? Vos consolations, si affectueuses qu’elles soient, car je sais que vous m’aimez, cent fois vous me l’avez prouvé ; vos consolations n’atteindront pas le but que sans doute vous vous proposez ; mon crédit à la cour est à tout jamais perdu maintenant ; je suis déshonoré ; je me suis laissé entraîner au fond d’un gouffre dont je ne puis sortir que par la mort.
— Vous divaguez, Gaston. Votre crédit est aussi fort que jamais ; la reine et le cardinal ignorent tout ; quant à votre honneur, il est sauf, puisque ce crime qu’on vous poussait à commettre, maintenant…
— Oh ! je vous le jure ! s’écria-t-il avec exaltation. Pauvre cher ange ! je la défendrai contre tous, même…
— Contre votre frère… C’est bien, Gaston ; je retiens votre parole et j’y compte.
— Mais dites-vous vrai ?… mon crédit à la cour…
— Ai-je jamais menti ?
— Pardonnez-moi, mon vieil ami, je suis fou.
— Maintenant, voulez-vous m’écouter !
— Oui, car j’ai hâté de savoir par quel hasard, ou plutôt quelle fatalité, vous vous trouvez mêlé à tout ceci.
— Il n’y a ni hasard, ni fatalité, mon ami. Ainsi qu’on vous l’a dit, sans doute, je suis originaire de cette province, où je possède quelques propriétés. Une de ces propriétés, où je me rends, chaque fois que les devoirs de ma charge me laissent quelques jours de liberté, est située aux environs de Luçon, à deux portées de fusil au plus du château héréditaire des comtes de Manfredi-Labaume, qui, ainsi que vous le savez mieux que personne, vous, leur ennemi implacable, ont suivi la reine Catherine de Médicis lorsqu’elle vint en France.
— Cette haine est ancienne, docteur ; elle date de la Saint-Barthélemy.
— Je le sais ; vous étiez huguenots alors, tandis que les Manfredi-Labaume, alliés de très près à la reine, étaient, ce qu’ils sont encore, de zélés catholiques. Mais laissons cela, quant à présent ; aujourd’hui vos deux familles sont de la même religion ; depuis longtemps déjà cette haine devrait être éteinte.
— Quant à moi, je vous assure, docteur…
— Oui, oui, dit celui-ci avec ironie ; mais vous avez, convenez-en, une singulière façon de renouer les relations. Je vous le répète, laissons cela. Je suis l’ami intime de cette famille, le parrain de la pauvre Sancia ; c’est elle qui m’a tout confié ; ce secret, je l’ai précieusement conservé dans mon cœur ; moi seul le possède…
— Vous vous trompez, docteur, dit une voix rude et menaçante ; ce secret, je le sais aussi, moi !
Les deux hommes frissonnèrent comme s’ils eussent été piqués par un serpent, et ils se tournèrent vivement vers le fond de la chambre où un homme se tenait immobile, soulevant de la main gauche un pan de la tapisserie.
— Oh ! voilà ce que je redoutais ! murmura le docteur avec une expression de douleur navrante.
— Ludovic de Manfredi-Labaume ! s’écria le prince avec stupeur. Ah ! vous m’avez trahi, docteur !
— Personne ne vous a trahi, monsieur le prince de Montlaur, dit sévèrement l’homme qui était apparu d’une façon si étrange. Sancia m’a écrit, à moi ; ne suis-je pas son frère, le chef de la famille, responsable de son honneur ?
Il laissa alors retomber le pan de la tapisserie devant l’entrée secrète qui lui avait livré passage, traversa la chambre d’un pas de statue, et poussa les verrous de la porte.
— Je prends mes précautions pour que nous ne soyons pas interrompus pendant notre explication, dit-il froidement aux deux hommes, qui le regardaient faire avec une surprise mêlée d’épouvante.
— Je suis à vos ordres, monsieur le comte, dit le prince en se levant.
Les deux ennemis se toisèrent un instant, sans prononcer une parole ; mais les regards fauves qu’ils échangeaient montraient clairement la haine implacable qui dévorait leur cœur.
Henri-Charles-Louis-Gaston de la Ferté, comte de Chalus et prince-duc de Montlaur, appartenait à une des plus nobles et des plus anciennes familles du Poitou : celle des princes de Talmont, dont, en sa qualité de premier-né, il était l’héritier direct, famille alliée à tout ce que la France possédait alors de plus grand et de plus justement renommé en fait de noblesse, jouissant d’une fortune incalculable et d’une influence immense dans les provinces de Poitou et d’Anjou, où elle avait toujours joué un rôle important.
Le prince de Montlaur était un élégant gentilhomme, de vingt-quatre à vingt-cinq ans, aux traits mâles, au teint blanc et pur comme celui d’une femme ; ses yeux noirs, bien ouverts, dont les longs cils faisaient ombre sur ses joues, avaient le regard doux et caressant, mais qui prenait un éclat terrible sous l’impression de la colère ; sa chevelure brune, naturellement bouclée, s’éparpillait en touffes parfumées sur ses épaules, sa moustache, coquettement retroussée, imprimait à sa physionomie un cachet de crânerie qui lui donnait un charme extrême.
Le costume grossier qu’il portait en ce moment, loin de lui être désavantageux, faisait, au contraire, ressortir ses formes réellement exquises et la noblesse innée de ses moindres gestes.
Le comte Ludovic de Manfredi-Labaume, par ses allures et sa prestance, était l’opposé le plus complet du prince de Montlaur : soigneusement enveloppé d’un caban de marin, sans doute pour se garantir des atteintes glaciales de la brise qui, au dehors, soufflait en foudre, il avait la tête abritée par un de ces chapeaux de toile goudronnée auxquels les matelots donnent le nom de Surouest et dont les ailes retombent par derrière jusqu’au milieu du dos ; de larges hauts-de-chausses, serrés aux hanches par une ceinture en cuir jaune, dans laquelle étaient passés deux pistolets, une hache et un poignard, complétaient son costume.
Le comte, ainsi que nous l’avons dit, était d’origine italienne ; mais il appartenait à cette race blonde, si belle et si appréciée par-delà les monts, que Raphaël, à qui elle parut presque divine, fit toutes ses vierges blondes ; il paraissait doué d’une vigueur extraordinaire ; c’était un homme d’une taille un peu au-dessus de la moyenne, trapu et solidement charpenté ; en entrant dans la chambre, il avait jeté son surouest sur un meuble, par un mouvement machinal ; ce qui permettait de voir sa tête, grosse, couverte d’une forêt de cheveux d’un blond fauve, dont les boucles épaisses tombaient sur ses épaules et se confondaient avec sa barbe, de même couleur, qu’il portait entière et longue ; ses yeux gris, bien ouverts, pétillaient d’intelligence et de finesse, quoique son regard fût droit et franc ; son front découvert, son nez un peu recourbé, aux narines mobiles, sa bouche grande, aux lèvres rouges, sensuelles et aux dents bien rangées et d’une blancheur éclatante, lui composaient une physionomie qui aurait été extrêmement sympathique, sans l’expression de dureté et d’énergie froide répandue sur ses traits, et qui donnait à son visage quelque chose de sévère et de sombre ; bien que la pluie, le soleil, le froid et le chaud eussent parcheminé sa peau, creusé sur son front des rides précoces et donné à son teint presque la couleur de la brique, cependant il était facile de reconnaître qu’il était jeune encore, et ne devait pas avoir plus de vingt-sept ou vingt-huit ans ; il avait cette vigueur de formes particulière aux marins : des épaules légèrement voûtées d’une largeur peu commune, des bras longs, cerclés de muscles entrecroisés, durs comme des cordes et terminés par des mains épaisses et nerveuses.
De même que tous les marins de profession, il marchait la tête un peu inclinée sur la poitrine, les jambes écartées, en se dandinant à droite et à gauche, par un mouvement cadencé, comme si, bien qu’en ce moment il fût à terre, le roulis de son navire continuât à se faire sentir pour lui.
— J’ai entendu toute votre conversation, dit-il d’une voix calme ; depuis deux heures, je me tiens embusqué, comme un tigre qui guette, derrière cette tapisserie ; je n’ai, à la vérité, rien appris que je ne susse déjà ; mais je vous avertis, afin que nous venions vite au fait, et que nous ne perdions pas notre temps en paroles oiseuses ; vous devez avoir autant que moi hâte d’en finir, n’est-ce pas, monsieur de Montlaur ?
— En effet, monsieur, c’est mon plus vif désir, répondit froidement le prince.
— Ne craignez rien, nous irons vite en besogne ; afin que vous ne vous trompiez pas à la portée de la démarche que je fais en ce moment, je dois encore vous avertir de ceci : le vénérable abbé de Saint-Maur-lès-Paris, marquis de la Roche-Taillée, et votre frère, a eu, avec moi, une discussion un peu vive, à la suite de laquelle je lui ai passé mon épée à travers le corps.
— Monsieur ! s’écria le prince.
— Ne vous inquiétez donc pas de lui, continua le comte dont le sang-froid, en ce moment, semblait d’autant plus effrayant qu’il cachait une fureur terrible ; ce sera, dans quelques instants, l’affaire du docteur, je désire qu’il le guérisse, bien que je redoute le contraire.
— Monsieur le comte, interrompit le jeune homme avec colère, finissez, je vous prie, ces sarcasmes de mauvais goût ; je suis prêt à faire votre partie.
— Patience, mon gentilhomme, cela viendra bientôt, n’ayez peur ! reprit le comte, sans rien perdre de son impassibilité ; mais il nous faut procéder dans les règles ; il me reste à vous avertir que vous n’avez à compter sur aucun de vos gens ; ils sont tous mes prisonniers ; votre lougre même est en mon pouvoir.
— À ce qu’il paraît, dit le jeune homme avec une ironie méprisante, vous exercez la piraterie jusque sur les côtes de France ; c’est bon à savoir !
— On fait ce qu’on peut, monsieur ; quant à ce dont vous me menacez, il est probable que ce ne sera pas vous qui dénoncerez le métier plus ou moins lucratif auquel je me livre. Aussi n’ai-je aucune inquiétude à ce sujet. C’est par suite d’une vieille habitude de prudence que j’ai fermé la porte de cette chambre ; en vous disant ce que je vous ai dit, et en agissant ainsi que je l’ai fait, j’ai voulu simplement que vous comprissiez ceci : nous sommes bien seuls, en face l’un de l’autre, armés de notre haine, sans secours possible, d’où qu’il vienne ; maintenant, monsieur le prince de Montlaur, si vous y consentez, nous allons un peu causer comme deux anciens amis que nous sommes. (Ces dernières paroles furent scandées avec une intonation effrayante.) J’attends ce que vous avez à me répondre, ajouta-t-il.
— Je serai bref, monsieur le comte, répondit le jeune homme avec une hauteur dédaigneuse ; ainsi que vous-même l’avez dit, toute explication serait oiseuse entre nous ; c’est une réparation qu’il vous faut, soit ! je suis prêt à vous la donner, aussi entière et aussi éclatante que vous l’exigerez.
— Voilà de belles paroles, monsieur, malheureusement vos paroles ne répondent que rarement à vos actions ; je ne sais pourquoi j’ai la conviction intime que, lorsque je vous aurai dit ce que j’exige de vous, vous ne me répondrez que par un refus.
— J’en doute, monsieur, car je vous le dis encore, je suis déterminé à vous satisfaire, quoi que vous me demandiez, une seule chose exceptée cependant.
— Ah ! fit le comte avec un ricanement sinistre, une restriction !
— Oui, monsieur, mais une seule ; en tout ce qui m’appartient en propre, qui m’est personnel, en un mot, je vous reconnais le droit d’exiger de moi ce qui vous plaira.
— C’est heureux ! murmura le comte avec amertume.
— Mais, continua le jeune homme, il est un bien auquel je ne puis toucher en aucune façon, parce qu’il n’est pas seulement à moi, mais est la propriété de toute ma famille, et m’a été légué par une longue suite d’ancêtres, pur et sans tache ; ce bien, c’est mon nom, que je ne puis ni souiller, ni avilir, parce que je dois, à mon tour, le léguer à ceux qui me suivront tel que je l’ai reçu.
— Ah ! je le savais ! s’écria fiévreusement le comte ; l’honneur de votre nom ! et l’honneur du mien, ce n’est donc rien à vos yeux ? Ne suis-je pas d’aussi bonne race, d’aussi haute lignée que vous ? Avez-vous pu supposer un instant que cette flétrissure que vous ne voulez pas subir, vous, traître et lâche, je l’accepterais, moi ! moi, que vous avez froidement déshonoré ! Ah ! c’est trop d’outrecuidance, mon gentilhomme !
— Que prétendez-vous donc, monsieur !
— Ce que je prétends ! s’écria-t-il d’une voix vibrante, je vais vous le dire, monsieur le prince de Montlaur : je prétends vous rejeter à la face l’infamie dont vous avez osé couvrir mon nom, auquel je tiens, plus que vous ne tenez au vôtre, car toujours j’ai su le porter haut, devant tous ! Je prétends vous imprimer un stigmate indélébile qui, partout et toujours, vous fera reconnaître au premier regard pour ce que vous êtes réellement : un traître, un lâche et un larron d’honneur !
— Monsieur ! s’écria le jeune homme, pâle de colère, de telles insultes ne demeureront pas impunies !
— Non, certes, reprit-il en ricanant ; rapportez-vous-en à moi pour cela ; je suis de race italienne ; on dit là-bas, par-delà les monts, que la vengeance se mange froide et à petites bouchées ; ainsi ferais-je, sur mon âme ! je vous en donne ma foi de gentilhomme, et je ne me parjure jamais, vous le savez ; songez-y donc, monsieur, avant que de répondre par un refus à la proposition que je vais vous faire.
Ces paroles furent prononcées avec une telle véhémence ; les traits du comte avaient pris une telle expression de férocité que, malgré tout son courage, le jeune homme sentit son cœur se serrer douloureusement : une sueur froide inonda son front pâle ; il eut peur.
Cependant il se raidit contre cette émotion qui le maîtrisait et s’emparait de tout son être ; ce fut le visage serein et la voix calme qu’il répondit :
— Trêve de menaces, monsieur ! je ne suis pas un enfant ou une femme craintive que l’on effraie avec des mots. Expliquez-vous une fois pour toutes : Qu’exigez-vous de moi ?
En ce moment, le docteur Guénaud qui, depuis quelques instants était demeuré penché avec anxiété sur le lit où gisait, sans mouvement, la malheureuse jeune fille, se redressa brusquement, et, s’élançant entre les deux hommes :
— Silence, messieurs ! s’écria-t-il avec autorité, silence ! voici arrivée l’heure où cette infortunée va devenir mère ; cessez ces cris et ces débats ; laissez-moi toute ma liberté d’esprit pour accomplir le pénible devoir qui m’incombe, je vous l’ordonne au nom de l’humanité !
— Soit ! murmura le comte d’une voix sourde, venez, monsieur.
— Où me conduisez-vous ? demanda le jeune homme avec une appréhension secrète.
— Oh ! ne craignez rien, monsieur, reprit le comte avec un sourire ironique ; nous ne quitterons pas cette pièce. Nous nous dissimulerons seulement derrière les épais rideaux de cette alcôve, afin de laisser au docteur Guénaud toute la liberté qu’il réclame de nous et dont il a besoin, pour mener à bonne fin la rude besogne dont vous l’avez si malencontreusement chargé.
Le prince de Montlaur ne fit aucune objection ; il se contenta de s’incliner et de suivre le comte, auprès duquel il se plaça, dans l’angle le plus obscur de la chambre.
Là, ils demeurèrent tous deux immobiles et silencieux, l’épaule appuyée au mur, les bras croisés sur la poitrine, la tête basse, et réfléchissant profondément.
Quelles sinistres pensées roulaient ces deux implacables ennemis dans leur cerveau en feu, tandis que la sœur de l’un, qui était la maîtresse de l’autre, se tordait, sans en avoir conscience, dans les douleurs de l’enfantement ?
Quant au docteur Guénaud, il avait complètement oublié les deux jeunes gens ; l’homme avait disparu pour faire place au médecin ; il ne songeait plus qu’à la malade.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au dehors, la mer mugissait et se brisait avec fureur contre les rochers du rivage ; la pluie tombait et fouettait violemment les vitres ; le vent sifflait avec des plaintes sinistres : c’était une horrible nuit, qui remplissait l’âme de tristesse et de terreur !
Chapitre 3 De quelle façon le comte de Manfredi-Labaume comprenait la vengeance
Chapitre 3De quelle façon le comte de Manfredi-Labaume comprenait la vengeance
Les heures sombres de la nuit s’étaient lentement écoulées ; l’aube commençait à teinter les vitres d’une lueur grisâtre qui faisait pâlir les lumières, le feu s’éteignait tristement dans l’âtre ; des bouffées d’un air froid et humide couraient sur les longues tapisseries qu’elles faisaient frissonner ; un silence de mort planait sur la chambre de la malade.
Silence rendu plus farouche et plus significatif par l’immobilité marmoréenne des deux ennemis ; toujours placés côte à côte, le cou tendu et le regard étincelant, à demi dissimulés dans les larges plis des lourds rideaux, comme deux tigres aux aguets, ils n’avaient pas échangé un mot, pas fait un geste, depuis que le docteur avait brusquement mis fin à leur débat.
Le docteur Guénaud, pâle, les sourcils froncés, les lèvres serrées, prodiguait à la malade les soins les plus intelligents et les plus affectueux ; sans s’arrêter une seconde, luttant pied à pied contre la crise terrible qui, en se prolongeant, menaçait d’être fatale à la pauvre jeune fille, essuyant furtivement son front inondé de sueur, oubliant sa fatigue, sa douleur, pour ravir à la mort cette proie dont elle voulait s’emparer.
Il y avait quelque chose de grandiose et de terrible dans cette lutte acharnée de la science, que rien n’aidait dans ce corps inerte et que la vie semblait avoir abandonné, contre les affres terribles d’un enfantement laborieux ; dans des circonstances aussi en dehors de toutes prévisions, soutenu seulement par un dévouement sans bornes et une énergie que rien ne pouvait abattre, pas même la certitude que la frêle créature qui allait naître était, à l’avance, vouée au malheur et à la honte.
Tout à coup, le médecin se redressa ; il tenait un enfant dans les bras ; son front s’éclaira et un éclair traversa son regard.
L’enfant jeta un cri.
Les deux hommes tressaillirent.
— Messieurs, dit le docteur d’une voix émue, c’est un garçon !
Le prince de Montlaur voulut s’élancer.
Une main de fer le cloua immobile à sa place, tandis que le comte lui disait avec un accent terrible :
— Vous n’êtes pas son père encore ?
— Ne puis-je donc l’embrasser ? demanda-t-il avec égarement.
Le premier cri de son enfant lui avait brisé le cœur, en lui révélant un sentiment qu’il ignorait, le sentiment le plus vrai, le plus doux de la nature : la Paternité.
— Peut-être l’embrasserez-vous, répondit froidement le comte, cela dépend de vous seul.
— Que faut-il faire pour cela ?
Le comte le traîna, plutôt qu’il ne le conduisit, devant le lit où gisait, pâle, muette et pâmée, la jeune femme.
— Ce qu’il faut faire ? reprit-il.