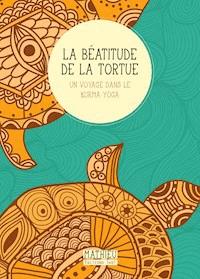
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions ThoT
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Récit d'un voyage envoûtant en Inde, pays de la méditation...
La Béatitude de la tortue est le récit d’un voyage. En 1981, parcourir l’Inde était encore une aventure. On y croisait de drôles de gens, certains assez connus comme Krishnamurti, Mâ Anandamaye ou Vijayananda, et d’autres, inconnus ou anonymes, comme ce cireur de chaussures méditant sur le silence au cœur de la gare la plus bruyante du monde, ou comme ces prêtres provoquant, par leurs prières, le lever du soleil.
Mais le personnage le plus paradoxal de ce récit reste l’Inde, un pays hallucinant et fascinant, qui ressemble au nôtre, mais où rien ne fonctionne de la même manière.
C’est une suite de coïncidences qui va mettre notre narrateur, venu en Inde pour s’initier au yoga et à la méditation, sur la piste d’une mystérieuse transcription en sanskrit intitulée
La Béatitude de la tortue. Les six textes, qui abordent les fondements du yoga, sont dispersés à travers l’Inde. Cette enquête devient vite une quête singulière au travers d’un véritable labyrinthe : de Darjeeling à Lucknow, de Bombay à Madras, de Rishikesh au cap Comorin et de la périphérie de nous-mêmes vers notre centre.
L'auteur nous raconte ses sillonnements à travers le Sous-Continent, ses rencontres étonnantes et sa quête toujours inassouvie de spiritualité.
EXTRAIT
Je ne sais si un voyage se prépare. Depuis longtemps, je rêvais de l’Inde, et ce voyage – étonnant, fabuleux, impossible – longtemps je l’ai rêvé, imaginé, fantasmé, dessiné, en même temps que je l’ai craint, redouté, évité, oublié. Puis un jour, la décision arrive ; on ne sait jamais bien comment ni par quel miracle le choix s’impose. Partir en Inde devient alors une réalité, un fait, une situation concrète, qui quitte le monde des songes et se matérialise par l’achat d’un billet d’avion, la demande d’un visa, la constitution d’un sac à dos léger et la vague conception d’un itinéraire. Ce jour-là, c’est comme si le voyage s’était préparé de lui-même, de manière secrète, silencieuse et latente, durant tout le temps précédant la décision.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Mathieu se contente d’un prénom. Après des études d’ethnologie dans le domaine indien, il parcourt l’Inde ponctuellement depuis 1972.
Il est cofondateur de la Maison du Yoga à Paris. Il se spécialise dans des formes de yoga particulières comme le kurma yoga, ou yoga de la tortue, et le yoga nidra traditionnel. Il codirige la revue
Infos Yoga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉSENTATION DE L'AUTEUR
Mathieu se contente d’un prénom. Après des études d’ethnologie dans le domaine indien, il parcourt l’Inde ponctuellement depuis 1972. Il est cofondateur de la Maison du Yoga à Paris. Il se spécialise dans des formes de yoga particulières comme le kurma yoga, ou yoga de la tortue, et le yoga nidra traditionnel. Il codirige la revue Infos Yoga.
www.ecoledeyogamathieu.fr
RÉSUMÉ
La Béatitude de la tortue est le récit d’un voyage. En 1981, parcourir l’Inde était encore une aventure. On y croisait de drôles de gens, certains assez connus comme Krishnamurti, Mâ Anandamaye ou Vijayananda, et d’autres, inconnus ou anonymes, comme ce cireur de chaussures méditant sur le silence au cœur de la gare la plus bruyante du monde, ou comme ces prêtres provoquant, par leurs prières, le lever du soleil. Mais le personnage le plus paradoxal de ce récit reste l’Inde, un pays hallucinant et fascinant, qui ressemble au nôtre, mais où rien ne fonctionne de la même manière. C’est une suite de coïncidences qui va mettre notre narrateur, venu en Inde pour s’initier au yoga et à la méditation, sur la piste d’une mystérieuse transcription en sanskrit intitulée La Béatitude de la tortue. Les six textes, qui abordent les fondements du yoga, sont dispersés à travers l’Inde. Cette enquête devient vite une quête singulière au travers d’un véritable labyrinthe : de Darjeeling à Lucknow, de Bombay à Madras, de Rishikesh au cap Comorin et de la périphérie de nous-mêmes vers notre centre.
Nous sommes peut-être, à cet instant précis, le jouet d’un sortilège qui rend ce livre et le voyage qu' il raconte aussi illusoires que les songes qui disparaissent lorsque nous cessons de rêver.
Tout est vrai, sauf moi.
Merci à Fabienne Costa pour son aide et à tous ceux qui ont assuré la relecture.
PROLOGUE
Je ne sais si un voyage se prépare. Depuis longtemps, je rêvais de l’Inde, et ce voyage – étonnant, fabuleux, impossible – longtemps je l’ai rêvé, imaginé, fantasmé, dessiné, en même temps que je l’ai craint, redouté, évité, oublié. Puis un jour, la décision arrive ; on ne sait jamais bien comment ni par quel miracle le choix s’impose. Partir en Inde devient alors une réalité, un fait, une situation concrète, qui quitte le monde des songes et se matérialise par l’achat d’un billet d’avion, la demande d’un visa, la constitution d’un sac à dos léger et la vague conception d’un itinéraire. Ce jour-là, c’est comme si le voyage s’était préparé de lui-même, de manière secrète, silencieuse et latente, durant tout le temps précédant la décision.
Je prends congé du minuscule studio que je loue à Paris. Le matelas finira sur le trottoir, une amie récupère le réchaud et quelques objets de cuisine, je vends, au marché aux puces de Montreuil, mon tourne-disque et la collection complète des aventures de Tintin que je ne lisais plus depuis longtemps. Ce qui reste tient dans une valise que je confie à un ami.
Je pique-nique dans le studio vide en attendant le propriétaire pour lui remettre les clés. Dans mon sac à dos, au milieu de quelques effets personnels, je glisse un paquet de cartes de visite imprimées en relief par un ami, l’adresse en sera obsolète dans une heure ; j'y glisse aussi trois livres, un guide de voyage, un roman de Luc Dietrich et un traité de yoga, pratique à laquelle je m’adonne depuis mon adolescence. Mon corps va m’amener, ou peut-être m’apporter, en Inde, je ne sais comment on doit dire. Mon esprit part aussi, mais qu’en est-il de l’âme ? Peut-être aurai-je une réponse là-bas.
La nuit dernière, j’ai rêvé d’un immense escalier en colimaçon, une spirale sans fin à l’image de la tour de Babel, dont le sommet – dit-on – atteint les cieux. Je n’ai d’autre choix que de gravir les marches sonores de cet escalier géant. En effet, chacune émet, lorsque je pose le pied, une note de musique cristalline. Je ressens en moi à la fois une assurance inébranlable et un sentiment de vertige, dans cette étrange position du voyageur aimanté par plus grand que lui, effrayé par le passage périlleux d’un pont dont il ne sait où il mène. Je quitte le connu pour aller vers l’inconnu, à moins que ce ne fût le contraire ?… Chaque marche, chaque étape, chaque arrêt sur mon chemin me guide vers des rencontres inattendues et de nouvelles surprises, parfois délicieuses, parfois étranges, parfois effroyables : l’exaltation joyeuse du nouveau, la douleur de la séparation, l’ombre noire de l’égarement, les promesses offertes au moment du plus grand découragement, les rencontres providentielles avec des êtres de sagesse ou de simples guides m’ouvrant les bonnes portes, les fausses pistes et les déceptions, les rêves, les contes et les mythes, et bien sûr le yoga immuable.
C’est alors que je décidai de partir et d’écrire le récit de ce voyage en Inde.
Il vient de là, ce récit, de ces pérégrinations dans les airs, du rythme lancinant des roues sur les rails, du tressaillement des bus sur les routes cahotantes, de la confusion tonitruante des villes, d’un monde peuplé d’odeurs subtiles, de lumières changeantes et de couleurs éclatantes, de l’empreinte de mes pieds sur la terre indienne, de ce mouvement incessant qui m’a guidé d’étape en étape, de ville en ville, de lieu en lieu. Il vient de là, d’ailleurs et de nulle part, il vient de ce voyage intérieur, dense, profond et mystérieux vers le centre de moi-même.
1. LE DÉPART
Nous sommes le 21 mai 1981, il est 19 heures. Un Iliouchine II-86 de la compagnie Aeroflot décolle de l’aéroport de Roissy. Il pleut. Je pars en Inde, c’est mon premier voyage vers ce continent inconnu.
Au même moment, onze jours après son élection, François Mitterrand, de retour à l’Élysée après la cérémonie qu’il a organisée au Panthéon le jour même, devient le vingt-et-unième président de la République française. La gauche fait son entrée dans l’Histoire de la Ve République.
Je laisse derrière moi une France en liesse et remplie d’espoirs, et je pars en Inde, seul. Je ne sais pas vraiment pourquoi je pars, sans doute pour m’évader et échapper à un quotidien trop monotone. Dans mes maigres bagages, des effets personnels réduits à l’essentiel, un guide de l’Inde, quelques notions de sanskrit, de yoga et un désir de nouveauté et de rencontres. Je me souviens d’avoir entendu dire que celui qui tombe dans la chaudière indienne n’en ressort jamais indemne.
Fidèle à sa réputation, Aeroflot n’offre aucun des services auxquels les passagers des autres compagnies sont habitués. Mais c’est le vol le moins cher que j’aie trouvé. L’avion qui me transporte de Paris à Dacca, capitale du Bangladesh, en passant par l’immense territoire soviétique, ressemble à un autocar robuste, rudimentaire et bruyant, muni de deux ailes et de quatre réacteurs.
Au milieu de la nuit, il atterrit pour une escale technique. C’est du moins ce que je suppose car on ne nous dit rien. La presse occidentale accuse depuis longtemps les autorités soviétiques de mentir à propos de l’autonomie de leurs avions de ligne, qui doivent faire le plein de kérosène bien plus souvent qu’elles ne l’admettent.
Nous descendons par une passerelle branlante sur le tarmac d’un aéroport inconnu : impossible de savoir de quel endroit il s’agit, aucune pancarte, aucun nom. D’après la douceur de l’air, nous ne sommes vraisemblablement pas en Sibérie.
Je m’adresse en anglais à mon voisin :
— Excusez-moi, savez-vous où nous sommes ?
Il ne comprend pas ce que je dis. Les passagers sont apparemment tous soviétiques, je remarque que certains d’entre eux portent des jeans flambant neufs de marque américaine. Je m’interroge sur les raisons qui les ont amenés sur cette liaison aérienne. Incapable de trouver une réponse logique, j’ai une suspicion : les passagers sont des membres du KGB. L’hypothèse est peu probable, mais j’ai ainsi une réponse.
À peine avons-nous posé pied à terre qu’on nous fait entrer dans un bâtiment de taille démesurée, plongé dans une obscurité presque totale. Les sources de lumière émanent de plusieurs veilleuses et d’une horloge lumineuse indiquant 4 heures. Une ambiance propice à la somnolence, d’autant plus que la fatigue me gagne. J’avance à tâtons et me laisse tomber dans un fauteuil, en essayant de ne pas sombrer dans le sommeil : j’ignore la durée de l’escale et ne voudrais pour rien au monde rater le redécollage.
Un battement rythmique et régulier comme une pulsation cardiaque secoue la structure métallique de mon siège. Les vibrations sonores proviennent d’une porte entrouverte dans le fond du bâtiment, d’où s’échappent des éclairs multicolores. En tendant l’oreille, je perçois le rythme d’une lointaine musique disco. Au comble de la surprise, je renonce toutefois à m’aventurer vers ce lieu : l’URSS et ses inconcevables boîtes de nuit perdues au milieu de nulle part ne m’intéressent pas, pas plus que le Bangladesh, ce sont juste des étapes pour atteindre l’Inde.
Un vrombissement me fait sursauter, c’est le bruit d’un avion en train d’atterrir. J’ai dû m’assoupir. Quelques instants plus tard, un groupe de passagers loquaces pénètre dans le hall plongé dans la pénombre. La musique de leur langue, chantante et fluide comme le ruissellement ininterrompu d’un cours d’eau, accapare joyeusement l’espace, transformant l’ambiance lugubre en air de fête. On dirait de l’italien. Puis vient le moment où le groupe s’engouffre vers la sortie pour regagner son avion. Le rude réalisme soviétique, sur un fond insolite de musique disco, refait alors surface.
Je me sens mal à l’aise. Je sais ce que je quitte – le connu, l’habitude, le tempo régulier d’une existence sans surprises –, mais je ne sais pas où je vais. Bien sûr, je pars en Inde, mais cet immense pays me semble encore tellement éloigné, presque inaccessible. L’étape du Bangladesh me rend soucieux. Je me sens dans un entre-deux inconfortable : entre hier et demain, entre ici et là-bas, coincé dans un présent figé et muet, dans un lieu sans âme, dans l’espace indéfinissable de l’attente, en transit entre moi et moi…
2. BANGLADESH
Au petit matin, nous atterrissons à Dacca. Nous descendons par la porte arrière de l’avion. La chaleur est tellement oppressante que je l’attribue tout d’abord aux réacteurs, mais elle persiste jusque dans l’aéroport. L’air est imprégné d’une odeur d’épices, de moisissure et d’urine. Je me dirige vers un guichet où un fonctionnaire moustachu tamponne deux fois de suite mon passeport. Puis je récupère mon sac de voyage et parcours le hall délabré à la recherche d’un bureau de change ouvert.
— Strike, me prévient un autre moustachu. Les banques sont en grève ! Vous pourrez peut-être changer vos traveller’s chèques au Radisson hotel, le plus grand hôtel de la ville.
Je quitte l’aéroport sans le moindre taka, la monnaie locale ; je négocie une longue course en vélo-rickshaw. Assis derrière cet homme qui s’épuise à pédaler pour m’amener à bon port, je me sens embarrassé et pris d’un sentiment de culpabilité que mon généreux pourboire ne parviendra pas à apaiser.
Nous arrivons devant l’élégante entrée du Radisson où vont et viennent des clients opulents, dont la mise soignée tranche avec l’apparence pauvre de la population locale. Le portier, habitué aux grosses berlines type Mercedes, contemple d’un air perplexe mon vélo-taxi qui m’attend patiemment. J’entre dans le hall luxueux et change juste assez d’argent pour régler ma course et subvenir à mes besoins jusqu’à mon entrée en Inde. Puis, grâce à mon chauffeur-cycliste, je déniche une chambre dans un établissement bien plus ordinaire que l’hôtel Radisson, près de la gare routière.
Après une nuit lourde et sans rêves, je parcours au matin la vaste gare routière de Dacca à la recherche du bus allant à Chilihari, la dernière ville au nord du pays. Grâce à mes notions de sanskrit, je déchiffre, non sans mal, le mot « Chilihari » sur l’avant d’un bus. Le nom des destinations est transcrit exclusivement en devanagari, cette belle écriture constituée d’un trait horizontal sous lequel s’accrochent à intervalles réguliers des symboles harmonieux aux courbes spiralées. La plupart des langues du nord de l’Inde utilisent cette écriture qui est aussi celle du sanskrit.
C’est à bord d’un vieux car brinquebalant que j’entreprends la traversée du pays. Une grande pauvreté règne à Dacca, mais dès la campagne la pauvreté se transforme en misère. Le choc est violent. Les silhouettes entraperçues sur le bord de la route sont faméliques ; la campagne aride, parsemée de hameaux tristes et sans vie, est sale et jaune de poussière.
À l’heure du déjeuner, le bus fait halte dans la gare routière d’une ville moyenne. Je descends à la recherche de quoi me sustenter, mais je ne trouve rien. Les rares boutiques sont vides : pas le moindre fruit, pas le moindre légume, pas même un malheureux paquet de biscuits.
— Êtes-vous de l’UNICEF ? s’inquiète dans un anglais approximatif un commerçant qui n’a rien à vendre, la présence d’un occidental ne pouvant qu’être liée à une ONG.
Je finis par tomber sur la seule denrée disponible, du thé au lait, dont je bois plusieurs tasses avidement.
La halte terminée, nous repartons. Je somnole pendant tout le trajet. Le bus s’arrête pour la nuit devant une auberge perdue en pleine campagne. Je m’endors dans une chambre remplie de vermine après avoir refusé l’inquiétante assiette de viande en sauce proposée aux autres voyageurs.
Le lendemain, au milieu de l’après-midi, le bus finit par atteindre Chilihari, tout au nord du pays. La route se termine sur une magnifique rizière d’un vert parfait. Je suis le dernier passager à m’être aventuré jusqu’au bout du monde.
Au terme d’un savant demi-tour, le bus s’éloigne dans un nuage de poussière et de fumée. Je ne suis cependant pas seul : assis à même le sol au bord de la rizière, un marchand propose, sur son étal, trois parapluies, dont un apparemment hors d’usage. Le soleil est intense, la chaleur étouffante, il ne pleuvra pas avant plusieurs semaines, lorsque arrivera la mousson. Je demande au marchand où se trouve la frontière avec l’Inde. Au son du mot « India », il désigne du doigt un bosquet touffu qui effleure l’horizon. J’achète le parapluie en toile noire pour me débarrasser des quelques pièces qui n’auront bientôt plus cours et je pars dans cette étincelante étendue verte, pieds nus dans l’eau tiède de la rizière. Au bout de quelques mètres, j’ouvre le parapluie pour éviter une insolation. De dos, je dois ressembler à un tableau inédit de Magritte ; ceci n’est pas moi.
Des masures disséminées se détachent sur le paysage. Ce n’est pas encore l’Inde, mais j’aperçois le poste-frontière du Bangladesh, dissimulé derrière les murs en pisé d’une maison que seul un drapeau distingue des autres cahutes.
J’entre. Des piles de dossiers poussiéreux posés à même le sol entourent la table minuscule et l’unique chaise de ce bureau improvisé. Un fonctionnaire est assis. Je me demande depuis combien de temps il attend ainsi, à quand remonte l’arrivée de son dernier migrant. Je ferme mon parapluie, il ouvre mon passeport et le lit de la dernière à la première page. Il relève la tête, soupçonneux, pour m’annoncer dans un anglais rudimentaire :
— Si vous sortez du pays, vous ne pourrez plus rentrer.
— Peu importe, je veux aller en Inde, c’est tout.
— Si je vous laisse passer, vous ne pourrez plus revenir au Bangladesh. Mais je doute que mes collègues indiens vous fassent entrer. Votre visa touristique indien ne permet pas de traverser cette frontière. Vous serez coincé dans la bande du no man’s land. Une seule solution : retourner à Dacca et prendre la route de Calcutta.
Le ton est impératif. Je suis soudain saisi d’effroi à l’idée de retourner en arrière et de parcourir une nouvelle fois ce pays sombre et misérable. La chaleur est tellement accablante que je n’envisage pas une seconde de faire demi-tour. Mon passeport bleu gît sur la table. Le fonctionnaire fixe le mur devant lui. Une grosse mouche vrombit dans la pièce confinée. J’attends. Le temps semble s’être arrêté. Au bout d’un moment, je décide inopinément de quitter le fonctionnaire, de tourner définitivement le dos au Bangladesh et de prendre le risque d’être refoulé en Inde.
Le territoire indien prend naissance de l’autre côté de la rizière. À cet endroit apparaît une route, non loin du bourg d’Haldibari. J’aperçois le poste frontalier, vers lequel je me dirige. J’interromps la sieste de cinq policiers frontaliers, visiblement mécontents d’être tirés de leur sommeil. La négociation commence mal. Je tends mon passeport à l’un d’entre eux, qui confirme :
— Votre visa n’est pas valable ici, la frontière est interdite aux étrangers, seuls les ressortissants du Bangladesh et les Indiens peuvent la traverser. Vous devez retourner au Bangladesh !
Le ton n’admet aucune réplique. Je suis tellement accablé par cette sentence et tellement anéanti par la chaleur que je ne montre aucune réaction. Découragé, je sors du poste et contemple la frontière bordant la rizière en me disant avec fatalité que c’est probablement là que je vais finir mon existence. Le temps s’écoule lentement. Tout autour de moi flamboie le vert translucide du paysage.
Soudain, une main se pose sur mon épaule. L’un des policiers, le plus jeune, me tend mon passeport que j’avais oublié. Juste avant de le ranger, je l’ouvre presque machinalement. À côté du visa indien est apposée la date de ce jour, suivie du nom « Haldibari » écrit à la main, et d’un tampon à l’encre rouge dont les bavures maculent la page. Je viens de recevoir, contre toute attente, l’autorisation de sauter enfin dans le chaudron indien.
3. HALDIBARI
Haldibari est une bourgade sans intérêt du Bengale-Occidental, dans le nord de l’Inde. À côté du Bangladesh, l’Inde paraît riche : les échoppes débordent de victuailles ; les gens, souriants, portent des vêtements colorés, les rues sont animées, les enfants jouent joyeusement.
Je parviens, en moins d’une heure, à changer quelques dollars en roupies dans l’unique banque de la ville. Je me rends dans le restaurant de l’hôtel populaire de la gare d’où je partirai en bus, le lendemain matin, et je mange, avec appétit, mon premier vrai repas depuis mon arrivée à Dacca.
Je savoure mon repos durant une nuit longue et chaude. Le lendemain matin, je cherche en vain le bus pour Darjeeling dans la gare routière écrasée par le soleil naissant. Je me dirige vers un homme assoupi qui semble être le préposé aux renseignements. J’explique que je veux me rendre à Darjeeling. L’homme esquisse un geste vague en direction de l’arrêt du bus fantôme et se rendort aussitôt. Je ne vois pourtant aucun véhicule. Quelques voyageurs attendent, comme moi, devant l’arrêt. Je ne sais combien de temps je reste là, sans rien faire.
Enfin, au bout d’un moment, j’entends une vibration lointaine : le bus miraculeux surgit au milieu d’un nuage de poussière. Les voyageurs saisissent leurs bagages et prennent le bus d’assaut. Je n’ai même pas le temps de distinguer l’engin béni qu’il est déjà bondé lorsque je tente de monter. Après un combat sans pitié entre les rares voyageurs qui s’empressent de descendre et la foule qui tente de dénicher une place, les personnes qui attendaient avec moi s’installent enfin, assises ou debout, dans le bus plein comme un œuf. Je regarde la scène de l’extérieur, médusé. À mes côtés, un chien, qui comme moi n’a pas participé à l’assaut, s’étire, se gratte et se rendort.
Ayant saisi les règles sommaires de ce jeu de chaises musicales, je monte comme une flèche dans le bus suivant et parviens miraculeusement à m’asseoir juste au-dessus de la zone peu convoitée des roues arrière. Le bus démarre aussitôt : je suis tellement ballotté que je n’ai même pas le loisir de m’enorgueillir de mon exploit. Chaque fois que la route se dérobe ou se replie en d’imprévisibles ornières, dos-d’âne, rigoles ou nids-de-poule, tous les passagers assis sur la même rangée que moi sursautent : nos fesses décollent des sièges comme si nous étions dans les montagnes russes d’une fête foraine. Je n’aperçois que le bas-côté de la route et me dis que c’est certainement mieux ainsi. Conscient plus que jamais de la fragilité de mon existence, j’ai terriblement hâte d’arriver à destination.
Une histoire me revient en mémoire : deux Indiens – un prêtre et un chauffeur de bus – arrivent, après leur mort, devant les portes du paradis. Le dieu Shiva les accueille. Il s’empresse de faire entrer le chauffeur et refuse l’accès au prêtre en lui expliquant : « Quand les fidèles entraient dans le temple où tu officiais, presque personne ne se recueillait, mais quand ils étaient dans le bus du chauffeur, tous les passagers priaient avec ferveur ! » Je me sens effectivement dans un état de prière permanent…
Un virage me précipite brusquement contre mon voisin de droite, le dernier de la rangée. C’est un vieil homme à la silhouette frêle, vêtu de la robe orange des renonçants, avec une longue barbe blanche qui auréole son visage d’une expression d’allégresse. Je marmonne une inintelligible excuse.
Le vieil homme me dit alors :
— La chance suprême du voyageur est de ne pas savoir où il va.
Cramponné à la banquette devant moi, j’apprécie la pertinence de sa remarque, absolument appropriée aux circonstances.
— Où allez-vous ?
Je ne comprends pas bien le sens de sa question : ne vient-il pas de proclamer comme une vérité universelle qu’un voyageur ne se soucie pas de la destination de son voyage ?
— Je vais à Darjeeling.
— Je descends bientôt, poursuit-il en se penchant vers moi, vous pourrez prendre ma place, c’est la meilleure.
Ses propos me semblent obscurs. Lisant la surprise sur mon visage, le vieil homme me raconte alors, dans un excellent anglais, son histoire :
« Il y a longtemps, très longtemps – c’était un jour béni –, j’étais assis dans un bus semblable à celui-ci, à cette même place, juste au-dessus de la roue arrière. Un moine tibétain était assis là où vous êtes. Enroulé dans un vêtement plus adapté à la rigueur de l’Himalaya qu’à notre climat indien, il suait à grosses gouttes. À cette époque, l’Inde accueillait déjà des réfugiés tibétains et les routes étaient beaucoup plus défoncées qu’elles ne le sont aujourd’hui.
Soudain, un terrible soubresaut me fit décoller de la banquette : il m’aurait lancé jusqu’au ciel si le toit du bus n’avait pas été solide ! En retombant brutalement sur mon siège, je poussai un cri de surprise. Le moine contempla ma réaction avec stupéfaction avant de s’exclamer que le son qui venait de s’échapper de ma bouche n’était autre que le « Om mani padme hûm », le mantra de Chènrézi.
Je lui avouai alors que je ne connaissais aucun mantra, et encore moins celui de Chènrézi, que mes préoccupations étaient très éloignées de la spiritualité et de la religion et que j’avais juste poussé un cri de stupeur. Bien qu’appartenant à une famille hindoue, les dieux ne m’intéressaient pas, je leur préférais le criquet. Mais le moine tibétain insistait, et répétait qu’il avait entendu distinctement sortir de ma bouche le « Om mani padme hûm ». Pour lui, cela ne faisait pas l’ombre d’un doute, c’était un signe.
Juste avant de descendre – il approchait de sa destination –, il me tendit un petit bout de papier sur lequel il avait griffonné en caractères tibétains, sanskrits et latins le mantra : « Om mani padme hûm ». « Ce mantra est sorti de votre bouche, faites-en bon usage », prédit-il en me quittant.
Je le regardai partir, puis j’examinai les différents alphabets dessinés sur le bout de papier traduisant chacun le mantra de la compassion.
À cette époque, comme je viens de le dire, j’ignorais que les mantras pouvaient être de véritables amulettes verbales et, à plus forte raison, que le mantra de Chènrézi récité par les Tibétains, « Om mani padme hûm », signifiait littéralement « Ô le joyau dans le lotus ». Je ne savais pas, à cette époque, que la flamme existe avant d’être allumée et qu’elle existe encore après avoir été éteinte. Et c’est seulement bien plus tard que je compris qu’une simple goutte de rosée peut glisser sur un pétale de lotus flottant sur un étang, puis s’immerger et se fondre dans les eaux, devenant alors l’étang tout entier. Comment le jeune hindou non pratiquant et profane que j’étais, aurait-il pu prononcer ce mantra ? Les paroles du lama, exprimées avec assurance et sincérité, m’avaient remué profondément. Mais j’écartai rapidement ces considérations et me rassurai en me disant – comme vous-même en ce moment, peut-être – qu’on rencontrait décidément de drôles de gens dans les bus !
Il faisait chaud, les soubresauts du véhicule me secouaient toujours avec la même vigueur, et le voyage s’éternisait. Sans même m’en rendre compte, je me mis alors à répéter silencieusement : « Om mani padme hûm, Om mani padme hûm, Om mani padme hûm ». J’en fus tout étonné. Cette récitation ressemblait à un jeu, à une simple ritournelle pour passer le temps. Puis, petit à petit, une douce ivresse m’envahit tandis que je répétais encore et encore : « Om mani padme hûm ». Je prononçai le mantra de la compassion peut-être mille fois et je trouvai Dieu assis à la place où vous êtes.
Dès lors, ma vie bascula : elle avait enfin un sens, et depuis ce jour, je savoure, instant après instant, le vrai sens de l’existence. Chaque fois que je voyage en bus, je m’arrange pour m’asseoir à cette même place, en souvenir de ce jour béni où le sursaut de mon âme me libéra à jamais de l’ordinaire et m’éloigna de l’ignorance. »
Au moment où le vieil homme vêtu de la robe orange termine son histoire, le coup de sifflet du contrôleur signale au bus de s’arrêter. L’homme se lève, passe devant moi en me souhaitant un bon voyage, puis descend du bus en me faisant un petit geste de la main : est-ce un signe d’adieu, ou le conseil de m’asseoir à sa place, juste au-dessus de la roue ? Je choisis la seconde option. J’aperçois alors sur le bord de la route la silhouette frêle et radieuse du vieil homme observant d’un sourire complice le bus redémarrer.
Déjà les creux et les bosses de l’asphalte s’impriment de manière saisissante dans tout mon être. Alangui par la chaleur, je me mets à rêver à ces trésors enfouis au fond de moi – peut-être tout le savoir du monde ? – que je suis venu chercher sur les routes de l’Inde, dans les âshrams, auprès des yogis et des maîtres. Je pense à tous ces joyaux invisibles, mystérieux et merveilleux, qui attendent patiemment le choc décisif qui les révélera, et qui se dévoilent sans doute lorsqu’on ne s’y attend pas, au détour d’un chemin, ou dans un bus cahotant au milieu de la campagne.
4. DARJEELING
Le bus me dépose à la gare de New Jalpaiguri à Siliguri. Je me sens comme je me suis toujours senti, rien d’extraordinaire ne m’est arrivé au cours de ce trajet, je n’ai pas atteint la délivrance… C’est probablement parce que je n’ai pas répété suffisamment de fois le mantra de Chènrézi, pensé-je en souriant intérieurement. Mais cette première rencontre inopinée – celle avec le renonçant féru de voyages en bus – est un signe : l’aventure indienne commence bel et bien. Il est vrai que je ne sais absolument pas où je vais, et les paroles du vieil homme me reviennent en mémoire : « La chance suprême du voyageur est de ne pas savoir où il va ». Ce que je sais, c’est que je vais à Darjeeling, mais pour quelles raisons ? Peut-être tout simplement parce que les sonorités de ce nom me fascinent depuis longtemps, qu’elles recouvrent pour moi une invitation profonde, envoûtante et mystérieuse.
Bien que le bus desserve Darjeeling, je décide de descendre à New Jalpaiguri pour poursuivre ma route en chemin de fer : c’est ici que démarre la longue ascension du petit train à crémaillère qui me mènera tranquillement à destination, du moins je l’espère. On dirait un gros jouet avec sa locomotive à vapeur et ses quatre petits wagons en bois.
Nous sommes trois passagers pour quatre cheminots. Notre convoi traverse une succession de minuscules villages, frôle les échoppes, croise et recroise la route principale, longe d’impressionnants précipices, et continue lentement et sûrement sa montée. Les deux autres passagers descendent en cours de route. Je me retrouve alors seul à bord de ce train qui grimpe si lentement qu’il finit par ne plus avancer. Les quatre employés s’activent autour de la locomotive d’où s’exhalent des volutes de vapeur. Je ne suis pas certain qu’ils pourront réparer rapidement.
Je saute alors du wagon et décide de poursuivre à pied par la route. Je m’essouffle, la brume laisse par instants apparaître un paysage grandiose. L’Inde de la plaine fait graduellement place à l’une des terres d’exil des Tibétains. La fraîcheur de l’air remplace la chaleur harassante, le froid n’est pas plus agréable que le chaud, l’Inde apprécie les extrêmes. De vertigineuses vallées foisonnant de magnolias, d’hibiscus et de rhododendrons apparaissent par éclairs puis tout redevient ouaté, moite et imprécis. Nappé de brume le monde est une splendeur.





























