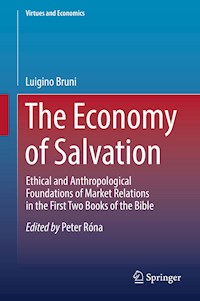Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nouvelle Cité
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Comment réhumaniser notre économie capitaliste ?
L’économie moderne, au moyen des contrats et du marché, évacue les relations personnelles directes. En garantissant une sécurité maximale, elle évite le contact avec les autres, qui est toujours source de blessures. Mais elle élimine aussi le bonheur de la rencontre avec l’autre. Un économiste napolitain du XVIII siècle, Antonio Genovesi, disait : « C’est une loi de l’univers que nous ne pouvons pas faire notre bonheur sans faire celui des autres. » Pour lui, la réciprocité – pas seulement la relation – est l’élément caractéristique de la socialité humaine. Il est illusoire de croire que la recherche de l’intérêt personnel est la seule chose qui compte et que , par une « main invisible », la satisfaction de l’ensemble des intérêts personnels contribue au bien commun. L’auteur développe les idées de Genovesi en expliquant un concept nouveau élaboré par des économistes contemporains : les biens relationnels et leur corollaire indispensable, la gratuité. Il revisite sur cette base l’idée de responsabilité sociale de l’entreprise, de bien commun et d’entreprise comme communauté. Il montre comment des expériences économiques ouverte sur la gratuité du rapport avec l’autre peuvent offrir une issue à la crise que nous traversons. Ainsi pourrait se développer une « économie civile », à la recherche d’une vie humaine et plus heureuse, sans nier les difficultés et le risque qu’une telle opération porte en soi.
Un regard novateur sur la place à donner aux relations humaines dans notre économie de marché.
EXTRAIT
Imaginez... une ville sans immeubles bruyants et sources de disputes, où chaque famille possède sa petite villa isolée acoustiquement et visuellement des autres, de telle façon qu’aucun voisin ne puisse déranger qui que ce soit ; une ville où les quelques gratte-ciel restés debout sont construits de façon à éviter toute rencontre dans les escaliers ou sur le palier ; une ville où, dans les bureaux ou sur son lieu de travail, on communique uniquement par mail ou par Skype pour les décisions les plus délicates ; une ville où tous les espaces autrefois communs, les places et les quartiers, ont été lotis et privatisés, où chacun défend et contrôle son morceau de territoire ; une ville où un simple mail nous permet de commander les courses qui sont livrées chez nous sans que nous ayons besoin de sortir et de perdre un temps précieux ; une ville où les médias sont devenus sophistiqués et interactifs, jusqu’à nous donner l’impression que nous sommes en compagnie de nombreuses personnes toute la journée, alors que nous passons de plus en plus d’heures seuls devant notre ordinateur ou devant la télévision
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Alimentant les sources anciennes de réflexions contemporaines sur les biens relationnels, Luigino Bruni poursuit sa démonstration pour souligner que le marché est bel et bien un terrain où peuvent coexister don et contrat, économie et société, intérêt individuel et relations humaines saines. -
Diane de Zélicourt, Revue Projet
À PROPOS DE L'AUTEUR
Luigino Bruni est Professeur d’économie à l’Université LUMSA de Rome et à l’Institut Universitaire Sophia. Historien de la pensée économique, il a publié sur le sujet de nombreux livres en italien et en anglais.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Bruni
La blessure
de la rencontre
L’économie au risque de la relation
Traduit de l’italien par Claire Perfumo
Préface de Pierre-Yves Gomez
postface de l’auteur pour l’édition française
Nouvelle Cité
Titre original : Luigino Bruni, La Ferita dell’altro, Economia e relazioni umane, © 2007 Casa editrice Il Margine, Via Taramelli, 8 – 38100 Trento
Le G.R.A.C.E (Groupe de Recherche Anthropologie Chrétienne et Entreprise) est un collectif de chercheurs qui désirent approfondir les connaissances sur l’entreprise à partir du point de vue anthropologique chrétien. Interdisciplinaire et interuniversitaire, il réunit des spécialistes en gestion, des économistes, des philosophes, des théologiens, des sociologues ou des anthropologues. L’entreprise est l’objet d’étude qui fait converger ces différents regards pour comprendre comment l’homme travaille, échange et organise.
La collection du G.R.A.C.E. publie des recherches innovantes ou des essais qui participent au débat public afin de voir l’économie à hauteur d’homme. Elle est dirigée par Pierre-Yves Gomez.
Composition : Pauline Wallet
Couverture : Laure d’Amécourt
Illustrations de couverture :
p. 1, © photo Istock
p. 4, portrait de l’auteur, D.R.
© Nouvelle Cité 2014, pour l’édition papier
© Nouvelle Cité, 2015 pour l’édition numérique.
Domaine d’Arny – 91680 Bruyères-le-Châtel
ISBN de l’édition papier : 978-2-85313-738-6
ISBN de l’édition numérique : 978-2-85313-972-4
Sommaire
Préface
Introduction
Chapitre 1
L’ange et l’autre
1. La grande ambivalence de la vie en commun
2. La communauté tragique
3. La médiation de l’Absolu
4. La découverte du « tu » : l’ange devient l’autre
Chapitre 2
L’économie politique moderne, une science où la gratuité n’existe pas
1. Le « péché originel » d’Adam […Smith]
2. L’économie sans « bienfaisance »
3. Réciprocité
Chapitre 3
Quelle responsabilité pour l’entreprise ? Entre immunitas et communitas
1. Économie moderne, marché et entreprise : un unique processus immunitaire
2. Marché et hiérarchie
3. Une cohérence au-delà des oppositions
4. Une autre conception de la responsabilité communautaire
5. Du marché à l’entreprise et de l’entreprise au marché
6. Conclusion
Chapitre 4
Éros, philìaetagapè
1. Économie et gratuité
2. L’amour humain, un et multiple
3. Éros, philìa et bien commun
4. Le bien commun comme auto-tromperie
5. Au-delà d’une économie « érotique »
6. Conclusion
Chapitre 5
« L’économie sans joie »
1. En guise d’introduction
2. Le « bonheur public » et l’économie civile chez Antonio Genovesi
3. Relations et bien-être
4. Pourquoi sommes-nous moins heureux que nous ne pourrions l’être ?
5. Le paradoxe de l’absence de bonheur dans l’opulence
6. Un jugement critique sur le débat autour de l’économie et du bonheur
Chapitre 6
Les relations en tant que biens
1. Les relations, les biens que l’économie traditionnelle ne réussit pas à voir
2. Les biens relationnels
3. Relations primaires et secondaires
4. « L’enfer, c’est les autres »
Chapitre 7
Le sens économique et civil des charismes
1. Un regard différent
2. Charismes et innovation
3. Charis ou « ce qui apporte de la joie »
Conclusion L’étreinte de l’autre
Postface de l’auteur pour l’édition française
1. L’éthique des vertus
2. L’économie civile
3. Charismes, gratuité et grâce
Bibliographie
Fin
Préface
« Il y a eu la tradition française, fondamentalement anticapitaliste et opposée au marché, et la tradition italienne. Celle-ci, qui s’inscrivait dans la continuité de la tradition de l’économie civile et suivait la pensée de son contemporain John Stuart Mill et des économistes anglais tels que John Elliot Cairnes, était, quant à elle, plus favorable au marché, qu’elle voyait comme un lieu d’exercice des vertus civiles. »
Cette affirmation de Luigino Bruni résume admirablement l’intérêt que trouvera le lecteur à la découverte de l’ouvrage que nous avons la chance de découvrir aujourd’hui en langue française.
D’abord il donne l’occasion d’élargir notre horizon culturel grâce à l’un des meilleurs connaisseurs italiens de l’histoire de la pensée économique. Luigino Bruni travaille depuis de longues années à comprendre comment une certaine conception de l’économie capitaliste de marché a émergé dans la modernité européenne, et comment elle a imposé avec elle sa conception de l’homme en société. La large culture de l’auteur embrasse l’Europe et notamment l’Angleterre dont il analyse les pères fondateurs du libéralisme, de Locke à Smith, mais aussi la France qu’il connaît bien et dont il maîtrise la langue.
Mais, c’est, d’abord, par son point de vue italien que sa réflexion aiguise l’intérêt. Car il puise dans des auteurs et des écoles de pensée qui, pour être généralement inconnus du public français, sont indispensables pour comprendre pleinement la modernité européenne. Il nous invite en particulier à découvrir la grande école napolitaine du xviiie siècle avec Giambattista Vico, le plus célèbre de ses penseurs, mais aussi Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri ou Giacinto Dragonetti, moins connus mais qui participèrent à l’élaboration d’une réflexion philosophique et économique originale dans le grand bouillonnement du siècle des Lumières.
C’est donc d’abord à cette confrontation culturelle que le lecteur est appelé, non que Luigino Bruni nous soit totalement étranger, mais parce que, quelle que soit l’étendue de sa culture, il nous parle de l’économie d’un point de vue italien, dans la tradition et avec les références d’un Italien. Pour un Français qui a trop souvent la faiblesse de croire que son point de vue est universel, ce décalage culturel introduit un dialogue intrigant avec les concepts, les représentations et les points de vue qui nous sont habituels.
Mais il y a plus, bien sûr. Luigino Bruni nous montre l’opposition entre les traditions d’économie politique italienne et française. Cette dernière se présente volontiers comme anti-capitaliste et opposée à « l’économie de marché ». N’est-il pas remarquable de constater que les plus illustres tenants du libéralisme économique, parmi lesquels Jean-Baptiste Say ou Frédéric Bastiat, sont des Français, mais qu’ils ne connaissent pas en France la gloire qui est la leur par exemple dans les pays anglo-saxons ? Par une évolution qui mériterait sans doute à elle seule un ouvrage, la tradition de l’économie politique française s’est de plus en plus affirmée en opposition critique avec l’économie libérale moderne. Il en a résulté des ambiguïtés et des contradictions comme par exemple la manière dont les Français considèrent le marché, à la fois honni comme espace de régulation sociale et revendiqué comme instrument de liberté privée.
Luigino Bruni nous montre que la tradition italienne a suivi une autre voie dès l’origine, notamment avec l’école dite de l’économie civile. Au tournant du xive siècle, lorsque le vieil ordre médiéval faisait place à la société moderne, l’Italie a connu une brève période d’humanisme civil, particulièrement à Florence, caractérisée par l’apparition de cités libres et, avec elle, par une intense réflexion politique pour penser les nouvelles libertés publiques et privées. Si cet humanisme n’a jamais pu fonder une nouvelle société politique, il a fortement influencé la culture italienne en lui permettant de considérer la société moderne et notamment l’économie, non pas en rupture radicale avec la période médiévale, mais comme son développement naturel et même son accomplissement.
Cela nécessite quelques précisions tant le public français est habitué à penser la période moderne en opposition totale avec le Moyen Âge et la culture judéo-chrétienne qui prévalait alors. Pour nous, la Révolution de 1789 marque une division franche de l’histoire entre un « avant » et un « après » : un « avant » de ténèbres religieuses et féodales, un « après » de lumières scientifique et démocratique. Nous sommes si formatés par cette leçon, apprise dès le plus jeune âge dans les écoles, que nous la croyons universelle. Or, elle n’est que française. La plupart des pays n’ont pas connu une évolution brutale, qu’elle soit réelle ou mythique. Tel est le cas de l’Italie. Le passage de la société médiévale à la société moderne a été graduel, donnant lieu à de nombreuses expériences à la fois politiques et sociales, depuis le mouvement franciscain, l’humanisme civil toscan déjà nommé, jusqu’aux foyers intellectuels à Naples ou à Milan qui ont cherché à comprendre l’esprit moderne, davantage centré sur l’individu que sur la communauté, sur la raison que sur la foi, comme la poursuite et l’enrichissement de l’esprit médiéval.
L’école de « l’économie civile », particulièrement florissante à Naples au xviiie siècle, a contribué à ce mouvement : elle a cherché à comprendre comment les nouvelles données de l’économie comme le marché ou l’entreprise, loin de détruire les fondements de la société, permettent au contraire d’affirmer davantage les vertus humanistes, notamment judéo-chrétiennes, qui étaient celles de la société médiévale. Pas de rupture donc mais le besoin d’inclure les innovations sociales, économiques et politiques du siècle des Lumières dans une continuité historique.
Tel est donc le deuxième profit que le lecteur français peut tirer à la lecture de l’ouvrage de Luigino Bruni. Découvrir que l’économie de marché et de l’entreprise ne nous place pas nécessairement devant l’alternative de l’accepter comme telle ou de la rejeter en bloc, mais que l’on peut aussi considérer le marché et l’entreprise comme des moyens de développer l’être humain, les relations sociales et le bien commun. Des moyens et non des fins, précisément parce que le véritable sujet qui fait la continuité historique, selon Luigino Bruni, ce n’est pas l’économie, c’est la personne humaine qui participe – et qui participe depuis toujours – à l’économie. Dès lors, avec les tenants de l’économie civile, il cherche à établir les conditions qui font du marché ou de l’entreprise des outils au service du développement de la personne et non de son asservissement.
Et c’est ainsi que la tradition italienne de l’économie civile a été dès l’origine « favorable au marché, qu’elle voyait comme un lieu d’exercice des vertus civiles ». L’affirmation est décisive. Car, selon elle, ce sont les vertus civiles c’est-à-dire les vertus nécessaires à la vie en société, qui peuvent s’épanouir par un usage approprié de l’économie, de l’entreprise et du marché. Les vertus humaines ne se dissolvent donc pas dans l’économie, elles y trouvent au contraire le lieu favorable pour se manifester.
On voit ici la grande différence avec la tradition française. Parce que celle-ci a pensé la modernité comme une rupture, elle a considéré l’économie du marché et de l’entreprise comme une nouveauté radicale qui s’opposait non seulement à la manière prémoderne de se représenter la personne humaine, mais aussi à toute forme d’« humanisme ». D’où une séparation franche, dans notre culture, entre la culture politique et la culture économique. Le marché et l’entreprise sont vus comme des espaces sociaux contre l’espace politique.
Il est bon de découvrir à travers le livre de Luigino Bruni que cette manière de penser n’est pas universelle et que l’on peut aussi considérer que, tout au contraire, le marché et l’entreprise sont inclus dans un espace politique plus vaste, puisqu’ils sont eux-mêmes des lieux (parmi d’autres) de mise en œuvre des vertus civiles.
Encore faut-il que certaines conditions soient remplies quant à une juste représentation des relations économiques. Luigino Bruni propose une remarquable réflexion sur la nature réelle de l’économie de marché et de l’économie d’entreprise dans une thèse stimulante qui est le cœur de son livre. En revenant aux pères fondateurs et notamment à Adam Smith, il montre comment des erreurs d’interprétation ont pu être commises, dès l’origine, sur la nature de l’homme. La principale de ces erreurs a concerné la définition de la liberté. Dès le xviie siècle, la liberté individuelle a été vue comme limitée par la liberté des autres individus. L’individualisme moderne a donné à chacun un potentiel d’autonomie quasiment infini mais qui était, par définition, limité par le potentiel infini… des autres individus. Tout le drame de la modernité est là : arriver à concevoir et à réaliser une société qui affirme une liberté individuelle qui est immédiatement contredite par la liberté des autres. L’autre est présenté comme un obstacle à la réalisation de soi. On retrouve ici l’une des intuitions majeures de René Girard.
Or si chacun considère que l’autre est une contrainte pour la réalisation de sa propre liberté, il en résulte une société et, en particulier, une économie où se généralise ce que Hobbes a appelé « la guerre de tous contre tous » : contraintes, concurrence, compétition. C’est contre les autres qu’il faut arracher son espace de liberté. Plus la promesse de liberté s’impose, plus grandit le sentiment qu’elle est entravée. Plus on doit se battre pour l’affirmer. Nous agissons en nous heurtant, l’autre nous agresse et nous blesse (La Blessure dela rencontre, comme le dit le titre de ce livre).
En conséquence, cette forme de libéralisme a dû définir des processus de régulation collectifs pour qu’une telle société fonctionne. Et c’est ainsi que le marché, loin d’être le lieu d’exercice des vertus civiles, est devenu une sorte de Léviathan, qui impose des lois et des pratiques pour coordonner la société et la rendre viable malgré les blessures que s’infligent ses membres. Il le fait en imposant la concurrence comme un bienfait et la compétition comme un idéal, faisant ainsi de la « blessure de la rencontre », la mécanique des relations sociales. Triste société.
On voit que Luigino Bruni et les tenants de l’économie civile sont à l’opposé des libéraux ou des partisans idolâtriques de l’économie de marché comme on en trouve en France (par réaction excessive à la doxa anti-marché dont nous avons parlé). Pour Bruni, l’économie de marché peut être un milieu propice au développement des vertus civiles et à la civilisation, mais à la condition que le marché soit bien compris et donc qu’en amont, la personne humaine et sa liberté soient bien définies.
C’est ce que la deuxième partie de l’ouvrage s’efforce de montrer : une juste considération de la personne humaine doit tenir compte du rôle que jouent la gratuité, le don et la réciprocité dans les relations interindividuelles. La liberté n’est pas limitée par celle d’autrui. Au contraire, elle peut être augmentée par elle, si on considère que la capacité à donner est au fondement même de la liberté individuelle. Est vraiment libre celui qui se met en situation de donner. Si la liberté grandit avec le don, c’est une économie de l’échange et de la réciprocité qui se dessine dont le marché, avec ses règles d’échange propres, est un cas particulier.
Y compris dans l’ordre économique, nous entrons en relation les uns avec les autres non pas parce que nous sommes mus par une absurde liberté autocentrée qui exclurait les autres, mais au contraire, par notre capacité à donner et à recevoir dont l’échange marchand est une des modalités. L’autre n’inflige pas une blessure mais invite à une rencontre – ou plutôt cette blessure est une rencontre. Il est alors tout naturel de conclure que le marché peut être le lieu de réalisation des vertus civiles puisque l’homme n’est pas une entité autonome autocentrée mais un être de relations et donc, d’une manière particulière, de relations économiques.
Telle est donc la grande thèse dans ce livre qui, tout en s’inscrivant dans la tradition italienne, interpelle l’universel. Luigino Bruni n’oppose pas la société économique moderne à une « autre société », il oppose l’économie réaliste, fondée sur une anthropologie correcte, à une économie libérale caricaturale parce qu’elle caricature l’homme qu’elle est censée libérer.
Pour cela, il puise dans l’héritage judéo-chrétien et en particulier très directement dans la pensée sociale de l’Église. Pour nous, Français, il y a là encore matière à élargir nos horizons. Un lieu commun veut que, chez nous, une réflexion n’est recevable que si elle fait abstraction de ses fondements spirituels ou religieux. À y regarder de près c’est absurde puisque, d’une part, les fondements religieux produisent de la réflexion et que, d’autre part, notre culture est puissamment pétrie par la tradition chrétienne. Ne pas en tenir compte c’est se couper de sources abondantes. Luigino Bruni n’a pas nos inhibitions culturelles. Il cite aussi bien John Locke que Benoît XVI, et puise autant dans les derniers concepts de l’économie comportementale que dans la définition tripartite de l’amour, telle que la propose la philosophie chrétienne classique, en Éros, Philìa et Agapè. Cet usage de la pensée sociale de l’Église ne se présente jamais comme idéologique ou apologétique, mais tout simplement comme un corpus intellectuel utile à la démonstration.
On pourra critiquer des points de détail et des affirmations dans cet ouvrage. On pourra aussi débattre de sa thèse. Tant mieux. Ce livre est publié pour cela et il nous invite à le faire. Mais on ne pourra pas nier que Luigino Bruni renouvelle avec force et rigueur les représentations courantes que nous pouvons avoir de l’économie de marché et de l’économie tout court. C’est pourquoi j’espère que le lecteur sera aussi heureux que moi de le travailler, crayon en main.
Pierre-Yves Gomez
Professeur à l’EM Lyon Business School
Directeur de l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises
Mai 2014
Je dédie ce livre à Chantal et José ainsi qu’aux entrepreneurs français engagés dans l’économie de communion. Durant toutes ces années, ils m’ont montré un visage merveilleux de la France, m’ont offert leur amitié et, surtout, ils ont beaucoup aimé les pauvres.
Cette même nuit, il [Jacob] se leva […] et passa le gué du fleuve Yabboq. […] Jacob resta seul. Et quelqu’un lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l’emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. Il dit : « Lâche-moi, car l’aurore est levée », mais Jacob répondit : « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m’aies béni. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Jacob », répondit-il. Il reprit : « On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l’as emporté. » Jacob fit cette demande : « Révèle-moi ton nom, je te prie », mais il répondit : « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et, là même, il le bénit.
(Genèse 32,23-30)
Introduction
Imaginez… une ville sans immeubles bruyants et sources de disputes, où chaque famille possède sa petite villa isolée acoustiquement et visuellement des autres, de telle façon qu’aucun voisin ne puisse déranger qui que ce soit ; une ville où les quelques gratte-ciel restés debout sont construits de façon à éviter toute rencontre dans les escaliers ou sur le palier ; une ville où, dans les bureaux ou sur son lieu de travail, on communique uniquement par mail ou par Skype pour les décisions les plus délicates ; une ville où tous les espaces autrefois communs, les places et les quartiers, ont été lotis et privatisés, où chacun défend et contrôle son morceau de territoire ; une ville où un simple mail nous permet de commander les courses qui sont livrées chez nous sans que nous ayons besoin de sortir et de perdre un temps précieux ; une ville où les médias sont devenus sophistiqués et interactifs, jusqu’à nous donner l’impression que nous sommes en compagnie de nombreuses personnes toute la journée, alors que nous passons de plus en plus d’heures seuls devant notre ordinateur ou devant la télévision. Nous assistons même à nos cours magistraux chez nous par internet, grâce à des professeurs virtuels très compétents qui nous suivent personnellement depuis n’importe quelle partie du monde, sans que nous ayons besoin de nous rencontrer face à face.
Une ville « idéale ». En effet, les conflits ont été éliminés parce que la condition préliminaire du conflit, la vie sur une terre commune, une communitas, n’existe plus.
Aimeriez-vous vivre dans une telle ville ? Je vous souhaite que ce soit le cas, parce que cette scène stylisée ressemble beaucoup à la situation réelle qui se profile dans les villes que nous imaginons et projetons dans nos sociétés de marché. Marché : oui, parce que le marché et sa logique sont bien ce qui détermine le plus ce scénario.
Ce livre se propose d’apporter quelques explications sur la raison pour laquelle un tel cadre se profile actuellement, mais également d’offrir quelques pistes de réflexion à ceux qui, comme moi, sont très préoccupés par une telle perspective.
Ce texte part d’une image et d’une intuition. L’image, c’est le combat de Jacob contre l’ange, évoqué dans la Genèse. L’intuition qui y est associée, c’est le lien indissoluble, présent au sein de toute relation humaine authentique, entre « blessure » et « bénédiction ».
Tôt ou tard, toute personne fait une expérience qui marque le début de sa pleine maturité : elle comprend dans sa propre chair et grâce à son intelligence que, si elle veut expérimenter la bénédiction engendrée par sa relation avec l’autre, elle doit accepter la blessure qui en découle. Autrement dit, cette personne comprend que l’on ne peut mener une vie bonne sans traverser le territoire obscur et dangereux de l’autre et que, lorsque l’on cherche à échapper à ce « combat » et à cette angoisse, cela nous mène inévitablement à une condition humaine sans joie. Dans un certain sens, l’idée qui se trouve à l’origine de ce livre se trouve entièrement résumée ici. Ce livre se propose de faire dialoguer l’économie avec ce « combat », avec la blessure et la bénédiction de la rencontre avec l’autre.
Pourquoi tenter ce dialogue ?
En cette fin d’époque moderne, la science économique, avec sa promesse d’une vie en commun sans sacrifices, représente un moyen efficace de fuir la contagion de la relation personnelle avec l’autre. C’est précisément pour cette raison que l’humanisme de l’économie de marché, qui a pourtant engendré de grandes réussites en matière de civilisation, figure parmi les grands responsables (bien qu’il ne soit pas le seul ; on pourrait également citer la technologie 1) de la dérive triste et solitaire des sociétés modernes de marché. Une condition humaine sans joie, qui repose entre autres sur une grande illusion : le marché, représenté par l’entreprise bureaucratique et hiérarchique, serait capable de nous faire vivre en commun sans douleur ; il nous permettrait de rencontrer un autre qui ne nous blesse pas, qui ne nous combatte pas mais échange simplement avec nous, de façon inoffensive. Et, en effet, nous nous « rencontrons » de plus en plus de cette façon sur les marchés postmodernes où règne l’anonymat. Mais peut-être sommes-nous en train de sortir du territoire de l’humain, s’il est exact que l’humain commence par la gratuité, qu’il s’agit toujours d’une expérience de relations interhumaines risquées et, par conséquent, potentiellement douloureuses.
Pourtant, et c’est là l’erreur, cette rencontre inoffensive avec l’autre, qui n’occasionne aucune blessure, est aussi une rencontre qui ne nous permet pas de vivre une vie pleinement humaine, pour la personne comme pour la société, ainsi que le démontrent avec force les études récentes sur les « paradoxes du bonheur », et comme nous aurons l’occasion de le voir dans la dernière partie de cet essai. En effet, aujourd’hui nous payons cette grande illusion de la modernité avec la monnaie du bonheur, et il est temps de dénoncer ce grand bluff.
C’est sur ce ton un peu dur que j’ouvre ce livre, qui n’a cependant pas été écrit par un pessimiste, ni par un ennemi des marchés et de la société contemporaine, ni même par un nostalgique des vieilles communautés prémodernes. Le regard que je porte sur le monde que j’essaie de décrire se veut en réalité étendu et positif ; il veut être le regard du fidèle compagnon de voyage des protagonistes (économistes compris) des histoires qu’il raconte. Les pages qui suivent ne sont qu’une tentative de comprendre certaines dynamiques moins visibles des causes de la crise historique que nous traversons actuellement (et qui est une crise essentiellement relationnelle), mais aussi d’ébaucher un discours qui redonne des raisons d’espérer, une espérance dont je souhaite qu’elle soit la dominante de tout cet essai.
Le fil conducteur qui le parcourt est donc une réflexion d’ensemble sur les relations humaines, notamment sur les relations horizontales face-à-face (j’évoquerai très brièvement les relations asymétriques de pouvoir). Comme nous le verrons, dans cette vaste gamme des relations humaines, l’économie s’est concentrée essentiellement sur une seule forme, que l’on peut assimiler à l’éros, négligeant la philìa (l’amitié) et laissant totalement de côté l’agapè, la relation axée sur la gratuité, et ce en raison de la charge potentielle de souffrance que l’agapè porte en elle et qui est due à l’impossibilité de la contrôler entièrement. La subdivision classique de l’amour humain en éros, philìa et agapè sera, et ce n’est pas un hasard, un autre sujet dominant, une autre clé de lecture pour les pages qui suivent.
Je tiens encore à souligner une chose : ce livre ne contient aucun appel à combattre les marchés ou à construire une société sans marchés. À travers ces pages, j’essaie plutôt de fournir quelques raisons valables pour justifier l’importance et l’urgence de rencontrer l’autre et la communitas dans leur mystère dramatique, sans nous replonger pour autant, je le répète, dans un monde prémoderne et sans marchés, ou bien dans une des nombreuses formes revêtues aujourd’hui par le « communautarisme ». En effet, l’histoire humaine nous montre que, là où le marché n’arrive pas, en général ce n’est pas l’amour réciproque qui prend sa place ; dans les grandes communautés notamment, les rapports de force, au sein desquels le plus fort exploite le plus faible, viennent souvent combler le vide du contrat. Sur le marché aussi, on trouve des forts et des faibles, mais ils sont souvent faciles à reconnaître et l’on peut essayer de dépasser les asymétries. J’ai la conviction qu’une société sans marchés ni contrats n’est pas une société décente ; cependant, une société qui recourt uniquement aux marchés et aux contrats pour définir les relations humaines l’est encore moins. Une grande partie du propos que nous développerons dans cet essai évolue sur le terrain situé entre ce « sans » et ce « uniquement ».
Le marché, cette « zone franche » où nous pouvons nous rencontrer sans sacrifices, de façon indirecte et avantageuse pour les uns comme pour les autres, est à la fois une conquête de la civilisation et un instrument de civilisation. Parfois, il peut même s’allier à la gratuité afin de permettre une coexistence humaine plus libre et plus fraternelle. Les nombreuses expériences d’économie sociale, civile et de communion, d’hier et d’aujourd’hui, ne nous enseignent pas autre chose : le marché peut devenir un lieu de vraie rencontre avec l’autre et un lieu de bénédiction, pourvu qu’il s’ouvre à la gratuité et ne fuie pas devant la blessure de la rencontre.
Enfin, même si, dans cet essai, nous mettrons en lumière en premier lieu les aspects problématiques liés à la « tiercité » de la médiation, il ne faut pas oublier que les médiations peuvent jouer un rôle civil : la protection face à la blessure de la rencontre, assurée par le système indirect et décentralisé des prix, mais aussi par la médiation de la loi, peut même jouer un rôle positif et civilisateur, en particulier au sein des sociétés où le marché est peu développé et où l’égalité et la liberté sont constamment en danger. Il existe pourtant un point critique, un seuil à ne pas franchir, sans quoi les relations anonymes sur les marchés engendrent le désordre, la solitude et une perte des liens identitaires. Selon moi, les sociétés occidentales, qui vivent dans l’opulence, ont déjà franchi ce seuil, qui délimite également le territoire de l’humain.
C’est la thèse que nous tenterons de discuter et de défendre dans les pages qui suivent, en la déclinant sous diverses formes au fil des chapitres.
Les mots qui nous serviront à construire ce dialogue et qui puiseront dans divers registres linguistiques et théoriques, sont nombreux mais dans une certaine mesure complémentaires : fraternité, réciprocité, gratuité, responsabilité, amour, bonheur. La théorie et l’histoire seront nos principaux outils de travail pour construire le propos que nous allons entamer et dont je souhaite qu’il soit surtout un discours fondateur.
Juin 2007
(1) J’ai la conviction que l’on pourrait raconter une histoire très semblable à celle qui fait l’objet de ce livre si nous examinions la technologie en tant que médiateur des relations personnelles je-tu.
Chapitre 1
L’ange et l’autre
Ours is not mine 2.
(proverbe africain)
1. La grande ambivalence de la vie en commun
Nous partirons d’une phrase de l’anthropologue et philosophe Tzvetan Todorov : « Si l’on prend connaissance des grands courants de la pensée philosophique européenne concernant la définition de ce qui est humain, une conclusion curieuse se dégage : la dimension sociale, le fait de la vie en commun, n’est généralement pas conçue comme étant nécessaire à l’homme. Cette “thèse” ne se présente cependant pas comme telle ; elle est plutôt un présupposé qui reste non formulé […] » (1995, p. 15).
En effet, la tradition culturelle moderne envisage la dimension sociale et relationnelle de la vie humaine comme un élément réel ou existentiel (on ne vit pas seul), mais la socialité, à savoir, les relations interpersonnelles, représente fondamentalement un problème, un mal nécessaire : l’autre est d’abord « blessure » et, par conséquent, une chose à éviter dans la mesure du possible. L’homme moderne passe à côté de la « bénédiction » associée à cette blessure, à cette « rencontre-combat ». C’est pour cette raison que l’on essaie d’éviter l’autre et que l’on recherche la beata solitudo 3.
En réalité, ce processus culturel commence avec l’avènement de l’humanisme, notamment à partir de la seconde moitié du xve siècle, lorsque, une fois fermée la parenthèse de l’humanisme civil (un phénomène culturel important en Italie centrale), la culture européenne redécouvre avec émerveillement la tradition néoplatonicienne et réaffirme l’idéal de la fuite hors de la cité, loin des autres hommes, afin de mener une vie heureuse. Jean Pic de la Mirandole, Marsile Ficin et beaucoup d’autres penseurs se font les protagonistes d’un « second » humanisme ; celui-ci, loin de développer l’âme civile qui avait caractérisé l’expérience des communes et des nouvelles formes de communauté fraternelle au sein des ordres mendiants apparus aux xiiie et xive siècles (il suffit de penser au franciscanisme), désigne la solitude comme la recette infaillible et exempte de risques pour être heureux. Les fresques du Bon gouvernement, peintes par Ambrogio Lorenzetti, tout comme les fresques civiles de Santa Maria della Scala à Sienne, laissent la part belle aux représentations mythologiques, rurales et épicuriennes des villas médicéennes du xvie siècle. À partir de la Renaissance, la vie dans la cité et l’engagement civil et économique ne sont plus des lieux de vie bonne, mais sont peu à peu considérés comme des activités secondaires auxquelles le « bon chrétien » ne doit pas se consacrer. Le xviie siècle voit une accentuation de ce processus. Celui-ci s’accompagne d’une nouvelle féodalisation de l’Europe (en particulier de l’Europe méridionale), qui place au centre de la hiérarchie sociale la possession de terres, de titres de noblesse et de statuts liés à cette hiérarchie (comtes, barons, ducs, marquis…) 4, ce qui jette le discrédit sur la valeur sociale de la vie civile et économique 5.
L’apogée de la littérature sur les utopies et sur l’« État parfait », aux xvie et xviie siècles, doit lui aussi être interprété comme un élément s’inscrivant dans ce même processus. Cette littérature acquiert une importance particulière au cours de la période qui va du déclin de l’humanisme à la naissance de l’économie politique, dans la seconde moitié du xviiie siècle. Une période marquée par les désillusions et le pessimisme, qui pousse à rêver de sociétés et d’États idéaux pour fuir les réalités politiques qui étaient tout sauf idéales, mais aussi en réaction à la pensée individualiste et asociale du second humanisme.
La « cité heureuse » est une expression que l’on voit apparaître dans les titres de certaines œuvres de ces auteurs (Anton Francesco Doni et Francesco Patrizi, par exemple). Pourtant ces cités se résument désormais à des descriptions de réalités lointaines et imaginaires, à un espoir déçu : « Au moment même où se fait plus sévèreet plus dur le sentiment que la société humaine estdivisée et tourmentée, le besoin d’une cité pacifiée et sereinedevient plus vif et plus fort. Même une fois passéel’illusion, chère au premier humanisme, de pouvoir faire coexister lesdeux cités, réelle et idéale, la réalité de l’une necesse pas pour autant de renvoyer à l’idéalité de l’autre » (Eugenio Garin, 1988, pp. 93-94).
Il se crée alors une fracture entre l’humanisme civil et la modernité. La Renaissance représente « une aube inachevée », pour reprendre l’expression très parlante d’Henri de Lubac. L’expérience de vie civile des villes italiennes ne s’impose pas dans la culture de la Renaissance, une période caractérisée plutôt par des luttes et des guerres sans merci entre factions. La réflexion sur la vie civile s’est en effet révélée trop fragile pour résister aux attaques de la réalité de l’histoire, marquée par les guerres civiles et l’incivilité.
L’œuvre de Nicolas Machiavel doit être replacée dans ce contexte. Sur le plan des idées politiques et civiles, sa pensée est très représentative de cette période de la culture européenne. Chez Nicolas Machiavel et, plus tard, chez Thomas Hobbes, l’individu est mauvais, peureux, incivil et rusé, des mots qui passèrent par la suite dans le vocabulaire de l’anthropologie moderne 6. Car, au cœur de la théorie politique de Machiavel, on relève un très grand pessimisme anthropologique ayant entre autres pour origine les événements historiques dont il était témoin en Italie, et qui imprègne et explique toute son œuvre :
Car on peut dire généralement une chose de tous les hommes : qu’ils sont ingrats, changeants, dissimulés, ennemis du danger, avides de gagner ; tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi, leur sang, ils t’offrent leur sang, leurs biens, leur vie et leurs enfants, […] quand le besoin est futur ; mais quand il approche, ils se dérobent (1952 [1513], Le Prince, XVII, p. 339).
Si l’être humain est vraiment ainsi, alors la vie en commun ne peut se fonder que sur la crainte et non sur l’amour :
« Les hommes hésitent moins à nuire à un homme qui se fait aimer qu’à un autre qui se fait redouter ; car l’amour se maintient par un lien d’obligations lequel, parce que les hommes sont méchants, là où l’occasion s’offrira de profit particulier, il est rompu ; mais la crainte se maintient par une peur de châtiment qui ne te quitte jamais » (Ibid.) 7.
Le « prince » est donc celui qui, grâce à sa vertu politique, libère ses sujets – qui ne sont plus des citoyens – des conflits destructeurs provoqués par l’animal incivil lorsqu’on le laisse libre d’agir dans la cité. Un prince qui ressemble donc beaucoup au Léviathan de Hobbes. Par conséquent, la révolution de Machiavel fut essentiellement une révolution anthropologique, et c’est à partir de là qu’il développe les thèses de sa théorie politique.
Machiavel, en rupture nette et explicite avec l’anthropologie et l’ecclésiologie chrétiennes (il estime qu’elles ont rendu l’homme incapable de construire la cité des hommes, trop préoccupé qu’il était par la cité de Dieu), soumet de nouveau l’histoire à la chance (ou au destin) et suggère au prince et à l’homme politique les moyens à déployer pour « attirer » la chance de son côté : grâce à la vertu politique, le prince fait en sorte que la déesse aux yeux bandés verse sur lui sa corne d’abondance 8.
Le passage de l’humanisme civil du xve siècle à la théorie de Machiavel au xvie siècle constitue donc également une transition anthropologique et culturelle : à présent, on ne considère plus la vie en commun comme une « bénédiction », comme on le faisait à la suite d’Aristote, mais fondamentalement comme une « blessure ». L’autre me fait du mal, il me maudit.
Dans ce chapitre, nous essaierons de comprendre quelques-unes des raisons qui ont conduit, y compris dans l’économie moderne, à l’affirmation d’une vision individualiste et asociale de l’être humain. Nous verrons que, dans l’humanisme individualiste de Nicolas Machiavel, Thomas Hobbes et Adam Smith, il existe une continuité philosophique bien perceptible quant à la manière de concevoir la vie en commun. Nous découvrirons ainsi que la naissance de la science économique représente une étape importante pour l’ensemble de l’humanisme individualiste, immunitaire et non-communautaire, de la modernité en Occident.
2. La communauté tragique
Au sein de la société traditionnelle telle qu’elle existait au Moyen Âge, la possibilité de vivre en commun était intimement liée au sacrifice et à la tragédie.
Cette vision trouve son origine dans la pensée grecque, notamment dans l’éthique d’Aristote.
Ce grand penseur avait relevé un paradoxe présent dans tout l’Occident : la « vie bonne », la vie heureuse, est à la fois civile et vulnérable. Puisque, comme il nous l’indique dans le chapitre 9 du Livre IX de son Éthique à Nicomaque (1169b), « l’homme heureux a besoin d’amis » et que, pour cette raison, on ne peut être heureux en restant seul, il est impossible de trouver le bonheur dans la solitude, en fuyant la vie civile et la relation avec l’autre. Mais, s’il faut avoir des relations sociales pour être heureux, autrement dit, fondées sur l’amitié et la réciprocité, et si l’amitié et la réciprocité sont une affaire de liberté que l’individu ne peut contrôler pleinement et unilatéralement, alors notre bonheur dépend de la réponse des autres, de ce que les autres nous rendent ou non notre amour, notre amitié et la réciprocité. En d’autres termes, si, pour être heureux, j’ai besoin d’amis et de réciprocité, alors la vie heureuse est ambivalente : l’autre représente pour moi à la fois une joie et une souffrance ; il est pour moi la seule façon d’être vraiment heureux, mais aussi celui ou celle qui peut me rendre malheureux. La « vie bonne », la bénédiction, dépend alors des autres, qui peuvent cependant me blesser.
D’autre part, si je me réfugie dans la solitude et dans la contemplation à l’abri des autres (c’est la grande alternative néoplatonicienne) afin d’échapper à cette vulnérabilité et à cette souffrance probable, la vie ne peut s’épanouir pleinement. C’est alors que la tradition de la pensée aristotélicienne, davantage qu’Aristote lui-même, associe la vie heureuse à la tragédie. La philosophe contemporaine Martha Nussbaum s’exprime en ces termes au sujet des relations interpersonnelles : « Ces composantes de la vie bonne vont être à peine autosuffisantes. Et elles seront profondément et dangereusement vulnérables » (2009 [1986], p. 344).
De ce point de vue, la vie en commun, la communitas, porte la marque de la souffrance dans sa chair. Le monde juif nous rappelle, en recourant à de grands symboles et mythes, présents notamment (mais pas uniquement) dans la Genèse 9, que l’autre est bénédiction, car nous ne pouvons être heureux sans lui, mais qu’il est aussi celui qui nous blesse et que nous blessons à notre tour (la blessure, de même que la bénédiction, est toujours réciproque) 10.
La pensée de l’époque prémoderne et de l’antiquité avait deviné la nature ambivalente de la vie bonne : on ne peut être heureux sans la communitas, et pourtant, en raison de notre besoin essentiel de sentir la présence de l’autre et d’entretenir une relation avec lui, la vie bonne se mêle à la mort de diverses façons. Les mythes fondateurs des cités dans l’antiquité sont
emblématiques à cet égard. La première cité, Hénok, évoquée dans la Bible, est fondée par le fratricide Caïn, et la fondation de Rome est associée à l’assassinat de Remus par Romulus. Le Christ crucifié, en tant que fondateur de la nouvelle koinonia (l’ekklesia), est le symbole le plus fort de cette intuition remontant à l’antiquité et qui a façonné tout l’Occident 11.
Dans l’Occident prémoderne, l’idée de bien commun n’était pas associée à une somme d’intérêts privés mais sous-entendait plutôt, pour ainsi dire, une soustraction : si l’on prenait le risque de renoncer à quelque chose qui nous appartenait (un bien privé), alors, seulement, on pouvait construire le « nôtre » (le bien commun), qui devenait commun parce qu’il n’appartenait à personne 12.
3. La médiation de l’Absolu