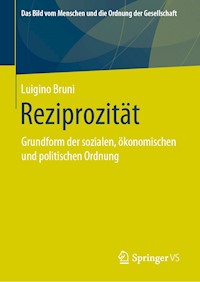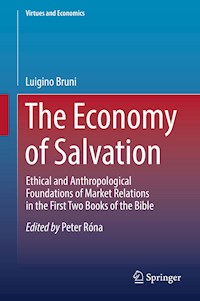Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nouvelle Cité
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
De tout temps, les charismes ont été bien plus qu’une affaire purement religieuse. Ils ont pour mission d’embellir la terre, et pas seulement les religions et les églises. Dans le même temps, on voit invariablement se mettre en place, autour des charismes, des dynamiques sociales, éthiques et spirituelles extrêmement délicates et souvent dangereuses, étant donné leur immense force qui peut être orientée, souvent involontairement, vers des objectifs néfastes aussi bien pour les personnes que pour les organisations charismatiques elles-mêmes.
Il est fort difficile, pour les responsables d’organisations charismatiques, de prendre conscience de la crise du charisme qu’eux-mêmes sont en train de créer, parce que, justement, susciter une crise et un déclin est totalement étranger à la conscience des fondateurs et des leaders.
L’esprit qui anime cet ouvrage est d’offrir une « grammaire des crises » dans les mouvements et communautés, reconnaître les premiers signaux faibles d’un déclin et agir au moment où le processus est encore réversible.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Luigino Bruniest bibliste, économiste et éditorialiste pour le quotidien italien « L’Avvenire ». Il est l’auteur de nombreuses publications traduites dans le monde entier, sur l’économie et plus récemment sur la Bible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteuraux mêmes éditions
La blessure de l’autre – L’économie au risque de la relation, 2014 (traduction de l’italien)
L’économie silencieuse, avec A. GREVIN, 2016
Ce que dit la Bible sur le Travail, 2018
Luigino Bruni
La destruction créatrice
Affronter les crises au sein des mouvements et des communautés
Traduction de Claire Perfumo
nouvelle cité
Traductions de :
La distruzione creatrice – Come affrontare le crisi nelle organizzazioni a movente ideale © Città Nuova 2016, pour les chapitres 1 à 7 et 16
Elogio dell’auto-sovversion – La fioritura umana nelle organizzazioni a movente ideale © Città Nuova 2017, pour le chapitre 17
Il capitale narrative – Le parole che faranno il domani nelle organizzazioni e nelle comunità © Città Nuova 2018, pour les chapitres 8 à 10
I colori del cigno – Quando le persone sono più grandi delle loro organizzazioni © Città Nuova 2020, pour les chapitres 11 à 15
Ce livre a été traduit grâce à une aide du Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Composition : Soft Office
Couverture : Florence Vandermarlière
© Nouvelle Cité 2021
Domaine d’Arny
91680 Bruyères-le-Châtel
www.nouvellecite.fr
ISBN 9782375822432
Je dédie ce livre à tous ceux qui vivent au sein de communautés et de mouvements « charismatiques ». À tous, mais surtout à ceux qui choisissent de continuer à croire et à rester lors des périodes de maladies organisationnelles. Pour les soigner, pour continuer à espérer et à aimer. Car la terre promise n’est pas la terre où nous vivons, mais celle de nos enfants.
Introduction
Envoie, Seigneur, d’autres prophètes,des hommes convaincus de Dieu,
des hommes au cœur enflammé.
Et toi, parle depuis leurs buissons ardentssur les décombres de nos paroles,au milieu du désert des temples :
Viens dire aux pauvres
d’espérer encore.
David Maria TURÒLDO, O sensi miei…
Si nous voulons comprendre la culture de notre temps, il nous faut apprendre à examiner ce qui se passe à l’intérieur des organisations, notamment les organisations de grande taille : les entreprises, les banques et les sociétés mondiales de conseil. Cependant, il convient également d’apprendre à scruter la présence, et plus encore l’absence, d’idéaux plus grands que les personnes car, dans de nombreux cas, ceux-ci possèdent la capacité de donner vie à des organisations et communautés différentes de celles qui sont fondées à des fins exclusivement lucratives. Ce livre traite des organisations et des idéaux, et plus particulièrement les expériences qui, de par leur nature et leur vocation, ont pour mission de les faire coexister. Il s’agit des organisations à mouvance idéale (OMI), les mouvements et communautés nés de ce que nous désignerons sous le nom de charismes.
Actuellement, ce sont les grandes entreprises qui définissent la nouvelle koinè de notre société ; c’est là que prennent forme le vocabulaire et la grammaire de la vie en commun, qui migrent peu à peu des organisations économiques vers toutes les sphères de la vie sociale, une émigration accueillie sans aucun contrôle aux frontières et sans aucune crainte de contagion. Au contraire, bien souvent la société civile, l’école, la politique et la santé semblent pressées de se faire contaminer par la culture de l’économie et des affaires, la seule réellement efficace et sérieuse à leurs yeux. C’est ainsi que des termes tels qu’efficience, mérite, innovation ou réussite, issus du langage de l’économie et de l’entreprise, deviennent peu à peu les seules bonnes paroles de l’humain.
Cette occupation silencieuse atteint aujourd’hui même le monde non tourné vers le profit, les organismes de coopération internationale, les coopératives, et s’étend à présent jusqu’aux églises et aux mouvements spirituels, qui courent le danger de se convaincre que la solution à n’importe quelle crise consiste à trouver les instruments de gestion adaptés.
C’est la vieille utopie et illusion selon laquelle la technique peut nous sauver des crises traversées par nos âmes et nos relations. Nous cherchons à nous persuader que, face à la baisse de nos motivations les plus élevées et à l’épuisement de nos énergies spirituelles, il nous suffit de restructurer les organisations pour résoudre les problèmes ; que, face à l’effondrement de notre créativité, nous pouvons nous contenter de faire appel à un bon expert en communication afin de parler à tout le monde de tout ce que nous possédons et que nous ne parvenons pas à exprimer. Le jour n’est pas si loin – et, dans certains cas, peut-être est-il même déjà arrivé – où, lors des retraites spirituelles de nos communautés, nous ferons venir un professionnel pour organiser les rencontres et trouverons des coachs en lieu et place des confesseurs au sein des sanctuaires et des églises. C’est ainsi que, dans les moments de crise, au lieu de chercher la cause de la baisse de vitalité des communautés et de leurs membres, nous préférons nous en remettre aux meilleures techniques et investir l’énergie qui nous reste dans la refonte de la gouvernance et des instruments de gestion qui, à un moment donné, ne sont plus que le chant du cygne, un chant auquel nous payons souvent un lourd tribut.
Ce livre propose une première analyse, qui n’en est encore qu’à ses débuts ; une analyse qui utilise un langage accessible même aux non-spécialistes en économie ou en théorie des organisations et pouvant concerner toute organisation. Il devrait acquérir un relief particulier pour les OMI et les mouvements charismatiques, des structures créées autour des idéaux d’une ou plusieurs personnes, d’une communauté ou d’un peuple. Une analyse que je me suis efforcé de développer avec pietas, avec compassion et une grande sympathie affective et émotionnelle envers les dynamiques que je relate. Celles-ci décrivent presque toutes, en les généralisant et en les interprétant, des expériences vivantes que j’ai pu vivre en fréquentant de nombreuses OMI (dans le domaine de l’économie sociale, l’économie civile et l’économie de communion), ainsi qu’un grand nombre de communautés et de mouvements charismatiques. J’y inclus ma propre expérience, que j’ai étoffée et alimentée grâce à ma rencontre avec un mouvement charismatique (les Focolari), une rencontre qui constitue, avec ma famille naturelle, la plus grande bénédiction de ma vie.
Les OMI et, à plus forte raison, les communautés et les mouvements charismatiques, sont des lieux où les motivations des personnes constituent le facteur décisif, où toute la vie de l’organisation – y compris les recettes lorsque nous avons affaire à des agences économiques – dépend de la façon dont les motivations des personnes changent, évoluent ou se détériorent, notamment les motivations de certaines figures-clé : fondateurs, dirigeants et, d’une manière générale, celles de personnes qui ajoutent à leurs valeurs individuelles celles de l’organisation.
Les arguments exposés dans les pages qui suivent cherchent à prendre le contrepied de tous ces raisonnements, car ils partent de l’intention explicite d’offrir des outils permettant d’analyser les phénomènes caractéristiques de l’organisation des mouvements. Ceci vaut pour les communautés affectées depuis longtemps par les maladies et névroses que nous décrirons plus loin, mais aussi et surtout pour celles qui se trouvent encore dans leur phase de réussite et de développement ; en effet, comme nous le verrons, le phénomène en raison duquel il est quasiment impossible de se rendre compte à temps du déclin spirituel et social des mouvements charismatiques, est ce que nous désignerons par l’expression « crépuscule de midi ». Les grandes crises s’amorcent alors que tout parle de réussite et de développement, lorsque les leaders n’ont pas la sagesse de changer au moment où personne ne le souhaite (encore).
Au cours de l’histoire, les charismes prolongent la mission des prophètes de la Bible. Ils sont de vrais cadeaux pour le bien commun, et leur spécificité réside dans leur capacité à nous rappeler combien la gratuité, la justice et la vérité sont précieuses ; en raison de leur vocation, ils se trouvent souvent dans une relation tendue mais énergique et nécessaire avec les institutions, animées par d’autres valeurs. En l’absence de prophètes, la terre promise demeure une simple utopie, les institutions deviennent des structures servant à dominer et à exploiter les plus faibles, et le monde ne sait plus écouter la voix qui parle, ni l’esprit qui souffle. Il en va de même des charismes, qui constituent une dimension essentielle pour rehausser la qualité spirituelle et morale du monde et pour regarder vers le haut, depuis les toits. Ainsi, lorsque les charismes sont absents des communautés, des organisations et des peuples, ou bien, lorsqu’ils sont réduits au silence et marginalisés, comme cela se produit actuellement, la vie en commun perd de sa beauté, de sa légèreté et de sa force spirituelle ; nous nous contentons alors peu à peu de maigres et tristes objectifs, et nous en arrivons à penser que le toit du monde n’est pas plus haut que celui de notre maison ou de notre bureau.
De tout temps, les charismes ont été bien plus qu’une affaire purement religieuse. Ils ont pour mission d’embellir la terre, et pas seulement les religions et les églises. Aujourd’hui comme hier, ils s’alimentent de l’eau des fontaines publiques en plus de celle des bénitiers et des fonts baptismaux. Cependant, de nombreux charismes vivent bien davantage que jadis hors des frontières visibles des églises et des religions, ce qui ne les empêche pas de continuer à remplir inlassablement leur fonction essentielle, charis, autrement dit, de prophétie et de beauté. Dans le même temps, on voit invariablement se mettre en place, autour des charismes, des dynamiques sociales, éthiques et spirituelles extrêmement délicates et souvent dangereuses, étant donné que leur immense force peut être orientée, presque toujours involontairement, vers des objectifs néfastes aussi bien pour les personnes que pour les organisations charismatiques elles-mêmes.
Les charismes, et les mouvements dont ils sont à l’origine, sont comparables à ces vieux édifices de nos villes médiévales. À la différence des villas des nobles, qui nous sont parvenues plus ou moins sous la forme où elles avaient été construites, les bâtiments populaires du centre de Rome ou de Lisbonne ont certes conservé des éléments de la première construction ancienne, mais des générations d’habitants les ont changés, modifiés, surélevés, restructurés, parfois subdivisés entre les différentes branches d’une même famille. Ces bâtiments sont restés vivants grâce à ces transformations successives ; en eux cohabitent l’empreinte originelle de l’architecte qui les a conçus et la créativité et la force de vie de ceux qui les ont habités tout au long des siècles et y ont laissé leur empreinte.
Or, c’est précisément dans cette nécessité de renouvellement et de restructuration que surgissent les plus grandes difficultés. Le renouveau d’une communauté charismatique est aussi crucial qu’improbable, car les institutions qui naissent d’un charisme pour le garder vivant et le servir, finissent par devenir le but ultime du mouvement lui-même. Presque toujours, on a tôt fait d’oublier que les structures, les œuvres et les statuts étaient nés pour servir le charisme et, donc, l’idéal dont il était porteur, et c’est ainsi que le développement et l’essor de l’œuvre devient la finalité même du charisme. Un mouvement né avec pour idéal de contribuer à l’évangélisation du monde, finit par investir toutes ses forces pour maintenir debout sa structure, lorsque le cours de l’existence de ses fondateurs s’achève ; c’est ainsi que l’on fait passer de plus en plus l’idéal au second plan, ce dernier étant désormais considéré un peu trop comme allant de soi. L’élément le plus important, l’élément crucial, pour comprendre le ton des pages qui suivent, est la non-intentionnalité de ces récits. Ni les fondateurs, ni les membres les plus motivés et les plus innovants ne souhaitent le déclin de l’idéal qui les a suscités. C’est tout le contraire ; ils consacrent toutes leurs forces à faire vivre le charisme et à lui faire porter des fruits abondants. Tout est orienté vers cette cause. L’accent, mis d’abord sur le charisme, se porte désormais vers l’œuvre ; ce déplacement se fait progressivement, sans que l’on ait conscience des effets qui en découlent aujourd’hui et en découleront dans les années à venir.
On le sait, grâce aux nombreuses études menées dans le cadre de la sociologie des religions et des mouvements charismatiques : la tentation la plus naturelle de toute réalité née d’un charisme, qu’il soit laïque ou religieux, est la tentation de l’idéologie et de l’idolâtrie, dont la nature et la grammaire nous sont montrées avec une force inégalée par la Genèse, l’Exode et les livres prophétiques. La Bible, avec sa religion totalement différente et exigeante, a combattu l’idolâtrie comme son ennemi principal et impitoyable, pour en avoir elle-même éprouvé la fascination (et y avoir parfois cédé), et connu sa force destructrice.
La transformation de Dieu en idole est toujours possible, car le Dieu de la Bible est trop exigeant pour que l’on ne soit pas tenté de le rendre plus simple et davantage semblable aux dieux des autres peuples, à taille humaine. De manière analogue, l’idée d’un charisme venu dans le monde comme une anti-idole, et destiné à remédier aux maladies de l’idolâtrie, reste lui-même tant que la communauté garde la distance nécessaire entre son idéal et son expérience réelle, c’est-à-dire la distance entre le charisme, d’une part, et, d’autre part, les œuvres nées pour l’incarner et le traduire en vie. On tombe dans l’idolâtrie lorsque cette distance s’efface et que l’idéal finit par coïncider avec les œuvres et l’œuvre qu’il a fait naître. Idolâtrie et idéologie sont deux mots très proches. Un charisme entame son déclin lorsqu’il se transforme en idéologie, quand on fait passer pour le charisme l’explication de toute la réalité (quelle que soit la grandeur de ce charisme, celui-ci ne constitue jamais qu’une partie de la totalité). On le sort du contexte dans lequel il est né (une église, l’évangile…) ; il devient entièrement autoréférentiel, et on ne ressent plus la nécessité de le remettre en question, ni de le purifier par des réalités différentes et plus universelles. Établir une distinction entre le charisme et l’idéologie du charisme est un processus décisif, délicat et cependant indispensable pour protéger le charisme de lui-même, le faire mûrir dans toute sa beauté et dans toute son ampleur1.
Il est fort difficile, pour les responsables d’organisations charismatiques, de prendre conscience de la crise du charisme qu’eux-mêmes sont en train de créer, parce que, justement, susciter une crise et un déclin est totalement étranger à la conscience des fondateurs et des leaders. L’histoire nous montre une longue série de communautés charismatiques qui ont connu le déclin et la mort ; en revanche, elle donne à voir des histoires heureuses qui ont traversé les siècles et qui sont toujours vivantes aujourd’hui. L’esprit qui anime cet ouvrage est de contribuer à reconnaître les premiers signaux faibles d’un déclin et d’agir au moment où le processus est encore réversible.
Au fil de notre discours, page après page, notamment à partir du quatrième chapitre, nous affirmerons, de différentes manières, qu’une communauté ou un mouvement charismatique reste vivant tant qu’il met ses habitants en condition d’embellir, de restructurer et de repeindre, voire de remodeler l’édifice, des conditions toujours exigeantes et jamais définitivement acquises. Tant qu’une communauté accorde à ses membres la possibilité de restructurer l’immeuble de manière créative, d’exercer ce que l’économiste Joseph A. Schumpeter appelait une « destruction créatrice », la qualité de la vie de cette communauté reste élevée et dynamique. Lorsqu’à l’inverse, cette possibilité et cette liberté font défaut, les notes dominantes sont la tristesse et la mort de toute créativité. Sans cette possibilité, risquée et vitale, les seuls scénarios possibles sont la destruction de l’édifice ou sa vente à d’autres propriétaires et, partant, la perte de son identité et de son histoire.
Les mouvements charismatiques qui ont fait preuve de vitalité et de longévité sont ceux qui possèdent des deltas pluriels et de nombreux ruisseaux. Les estuaires monolithiques, compacts et monotones, ont une durée de vie brève. La biodiversité, c’est la loi de la vie, de toute vie sous le soleil.
***
Ce livre rapporte, avec quelques variantes et quelques notes de bas de page, des articles publiés dans le quotidien italien Avvenire. J’adresse mes remerciements sincères et profonds à son directeur, Marco Tarquinio, qui a bien voulu accompagner ce parcours, en me proposant des pistes de réflexion et des idées qui ont enrichi ces articles et ce livre.
1. Le livre qui représente le milleur remède aux tentations idéologiques est celui de Job : une grande lutte contre la foi réduite à une idéologie idolâtre.
1
La force de la confiance vulnérable
Communitas est un ensemble de personnes unies non pas par une « propriété », mais par un devoir ou une dette ; non pas par un « plus », mais par un « moins », par un manque, une limite qui apparaît comme une charge, voire comme une déficience, aux yeux de celui qui en est « affecté », contrairement à celui qui en est « exempt » ou « exempté ».
Roberto ESPOSITO, Communitas
Les communautés et les organisations2 qui sont restées créatives et fécondes dans le temps ont su s’accommoder de la vulnérabilité ; elles ne l’ont pas éliminée entièrement de leur territoire, mais l’ont accueillie. La vulnérabilité (du latin vulnus : blessure), comme beaucoup de mots vrais définissant l’homme, est ambivalente, parce que la bonne vulnérabilité vit à côté de la mauvaise et, souvent, les deux s’entremêlent. La bonne vulnérabilité est au cœur de toutes les relations humaines génératrices car, si je ne mets pas l’autre en mesure de me « blesser », la relation n’est pas assez profonde pour être féconde.
La bonne vulnérabilité se vit dans les relations d’amour, avec nos enfants, entre amis, au sein des communautés ordinaires de notre vie. Nous savons aujourd’hui que les équipes de travail les plus créatives se composent de personnes qui se voient accorder une ouverture de crédit authentique, donc risquée. Dans n’importe quel domaine, la capacité à générer éprouve un besoin essentiel de liberté, de confiance et de risque, et tous ces éléments rendent vulnérables ceux qui les concèdent. La vie naît des relations qui se risquent à la blessure de la rencontre. Nous ne pourrions aider aucun enfant à devenir une personne libre sans lui accorder une confiance vulnérable au sein des familles, des écoles ou des milieux éducatifs ; de même, en tant qu’adultes, nous devons être en mesure de recevoir et d’accorder une confiance risquée et vulnérable afin de nous épanouir au travail.
Or, la culture des grandes entreprises mondialisées veut aujourd’hui l’impossible : elle demande à ses salariés d’être créatifs sans accueillir la vulnérabilité des relations. Pensons à la « subsidiarité managériale », selon laquelle le chef de projet intervient dans les décisions d’un groupe qu’il coordonne uniquement dans le cadre des activités qui produiraient de moins bons résultats sans son « secours ». En effet, les grandes entreprises prennent aujourd’hui conscience qu’elles doivent veiller à ce que leurs salariés se sentent libres et acteurs de leur travail si elles veulent qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Il n’est de créativité que dans la liberté ; cependant, pour que la subsidiarité fonctionne, les salariés et les groupes de travail doivent avoir réellement confiance en elle et pouvoir aussi en user à loisir. Peu de choses sur terre procurent autant de joie que la participation à la libre action collective entre pairs.
Afin que cette magnifique et vieille idée de subsidiarité ne se limite pas à un principe inscrit dans les bilans sociaux, il est impératif que la direction place vraiment sa confiance dans le groupe de travail, sans chercher à contrôler tout le processus par crainte des abus de confiance et des « blessures ». D’ailleurs, si la personne qui se voit déléguer les tâches perçoit qu’en réalité, la confiance n’est qu’un instrument, une technique destinée à augmenter les profits, la subsidiarité cesse de produire ses effets. Voilà pourquoi la subsidiarité au sein des entreprises nécessite un système de propriété non capitaliste, où la délégation ne vienne pas d’en haut pour atteindre les employés, mais aille dans la direction opposée, comme c’est le cas en politique, où le principe de subsidiarité est apparu.
Or, la subsidiarité qui vient d’en haut est différente : elle fonctionne uniquement lorsque les personnes haut placées la jugent utile et décident donc qu’elle est peu résiliente face aux échecs. Seules ses véritables motivations intrinsèques, associées aux institutions appropriées, permettent à la subsidiarité et aux formes participatives de survivre aux crises provoquées par les graves abus de confiance. En réalité, les entreprises démocratiques et participatives, telles que les coopératives, sont celles qui pratiquent « naturellement » la subsidiarité, où « la souveraineté appartient vraiment au peuple », c’est-à-dire les salariés-associés, qui l’accordent aux managers et directeurs, dans un mouvement ascendant. En d’autres termes, la subsidiarité et la confiance fonctionnent réellement dès lors qu’elles sont risquées et vulnérables. Si nous devions résumer les relations humaines sur une pièce de monnaie, nous représenterions sur l’une des faces les joies de la rencontre libre dans la gratuité et, sur l’autre, les multiples images de nos blessures à l’origine de ces joies.
Cependant, et c’est là un autre paradoxe de notre système capitaliste, la culture enseignée dans toutes les écoles de management déteste la vulnérabilité, qu’elle considère comme son grand ennemi. Il y a différentes raisons à cela. Au cours des siècles, la civilisation occidentale a opéré une séparation nette entre les lieux de la bonne et ceux de la mauvaise vulnérabilité. Elle n’a pas accepté son ambivalence, créant ainsi une dichotomie. Elle a associé la bonne vulnérabilité, source de bénédictions, à la vie privée, à la famille et à la femme, première figure de la blessure générative. Dans la sphère publique, entièrement construite sur le registre masculin, la vulnérabilité est toujours perçue comme mauvaise. C’est ainsi que la vie économique et celle des organisations se sont fondées sur l’invulnérabilité. Montrer ses blessures et sa fragilité sur le lieu de travail passe pour de l’incompétence, un manque d’efficience et devient un motif de blâme. Ces dernières décennies de capitalisme financier ont accentué la nature invulnérable de la culture du travail dans les grandes entreprises mondiales, qui rejette toute forme de vulnérabilité.
L’immunité