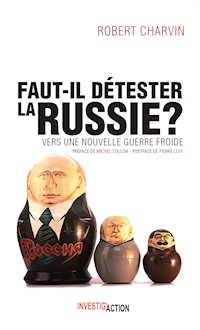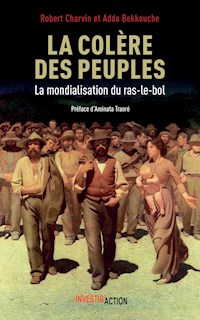
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Investig'Action
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Après
Faut-il détester la Russie et La Peur, arme politique, Robert Charvin, épaulé par Adda Bekkouche, juriste, revient avec un livre des plus actuels:
La Colère des peuples ou la mondialisation du ras-le-bol. Après une préface d'Aminata Traoré, les deux auteurs analysent toutes les révoltes récentes et explique la raison des soulèvements de plus en plus présents partout dans le monde.
À Rome, Amsterdam, Bruxelles suite au Covid-19, les jeunes et moins jeunes pour le climat, les Gilets jaunes et les autres mouvements populaires et les soulèvements contre le racisme, les peuples de la Planète semblent en ébullition. Où cela va nous mener? Comment agir pour obtenir des changements : découvrez la quatrième ci-dessous.
Partout dans le monde, les peuples grondent. Les jeunes contre la destruction de la planète, les Gilets jaunes et bien d’autres contre la régression sociale, les citoyens contre le racisme... En face, les violences policières pour réponses.
Les pouvoirs occidentaux (Biden, Bolsonaro, Macron, ou Boris Johnson pour les plus connus) essaient de gagner du temps. Aidés par une nuée de médias, scientifiques et juristes, ils tentent d’asservir les foules, d’abord avec des promesses, de la séduction, puis par la peur, la répression.
Robert Charvin et Adda Bekkouche analysent le passé proche pour mieux servir le présent. Que nous apprennent les luttes d’hier ? Quelles nouveautés apportent celles d’aujourd’hui ? Comment avancer ?
Les années 2020, l’aube d’un nouveau monde ?
À PROPOS DES AUTEURS
Robert Charvin, professeur émérite de droit à l'université de Nice. Ancien Conseiller général des Alpes Maritimes, il a représenté diverses ONG auprès de l'ONU.
Adda Bekkouche, docteur d'État en droit et ancien magistrat à la Cour des comptes d'Algérie, a enseigné à la Sorbonne. Maire-adjoint à la coopération et à la solidarité internationales pour la ville de Colombes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Colère des peuples
Ouvrages déjà parus chez Investig’Action :
Hernando Calvo Ospina, Un navire français explose à Cuba, 2021
Matthew Alford et Tom Secker, L’Empire vous divertit. Comment la CIA et le Pentagone utilisent Hollywood, 2020
Michel Collon, Planète malade. 7 leçons du Coronavirus, Entretien etEnquête, 2020
Élisabeth Martens, La méditation de pleine conscience. L’envers du décor, 2020
Staf Henderickx, Je n’avale plus ça. Comment résister au virus de l’industrie agroalimentaire, 2020
Jude Woodward, USA-Chine. Les dessous et les dangers du conflit, 2020
Johan Hoebeke et Dirk Van Duppen, L’Homme, un loup pour l’Homme ?, 2020
Michel Collon et Saïd Bouamama, La Gauche et la guerre, 2019
William Blum, L’État voyou, 2019
Ludo De Witte, Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent, 2019
Jacques Pauwels, Les Mythes de l’Histoire moderne, 2019
Robert Charvin, La Peur, arme politique, 2019
Thomas Suárez, Comment le terrorisme a créé Israël, 2019
Michel Collon, USA. Les 100 pires citations, 2018
Edward Herman et Noam Chomsky, Fabriquer un consentement, 2018
Saïd Bouamama, Manuel stratégique de l’Afrique (2 Tomes), 2018
Ludo De Witte, L’Ascension de Mobutu, 2017
Michel Collon, Pourquoi Soral séduit, 2017
Michel Collon et Grégoire Lalieu, Le Monde selon Trump, 2016
Ilan Pappé, La Propagande d’Israël, 2016
Robert Charvin, Faut-il détester la Russie ?, 2016
Ahmed Bensaada, Arabesque$, 2015
Grégoire Lalieu, Jihad made in USA, 2014
Michel Collon et Grégoire Lalieu, La Stratégie du chaos, 2011
Michel Collon, Libye, Otan et médiamensonges, 2011
Michel Collon, Israël, parlons-en !, 2010
Michel Collon, Les 7 péchés d’Hugo Chavez, 2009
Robert Charvin et Adda Bekkouche
La Colère des peuples
Ou la mondialisation du ras-le-bol
Investig’Action
© Investig’Action, Robert Charvin et Adda Bekkouche pour la version française
Chargé d’édition : David Delannay
Mise en page : Simon Leroux
Couverture : Joël Lepers
Correction : Sonia Étignard, Delphine Claire, Camille Ratonnat et David Delannay
Merci à tous !
Édition : Investig’Action – www.investigaction.net
Distribution : [email protected]
Commandes : boutique.investigaction.net
Interviews, débats : [email protected]
ISBN : 978-2-930827-81-0
Dépôt légal : D/2021/13.542/2
Table des matières
Préface
Pour introduire la réflexion...
Chapitre I : Le constat : la mondialisation de la révolte
La révolte contre le désordre établi néoconservateur
La révolte contre les révolutions inachevées.
Chapitre II : « L’élite » occidentale sur la défensive ?
Un petit monde à contre-pieds
Un sauvetage encore possible : une nouvelle « trahison des clercs » ?
Chapitre III : Les instruments de la domination : la technostructure au service de l’hypercapitalisme
La fabrique des instruments de domination
L’expérimentation des instruments de la domination
La généralisation des instruments déterminants de la domination
La « gouvernementalité », promesse d’un concept
Chapitre IV : La guerre idéologique
La guerre idéologique de « ceux d’en haut »
La guerre idéologique de « ceux d’en bas ».
Chapitre V : L’ère des masses
Les prémisses historiques de révoltes nouvelles
La recherche de nouvelles formes de lutte
Violence et contre-violence : a-t-on le droit de prendre la Bastille
Conclusion : L’insoutenable légèreté du néolibéralisme
Les indices de la phase terminale
Les révélations du Covid-19 (2020)
L’absence de sécurité
Préface
Multidimensionnelle, la crise du système néolibéral est généralement exclue du discours officiel sur l’Afrique. La descente aux enfers du Mali est exemplaire. Elle est imputée à l’incapacité pour ses institutions – État et armée – à protéger le territoire et les populations.
Les idéaux véhiculés lors des grandes conférences du dernier quart du XXIe siècle – « l’école pour tous », « l’eau pour tous », « la santé pour tous », « le logement pour tous » – résonnent comme autant de rendez-vous manqués avec l’histoire. Les inégalités persistent et s’aggravent. En effet, pour la plupart des peuples du Sud, aucune de ces exigences fondamentales n’a été résolue.
Au Mali, le Mouvement du 5 juin et du Rassemblement des forces patriotiques (M5RFP) est une coalition hétéroclite d’acteurs et actrices du monde politique et de la société civile. Ces derniers se sont regroupés autour de l’imam Mahmoud Dicko et de la CMAS (Coordination des mouvements, amis et sympathisants de Mahmoud Dicko) pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le coup d’État militaire du 18 août 2020 a considérablement affaibli le mouvement. Il serait mort de sa belle mort selon l’un de ses principaux animateurs.
La marche forcée du Mali vers le marché dit ouvert, libre et concurrentiel, mais outrageusement déloyal a sécrété le chômage et la pauvreté de masse. Ces fléaux contraignent souvent les populations à émigrer au risque de leur vie ou à saisir la perche du « djihadisme ». Le radicalisme religieux s’est engouffré dans les brèches ouvertes par le désengagement de l’État et la privatisation des biens et services publics.
Le chaos que la France prétend éviter à ce pays en s’y maintenant militairement résulte d’un « coup d’État institutionnel » permanent, perpétré par elle-même à travers des accords commerciaux, monétaires, migratoires, militaires conformes à ses propres intérêts. L’accord de paix d’Alger n’échappe pas à cette réalité.
À la suite de la chute du mur de Berlin, le prétendu « vent de la démocratie » a soufflé dans des pays africains minés par les conséquences des Programmes d’ajustement structurel (PAS) du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Les griefs des opposants et opposantes politiques ainsi que des contestataires portent rarement sur ces questions majeures. Les « révolutions » relèvent souvent de soulèvements populaires visant des régimes qui ont mis en œuvre ces programmes en se montrant sourds aux revendications des populations éprouvées par le chômage et la pauvreté de masse.
L’alternance politique ne pouvait donc pas tenir ses promesses. La démocratie libérale dont il s’agit concentre tous les pouvoirs entre les mains d’élus, qui appliquent les instructions de leurs bailleurs de fonds.
La transparence des urnes et la bonne gouvernance deviennent alors les seuls gages de la démocratie et du développement.
Cependant, l’organisation du Forum social mondial, en 2001, à Porto Alegre (Brésil) a largement contribué à l’éveil des consciences et à la convergence des luttes des peuples contre le système néolibéral. Le fardeau de la dette, les accords commerciaux monétaires, migratoires et le climat sont désormais au cœur du débat et du combat des mouvements sociaux.
Au forum de Davos et ailleurs, les gardiens du temple qui veillent au grain se sont emparés de la plupart des thématiques du mouvement altermondialiste pour les instrumentaliser.
Le Mali, comme bien d’autres pays, a, en somme, été embarqué, à son corps défendant, dans la guerre « antiterroriste ». En huit ans, cette dernière a tué plus de Maliens, civils et militaires que de « djihadistes ». Circonscrit dans le Nord, en 2013, le « djihadisme » s’est répandu au centre du pays ainsi qu’au nord-est du Burkina Faso et du Niger.
Les rébellions « touareg » qui étaient cycliques au nord du pays revêtent une dimension séparatiste avec le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). Les solutions politiques de ces insurrections ne résident aucunement dans l’organisation d’élections « transparentes » et « démocratiques » ni dans le déploiement de troupes, comme semblent le croire les Occidentaux.
« La guerre légitime, légale, rapide et propre » que le président de la transition, Dioncounda Traoré, a espérée avec l’appui de la communauté internationale était un piège sans fin. Nombreux sont les peuples enlisés dans les mêmes contradictions.
Les causes économiques, environnementales et géopolitiques doivent être au cœur du débat électoral, mais en y impliquant, comme jamais auparavant, la masse des femmes et des jeunes, qui paient le plus lourd tribut à cette marche macabre du Mali, du Sahel et de nombreux pays de tous les continents.
La décolonisation reste à achever.
Aminata Dramane Traoré
Ancienne ministre de la Culture du Mali.
Pour introduire la réflexion...
À chaque moment de l’Histoire, les mêmes questions sont posées par ceux qui, pourtant séparés les uns des autres, n’acceptent pas les fausses réponses et les mensonges de ceux qui les dominent1. Les dominants, préoccupés avant tout de se pérenniser, ne peuvent se priver de tricher avec les faits et de manifester leur mépris pour les dominés : ils suscitent ainsi des réactions de toutes natures, y compris violentes. Les peuples sont en état permanent de légitime défense et, périodiquement, ils le font savoir.
Le passé, revisité pour mieux servir le présent, est aussi incertain que l’avenir, mais ses redites sont visibles. En feuilletant les pages de l’Histoire et si l’on prend en considération le temps long (ce qui devient rare), on constate le retour fréquent d’une barbarie répressive des dominants toutes « couleurs » confondues. Ceux-ci sont obsédés par le pouvoir, l’argent et les privilèges et sont à la recherche de techniques renouvelées pour obtenir sinon la servilité du moins la soumission des dominés. La « tradition » des dominants est de faire peur aux dominés en usant de toutes les méthodes, du mensonge d’État à la violence policière. Elle se complète d’illusions préfabriquées par les clercs et la religion du moment, lesquelles sont entretenues par des rites et des institutions faisant croire, en dépit des inégalités abyssales, à la « cohésion sociale »… Mais s’ils s’efforcent de se faire craindre et de séduire, les dominants ont aussi peur des révoltes populaires lorsque certains seuils d’intolérance sont atteints. L’inédit de la période contemporaine ne se situe donc pas dans les mouvements populaires et leur répression. L’Histoire est faite de ces conflits sociaux, sous des couverts variés. Le questionnement du jour et qui s’impose porte sur ce qui est relativement « neuf » et sur les racines de ce renouvellement.
On constate, par exemple, une singulière accélération et intensification des mutations de toutes natures. La première est celle des techniques – y compris des outils d’intoxication2 de l’opinion, qu’il s’agit de standardiser et d’aligner sur les positions des pouvoirs établis. La seconde est celle du marché étendant son emprise dans tous les domaines – y compris celui de l’esprit et des valeurs, assimilé à « l’ordre naturel » des choses. La dernière est celle de la nature et du climat, qui réagissent à la surexploitation des gestionnaires du capitalisme. Il y a aussi un prodigieux rétrécissement du monde à l’origine d’un profond métissage des peuples et des réponses auxquelles ils sont soumis de la part des pouvoirs. En effet, les syncrétismes de toutes natures l’emportent, brisant les identités, les particularismes et dissolvant la diversité culturelle.
Aussi, le « charme discret » de la bourgeoisie enraciné dans un particularisme national, constitué au fil des siècles passés, a cédé la place à un cosmopolitisme brutal, mais se prétendant respectueux de la « diversité », sommaire et vulgaire, et s’affirmant « moderniste » et « progressiste ».
Le présidentialisme à la Sarkozy, Hollande et Macron, constitué d’une pseudo noblesse d’État et de nouveaux riches affairistes, n’est qu’une illustration « à la française » d’un pouvoir sans principes et sans conviction, dont la caractéristique est de tricher pour durer.
Les régimes ultra-personnalisés de Trump, Bolsonaro, Erdogan, Boris Johnson, succédant aux Berlusconi et autres clowns patentés de la vie politique du Nord et du Sud (style Bokassa, Bongo, ou Dutertre) témoignent aussi de manière plus caricaturale de ce « populisme », où sont associés politiciens professionnels et technocratie financière. Ils sont tous accompagnés d’une cohorte « d’éditorialistes » et « d’experts » qui se chargent de légitimer leur maître et de chanter leurs « vertus » !
Les renouvellements de plus en plus rapides de l’enveloppe des choses (y compris des leaders usés qui s’éternisent trop) font croire, grâce à une communication qui n’a jamais été aussi bavarde3, à une « révolution » permanente bien que rien d’essentiel ne change. En effet, le « bougisme » est tel dans les mots et les apparences que se distille dans l’opinion l’idée que la révolution, celle qui modifie les rapports de production et les modes de vie, n’a plus de sens, est inutile et dangereuse4 et que l’histoire est finie !
Dans ce confusionnisme entretenu, il convient d’essayer de démêler le neuf du vieux. Il convient également d’établir un constat général sur les processus en cours du capitalisme, des États et des peuples. Parallèlement à cela, il faut s’interroger sur la colère des peuples qui s’exprime quasi simultanément sur tous les continents sans référence idéologique commune. Comme si une lucidité croissante, surmontant tous les obstacles, redonnait vie à la lutte des classes sans pour autant avoir atteint un seuil suffisant pour déboucher sur des options politiques claires et radicales ! Comme si le Vieux Monde défraîchi – malgré un décor ravalé via les efforts de ses bénéficiaires qui lui restent évidemment très attachés (comme les Macronistes en France, par exemple) – se refusait à mourir et à céder la place, tandis que l’aube d’un Nouveau Monde ne se lève qu’à peine.
Il s’agit donc de tenter, dans ce brouillard qui se dissipe très peu, d’apporter si possible quelque lumière sur cette colère des peuples, sur cette « mondialisation du ras-le-bol ». Ceci n’est possible qu’avec l’aide de tous ceux qui travaillent dans la même direction, se refusant à participer à la traditionnelle « trahison des clercs » qui se répète à chaque époque de l’Histoire parce que c’est plus « facile » et plus « rentable » !
Au lieu de s’étonner de l’immense patience des peuples maltraités depuis le début des temps par les dominants et leurs courtisans, ces derniers feignent de ne pas comprendre les mouvements de colère sociale, comme s’il s’agissait de poussées de fièvre pathologique et d’anomalies inintelligibles !
Les pauvres n’ont jamais intéressé ceux qui ne l’étaient pas, y compris l’Église, dont la compassion au fil des siècles n’a concerné que l’extrême pauvreté totalement marginalisée. Dans l’ensemble des sociétés, les pouvoirs religieux et séculiers cultivaient, comme le soulignait La Boétie, la « servilité volontaire » et ne procuraient une assistance (de type caritatif) qu’aux miséreux « méritants ». En aucune manière, il ne s’agissait de courir le risque de déstabiliser le petit monde des « Maîtres », dont la légitimité reposait sur leur richesse et l’appui des forces « spirituelles ».
Après le XVIIIe siècle, les « démocrates » bourgeois se sont satisfaits de libéraliser la vie politique au sens le plus étroit ; par contre, tout ébranlement social était violemment refusé. Les réformes politico-sociétales avaient le mérite de rendre plus « efficaces » les travailleurs et donc plus rentable la force de travail. Au contraire, une « ligne rouge » difficilement franchissable réduisait à peu de chose les réformes sociales. En avril 1848, par exemple, les républicains (très modérés) saluaient le monde ouvrier venu à la rescousse pour renverser la Monarchie usée : « Chapeau bas devant la casquette ! » En juin 1848, c’est le fusil et la répression sauvage qui ont sanctionné la tentative de révolution sociale en faveur de meilleures conditions de vie pour la classe ouvrière ! En 1871, c’est une répression plus sanglante encore, celle de la Commune, qui a prétendu « régler la question sociale » !
En revanche, rien n’a fondamentalement changé en ce début de XXIe siècle : toutes les réformes sociétales, ou presque, sont concevables y compris, dans le domaine des mœurs. En effet, la « nouvelle » bourgeoisie va jusqu’à stimuler une évolution de plus en plus éloignée des valeurs bourgeoises du XIXe et du XXe siècle ! Elle ose s’écarter des préceptes de l’Église et de ce qui reste de l’influence catholique traditionaliste pour se faire championne de la « modernité ». Non seulement elle ne la remet pas en cause, mais elle lui fait gagner des parts de marché dans l’opinion !
Dans le secteur socio-économique, les contre-réformes et les mesures répressives sont partout à l’ordre du jour : les dominés, comme dans l’Antiquité, ont droit aux jeux de cirque et, si nécessaire, au minimum de pain. Pas question de mettre en cause le phénomène de domination dans l’Entreprise et plus généralement dans l’appareil économique et financier !
Dans les pays capitalistes, la petite caste qui décide du statut du travail, qui organise la production et le mode de consommation et, par là, qui accumule son capital et en assure la répartition, ne veut en rien perdre ses privilèges.
Dans les pays d’orientation socialiste, au cœur d’une planète fonctionnant essentiellement selon la logique du capitalisme et des marchés, les dominants tendent à se bureaucratiser. D’un autre côté, les forces révolutionnaires au pouvoir se développent dans un climat de précarité globale (sauf en Chine) en raison des agressions et menaces subies. Par conséquent, elles suscitent à leur tour un mécontentement croissant.
Ainsi, dans les sociétés d’argent, largement majoritaires – y compris au Sud – comme dans les régimes qui tentent de nouvelles expériences, la colère s’exprime.
En France, dans le sillage du monde anglo-saxon en dépit de son discours identitaire, la croyance officielle en « la » liberté perd de sa crédibilité : l’individu est prétendument « libre » sur le marché, mais il n’a aucun droit économique ou social attaché à sa personne. On lui refuse toute souveraineté sur son travail. Les autres termes de la devise républicaine perdent ainsi toute signification concrète : « l’égalité » subit un procès en règle systématique comme destructrice de l’efficacité ; la « fraternité » est vidée de son sens ou folklorisée.
Aucune réponse n’est apportée aux questions qui se posent : « Quelle liberté dans une société profondément inégale », en particulier entre les « Blancs » et les autres ? ; « Quelle fraternité dans la compétition intensive de tous contre tous, non seulement entre démunis et puissants, mais entre démunis ? » ; « Quel mode de développement dans les pays du Sud, dont les capitalismes imposés ne réalisent pas le nécessaire décollage ? » ; « Quel bonheur individuel possible au milieu des dévastations collectives comme celles de l’environnement, du climat, des territoires et de l’indifférence généralisée (faiblement compensée par le bénévolat humanitaire) ? ».
Pour le système, ces questions sont « malsaines » et dangereuses, elles sont subversives !
L’hypothèse peut être faite que ces colères sociales généralisées annoncent la fin d’un monde sans pour autant que ce dernier soit à la veille de disparaître : la prospective, qui s’est révélée si souvent fausse, ne relève pas des sciences exactes et l’Histoire a plus d’imagination que ceux-là mêmes qui la font.
Quelques faits semblent cependant pouvoir être constatés.
Le monde de l’argent – où fleurissent des scandales à répétition et dont on semble découvrir que le mode de gestion est dévastateur – semble historiquement épuisé. Il apparaît comme ne pouvant survivre qu’avec l’assistance à sa tête, dans chaque pays, de tricheurs dont les qualités premières sont l’habilité et la maîtrise des procédures et des techniques d’intoxication propagandiste, incapables cependant de résoudre le moindre problème de fonds.
Sous la direction de Berlusconi ou Sarkozy, de Trump ou de Bolsonaro, de Netanyahu, d’Orban ou de Macron, « l’élite » autoproclamée, à coup de crises d’ego et de mensonges d’État à répétition, d’impuissance délibérée – dissimulant un affairisme à son apogée – se délite. Elle enfonce les sociétés qu’elle domine dans un processus de médiocratisation et de décadence affectant tous les domaines. La pandémie (Covid-19) de 2020 est révélatrice de la dangerosité et de la fragilité généralisées d’un système à bout de souffle, créant du non viable partout et pour presque tous !
En réaction, partout aussi, se développe un sentiment d’exaspération, source d’un esprit d’insurrection : la peur des pouvoirs et celle de leur capacité de répression elles-mêmes diminuent. C’est le cas avec la mobilisation universelle qui a lieu, malgré toutes les mesures d’intimidation, contre les inégalités, le racisme et contre les violences policières.
L’usure de ce petit monde de privilégiés s’accélère, comme tous ceux qui ont précédé ; par-delà les redites de l’Histoire, là, peut-être est le neuf.
1 Voir, dans le même esprit que le présent essai, Bertrand Badie, L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale, Paris, Odile Jacob, 2019.
2 Le comble est que ce sont les « lanceurs d’alerte », considérés comme des « ennemis d’États », qui sont poursuivis pour avoir révélé ce que les pouvoirs dissimulent. Tel est le cas de Julien Assange ou de Chelsea Manning, par exemple, poursuivis par les autorités américaines au nom de « l’Espionnage Act ».
3 Les chaînes de télévision, particulièrement celles qui se prétendent « d’information » continue, se consacrent essentiellement à un bavardage permanent dans un climat de faux pluralisme sacrifiant les faits dont le compte rendu est de plus en plus raréfié, particulièrement sur l’international. Le téléspectateur subit les interprétations « d’éditorialistes » et « d’experts » sélectionnés, ainsi que des sondages dont on connaît les réponses sans connaître les questions posées, qui pèsent sur l’opinion ignorant la plupart des faits d’actualité et plus encore leurs racines historiques !
4 Après François Furet, qui eut son heure de gloire dès lors qu’il eut répudié son communisme de jeunesse, qui a développé l’idée que la Révolution française aurait dû être évitée, ayant été inutilement coûteuse, à la différence des mutations britanniques, Zemmour et Onfray s’autoproclamant Girondin et anti-robespierriste, sont tombés d’accord pour porter le même jugement sur 1793 et contre Rousseau (émission télévisée C8 du 21 février 2020) !
Chapitre I
Le constat : la mondialisation de la révolte
« On ne peut pas rétrécir la planète et en même temps augmenter les inégalités, sinon l’explosion est inévitable. Partout, le mépris des peuples par les classes dirigeantes devient insupportable. »
Michel Rogalski (Directeur de Recherches internationales)
Partout en ces années 2000, des fractions très larges de la population se sont mises en mouvement en rejetant ceux qui sont leurs représentants institutionnels plus ou moins mal élus.
Le « peuple légal » statique est composé d’électeurs, d’individus dispersés et bigarrés. Ses votes, canalisés par l’argent et les manœuvres tacticiennes des dominants, n’expriment que des intérêts particuliers. Dès lors, ce peuple légal cède la place à un peuple à l’initiative doté d’une conscience collective exprimant des « revendications communes enracinées dans les soucis quotidiens de l’existence concrète », selon la formule de J. L. Mélenchon1. Un « peuple » se constitue en effet lorsqu’il prend conscience de lui-même à travers un ressenti commun de besoins similaires et en les formulant non sur convocation du pouvoir et selon des modalités imposées, mais conformément à sa propre volonté. La prise de la Bastille du 14 juillet 1789 résulte de la seule décision du peuple de Paris et non de la mise en œuvre d’une décision institutionnelle !
La quasi-simultanéité des mouvements populaires dans de nombreux pays sur tous les continents peut être le fruit d’une coïncidence.
Certains représentants de la pensée occidentale officielle n’y voient que le fruit de la circulation rapide de l’information, qui « crée l’envie » et donne l’impression d’une révolte globale alors qu’il n’y a que « simultanéité ». D’autres parlent d’un « méli-mélo de revendications incohérentes ». S’expriment ainsi la crainte et le mépris du peuple2.
Il y a aussi une autre hypothèse. Ces réactions d’hostilité à des pouvoirs différents les uns des autres, d’orientation politique et économique parfois opposées, semblent avoir pour cause majeure – en dépit d’une origine immédiate souvent presque insignifiante – les difficultés sociales rencontrées par le plus grand nombre dans des sociétés où règne une inégalité de plus en plus insupportable.
Pour en réduire la portée et faire de ces mouvements des « agitations » irresponsables, les pouvoirs et leurs idéologues occidentaux insistent sur l’existence des réseaux sociaux et sur leur capacité manipulatrice. Ces réseaux produiraient ce « faux » peuple qui ne serait qu’une multitude instable et sans esprit, mais violente et anarchisante. Comme à l’ordinaire, les dominants expliquent le phénomène par la seule existence d’une technologie de communication capable du pire, tout comme les révolutions françaises du passé étaient de « la faute à Voltaire et à Rousseau » ! Les réseaux et internet, accusés de tous les maux, ne sont que le miroir de l’état d’une société auparavant dissimulée. Un miroir n’est pas responsable de ce qu’il reflète ! C’en est fini d’un « bon sens populaire » si souvent invoqué par le passé et des « majorités silencieuses » antérieurement valorisées ! Sont réapparues, avec les manifestations de masse des années 2000, les dénonciations de la « canaille du ruisseau » (comme l’écrivait L’Illustration en 1917 à propos des bolcheviks en Russie) ou de la « chienlit » (comme disait de Gaulle à propos des manifestants de 1968) « ne poursuivant aucun autre but que la destruction de la démocratie et de la Civilisation, comme les anarchistes du début du siècle3 ! »
On peut donc faire l’hypothèse que ce n’est pas le réseau (déjà d’usage courant depuis plus de vingt ans) qui crée le peuple en action, mais que le peuple existe quand il se met en mouvement en réseau et se constitue ainsi en acteur collectif.
On constate que ces mouvements populaires d’aujourd’hui démarrent pour des raisons apparemment dérisoires. Puis, des centaines de milliers de gens se répandent dans les rues des villes. Au Brésil, il s’agit d’exiger le financement de transports collectifs de meilleure qualité ; en Bolivie, de nombreux habitants de La Paz se sont soulevés pour protester contre les prix de l’eau, du gaz et les insuffisances des services publics ; au Venezuela, c’est le prix du ticket de bus qui a provoqué une explosion populaire. En France, le mouvement des Gilets jaunes a débuté pour protester contre une hausse du carburant.
La réalité profonde est évidemment plus complexe. Étant donné qu’il y a toujours un faisceau de causes à l’origine d’un mouvement de masse, une revendication limitée s’inscrit dans un climat d’insatisfaction généralisée.
Si les motivations populaires dans les pays du Nord sont essentiellement d’origine endogène, celles des pays du Sud sont constituées à la fois de facteurs purement intérieurs et de facteurs exogènes. En effet, la faiblesse des pays du Sud permet aux Puissances4 d’exercer des influences pour appuyer ou freiner les mouvements populaires, non seulement par des opérations de propagande, mais aussi par des appuis matériels en cadres militants et en argent. Il est difficile de démêler les forces qui revendiquent légitimement et celles qui canalisent et pervertissent.
C’est ainsi, par exemple, que le « Printemps arabe » et ses révolutions n’ont pas conduit à la promotion des peuples concernés, mais seulement au remplacement d’un personnel politique discrédité permettant le maintien des régimes étroitement liés à l’Occident et en particulier aux États-Unis. L’exemple de l’Égypte du maréchal Al-Sissi en témoigne comme celui de l’Irak post-baasiste. Les mouvements populaires de 2011 dans ces deux pays ont bénéficié d’un fort soutien et davantage encore de la part des États-Unis. En Égypte, par exemple, l’armée est depuis longtemps formée et financée par les Étasuniens. Sa dépendance est donc très forte. En n’intervenant pas pour rétablir l’ordre contre le mouvement populaire devenu maître de la rue, les militaires égyptiens, par leur seule neutralité, ont joué un rôle déterminant. Cette neutralité n’est pas le résultat d’une soudaine solidarité avec le peuple, mais d’une décision prise conjointement avec les instances étasuniennes pour se débarrasser du régime de Moubarak5.
En Amérique du Sud, le renversement du régime de Lula au Brésil et l’avènement d’une direction néofasciste avec Bolsonaro – tout comme l’élimination d’Evo Morales en Bolivie – ne sont pas seulement l’œuvre d’une fraction du peuple mécontente. Le rôle des États-Unis est loin d’être négligeable, tout comme par le passé l’assistance soviétique, cubaine et autres aux mouvements révolutionnaires (en Angola, par exemple, et dans les ex-colonies portugaises d’Afrique)6.
L’interventionnisme de « l’Empire » étasunien, loin d’être « une idée qui libère7 », relève des compétences extraterritoriales qu’il s’est octroyées à lui-même dans tous les domaines, y compris dans celui des « opérations de police », bases d’une souveraineté d’exception échappant au droit international8. Les États-Unis se voient donc reconnaître la capacité de changer les gouvernements et les régimes avec lesquels il y a désaccord : « L’organisation juridique de l’Empire insert l’état d’exception dans la permanence, comme forme d’organisation d’une société mondialisée », écrit Jean-Claude Paye9. La « bonne gouvernance » n’a plus d’autre définition que celle convenant aux intérêts étasuniens, qu’il s’agisse d’une forme de gouvernement ou d’une autre, y compris la dictature.
À la différence de la période de la domination bipolaire américano-soviétique – source d’une neutralisation réciproque des « deux Grands » et d’une relative stabilité des régimes politiques – l’unilatéralisme étasunien10 et la montée en puissance de la Chine et de la Russie créent un climat d’instabilité permanente, car les oligarchies du monde capitaliste sont menacées par les peuples qu’elles gouvernent. Les pouvoirs issus des mouvements populaires, lorsqu’ils se bureaucratisent et perdent leur base sociale, risquent aussi d’être éliminés par une ingérence étrangère ! Les régimes révolutionnaires ne peuvent plus se permettre de commettre des fautes de gestion contredisant leur programme progressiste. Les expériences de transformation radicale sont ainsi fragilisées.
Toutefois, cette fragilité croissante de toutes les catégories de régime a un mérite : dans tous les cas, qu’il s’agisse des régimes néolibéraux ou progressistes, le peuple dans sa diversité tend à se réapproprier l’Histoire contre tous ceux qui la confisquent en s’exonérant de toute responsabilité11.
Désormais, c’est la notion de « peuple » qui fait la différence12 ainsi que la nature de sa colère. Mirabeau soulignait déjà en 1789 que « le mot peuple se prêt[ait] à tout ». Par opposition à la « foule », magmatique, ou à la « majorité silencieuse » (parce que le plus souvent elle n’a rien à dire), le peuple n’existe que dans le combat, lorsqu’une fraction de la population devient acteur. Pour exister, « il doit témoigner de lui-même », selon le juriste Charles Chaumont. À propos du peuple dans la Révolution française, l’historien Georges Lefebvre disait : « La foule se coagule en peuple le 14 juillet », c’est-à-dire en s’affirmant d’abord contre avant d’être pour quoi que ce soit. « Le peuple est l’ensemble de ceux qui ne veulent pas obéir », selon Machiavel, alors que les dominants, autre fraction du peuple, « c’est l’ensemble de ceux qui veulent commander » toujours et pour toujours, dans tous les domaines de la société ! Pour Spinoza, le peuple, « c’est une multitude agissant comme un seul esprit ». Si, effectivement, le « concept de peuple fonctionne à l’émancipation » pour la pensée critique, il est aussi une réalité contradictoire. En effet, il connaît des composantes centrifuges, car il est composite, mais aussi des forces centripètes qui tendent à l’unifier contre ce qu’il n’est pas !
Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, était socialement hétérogène et le pouvoir a tout entrepris pour susciter des divisions et des clans (notamment par la médiatisation de certains contre d’autres). Sa cohésion s’est au contraire confortée au fil des mois pour durer pendant plus d’une année : un fait exceptionnel13. Les provocations et les violences policières ne sont pas parvenues à le faire imploser. Le système n’a pu qu’exprimer son mépris en accusant les Gilets jaunes d’un « populisme » grossier, inculte, allant jusqu’à ignorer ses propres objectifs14 !
Derrière cette arrogance, le régime macroniste a dissimulé sa crainte majeure, celle de découvrir que la lutte des classes est une réalité toujours vivante.
Depuis le début des années 2000, cette multitude est en marche d’un pays à l’autre, sous des formes variées. Elle acquiert le « sens de l’essentiel » et découvre peu à peu, avec une lucidité croissante, les responsables de ces maux : les marchés financiers et la poignée de personnages qui en profitent, qualifiés sommairement de « riches ». Il est clair que ce sont les « riches » qui font depuis toujours la guerre aux pauvres et qu’il est devenu urgent de « dégager » les parasites qui accaparent tous les pouvoirs et toutes les richesses : affairistes, politiciens et médias réunis15.
Il n’y a rien d’anormal de constater que les régimes nés d’une révolution d’orientation socialiste soient aussi contestés dès lors qu’ils ne répondent pas aux besoins sociaux et politiques fondamentaux (pouvoir d’achat, pouvoir réel de décision, maîtrise de l’emploi). La contestation de ces régimes, au terme d’une courte période, peut paraître inéquitable. À titre d’illustration, le chavisme vénézuélien n’est pas responsable de l’effondrement du cours mondial du pétrole, recette essentielle de l’économie nationale. De même, il est difficile de reprocher à Chavez comme à Maduro d’avoir financé la sortie de la pauvreté de nombreux Vénézuéliens au détriment d’une politique (plus « raisonnable ») d’investissements ! Il n’en reste pas moins que le mécontentement des classes moyennes, démultipliant celui inévitable de la bourgeoisie, a résulté d’erreurs de gestion et d’insuffisances dans le travail idéologique16.
Quant au renversement du régime d’Evo Morales, il est le fruit de contradictions inédites nées notamment des réussites des réformes entreprises. En effet, une partie des bambins sortis de la misère s’est constituée en une petite bourgeoisie hostile à l’expérimentation du socialisme indianiste du MAS. Loin d’être reconnaissante, elle s’est associée à l’opposition évidemment irrécupérable de la bourgeoisie favorable au capitalisme et aux États-Unis.
Apparaissent ainsi clairement des problèmes nouveaux. Le fait est, aujourd’hui, qu’un État d’orientation socialiste ne peut compter que sur lui-même pour durer et avancer. Les rapports de forces dans le monde sont encore trop favorables à l’Occident : la Corée du Nord l’a compris il y a longtemps et l’a même théorisé (« Le Djoutché »).
De plus, un nouveau modèle d’émancipation auquel les populations aspirent semble être en gestation. Toutefois, il ne peut plus être fondé exclusivement sur une accumulation quantitative, comme l’ont vécue douloureusement les peuples russes, chinois ou dans une moindre mesure les Cubains. L’objectif ne peut plus être essentiellement une croissance sans fin, proche du modèle capitaliste dans ses méthodes et ses fins. L’austérité extrême que cette voie exige n’est plus concevable sur une planète « transparente ».
Le renvoi des satisfactions matérielles et spirituelles « aux lendemains qui chantent » ainsi que la destruction de la nature et les perturbations climatiques imposent un « écosocialisme », dont le modèle est à édifier. Il n’est porté à ce jour par aucun État et n’est qu’une alternative qui doit être rationnelle et attentive au modèle de production et de consommation à inventer.
En tout état de cause, ni au Nord ni au Sud l’Histoire n’est parvenue à ce stade d’évolution. Ce qui paraît certain, c’est que la société à construire dans cet esprit est très éloignée des modèles simplistes et essentiellement quantitativistes des néolibéraux.
La « pensée » d’un Bernard-Henri Lévy, comme celle de bon nombre de ses collègues en réaction, relativement peu éloignée de celle des « bobos » de la gauche occidentale, ne peut pas simplement être « retournée » en son contraire. L’objectif ne peut être qu’infiniment plus ambitieux17.
Il ne s’agit pas d’opposer ce nouveau « Bien » à un vieux « Mal », d’opposer la société des droits de l’homme (y compris sociaux, économiques et culturels) à l’autoritarisme capitaliste en développement, d’opposer une régulation sociale inédite à l’État de droit bourgeois. Il ne s’agit pas non plus d’opposer la « barbarie » des privilégiés à la « solidarité communiste ». Il n’est plus possible de renouveler les erreurs et les crimes du passé, fussent-ils explicables. La réplique du néolibéralisme, dont la confusion s’accroît au fil de crises de plus en plus insolubles dans un cadre demeurant capitaliste (crise financière, crise écologique, crise sanitaire), est de plus en plus vide. De fait, elle est de plus en plus primitive et vulgaire, animée davantage par les médias que par une intelligentsia de plus en plus attentiste et repliée sur elle-même18. En résumé, la charge contre-révolutionnaire critique le « petit peuple » qui se fait « casseur » et qui est illégitime face à une « élite » seule compétente et aux représentants élus. En supplément, tous les clivages possibles et imaginables sont mis en avant pourvu qu’ils occultent « les conditions sociales qui ne sont plus la cause de rien »19.
Les colères populaires et la haine sociale sont pourtant de plus en plus vives : les dominants les ressentent sans doute plus clairement que les dominés, la domination subie étant source d’aliénations profondes. Mais la conscience d’appartenir au monde des dominés se développe partout, y compris aux États-Unis, par-delà les différences de statut, de revenus et de niveau culturel. Ils perçoivent que le choix du mode de vie leur échappe et que « la » liberté est une notion qui perd toute réalité concrète. Le sentiment qu’ils ne contrôlent rien, qu’ils sont traités en sujets manipulables et non en citoyens responsables, au sein d’une société où règnent des tricheurs privés de rien, s’intensifie. La surabondance des images et du bavardage officiel entraîne une désacralisation et un discrédit de plus en plus accentué de « l’élite », source d’une exaspération « dégagiste ». Un « devoir d’irrespect », selon la formule de Claude Julien, qui a été directeur du Monde diplomatique, s’impose à tous les esprits en réplique à un mépris de plus en plus vivement ressenti20.
Il est probable que cette colère populaire qui monte ne puisse plus être stoppée.
La révolte contre le désordre établi néoconservateur
Les années 2010-2020 ouvrent une ère où des masses de citoyens semblent ne plus avoir peur d’affronter les forces de répression, qu’elles se présentent comme telles pour dissoudre les manifestations ou qu’elles prétendent au contraire assurer une fonction de protection de la liberté de manifestation.
Leur comportement sur le terrain est partout analogue parce que sans doute les mouvements de masse qui se développent ne sont plus défensifs, mais offensifs : il s’agit de moins en moins souvent de refuser des mesures défavorables, mais de faire le procès d’une caste dirigeante suscitant une exaspération globale.
La violence policière ou militaire – proche parfois de celle des mercenaires et nervis relevant du sous-prolétariat et des mafias tolérées pour « services rendus » et dénoncées par Marx dans Le 18 Brumaire de Louis-Bonaparte21 – ne permet plus d’obtenir « l’apaisement » toujours recherché par les pouvoirs.
Les parties en présence ont le sentiment qu’elles sont arrivées chacune pour leur part au terme du supportable et de toute procédure de conciliation et qu’un affrontement direct est inévitable. Le phénomène se répète au Sud comme au Nord, quel que soit le niveau de développement des pays concernés.
Un exemple de réussite
C’est peut-être la « révolution des bougies » de 2016 en Corée du Sud qui inaugure avec succès « l’ère des masses » des années 2000. Des millions de Sud-Coréens ont manifesté leur colère dans toutes les villes de Corée du Sud, « enfant chéri » des États-Unis et de l’Occident en Asie, présentée longtemps comme un modèle pour tous les pays du Sud.
Une série de manifestations immenses, passée sous silence par les médias non asiatiques, a réussi à chasser le parti au pouvoir (le Saenuri) et à obtenir de l’Assemblée nationale de Séoul la destitution de la présidente Park Geun-hye, fille de Park Chung-hee, dictateur brutal des années 1960-1970.
La présidente déchue a même été ensuite jugée et condamnée à une longue peine de prison pour différents crimes et délits (corruption, abus de pouvoir, etc.). Au-delà du groupe dirigeant – dont la conseillère particulière Choi Soon-sil, qui avait aidé la présidente à détourner soixante-deux millions d’euros – c’est tout le système social et économique, y compris les grands patrons de Samsung, Hyundai et Korean Air, qui est mis en cause.
Le mouvement populaire de 2016 est la troisième révolte de l’Histoire contemporaine de Corée du Sud, après celles d’avril 1960 et de mai 198022, qui bouleverse la société et permet les victoires électorales de 2017, dont l’élection à la présidence de Moon Jae-in.
À la suite de ce raz-de-marée populaire et de la victoire électorale du président Moon, s’est produit un dégel des relations avec la Corée du Nord, entraînant les États-Unis dans une politique plus conciliante avec Pyong Yang.
Le nouveau régime sud-coréen a rompu avec des décennies de subordination vis-à-vis des États-Unis en affirmant une souveraineté ignorée depuis la fondation de la République en 1949 et basée quasi exclusivement sur l’anticommunisme. Le président Moon, reprenant la politique éphémère dite du « rayon de soleil » du président Kim Dae-jung – couronnée par le sommet intercoréen Nord-Sud de 2007 – procède à des contacts avec Pyong Yang, comme l’a fait le président Trump lui-même. Ainsi, le peuple sud-coréen, dont l’esprit national est très vivant (comme au Nord), a su réagir aux humiliations venues de l’extérieur, à l’omnipotence des grands groupes sud-coréens maîtres de l’économie nationale et à la corruption source de scandales financiers à répétition.
Une relecture de l’histoire coréenne est en cours, très différente du récit occidental sur la « démocratie » sud-coréenne. Les dizaines de victimes (emprisonnées, torturées et assassinées) de la loi sur la sécurité nationale de 1948, notamment, ne sont plus passées sous silence ! C’est ainsi, par exemple, que le président Moon, en 2018, a lancé le projet d’exhumation des victimes des massacres de l’île de Jeju et l’indemnisation de leur famille, prolongeant ainsi les excuses officielles présentées au peuple par le président Roh en 2003.
C’est une autre Corée du Sud que le peuple sud-coréen mobilisé a réussi à révéler au monde en mettant au grand jour les pages les plus sombres de son histoire et en commençant à travailler à la réunification ultérieure des deux Corées, malgré tous les blocages qui subsistent.
Petit tour en Afrique
Les conquêtes coloniales ont défiguré l’Afrique et tué des millions d’Africains. « L’Afrique n’existe plus, elle a été dépossédée de son espace » par les colonisateurs européens qui ont fait la démonstration que « l’on peut vaincre sans avoir raison », a pu écrire Cheikh Hamidou Kane, le grand écrivain sénégalais23. « L’Afrique doit redevenir elle-même en se basant sur les structures antérieures à la colonisation », comme l’empire du Mali et sa charte du Mandé et ne pas sombrer dans le mimétisme des métropoles ! Il ne s’agit pas d’un retour au passé, mais « d’un recours au passé » !
La subordination coloniale comme les fausses indépendances sont l’héritage d’une série de défaites. Dans l’espace francophone, les exemples sont nombreux.
Défaite cinglante en 1947-1948 à Madagascar24, colonie depuis 1896, malgré les engagements pris par la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale en faveur d’une « union française de progrès ». Le soulèvement de quelques paysans pauvres, suivi d’une insurrection pour protester contre la misère (la « Tabataba ») qui a duré deux ans, s’est achevé par le massacre de plusieurs dizaines de milliers de victimes, œuvre d’une armée coloniale de 30 000 hommes, trois ans seulement après la victoire contre le nazisme !
Défaite au Cameroun25, dont les militants de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) sont emprisonnés dans les pires conditions ou assassinés dans leur pays comme en Europe. Les chiffres des victimes de la répression varient de 20 000 à 120 00026.
Défaite en Côte d’Ivoire où la répression est permanente. Celle-ci s’exerce au nom de la lutte contre le communisme, particulièrement en 1949 contre le Parti démocrate de Côte d’Ivoire (PDCI) et en 1951 contre la RDA, son responsable Samba Amboise ainsi que les manifestants solidaires (arrestations, disparitions, etc.).
Défaite au Congo-Léopoldville, colonie belge.
Défaite de la longue résistance (plus de vingt ans) des tribus libyennes à la colonisation italienne, responsable de déportations massives et de l’exécution du leader Omar El Mokhtar, capturé et pendu en 1931.
Défaite de la résistance algérienne, dirigée par Abdelkader, de 1832 à 1847, de l’insurrection du 8 mai 1945 dans l’Est algérien, dont la répression fit plusieurs milliers de morts.
Défaite de la révolte d’Abdelkrim, dans le Rif marocain de 1921 à 1926.
La conférence de Brazzaville27 (1944), contrairement à la légende, « écarte toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de l’empire ».
En 1960, lorsque les indépendances sont enfin juridiquement reconnues, elles sont en réalité placées sous contrôle de l’ex-colonisateur, qui conserve ses intérêts et qui place ses hommes de confiance.
Le régime de Paul Bya, au Cameroun, est « exemplaire ». Il gouverne depuis quarante ans son pays par la violence et les prébendes28, avec l’assistance des gouvernements français successifs et quelques firmes transnationales dont Elf, Total et Bolloré sont les piliers de la gouvernance de fait du peuple camerounais. Paul Bya a quatre-vingt-six ans et il laisse ses parrains instrumentaliser un multiethnisme qui neutralise les oppositions et favorise l’immobilisme politique, surtout dans les zones rurales.
« Le ras-le-bol des Camerounais vis-à-vis du régime est évident », note le Crisis Grouplui-même le 24 juin 2010, car le régime de Bya est jugé « incapable de se réformer » et « corrompu ». Il a mis les ressources naturelles du pays (pétrole, bois, minerais divers) sous la coupe directe des firmes multinationales. Le résultat est huit millions de pauvres, en nombre croissant, et une violence populaire de plus en plus massive (particulièrement dans les zones anglophones de tendance sécessionniste). Une transition négociée est devenue impossible, puisque la jeunesse est de plus en plus mobilisée contre l’autocratie associée à l’ex-colonisateur.
Bon nombre de dirigeants africains au pouvoir depuis des décennies (au Gabon, au Togo, au Congo Brazzaville, etc.) sont réellement au pouvoir. En témoignent les interventions militaires, notamment françaises au Mali et au Tchad, dont les finalités sont incertaines29.
Au Mali, le sentiment populaire de vivre en pays à la fois occupé par l’armée française et sous-administré par un gouvernement corrompu a grandi. Les citoyens considèrent en effet que le pouvoir d’Ibrahim Babacar Keita (« IBK ») s’est avéré incapable d’assurer la sécurité et la souveraineté du pays, de régler le contentieux entre Peuls et Dogons tout en usant de la violence contre les opposants. Le Mali, bien que soutenu par la France (qui dépense 600 millions d’euros pour ses interventions militaires) occupe le 175e rang (sur 186) selon les Nations unies en termes d’indice de développement humain. Les élections ne pouvant se dérouler dans des conditions régulières – et aucune solution militaire n’étant en vue dans les régions du pays où l’armée française intervient contre les djihadistes – la seule perspective est l’intervention massive du peuple malien lui-même, comme en août 2020. Celui-ci installe alors à Bamako une nouvelle élite issue du mouvement populaire30, qui manque cependant de cohésion et qui est peut-être pénétré par les islamistes.
Au Tchad, l’opposition en mesure de prendre le pouvoir – et qui ne supporte plus vingt-neuf années du régime d’Idriss Déby installé par la France – est éliminée en 2008 par une intervention de l’armée française. Elle était déjà présente et armée dans le centre de N’Djamena. En 2019, les forces armées qui s’approchaient de la capitale sont stoppées et bombardées par l’aviation française. Les rafles pratiquées contre les militants et leur disparition fréquente ouvrent la porte à la guerre civile.
Précédemment, l’État français avait réussi à faire liquider Thomas Sankara au Burkina Faso ainsi que sa révolution marxiste, la plus authentique sans doute des révolutions africaines. Il s’est ensuite débarrassé de Laurent Gbagbo et du socialisme modéré du FPI au bénéfice d’un représentant des milieux d’affaires, Ouattara, en soutenant des forces rebelles hétéroclites.
Dès l’indépendance du Congo-Léopoldville, la Belgique a aussi été en mesure – avec l’aide des services étasuniens – d’éliminer Patrice Lumumba, trop souverainiste. Ella ainsi pu fabriquer un État zaïrois pro-occidental, malgré ses divisions internes.
Les indépendances ont ainsi été volées aux peuples africains, condamnés à s’insérer en position de grande faiblesse dans la mondialisation néolibérale et à adopter des institutions calquées sur celles de l’Europe. La « clé » (d’inspiration occidentale31) du progrès démocratique et social se limite à l’émergence d’une « société civile » qui ne s’oppose pas à l’État, mais défend simplement son autonomie (telle, par exemple, celle de l’une de ses composantes, les mouvements de femmes). Les ONG internationales et locales sont censées créer un espace de négociation et de lutte pour la démocratisation, mais à distance des masses populaires. Elles tendent à « accompagner » l’État conservateur beaucoup plus qu’à le mettre en cause.
En revanche, l’Afrique des années 2000 connaît des mobilisations populaires inédites s’en prenant frontalement au pouvoir et acceptant d’en payer le prix (les victimes de la répression sont nombreuses !)32.
La contestation frontale et massive ne cesse de se développer, sous des formes diverses, mais a pour origine des causes semblables : la longévité jugée pathologique de la classe politique au pouvoir, et particulièrement des chefs d’État ; le creusement des inégalités sociales et la pauvreté, alors que règne la corruption au sommet de l’État ; la faiblesse et l’esprit (fluctuant) de conciliation des partis d’opposition plus ou moins discrédités ; l’absence de souveraineté nationale et le refus de l’ingérence des ex-puissances coloniales, des États-Unis, de la Chine et du FMI33.
La spécificité de chaque mouvement contestataire qui met l’accent sur tels ou tels points provient du particularisme de sa structure sociale : la présence plus ou moins forte des étudiants, de la jeunesse citadine et des intellectuels, la place occupée ou non par l’armée, la présence de la classe ouvrière, des chômeurs et des couches moyennes, etc.
À la différence des luttes menées dans les années 1990 en faveur d’une « transition démocratique » qui n’a pas eu lieu – se finalisant en négociations « par le haut » portant sur des réformes institutionnelles sans grande portée –, le mouvement des années 2000 a un contenu plus radical (il y a incompréhension de la rationalité dominante du système). De plus, il est axé sur les questions sociales et la nécessaire « seconde indépendance » nationale.
C’est ainsi que la mainmise des firmes transnationales est violemment dénoncée par le mouvement « Y’en a marre » (Sénégal) et « Filioubi » ou « Le Lucha » (Congo-Kinshasa). La conscience que la politique des grandes firmes et celle du FMI (source d’une dette insurmontable) ne permettent qu’un « mal développement » s’y impose de plus en plus clairement. Quant à la souveraineté « oubliée » durant la période antérieure où régnait l’illusion d’une mondialisation ouverte « efficace », elle est réapparue au cœur de la contestation des jeunesses africaines34.
Ni la violence des milices et de l’armée ni les élections (en particulier celle de 2019 avec la victoire de Félix Tshisekedi) ne sont acceptées par la population qui, dans un pays particulièrement riche en matières premières, vit (pour les deux tiers) au-dessous du seuil de pauvreté. Les manifestations, qui ne cessent pas, réclament une alternance véritable, sans être encore en mesure de peser sur l’évolution du pays.
En Côte d’Ivoire, le régime, instauré par la victoire du Front populaire ivoirien et Laurent Gbagbo, est éliminé en 201135 par une rébellion armée soutenue par la France, le Burkina Faso de Compaoré et les États-Unis, inquiets des orientations de Laurent Gbagbo. Ce dernier s’interrogeait sur les accords à conclure avec la Chine notamment, sur l’éventuelle remise en cause du franc CFA et plus généralement sur le poids de la Françafrique toujours vivante.
Malgré les divisions du FPI, le mouvement anti-Ouattara – stimulé par l’acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale – a redonné force à une contestation globale de l’influence occidentale et du poids des grands groupes français et étasuniens sur l’économie nationale.
En Éthiopie, les masses populaires l’ont emporté. Le nouveau régime d’Abiy Ahmed a dès lors commencé à modifier la situation internationale avec, par exemple, un accord avec l’Érythrée, et en interne avec la libération des prisonniers politiques ainsi que la recherche des dizaines de milliers de militants disparus. En effet, en 2015-2016, le pouvoir précédent avait procédé à l’arrestation de 22 000 agriculteurs qui luttaient contre l’accaparement de leurs terres par l’État pour favoriser la minorité tigréenne. Ainsi, le mouvement populaire, en particulier les citoyens favorables à l’OLF (Front de libération Oromo), représentant un tiers de la population, a réussi la première étape d’un changement réel.
Les événements du Burkina Faso36 constituent également une illustration significative, mais d’autres exemples sont aussi éclairants (Burundi, Togo, Congo-Brazza, Gabon, Tchad, etc.).
En 2011, à l’occasion de la quatrième élection consécutive de Blaise Compaoré à la présidence, le Burkina Faso a connu une vague de contestations sans précédent. Le président s’est même vu contraint de se réfugier dans son village natal, mais sans pour autant que l’opposition obtienne son départ, alors que seulement 1 357 000 électeurs avaient voté pour Compaoré sur plus de sept millions de citoyens ! En octobre 2014, cependant, l’ampleur du mouvement populaire l’emporte à l’occasion d’une initiative de révision constitutionnelle pour permettre l’obtention d’un cinquième mandat du président sortant ! Le « pays réel », selon la formule d’Halidou Ouédraogo – fondateur du Mouvement pour les droits de l’homme burkinabé, plus radical que les forces politiques traditionnelles acceptant des compromis successifs proposés par la présidence – a fini par obtenir le départ de Compaoré. Ce dernier a été « exfiltré » par la France37 du président Hollande, avant d’être accueilli au Maroc, puis en Côte d’Ivoire.
La stratégie de Compaoré alterne, envers l’opposition, entre répression (assassinats du journaliste Zongo, du leader étudiant Dabo Boukary, etc.), changement de personnel politique, compromis avec les forces réformistes et promesses avortées. Elle lui a permis de durer jusqu’à l’extrême limite. Mais les sources d’irritation sont multiples. En effet, la jeunesse – y compris diplômée – vit dans la précarité et son organisation « Le balai citoyen » est en rupture avec leurs aînés discrédités par la corruption ambiante (particulièrement les élus locaux). De plus, l’insuffisance de droits sociaux et la faiblesse des salaires mobilisent les syndicats de travailleurs du secteur public. Enfin, la base de l’armée, en tension avec la hiérarchie militaire, est mécontente. Tous ces mécontentements se sont coagulés pour abattre le régime. De fait, le « cloisonnement social » a fini par être dépassé tant la légitimité du système Compaoré était atteinte par la succession de mouvements populaires et la « politique du vide » qui prétendait y répondre38. Il est apparu ainsi que l’élément spontané poussant au rejet et présent au cœur de chacun des groupes sociaux était « la forme embryonnaire du conscient », apte à les fédérer, au moins partiellement, et à commencer à édifier une volonté politique commune.
Bien évidemment et en résumé, le « circuit » de l’exploitation de l’Afrique par les grandes firmes est simplement fragilisé. Il n’est pas interrompu39. À l’impossibilité pour les États africains de respecter les objectifs imposés par le FMI pour rembourser leur dette aux organismes financiers privés et de supporter la baisse du prix des matières premières qu’ils exportent sans les transformer, s’ajoute désormais un désordre dû à une mobilisation politique remettant en cause les complices locaux d’une recolonisation de fait.
Petit tour en Amérique du Sud
L’effervescence règne aussi sur le continent sud-américain. Partout, la chute du prix des matières premières provoque des dégâts sociaux. C’est le cas pour le pétrole du Venezuela, victime de surcroît d’un embargo très strict. C’est le cas aussi pour le pétrole équatorien, pour les minerais du Pérou, le gaz et le lithium de Bolivie, etc. Partout, les couches populaires sont écrasées par une pauvreté dont elles ne sont pas responsables et les couches moyennes (aux alentours de plus ou moins 25 % du revenu médian) subissent une paupérisation accélérée. C’est le cas en Argentine et au Chili par exemple, dont la gestion était inspirée des « Chicago Boys », élèves de Milton Friedman.
En apparence, il y a combat permanent entre courants progressistes anticapitalistes et courants conservateurs néolibéraux, avec une alternance de succès et de défaites respectives.
Le début des années 2000 est en effet illustré par une forte dynamique progressiste avec l’apparition de régimes de « gauche et de centre gauche », fruits d’une conjugaison de mouvements populaires et d’élections victorieuses. Dans un second temps, les forces conservatrices – passées à la contre-offensive par la voie du coup de force (comme au Honduras 2009) ou des succès électoraux (au Chili ou en Colombie en 2010) – reprennent le pouvoir.
Une nouvelle alternance semble se préparer ces dernières années avec le développement de mouvements populaires de masse se confrontant à des violences policières de plus en plus systématiques.
La réalité est cependant plus complexe et la situation très mouvante est en voie de renouvellement sous l’effet de fortes contradictions.
Les gouvernements conservateurs néolibéraux en situation financière difficile obéissent aux exigences du FMI pour en obtenir les prêts réclamés. L’austérité sévère que les plans d’ajustement structurels exigent provoque des oppositions sociales de plus en plus radicales, réprimées de plus en plus violemment par une police, une armée et des milices fascisantes. L’extrême droite est donc entrée en compétition politique avec les conservateurs traditionnels.
Les forces politiques ainsi que les gouvernements de gauche sont de même affaiblis par les contradictions survenues avec les nombreux mouvements sociaux, où les Amérindiens, en particulier, jouent un rôle croissant. Ces mouvements populaires, héritiers de l’expérience zapatiste et de ses communautés qui se sont ancrées sur le territoire du Chiapas au Mexique, ne se satisfont pas de l’amélioration de la condition sociale que réalisent les gouvernements progressistes ou qu’arrachent les syndicats. Inspirés par la culture amérindienne, ils s’opposent même à la position « productiviste » des gauches traditionnelles et à « l’extractivisme », détruisant la nature à des fins industrielles. Plus que des réformes sectorielles, ils revendiquent des changements structurels. Sans attendre, ils établissent des micropouvoirs avec des entreprises, des écoles ou des exploitations agricoles. C’est le cas en Argentine, où nombre d’usines ont été récupérées par les travailleurs et en Colombie, où sont nés 12 000 « aqueducs communautaires ». Au Mexique, en Argentine, en Équateur, ces communautés ont organisé des formations scolaires inédites et développé une politique culturelle importante (sites, revues, radios, etc.). Au Brésil, le Mouvement des paysans sans terre cultive des milliers d’hectares appartenant aux grands propriétaires fonciers !
Les forces conservatrices ont, dans un premier temps, vu dans ces expériences, jugées certes « dangereuses », un moyen d’affaiblir les forces politiques de gauche40, rivales pour le contrôle des institutions. Il s’avère que, progressivement, malgré des conflits, les gauches et les mouvements sociaux se sont rapprochés et se sont engagés dans un processus de radicalisation, de type « dégagiste » : « Qu’ils s’en aillent tous ! » Le nouvel affrontement qui a commencé semble donc concerner désormais les structures mêmes du capitalisme sud-américain et la propagande occidentale ne s’y trompe pas !
Le Chili du président milliardaire Pinera est tout particulièrement la cible d’une véritable révolte populaire, alors qu’il était présenté en Occident comme un modèle de pays stable et en croissance régulière de plus 2 %. En réalité, le Chili figure parmi les pays les plus inégalitaires du monde. En effet, 1 % des plus fortunés possède 26,5 % de toutes les richesses du pays. Les retraités connaissent de graves difficultés avec un système de capitalisation qui leur est défavorable. La Constitution de Pinochet de 1980, toujours en vigueur, facilite une répression brutale : les victimes sont nombreuses à chaque manifestation. Cette répression s’exerce particulièrement contre les Amérindiens Mapuche d’Araucanie, de plus en plus mobilisés. Ils réclament la restitution de leurs terres bradées aux firmes transnationales et dont les droits – reconnus aux peuples autochtones en 2007 par la déclaration du 13 septembre des Nations unies – sont systématiquement violés41.
Après la grande mobilisation étudiante de 2011, les forces politiques et syndicales de gauche se regroupent dans le cadre de la table d’unité sociale. Selon le professeur Gaudichaud, coprésident de l’association France-Amérique latine42, la révolte de 2019 n’est encore qu’urbaine, même si elle montre que « la marmite est sur le point d’exploser », malgré le couvre-feu et l’état d’urgence rétablis comme à l’époque de Pinochet. Comme sur les chaînes de télévision françaises lors des manifestations de Gilets jaunes, la télévision chilienne diffuse des scènes de pillages qui passent en boucle et montre avec beaucoup moins de force les mouvements de protestation qui ont lieu tous les jours. Les manifestants sont qualifiés « d’ennemis de l’intérieur » ayant pour « seul but d’engendrer le plus de dommages possibles », selon le président Pinera43.
Les manifestations de masse contre le régime néofasciste de Bolsonaro au Brésil44, qui vise à effacer les acquis sociaux qu’avaient fait adopter les présidences Lula et Roussef de 2003 à 2016, ébranlent un pays (y compris l’armée). Le nouveau président, avec l’appui des États-Unis, tente tout de même de se constituer en bastion du conservatisme en Amérique du Sud, particulièrement avec le glissement à gauche du Mexique et la stabilisation de la situation au Venezuela45.
Le président Lula, condamné abusivement à douze ans puis huit ans de prison ferme, a pu ainsi obtenir une libération provisoire dans le cadre d’une intense bataille juridico-politique, soutenue par des manifestations permanentes.
Une autre illustration significative du néofascisme brésilien concerne les universités. À la répression contre les étudiants et les professeurs, accusés de « semer le désordre », s’ajoute la réduction de 30 % du budget de l’enseignement supérieur à partir d’une vision purement utilitariste (notamment la suppression du financement de la philosophie et de la sociologie).
De plus, l’armée, omniprésente au gouvernement, favorise une alliance étroite avec les États-Unis (octroi d’une base de lancement spatial, installation d’une base militaire, etc.). S’y ajoute l’usage de l’article 142 de la Constitution (recours à la force armée « pour le maintien de la loi et de l’ordre »), qui fait de l’armée une garde prétorienne. Ainsi, Bolsonaro tend à réaliser le mariage de l’armée et du libre marché en écartant tous les obstacles y compris le Parlement et la Justice !
Malgré l’installation d’une dictature conservatrice ouverte, une large partie de la société brésilienne qui avait combattu les erreurs du régime Lula en 2013, sources de profondes désillusions46, se retrouve aujourd’hui dans le camp de l’opposition sans crainte de s’affronter, dans un esprit nouveau de type « dégagiste »47. À celui-ci n’échappent que les rares personnalités comme Lula, qui symbolise, pour nombre de Brésiliens, la sortie de la misère.
En Haïti, le peuple manifeste presque tous les jours depuis février 2019 et ce, malgré une répression policière qui fait des morts tués par balle, lorsque ce ne sont pas des gangs financés par le trafic de drogue48, le patronat et le gouvernement, lesquels interviennent avec la plus grande violence.
Le peuple demande la démission du président Moïse, élu en 2017 avec 21 % de participation, accusé de corruption et d’incompétence.
Haïti ne s’est pas relevé du séisme de 2010 (200 000 morts et 1,5 million de sans-abris). L’aide internationale a été détournée et la corruption du régime du président Moïse a même été dénoncée par la Cour des comptes. Cette dernière a, dans un rapport de juin 2018, mis en cause une quinzaine de ministres et de hauts fonctionnaires. Le programme de Moïse était pourtant axé sur l’élévation du pouvoir d’achat. Le résultat est la dévaluation de la monnaie nationale, une inflation de 15 %, la hausse des prix des produits de base, 60 % de chômeurs et six millions de Haïtiens au-dessous du seuil de pauvreté (2,4 dollars/jour) ! Deux millions d’enfants ne sont pas scolarisés. 500 000 personnes sont en situation de préfamine et un Haïtien sur trois se trouve en insécurité alimentaire49.