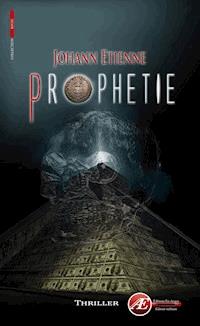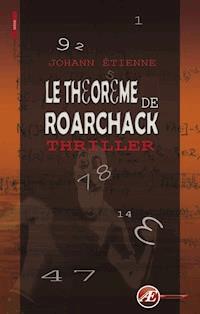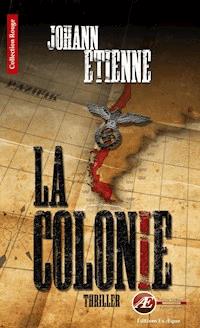
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rouge
- Sprache: Französisch
À l’ombre de la cordillère des Andes, la bête immonde a survécu…
Samuel Atlan possédait la capacité de se souvenir de tout. Un cas rare d’hypermnésie, selon les médecins. Une mémoire sans faille, à l’exception d’une seule : Samuel ne se rappelait rien de ce qui précédait le jour où on l’avait trouvé, à l’âge de sept ans, errant au bord d’une route. Quand son passé refait surface de la plus singulière des façons, il se retrouve confronté aux versants les plus sombres de la science nazie, traquant sans le savoir, entre Paris et les plaines du Sud chilien, l’un des pires monstres qu’ait engendré l’Histoire…
Suivez la traque haletante d'un ancien nazi à travers l'Amérique du Sud, dans ce thriller historique palpitant.
EXTRAIT
"— Yacine Chouqri, vingt-huit ans et plus vraiment toutes ses dents.
Le trait d’humour de Berthaux, le géant, ne dérida personne. Un œil jeté sur la victime suffisait à comprendre pourquoi. L’homme avait visiblement subi un passage à tabac dans les règles. Son visage tuméfié n’était plus qu’un amas de chair informe, tandis qu’on devinait à la disposition du cadavre que plusieurs de ses membres avaient été brisés. Ce qui frappait sans doute le plus, pourtant, c’était la position inhabituelle de la tête, qui formait un angle à cent quatre-vingts degrés avec le reste du corps. La précision du légiste s’imposait."
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Les fans de roman historique prendront autant de plaisir à cette lecture que les amateurs de littérature noire ou de roman d'espionnage." - Blog Ceci Bon... de Lire
"Je n’ai pu lâcher le livre sans en connaître l’issue. Addictif et jubilatoire." - Les chroniques de Mandor
"Un roman bien construit où se ressentent beaucoup de recherches afin d'en faire un thriller aux faits vraisemblables ! D'ailleurs comme le mentionne sa biographie, l'auteur se sert de faits réels qu'il manie de manière à en faire une histoire haletante et intrigante à souhait, pleine de rebondissements ! Il n'y a pas un moment où l'on a le temps de s'ennuyer dans ce roman !" - Blog Des livres plein la bibliothèque
"Beaucoup de mystères, de secrets, de manipulations et une énorme machination qui a commencé durant la seconde guerre mondiale. Fiction se basant sur des faits réels, le résultats n'en est que plus effroyable. Percutant." - Fan06, Booknode
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1975 à Troyes, dans l'Aube, Johann Étienne écrit depuis l'âge de seize ans. Passionné d’Histoire et d’actualité, il se sert des réalités qui nous entourent pour élaborer intrigues et personnages au profit de romans de fiction policière.
Il est l’auteur de deux précédents thrillers, Le Théorème de Roarchack et Prophétie, et d’un roman court intitulé Le Plan, tous trois parus chez Ex æquo. La Colonie est son quatrième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Colonie
Résumé
Remerciements
Note de l’auteur
Prologue
Quimera
Colonia Libertad
Memoria
Frontera
Johann Etienne
La Colonie
thriller
ISBN : 978-2-35962-6209
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal mai 2014
©couverture Ex Aequo
©2014 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
Éditions Ex Aequo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières les bains
www.editions-exaequo.fr
Résumé
À l’ombre de la cordillère des Andes, la bête immonde a survécu…
Samuel Atlan possédait la capacité de se souvenir de tout. Un cas rare d’hypermnésie, selon les médecins. Une mémoire sans faille, à l’exception d’une seule : Samuel ne se rappelait rien de ce qui précédait le jour où on l’avait trouvé, à l’âge de sept ans, errant au bord d’une route.
« La Terre s’est imposée l’Homme pour châtiment. »
Pablo Neruda
Aux infatigables chasseurs.
Remerciements :
Je remercie en premier lieu les Éditions Ex Aequo d’avoir permis que ce livre puisse se trouver en ce moment même entre les mains de ses lecteurs.
J’adresse ensuite, des remerciements tous particuliers à Céline, pour la qualité de ses corrections, ses précieux apports littéraires et sa vision de femme et de mère sur le personnage de Paulina.
Note de l’auteur
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la trame de ce roman se base sur des faits authentiques. Pour les besoins de l’intrigue, personnages, dates et lieux ont été modifiés ou crées de toutes pièces, mais la réalité historique rejoint sans cesse la fiction, croisant les fils d’une histoire à peine croyable, celle d’une Colonie dont aucun romancier n’aurait pu imaginer l’existence.
Tout commence en l’Allemagne, à la fin des années cinquante, quand un certain Paul Schaefer, ancien brancardier de la Wehrmacht, est contraint de fuir son pays à la suite d’un mandat d’arrêt pour abus sexuels sur mineurs. Il trouve refuge au Chili, où il y acquiert, en 1961, quelques milliers d’hectares de terres à quelques kilomètres de Parral (la San Joachim du roman) pour y fonder la Colonia Dignidad (Colonie Dignité), une société de bienfaisance aux allures de forteresse, avec barbelés, miradors et caméras de surveillance.
Lorsque Pinochet prend le pouvoir en 1973, la Colonie, qui possède désormais sa propre école et son propre hôpital, devient une annexe de la DINA, la police politique. On y pratique la torture sous l’égide du maître des lieux. Puis la démocratie revient en 1990. Pendant tout ce temps, des personnes disparaissent, d’autres meurent, d’autres encore s’évadent de l’enclave et témoignent. Peu à peu, le Chili prend la mesure des exactions perpétrées par Schaefer et ses sbires.
Quelques timides enquêtes sont pourtant menées depuis les années soixante, qui se multiplient après la chute de la dictature. Entre perquisitions ratées et procédures qui n’aboutissent jamais, la justice chilienne se montre cependant particulièrement inefficace lorsqu’il s’agit de se pencher sur les vestiges des années noires. En 2005, malgré les puissantes protections dont il bénéficie, Paul Schaefer est finalement rattrapé par ses juges, arrêté en Argentine et condamné l’année suivante à vingt ans de réclusion. Il est mort en prison en 2010. Aujourd’hui, la Colonie (rebaptisée entre temps Villa Baviera) est devenue… un centre de vacances !
Sur ce sujet, je remercie grandement Frédéric Ploquin et Maria Poblete pour leur remarquable travail d’investigation intitulé « La colonie du docteur Schaefer » (Fayard, 2004), travail qui m’a servi de bible et sans lequel ce roman n’aurait pu voir le jour.
Quant aux Lebensborn, ces désormais tristement célèbres « maternités » SS, l’un des plus terrifiants projets entrepris par les nazis, elles ont vu naître près de vingt mille enfants entre 1935 et 1945. Soixante-dix ans après les faits, certains d’entre eux n’ont découvert leurs véritables origines que très récemment. À lire à ce propos l’enquête édifiante de Boris Thiolay intitulée « Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits » (Flammarion, 2012).
Prologue
D’abord, l’obscurité, lourde, impalpable, absolue. Puis vint le froid, paralysant les membres, engourdissant les muscles et les pensées. La tête enfouie dans ses genoux, il ne sentait plus rien, à présent ; comme si son corps tout entier s’était dissous dans les ténèbres glacées. Seuls les soubresauts de la carlingue, à l’approche de l’atterrissage, vinrent le tirer de sa léthargie.
Peu à peu, avec toutes les peines du monde, il déplia bras et jambes, et leva les yeux. Le choc soudain des roues sur le tarmac le fit bondir en tout sens, pantin désarticulé contraint de s’agripper à une cage métallique recouverte d’une bâche, de laquelle surgit une gueule noire aux crocs menaçants. Les chiens aussi voyageaient en soute. Le molosse venait le lui rappeler avec force.
Le calme, de nouveau. Recroquevillé dans un coin, il lui faudrait attendre, encore. Dix heures plus tôt, il se réveillait là, sans presque aucun souvenir de la manière avec laquelle il y était parvenu. Peu lui importait, en vérité. Malgré le froid et la faim, malgré cette fuite éperdue qu’il croyait ne jamais voir finir, il avait survécu. Au-dehors, un monde nouveau l’attendait, loin de ce bon docteur, loin de la Colonie.
Lorsque la porte du compartiment à bagages s’ouvrit enfin, les premières rumeurs de l’extérieur éveillèrent un à un tous ses sens. Les lumières vives et aveuglantes des véhicules de piste, virevoltant dans la nuit tel un ballet anarchique, balayèrent ses rétines, tandis que des voix s’exprimant dans une langue inconnue lui parvenaient aux oreilles.
Éviter les contrôles lui serait impossible, il le savait. Éclairé de toutes parts, l’aéroport international Roissy Charles de Gaule ne dormait jamais, malgré le calme apparent de la nuit. Sous le regard invasif d’une nuée de caméras de surveillance, chaque mètre carré du terminal était épié, scruté dans ses moindres détails. Aucune chance d’y échapper.
Il n'avait pas fait tout ce chemin, pourtant, franchi les montagnes et les océans pour renoncer maintenant. Alors, d'un geste, il détendit ses jambes et bondit hors de la soute, sous les regards médusés des bagagistes impuissants. Ses pieds avaient à peine touché le sol que déjà, derrière lui, des cris donnaient l'alerte.
Il courait, à présent, aussi vite que sa fragile constitution lui permettait de le faire. Sous ses semelles élimées, il pouvait presque sentir le bitume rugueux lui griffer la plante des pieds. Face à lui, à cent mètres à peine, la clôture grillagée, synonyme de salut. Derrière elle, il serait libre, plus libre qu’il ne l’avait jamais été. Son cœur martelait sa poitrine, tandis que son visage émacié s’affichait à présent sur tous les écrans de contrôle. Vigipirate aurait bientôt raison de sa cavale, sans même qu’il ait jamais entendu prononcer ce nom.
Cinquante mètres encore. Si près, si loin pourtant. Dans son dos, les policiers lancés à ses trousses vociféraient des ordres qu’il ne comprenait pas. Les muscles tétanisés par sa course éperdue, il consacra ses dernières forces à tenter de leur échapper, avant qu’une boursouflure sur l’asphalte ne le fasse trébucher et s'affaler de tout son long dans une flaque aux reflets irisés d’hydrocarbure.
Couchée sur le flanc, la bête traquée ne chercha même pas à se débattre. Apeuré, l’homme se recroquevilla sur lui-même, ignorant les cris et les injonctions. D’effroyables images lui revinrent brutalement en mémoire : l’odeur du sang, les aboiements des chiens, le bruit des os qui se brisent sous les coups.
Trente minutes plus tard, il se trouvait seul dans une petite pièce à l’éclairage blafard, assis à une table de métal, menotté sur sa chaise, encore étourdi par sa fuite avortée. Punaisé au mur, un calendrier de la compagnie Air France marquait l’année 2005. Le clandestin ne parvenait à dévier son regard de la date, comme s’il découvrait une information qui lui était inconnue. Aucun bruit, autre que celui du crépitement des tubes au néon, ne venait troubler le silence, jusqu’à ce que des voix se rapprochent, accompagnant des silhouettes maintenant visibles au travers de la vitre dépolie d'une porte close.
— C’est comme je te le dis, j’y comprends rien !
L’officier des douanes, un quadra bedonnant au visage rougeaud, entra en trombe, scandant ses mots en agitant les bras. Derrière lui, son collègue, la trentaine juvénile, tout aussi perplexe, jeta un regard stupéfait sur le clandestin.
— Ben merde alors, t’as vu ses yeux ?
— Bien sûr que j’ai vu ses yeux, mais c’est pas pour ça que je t’ai fait venir. T’es bien Alsacien, non ?
— Oui, mais je vois pas le rapport. Tu m’as dit que ce type venait du Chili…
— Interroge-le, tu vas comprendre.
— Moi ? Je parle pas un mot d’espagnol !
— Pas en espagnol, triple buse, dans le patois de ta région !
Circonspect, le douanier s’exécuta néanmoins, bredouillant une vague question dans une langue qu’il n’avait pas pratiquée depuis l’enfance. Lorsque l’autre lui répondit, il se tourna, hagard, vers son collègue.
— Alors ?
— Alors, c’est pas de l’alsacien. C’est de l’allemand !
I
Quimera
— chimère —
Chimère (n. f.) :
1. Monstre fabuleux à tête de lion, corps de chèvre et queue de dragon qui vomit des flammes.
2. Individu porteur de caractères génétiques issus de deux génotypes différents.
1
Cabinet du docteur Blöhm. 10 h 33.
Deuxième séance.
Les yeux grands ouverts, le patient fixait le plafond d’un regard absent. Les pupilles dilatées, il entamait son voyage intérieur, naviguant à l’aveugle dans les méandres de son subconscient. Seule la voix du praticien vint rompre le silence. La suggestion pouvait commencer.
— Détendez-vous et imaginez un endroit rassurant. Où vous trouvez-vous ?
— Je suis… dans une pièce toute blanche.
— Quel âge avez-vous ?
— Sept ans.
— Très bien. À présent, imaginez que les murs de cette pièce s’effacent peu à peu. Qu’y a-t-il juste derrière ?
— Je vois… un long ruban sombre qui serpente devant moi, comme… comme un chemin ou une route.
— Savez-vous où conduit cette route ?
— Non. Il y a de l’eau devant mes yeux.
— D’où vient cette eau ?
— Du ciel. Les gouttes glissent devant moi, mais je ne les reçois pas.
Assis dans son fauteuil Chesterfield, Matthias Blöhm écrasa sa cigarette sur le cristal d’un cendrier garnissant le guéridon voisin. Dans la pénombre de son bureau cossu, d’imposantes bibliothèques de bois sombre exposaient les flancs austères d’ouvrages presque exclusivement consacrés à la psychanalyse. En face d’elles, un sofa aux lignes résolument contemporaines, seule concession à la modernité, semblait flotter au-dessus du parquet de chêne.
Le silence feutré qui régnait dans la pièce n’était interrompu que par la percussion d’une pendule à balancier, égrainant les secondes comme un métronome. Une régularité nécessaire à l’état hypnotique dans lequel se trouvait plongé le patient. Étendu sur le divan, ce dernier livrait par bribes les souvenirs d’un événement que Blöhm s’ingéniait à faire émerger des profondeurs de sa mémoire.
En quarante années de pratique, le psychanalyste faisait figure de référence dans le domaine de l’hypnose. Il y avait consacré l’essentiel de sa carrière, de sa vie même, consumant deux mariages, balayant d’un revers de main quasi freudien toute idée de descendance. D’une certaine manière, l’hypnose s’était rendue maître de son propre praticien, au détriment d’une vie privée digne de ce nom. Et quand bien même en éprouvait-il quelque regret, du moins possédait-il la pudeur de ne jamais en faire état.
— Sur quoi s’écrasent ces gouttes ?
— Sur une vitre. Il y a des vitres autour de moi, comme une cage de verre. On dirait que… la cage avance sur le ruban sombre.
Le psychanalyste regroupa les informations que lui donnait le patient, puis ouvrit une large accolade devant laquelle il inscrivit les mots suivants : « Voiture ? Route ? Pluie ? »
— Connaissez-vous la destination de la cage de verre ?
— Non. Il y a du brouillard sur le verre. Je m’amuse à y écrire mon nom.
— Êtes-vous seul dans cette cage ?
— Je crois que… non.
— Qui sont les autres personnes ?
— Il y a un homme et une femme devant moi.
— Qui sont-ils pour vous ?
— Je ne sais pas. Je ne vois pas leurs visages.
— Y’a-t-il d’autres personnes dans la cage ?
— Je ne crois pas.
Blöhm extirpa un paquet de cigarettes de la poche de sa veste de tweed et poursuivit.
— Parlez-moi de cet homme et de cette femme. Est-ce qu’ils vous parlent ?
— Ils… Ils se disputent.
— À quel propos ?
— Je ne sais pas. Ils parlent, mais je ne comprends pas ce qu’ils se disent.
Silence.
— J’ai peur…
— De quoi avez-vous peur ?
— Je ne sais pas. Quelque chose n’est pas normal, comme si… comme nous n’étions pas seuls sur le ruban sombre.
L’heure impartie arrivait à son terme. Le thérapeute interrompit la suggestion, faisant doucement revenir le patient dans la sphère temporelle du présent. La première séance n’avait été qu’un long entretien d’usage, ponctué de questions de toutes sortes. Celle qui s’achevait à l’instant donnait déjà des résultats très satisfaisants, malgré les réticences émises par son client lors de leur rencontre initiale. Le débriefing, lui, fut réduit au minimum. Il faudrait encore de nombreuses sessions avant qu’apparaissent les premières certitudes.
***
2
Villepinte, Hôpital Robert Ballanger. 9 h 07.
Blancheur aseptisée, cliquetis métalliques des brancards qu’on déplace, personnel affairé. En ce début de matinée, les couloirs du service des Urgences grondaient déjà des plaintes des patients en attente. Traversant la cohue tel un canoë dominant des rapides, le docteur Yann Kessler entamait sa vingt-deuxième heure de garde consécutive avec l’énergie d’un interne de première année.
Et pour cause. Le cas qu’on venait de lui soumettre avait de quoi attiser bien des questionnements. Déjà, devant la porte de la chambre, une demi-douzaine de curieux se pressait pour tenter d’apercevoir « le patient X », ainsi que l’avaient surnommé les agents hospitaliers. Il était arrivé dans le service au beau milieu de la nuit, encadré de deux officiers de la police des douanes. Un clandestin, arrêté alors qu’il tentait de prendre la fuite sur le tarmac de Roissy Charles de Gaule. Un Chilien, à ce qu’on racontait.
De ce qu’on savait de lui, l’homme avait fait un malaise quelques heures seulement après son arrestation, alors qu’on le soumettait à l’interrogatoire d’usage. Très vite, la rumeur s’était répandue dans les couloirs : l’inconnu n’avait rien d’ordinaire, rien, en tout cas, de ce qu’on pouvait attendre d’un jeune homme de type sud-américain.
Ce qui frappait avant toute chose, c’était ses yeux, des yeux d’un bleu très pâle, presque translucides, qui conféraient à son regard quelque chose d’hypnotique. S’y ajoutaient des cheveux d’une blondeur étrange, ainsi qu’une peau parsemée de taches blanchâtres, à l’image d’un reptile dont on aurait interrompu la mue. Malgré les traits authentiquement amérindiens de son visage, le « patient X » semblait tout droit débarquer d’une autre planète. Même la langue dans laquelle il s’exprimait ne concordait pas avec ses origines supposées. Un étrange mélange d’allemand et d’espagnol, proprement incompréhensible.
Plus encore que ces traits singuliers, les radiographies avaient en outre révélé la présence d’anciennes fractures et de différents traumatismes, témoignant de sévices manifestes, pour ne pas dire d’actes de torture. Le clandestin souffrait enfin de carences diverses et d’une déshydratation sévère, symptômes auxquels s’adjoignait une paranoïa aiguë.
Ce n’était pourtant pas tant ces particularités physiques, psychiques ou langagières qui attisaient la curiosité de Yann Kessler, que les résultats des analyses sanguines qu’il tenait entre ses mains. Il avait d’abord cru à une erreur du labo, une confusion entre deux tubes de prélèvement. Après tout, ce genre de chose pouvait toujours arriver. Une seconde analyse avait pourtant livré des conclusions strictement identiques : l’inconnu possédait deux groupes sanguins différents.
Médicalement impossible, avait-il pensé aussitôt, jusqu’à ce qu’une plongée approfondie dans ses manuels de médecines fasse ressurgir l’existence d’une pathologie particulièrement rare, dont il existait un moyen simple et rapide de prouver la présence. Armé d’une lampe à ultraviolet, le médecin débarqua avec hâte dans la chambre du clandestin, fit sortir tous ceux qui s’y trouvaient et tira les rideaux. Puis il gagna la confiance du patient, le fit mettre debout, souleva sa chemise et passa la lampe dans son dos. Apparurent alors d’étranges marbrures sous-cutanées prenant la forme d’un V aligné sur l’axe de la colonne vertébrale.
Cette fois, plus de doute possible. Kessler éteignit la lampe et empoigna son portable. Avant d’en référer à ses supérieurs, un coup de fil à son mentor, un ancien ponte de l’Institut Pasteur, s’imposait. L’hypothèse se voulait suffisamment singulière pour qu’elle nécessite d’être avalisée avant même de se voir consignée au dossier. Après tout, ça n’était pas tous les jours qu’on croisait une chimère.
***
3
Paris, 18e arrondissement. 7 h 44.
Il avait plu toute la nuit. Les flaques bordaient les rues comme une pluie d’étoiles sous la lumière du petit jour naissant, ponctuant les abords du boulevard Barbès. Des voies environnantes, montait déjà la clameur des vendeurs occupés à décharger leurs portants des camions. Bravant le tumulte, une Peugeot se fraya un passage arbitraire à coup de sirène et de gyrophare, avant de marquer l’arrêt à l’entrée d’une ruelle isolée. Trois véhicules de police en barraient déjà le passage, tandis que des agents en uniformes balisaient de bandes plastiques le périmètre d’un immeuble défraîchi.
Teint blafard, démarche lasse, le commissaire Paul Marsac claqua sa portière et avisa la façade noirâtre du bâtiment, sur laquelle des volets de fer rouillé habillaient les fenêtres closes. Rien d’engageant, mais rien de surprenant non plus. Ici, on était à la Goutte d’Or, le paradis des vendeurs de fringues et des dealers. Passé le cordon de sécurité, Marsac exhiba sa carte au planton de faction, s’engouffra dans le hall sombre et humide et emprunta l’escalier branlant en soupirant.
« Troisième étage », lui avait-on indiqué en entrant. Le flic fatigué grimpa les marches comme un automate. Des odeurs de moisissures et d’urine emplissaient l’atmosphère. Autour de lui, les combinaisons blanches de la police technique et scientifique, chargée d’indices et de prélèvements, passaient comme des fantômes laiteux.
Appartement 23. Des flashs filtraient à intervalles réguliers de l’embrasure de la porte lorsqu’il en franchit le seuil. L’identité judiciaire n’en avait pas encore fini du capharnaüm qui régnait à l’intérieur. Partout où l’on portait le regard, tout n’était que meubles renversés, bris de verre constellant le sol, jusqu’aux murs, perclus de coups. Un peu plus loin, au milieu du désordre, encadré de deux O.P.J. aux mines de circonstance et d’un légiste concentré, un corps à la silhouette étrange gisait à terre comme une poupée de chiffon.
— Qu’est-ce qu’il fout ici ?
La question émanait de Lambert, un jeune lieutenant fraîchement débarqué à la brigade. Son coéquipier, un géant à la carrure impressionnante, le recadra vertement.
— Ta gueule, Goodyear, c’est encore lui le patron jusqu’à preuve du contraire.
— Ne m’appelle pas comme ça. T’as vu son état ? Je te parie ma paie qu’il n’a pas dormi depuis trois jours.
— Bonjour, Messieurs, qu’est-ce qu’on a ?
Marsac s’était subitement rapproché, n’ignorant rien des réflexions de ses hommes. Il était sur la sellette, il le savait. La procédure administrative était en cours, cela n’était plus qu’une question de temps, le désaveu de ses subordonnés n’en figurant que l’imminence. Dans quelques mois, il finirait probablement aux archives ou aux infractions routières, en attendant sa mise à la retraite anticipée. À vrai dire, il s’en foutait comme de l’an quarante. Si tout devait se terminer ainsi, soit. Cela n’avait plus grande importance, à présent.
— Yacine Chouqri, vingt-huit ans et plus vraiment toutes ses dents.
Le trait d’humour de Berthaux, le géant, ne dérida personne. Un œil jeté sur la victime suffisait à comprendre pourquoi. L’homme avait visiblement subi un passage à tabac dans les règles. Son visage tuméfié n’était plus qu’un amas de chair informe, tandis qu’on devinait à la disposition du cadavre que plusieurs de ses membres avaient été brisés. Ce qui frappait sans doute le plus, pourtant, c’était la position inhabituelle de la tête, qui formait un angle à cent quatre-vingts degrés avec le reste du corps. La précision du légiste s’imposait.
— On lui a brisé la nuque à mains nues. C’est sans doute ça qui l’a tué, mais j’en saurai plus à l’autopsie. Pour le reste, compte tenu de la température du foie et la rigidité cadavérique, je dirais qu’il est mort entre quatre et cinq heures du matin.
— Que sait-on de ce… Chouqri ?
Berthaux relut ses notes.
— Qu’il n’était pas inconnu de nos services. Arrêté plusieurs fois pour trafic de stupéfiants. On pensait que son dernier séjour à l’ombre l’avait vacciné, mais suffit de regarder autour de vous pour comprendre qu’il était toujours dans le business.
Un coup d’œil rapide sur l’appartement saccagé confirmait l’affirmation. Produits chimiques, tubes à essais, becs benzènes, bonbonnes de gaz et pilules en tout genre. Un véritable laboratoire clandestin. Le mobile du crime commençait à se préciser avant même le début véritable de l’enquête. Du moins, en apparence. À bien y regarder, cependant, le vol seul ne semblait pas devoir tout expliquer, comme l’indiqua l’officier.
— On a retrouvé deux kilos de résine de cannabis, huit cents grammes de coke non coupée, plusieurs centaines de pilules d’ecstasy et pas loin de dix mille euros en liquide. Si les types qui ont fait le coup en avaient après Chouqri, c’était apparemment pas pour lui piquer sa marchandise ou son fric.
Étrange, en effet. Un règlement de compte entre dealers, comme il en était sans doute question ici, faisait rarement dans la philanthropie. Le commissaire poursuivit l’interrogatoire.
— Des témoins ?
— Z’avez vu l’immeuble ? La moitié des appartements sont des squats. La plupart des occupants ont foutu le camp dès qu’ils ont entendu les sirènes. Alors, pour ce qui est des témoins…
— C’est une vraie supérette de la came, ici. Ça devait défiler comme dans un moulin. Et vu le boxon, je doute fort que personne n’ait rien entendu. Démerdez-vous pour me retrouver les locataires de ce taudis et arrangez-vous pour les faire parler.
Marsac n’était pas dupe. Il connaissait par cœur la loi du silence qui régnait dans ce genre de milieu. Quelque chose lui disait toutefois qu’il n’avait pas affaire à une simple vendetta entre trafiquants. Cela paraissait trop facile, trop évident, la violence du ou des tueurs témoignant d’un acharnement inhabituel.
Le sang, le verre brisé, les murs défoncés… tout s’embrouillait dans son esprit. Le flic avait un mal de chien à se concentrer. Les flashs aveuglants de l’I.J. lui brûlaient les rétines, renforçant le mal de crâne qui ne le quittait plus depuis l’aube. L’absence de sommeil commençait sérieusement à se faire sentir et son addiction aux antidépresseurs n’arrangeait rien. Il fallait qu’il prenne l’air avant de vomir ses tripes sur le plancher.
Au pied de l’immeuble, alors qu’il s’évertuait à refouler sa nausée, une berline noire attira son attention. Même dans son état, son instinct ne l’avait pas totalement abandonné, flairant à cet instant l’arrivée de nouveaux ennuis.
— Je te croyais déjà au placard, Marsac.
Avec ses cheveux poivre et sel parfaitement peignés, son costume de bonne coupe et ses chaussures vernies, Bertrand Schneider, le charismatique patron de la Brigade des Stupéfiants, ressemblait plus à un parrain de la mafia qu’à un flic. Seule la mention « police » inscrite au dos du pare-soleil de son véhicule contredisait cette impression.
— T’as rien à faire ici, Schneider. Un type s’est fait descendre, ça relève de la Crim’, pas des Stups.
— Yacine Chouqri faisait l’objet d’une enquête de nos services. Le procureur veut qu’on collabore sur ce coup.
Devant la mine renfrognée de son collègue, Schneider sortit de sa poche un document qui mit fin aux tergiversations.
— Ça ne m’enchante pas plus que toi, mais le Parquet ne nous laisse pas le choix.
À d’autres. Marsac savait pertinemment qu’il n’était plus en odeur de sainteté en haut lieu. Cette coopération forcée ne devait rien au hasard. Le patron des Stups ne mettait que rarement les pieds sur les scènes de crime. Sans doute pour ne pas salir ses chaussures, plaisantait-on jusque dans ses services. Sa présence n’était qu’une preuve supplémentaire que l’échéance était proche.
En remontant dans sa voiture, Paul Marsac se demanda où le mènerait cette nouvelle enquête, dans quels bas-fonds, dans quelle fange de l’âme humaine. Il se demanda aussi s’il aurait le temps de la conduire jusqu’à son terme. Pour l’heure, son urgence était ailleurs. Les derniers cachets de son flacon venaient d’achever leur course dans son œsophage. Il était temps de faire le plein et de trouver une pharmacie où on ne le connaissait pas encore.
***
4
Samuel Atlan était un homme singulier. Bien qu’il approchât des trente-quatre ans, on pouvait considérer sans médire qu’il était véritablement né un soir de février 1978, après qu’il fut trouvé, errant, sur le bord d’une route, à quelques kilomètres de Strasbourg. Très vite, « l’inconnu de la D60 », comme les médias le surnommèrent, avait fait la « une » des journaux. La région tout entière et bientôt au-delà, s’était passionnée pour ce gamin dont personne, pas même lui, ne connaissait les origines.
C’était l’une des raisons pour lesquelles le petit Samuel intrigua tant les foules, son histoire mystérieuse. Tout le monde se souvenait du récit de l’homme qui l’avait découvert, un chasseur de la région rentrant chez lui au terme d’une journée passée à traquer l’étourneau. Au détour d’un virage, sous une pluie battante, il avait manqué de percuter une silhouette sortie de nulle part, avant de s’aviser qu’il s’agissait d’un enfant.
Lorsqu’il s’en était approché, il l’avait trouvé hagard et désorienté, le visage couvert de sang, incapable de raconter ce qui lui était arrivé. Une amnésie rétrograde que les médecins mirent sur le compte de cette blessure à la tête, probable conséquence d’un choc violent dont personne, y compris le principal intéressé, ne connaissait la cause.
L’enquête de gendarmerie avait d’ailleurs très vite tourné à vide. Samuel n’avait pas de papiers, ses vêtements ne comportaient aucun signe distinctif qui aurait pu permettre de l’identifier et personne n’avait signalé sa disparition. Seul élément remarquable : une petite marque derrière son oreille droite, sorte de brûlure de forme triangulaire aux contours imprécis. Pour le reste, tout ce qui précédait sa septième année, l’âge qu’on lui estimait, ressemblait à une gigantesque page blanche.
Ce qui avait suivi s’était avéré plus surprenant encore. Depuis ce jour précis de février 1978, Samuel se souvenait de tout, dans les moindres détails. Rien, absolument rien de ce qu’il l’entourait ou de ce qu’il ne faisait que croiser furtivement du regard n’échappait à sa formidable mémoire. C’était comme si chaque élément, du plus prégnant au plus anodin, se trouvait instantanément gravé dans les méandres de son cerveau. Un cas rare d’hypermnésie, diagnostiqué par les plus éminents spécialistes.
Six mois après qu’on l’eut trouvé, Samuel avait été adopté par le couple qui l’avait recueilli, les Atlan. Le chasseur et sa femme, installés depuis peu dans la région, désiraient y fonder une famille. Le jeune garçon, auquel ils offrirent un prénom et un toit, en fut le ciment inattendu. Les mois aidant, les médias se désintéressèrent peu à peu de l’affaire, le naufrage d’un pétrolier géant au large de la Bretagne venant bientôt occuper les gros titres des journaux.
Samuel Atlan grandit ainsi dans une indifférence relative, à l’exception de l’attention toute particulière que lui portèrent ses professeurs, subjugués par sa prodigieuse faculté à ingérer et à retenir le savoir. Pour la communauté scientifique, son cortex s’apparentait à un gigantesque réceptacle où chaque information était traitée et immédiatement classifiée, de façon à ce qu’elle puisse resurgir à la moindre sollicitation. Conversations, événements, calendriers remontants sur des décennies… La somme des éléments que cette mécanique semblait capable de retenir aurait donné des complexes au plus puissant des ordinateurs. Un don que Samuel payait par de fréquentes et violentes migraines, auxquelles aucun des praticiens qu’il consulta ne parvint à mettre un terme.
Élève brillant, mais solitaire, l’ex-enfant mystère se mua par la suite en étudiant frondeur, rebelle d’un système qui n’admettait les différences que lorsqu’elles le servaient et le nourrissaient. Sa première année passée à l’université en fut la triste illustration. Malgré des résultats scolaires toujours excellents, Samuel se distingua par quelques coups d’éclat destinés à rappeler qu’il n’était pas que cette bête de foire, cette curiosité scientifique, comme la nommaient les médecins, mais bel et bien un être humain à part entière.
C’est ainsi qu’on découvrit, un soir d’avril 1989, qu’il organisait chaque lundi des parties de poker clandestines au sein de sa résidence universitaire, jouant de sa prodigieuse mémoire sur le dos d’étudiants naïfs et avides de sensations fortes. Samuel apprendrait plus tard qu’il ne dut qu’à l’intervention de ses professeurs de ne pas être renvoyé ce jour-là, ce qui ne l’empêcha nullement de récidiver dans les semaines qui suivirent, délocalisant son petit cercle de jeu à l’extérieur du campus.
À dire vrai, ce n’était pas tant les cartes qui l’intéressaient que l’idée de se mettre au défi, non pour satisfaire les ambitions d’un tiers, mais pour son propre compte. Une provocation d’autant plus grisante qu’il excellait dans cet exercice, ce qui, d’une certaine manière, n’était pas non plus mauvais pour son ego.
En bref, au cours de cette première année d’étude, Samuel s’amusa. Le retour sur Terre eut lieu l’année suivante, lorsque son père adoptif, Joseph Atlan, succomba à une balle perdue au cours d’une partie de chasse. Un choc d’une violence inouïe pour l’adolescent, qui voyait avec cet homme s’éteindre la première personne dont il avait croisé le visage depuis le début de sa seconde existence, à l’âge de sept ans. Son tout premier souvenir.
Dès lors, l’étudiant rebelle s’assagit. Il renonça au jeu, rentra peu à peu dans le rang, n’eut même plus besoin de tricher pour obtenir de mauvais résultats – tout n’était pas qu’affaire de mémoire – et se découvrit une passion pour les langues. Le déclic eut lieu lors d’une série de voyages qu’il fit au cours de l’année 1990. Espagne, Grèce, Italie, Europe de l’Est, Maghreb… Chaque destination fut pour lui l’occasion de renouvelerson plaisir d’étrangeté, repoussant pour un temps la profonde affliction dans laquelle l’avait plongé la mort de son père.Un changement d’atmosphère salutaire auquel la découverte de langues nouvelles s’ajouta pour générer en lui l’apaisement qu’il poursuivait de ses vœux.
Sa vocation naquit ainsi, au contact de ces langages qui lui étaient inconnus, et que ses capacités de mémorisation lui permirent rapidement de maîtriser. En quelques mois seulement, il en domina les méandres grammaticaux, en retint les alphabets, les accents et les graphies. Au terme de son cycle d’études, Samuel parlait couramment plus d’une quinzaine de langues, dont les deux tiers ne faisaient pas partie de sa formation initiale.
Quand il en eut fini des voyages et de ses études supérieures, il mit à profit ses connaissances et occupa plusieurs années durant un poste de traducteur au sein du Parlement européen. Il était l’un de ces invisibles, l’une de ces voix dans les oreillettes, retranscrivant en temps réel les discours des députés. Mais Samuel avait un défaut : il s’ennuyait rapidement. Et lorsqu’il s’ennuyait, il lui fallait un nouveau défi.
L’opportunité se présenta sous une forme inattendue, quand, un jour qu’il s’effarait de la piètre traduction d’un roman scandinave dont il avait lu la version originale, il s’était permis d’en réaliser une nouvelle mouture avant de l’envoyer à l’éditeur. Trois semaines plus tard, ce dernier le contactait en personne pour lui proposer un engagement, qu’il obtint au terme d’un simple entretien.
Quatre années à présent qu’il officiait en tant que traducteur de romans étrangers pour le compte d’une importante maison d’édition parisienne. Il était désormais ce nom sur la page de garde, juste au-dessous de celui de l’auteur, cet inconnu qu’aucun lecteur n’aurait été capable de mentionner, mais à qui ils devaient de lire leurs écrivains préférés dans leur langue maternelle. L’activité comportait un double avantage : d’une part, la possibilité de travailler depuis son domicile. D’autre part – et cela en découlait – un certain isolement, loin de déplaire à son caractère solitaire.
Car Samuel n’avait jamais été très sociable. Il n’avait que peu d’amis, se bornait bien souvent aux visites et relations d’usage et n’avait jamais fait partie d’une bande. Cette personnalité, il la devait aussi à son don. L’inconvénient, quand on n’oubliait jamais rien, c’est qu’on n’oubliait jamais rien, le bon comme le mauvais, d’où une tendance naturelle à la mélancolie.
Pour le reste, Samuel Atlan vivait comme tout le monde, l’hypermnésie en plus. Il possédait un téléphone portable, bien qu’il soit vide du moindre numéro. Les agendas et autres blocs-notes n’avaient jamais franchi le seuil de son appartement strasbourgeois. Quant aux Post-its ornant la porte de son réfrigérateur, ils n’étaient là que par jeu, le jeune homme trouvant amusant qu’une série de jurons rédigés en arabe puissent être pris, par l’esthétisme de leur graphie, pour de la poésie. On ne notait ni ne conservait rien d’essentiel lorsqu’on possédait la capacité de se souvenir de tout.
Aujourd’hui, nous étions jeudi, il était 11 h 30 et Samuel sortait d’une nouvelle séance. Depuis quatre mois qu’il se conformait à ce rituel, suivant en cela le conseil prodigué au cours d’un déjeuner par Gerhardt Kirschner, un ami eurodéputé allemand, il avait fait d’indéniables progrès. Certes, ses migraines n’avaient pas cessé, mais elles se faisaient plus rares, moins virulentes aussi. Il se souvenait pourtant des réticences qu’il avait émises avant de se laisser convaincre de tenter l’expérience.
— Je connais quelqu’un qui pourrait vous aider, Sam.
— M’aider à quoi ?
Samuel avait toujours détesté les endroits bondés. Il s’y passait trop de choses, l’obligeant à un surcroît de concentration pour ne pas être assailli par les millions de détails insignifiants dont il ne souhaitait pas encombrer sa mémoire. Kirschner, lui, appréciait cette brasserie toujours pleine comme un œuf sur les coups de midi. La foule le distrayait un peu des interminables séances de l’Assemblée européenne. Les deux hommes s’étaient liés d’amitié lorsque Samuel y travaillait encore et conservaient depuis d’excellentes relations.
— Vous aider à comprendre l’origine de vos migraines. Ne me dites pas que cela ne vous intrigue pas ? Pas vous qui maîtrisez tout de votre vie, vous que j’ai vu retenir les noms des sept cent quatre-vingt-cinq membres du Parlement alors que vous n’y étiez en poste que depuis deux jours ?
Samuel avait souri. À vrai dire, il n’était plus très sûr de vouloir connaître la vérité. Depuis la mort de son père adoptif, il avait plus ou moins renoncé à en apprendre davantage, conformément à la promesse qu’il avait faite à sa mère. Après tout, n’avait-il pas vécu vingt-sept années dans l’ignorance et ne s’en était-il pas plutôt bien sorti ?
— L’homme dont je vous parle n’est pas n’importe qui. C’est l’un des meilleurs spécialistes dans son domaine. Je suis certain qu’il peut vous apporter quelque chose.
En prenant la carte que son ami lui avait tendue, Samuel n’avait pu totalement masquer sa curiosité. La proposition l’intriguait, lui qui n’aimait rien tant que les nouveaux défis. Peut-être son inconscient lui dictait-il qu’il était temps pour lui d’en savoir plus. Peut-être que la solution se trouvait là, quelque part, nichée dans cette pratique dont il ignorait tout. Au fil des séances, il avait acquis la certitude d’avoir fait le bon choix.
***
5
— Allo ?
— Ici le docteur Blöhm. Le patient s’est présenté aux deux premières séances. Le travail a commencé et il est prometteur.
Il y eut un silence, puis la voix au bout du fil reprit.
— Merci docteur. Informez-moi immédiatement dès que vous enregistrez le moindre progrès.
Blöhm raccrocha. Il se souvenait avec précision de sa rencontre avec cet interlocuteur mystérieux, quelques mois auparavant, sur le parvis de la cathédrale, et des mots qu’il avait employés pour le convaincre. Jamais peut-être, l’imposante façade gothique ne lui avait paru si effrayante. Sa décision de collaborer ne souffrit aucune objection. Il s’exécuterait, quoi qu’il arrive. On ne lui en laissait guère le choix.
***
6
Paris, 16e arrondissement.
Yann Kessler arriva sur les coups de sept heures du matin, stationna son véhicule devant l’hôtel particulier à façade haussmannienne et salua le portier. Il savait qu’à cette heure, le professeur était déjà debout. Depuis qu’il avait pris sa retraite, Jacob Rosenberg, ancien directeur de recherche à l’Institut Pasteur, s’obligeait à se lever chaque jour à six heures afin de ne pas rompre avec les habitudes prises durant sa vie professionnelle. Surtout, il ne voulait en aucun cas se laisser aller à l’oisiveté inhérente aux personnes de son âge, non par peur de la mort, mais par celle de la déchéance physique et mentale.
Lorsque Kessler pénétra dans le vaste bureau du premier étage, paré de boiseries et de bibliothèques richement dotées, il trouva son mentor en tenue de sport, achevant ses exercices matinaux. À plus de quatre-vingts ans, le doyen, cheveux blancs en bataille garnissant un front large et tavelé, sous lequel deux yeux bleu pâle surgissaient comme des éclairs, semblait au mieux de sa forme. Lorsqu’il vit son ancien élève entrer, il se précipita vers lui, abandonnant brusquement ses appareils de remise en forme.
— Montrez-moi !
Yann sourit, retrouvant dans cette entrée en matière l’énergie et la curiosité qui l’avaient tant fasciné lorsqu’il effectuait son internat sous sa tutelle, une décennie plus tôt. L’empressement de Rosenberg était à la mesure du cas qu’il souhaitait lui soumettre. D’un geste de la main, le vieil homme débarrassa à la hâte les papiers qui encombraient son bureau et invita son visiteur à y poser le dossier qu’il avait sous le bras. Puis il prit connaissance des différents documents qu’il contenait, en survola certains d’un rapide coup d’œil, s’attarda sur d’autres, avant de livrer ses premières conclusions, enthousiaste.
— Mon cher Yann, je crains fort que vous n’ayez raison. Vous tenez là un authentique cas de chimère génétique.
Kessler sentit tous ses muscles se détendre. En venant ici, il ne craignait rien tant que décevoir l’homme qu’il considérait, lui, l’orphelin ballotté de foyers en famille d’accueil pendant son enfance, comme son père spirituel, en médecine tout autant que dans l’existence. Jacob Rosenberg était une légende dans sa partie, précurseur de nombreuses avancées médicales, dont celles de la génétique et des thérapies qui en découlaient. Il avait été l’un des premiers à entrevoir le potentiel que représentait la recherche sur les cellules souches, bien avant les polémiques éthiques et législatives qui désormais l’entouraient.
— Savez-vous quelle est la probabilité que cela se produise ?
Kessler ânonna.
— Moins d’une centaine de cas sont décrits dans la littérature médicale.
— Exactement. Ce phénomène est parfaitement exceptionnel. Pendant longtemps, on a même mis en doute la possibilité de son existence. Tout est là pourtant, sous nos yeux : le double génotype, la présence des lignes de Blaschko{1}…
L’ancien professeur énuméra les symptômes. Aucun ne manquait à l’appel de l’étonnante pathologie, résultante improbable de la fusion de deux œufs ne formant plus qu’un seul embryon et qui voyait, au sein d’un même organisme, coexister deux ADN différents. Voilà ce qui avait tant attisé la curiosité de Kessler lorsqu’il avait eu les résultats des analyses sanguines du « patient X » entre les mains.
— Sait-on d’où vient cet homme ?
— Du Chili, d’après les officiers des douanes qui nous l’ont amené. C’est hélas tout ce que nous en savons. Le reste est dans le dossier.
— Dans ce cas, que doit-on faire pour en apprendre davantage ?
— Reprendre les symptômes un à un et remonter jusqu’à leur origine.
Yann Kessler se souvenait par cœur des leçons que lui avait inculquées son ancien professeur. Il se rappelait sa vision si particulière de la médecine, qu’il entrevoyait presque comme une enquête policière. Si l’on ignorait les antécédents médicaux d’un patient, il fallait recueillir tous les indices pouvant permettre de les découvrir. Dans le cas présent, ils étaient en nombre : fractures anciennes et multiples ; décoloration de la peau, des cheveux et des yeux, paranoïa aiguë, confusion des langues. Rosenberg analysa chacune d’elles.
— Les fractures sont à l’évidence la marque de mauvais traitements. Elles sont anciennes, mais ont visiblement été soignées. Si elles sont le résultat d’actes de maltraitance, elles peuvent très bien être à l’origine de sa paranoïa.
— Vous ne trouvez pas ça étonnant ? Je veux dire, pour quelle raison aurait-on torturé cet homme si c’était pour ensuite lui prodiguer des soins ?
— J’ai déjà vu bien plus surprenant, mon cher Yann. En matière de cynisme et d’abjection, l’homme est capable de battre tous les records, croyez-moi !
Le praticien parlait d’expérience. Il n’avait pas toujours été l’illustre Jacob Rosenberg, ce génie auquel le monde médical vouait une admiration sans bornes. Son autre histoire s’amorçait soixante ans dans le passé, dans la terreur de la France occupée, lorsque la Gestapo était venue le chercher chez ses parents, un soir d’hiver 1943. Il n’avait que vingt ans, toute la vie devant lui et n’avait commis qu’une erreur, celle de rejoindre, dans le plus grand secret, un réseau local de résistance.
La suite, il l’avait racontée dans un livre, écrit près d’un demi-siècle plus tard, sur les cendres d’un passé devenu trop lourd à porter. « Moi, Jacob Rosenberg, rescapé de l’Enfer », best-seller vendu à plus de cinq cent mille exemplaires, revenait en détail sur ce qu’il appelait lui-même les évènements. Les faits parlaient d’eux-mêmes. Interrogé et torturé dix jours durant dans les locaux de la police allemande, il avait ensuite été déporté au camp de concentration de Buchenwald où il avait passé les deux années suivantes, jusqu’à la libération.
Lorsque ce qu’il lui restait de famille était venu le chercher à l’hôtel Lutetia, au printemps 1945, elle avait eu peine à le reconnaître. Décharné, ne pesant que trente-quatre kilos, il n’avait plus rien du gaillard athlétique gravé dans la mémoire de ses proches. Réchappé de l’horreur, Jacob Rosenberg s’était tu cinquante années durant, enfouissant dans un coin de son cerveau, comme en sommeil, le souvenir de l’infamie, s’abandonnant dans le sport et l’obsession de la forme physique, construisant une carrière qui ferait bientôt de lui l’un des pères de la médecine moderne.
Alors oui, Jacob Rosenberg n’avait plus rien à apprendre lorsqu’il s’agissait de constater l’effarante cruauté dont les hommes semblaient capables.
— Les décolorations de la peau, des cheveux et des yeux sont beaucoup plus intéressantes. L’absence de mélanine peut être la conséquence de nombreuses maladies génétiques, mais les dépigmentations de l’épiderme sont irrégulières, tout comme sa blondeur anormale. Tout cela dénote que la fusion des deux génotypes est inachevée, voire incomplète. On en viendrait presque à croire que cet homme est le fruit d’une expérience ratée.
Kessler s’étrangla.
— Une expérience ? Vous voulez dire que son état ne serait pas… naturel ?
— J’en doute fortement. Les rares cas de chimères complètes connus à ce jour ne présentent pas de tels signes extérieurs, si bien qu’il est impossible de les détecter sans examens approfondis. De quel pays avez-vous dit que le patient venait ?
— Du Chili. L’avion duquel il est descendu était en provenance directe de Santiago. Vous pensez qu’il y a un rapport ?
— Comment savoir ? Encore faudrait-il connaître précisément de quel endroit il sort et…
Rosenberg s’interrompit subitement. L’une des photos du dossier à laquelle il n’avait pas prêté attention jusqu’alors semblait le clouer sur place. Le regard totalement absorbé par le cliché, l’ancien médecin, bouche entrouverte, donnait l’image d’un boxeur qu’on aurait mis K.O. debout. En s’approchant, Yann Kessler découvrit alors ce qui retenait tant l’attention de son mentor, une photo de profil du « patient X » réalisée par la police des douanes, sur laquelle on distinguait, juste derrière l’oreille droite, une petite brûlure de forme triangulaire.
***
7
Paris, 1er arrondissement. 18 h 16.
Depuis deux jours, le 36 quai des Orfèvres voyait défiler, en ordre dispersé, la cinquantaine d’occupants de l’immeuble où Yacine Chouqri avait été retrouvé mort. Tout au moins, ceux sur lesquels la police avait pu remettre la main, grâce à la souricière mise en place juste après le départ des enquêteurs. Un véritable melting-pot de nationalités : Africains, Chinois, Roumains… Pas un ou presque ne parlait français, si bien que des traducteurs avaient été dépêchés sur place, plombant la durée des interrogatoires.
Réfugié dans son bureau afin d’échapper au tumulte, le commissaire Marsac contemplait les affaires en cours entassées devant lui. Crime passionnel, règlement de compte entre malfrats, braquage qui vire au carnage… Un condensé de tout ce dont l’homme, prédateur suprême, était capable dans sa face la plus sombre. Dix-huit ans que le flic côtoyait chaque jour la noirceur, la violence et la mort. Dix-huit ans à arpenter les scènes de crime les plus sordides, à n’avoir sous les yeux que des cadavres et du sang, à endurer les annonces aux familles et les autopsies. Dix-huit ans à faire passer son job avant tout le reste, à s’abîmer peu à peu, à nier l’évidence.
Longtemps, il avait cru qu’il sombrerait le premier. Après tout, cela n’était pas humain de supporter toute cette fange. Personne ne le pouvait sans en subir les conséquences. Il le voyait chaque jour autour de lui, sur les visages de ses collègues, dans les récits de leur vie privée désastreuse. Mais la sienne échappait aux clichés, la sienne était magnifique. Florence était sa lumière innocente, son halo de tendresse dans l’inhumanité du quotidien, son phare dans l’obscurité. Elle l’éclairait chaque soir lorsqu’il rentrait, savait effacer de sa présence et de sa voix l’abjection que ses yeux avaient supportée au cours de la journée. Persuadé que l’illusion durerait toujours, il n’avait rien senti venir, rien vu se déliter, jusqu’à ce que la réalité le rappelle à l’ordre de la plus brutale des façons.
Le rapport préliminaire d’autopsie qu’il avait dans les mains le ramena au moment présent, tout aussi brutal. Les premières conclusions du légiste dénombraient pas moins d’une douzaine de fractures sur le corps de la victime : bras, chevilles, poignets, visage, jusqu’aux doigts, dont la moitié avait été brisés. S’il n’avait pas été trouvé dans son appartement, on aurait pu croire qu’il était passé sous un train. La cause véritable de la mort résidait dans une rupture des vertèbres cervicales, probablement à mains nues.
Marsac posa le dossier, avala deux cachets et se saisit, pensif, de son arme de service, dont il fit jouer le métal froid et lourd entre ses doigts. L’autopsie précisait qu’il n’y avait eu qu’un seul agresseur. L’homme qui avait fait le coup devait être doué d’une force peu commune pour réduire ainsi en miettes un type de soixante-dix kilos à la seule force de ses mains. Une puissance physique qui plaçait l’assassin dans une catégorie plutôt hors normes.
— On en tient un, commissaire !
L’entrée soudaine du lieutenant Berthaux surprit son supérieur, qui fit disparaître à la hâte son calibre dans un tiroir, renversant au passage sa boîte de pilules.
— Ça t’arrive de frapper ?
Les grognements du vieux flic ne coupèrent en rien l’enthousiasme de son subordonné.
— Désolé, Chef, mais un des locataires de Barbès à vu quelque chose le jour du meurtre. J’ai pensé que vous voudriez être le premier à le savoir.
— Le premier ?
— Vous savez bien, avant les Stups, quoi.
Schneider, la collaboration entre services, le flic avait failli oublier. Décidément, on ne lui épargnerait rien jusqu’à ce que le couperet tombe ou qu’il le fasse tomber lui-même. D’ici là, il faudrait faire illusion et mener l’enquête en faisant fi de cette épée de Damoclès qui planait au-dessus de lui. Pas facile d’y voir clair et d’avancer lorsqu’on enchaînait les nuits blanches. À moins que ce témoignage inopiné fasse avancer l’enquête et calme les vautours.
— Vous ne devriez pas faire ça.
Les deux hommes enchaînaient les couloirs étroits et défraîchis, cheminant vers le bureau exigu qui tenait lieu de salle d’interrogatoire. La remarque de Berthaux arriva comme un cheveu sur une soupe déjà froide.
— Pas faire quoi ?
— Vous savez bien, jouer avec votre flingue, là, comme tout à l’heure. Ça fait causer les hommes, si vous voyez ce que je veux dire.
Marsac appréciait le lieutenant Stéphane Berthaux. Avec son accent du Sud-Ouest et son physique de troisième ligne de rugby, le jeune gradé de trente-six ans en imposait aux suspects sans avoir besoin d’élever la voix. Ne rechignant jamais à la tâche, il avait aussi la particularité d’être doté d’un franc parlé qui ne se souciait guère de la hiérarchie ou des conséquences. En cinq années de collaboration, le vieux flic le considérait sans conteste comme son meilleur élément. À cet instant précis, pourtant, il lui aurait volontiers coupé la langue.
— Occupe-toi de tes oignons, Berthaux, je gère.
— Vous gérez, vous gérez… N’empêche, ça fout les collègues mal à l’aise. Et vos médocs, là, c’est pas bon pour ce que vous avez.
Le commissaire ne répondit pas. Berthaux avait raison, il le savait. Avec L’I.G.S sur les talons, le moindre soupçon de faille dans la procédure – et l’instabilité psychologique de l’enquêteur principal en était une – invaliderait toute l’enquête. Marsac avait pourtant depuis longtemps déjà passé le stade des craintes administratives. Depuis le temps qu’il faisait ce métier, il en connaissait par cœur le fonctionnement et savait que personne n’irait se plaindre de la mort d’un Yacine Chouqri, délinquant multirécidiviste, cancrelat d’une société pour laquelle son seul apport notable aura été de fournir leurs doses à des junkies. Tout n’était qu’une question d’apparence. La justice devait passer, même pour la pire des ordures. Ainsi en était-il du mirage tenace d’une démocratie exemplaire.
« C’est pas bon pour ce que vous avez », avait dit Berthaux. Qu’en savait-il, après tout ? Que savait-il de la douleur, de cette douleur qui vous hante jour et nuit, qui vous accompagne à chaque minute, tapie dans l’ombre, prête à surgir à la moindre baisse de vigilance ? Les antidépresseurs n’étaient peut-être pas la panacée, mais au moins avaient-ils le mérite de faire taire la souffrance en la remplaçant par l’apathie et, pour peu qu’on y mette la dose, l’oubli absolu.
Marsac gérait, comme il le disait lui-même. En vérité, il ne gérait plus rien depuis longtemps. Au début, il avait cru pouvoir maîtriser la situation. Mais l’addiction a cette perversité des choses qui ne s’annoncent pas, insidieuse, invisible, resserrant chaque jour un peu plus les mailles de son piège imparable, aussi imperceptible que des sables mouvants. Aujourd’hui, le grand flic qu’il avait été naviguait à vue comme ces navires-fantômes qui peuplent les légendes de marins.
— Quoi, c’est ça ton témoin ?
Derrière la vitre d’un bureau, assis sur sa chaise, regard perdu, un gamin d’une dizaine d’années s’efforçait de donner une description de l’homme qu’il avait vu la nuit du meurtre de Chouqri. En face de lui, un dessinateur chargé d’en réaliser le portrait-robot réclamait des détails, retouchant son esquisse, en affinant les traits. Il devait être quatre heures et demie, ce matin-là, quand l’enfant, réveillé par le vacarme, avait osé entrouvrir la porte de l’appartement pour voir ce qui se passait. C’est là qu’il disait avoir vu le « géant aux cheveux jaunes », comme il le nommait. Un homme gigantesque aux cheveux blonds, qui sortait de chez la victime, les mains pleines de sang. Le garçonnet n’avait pas eu le temps de bien voir, mais il était sûr de lui pour le sang. Et pour le bruit de verre aussi.
— Le bruit de verre ?
Marsac ignorait l’élément. Berthaux précisa.
— Le môme dit que le type faisait un drôle de bruit quand il a dévalé l’escalier, comme un bruit de bouteilles qui s’entrechoquent.
Le témoignage s’arrêtait là. Ensuite, la mère de l’enfant l’avait ramené dans sa chambre, en le sommant de ne plus ouvrir la porte en pleine nuit, quoi qu’il puisse se passer à l’extérieur. Un géant blond furtivement aperçu et un bruit de verre. C’était maigre, mais c’était tout ce que les enquêteurs pouvaient se mettre sous la dent. Le gradé ordonna en conséquence.
— Fais diffuser le portrait-robot dans tous les commissariats du secteur. On ne sait jamais, quelqu’un l’a peut-être déjà vu traîner dans le quartier.
— Z’êtes optimiste !
— Pas plus que ça, mais je ne pense pas que Chouqri était du genre à se vanter de ce qu’il magouillait dans son appart. Notre bonhomme devait connaître et l’adresse, et la victime. Il a peut-être même repéré les lieux avant de passer à l’action. Pas impossible qu’on l’ait vu dans le coin ces derniers jours. En plus de ça, le gabarit de l’agresseur correspond aux conclusions du légiste.
— Ça vaudrait peut-être le coup de jeter un œil aux caméras de surveillance du quartier, même si la rue de Chouqri n’en possédait pas.
— Appelle la préfecture pour obtenir les images et mets Lambert sur le coup. Moi, je retourne chez notre dealer.
— La scientifique a déjà tout passé au peigne fin, vous espérez y trouver quoi ?
— T’as entendu le gamin comme moi ? Le suspect avait les poches pleines en repartant. On a peut-être raté quelque chose.
***