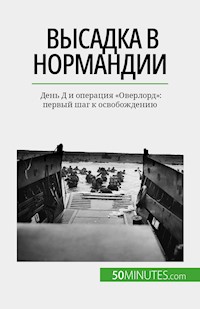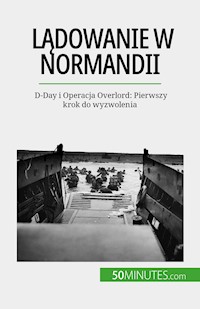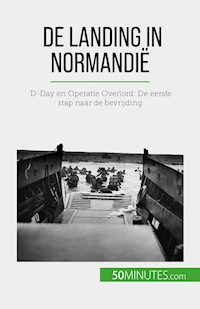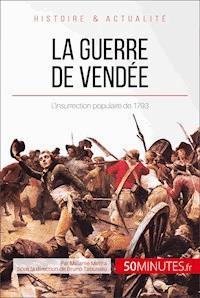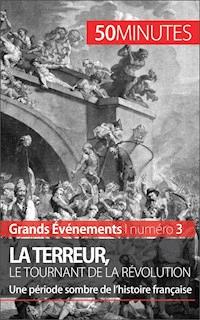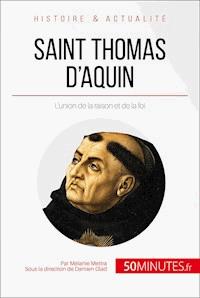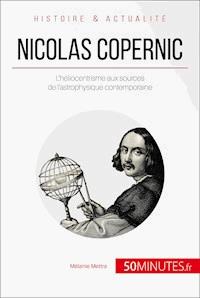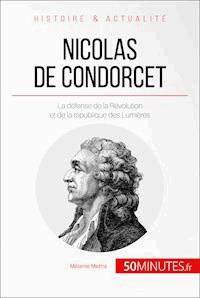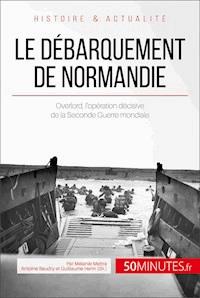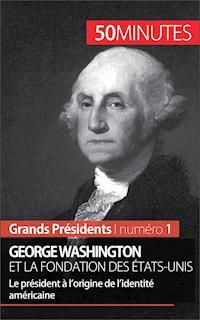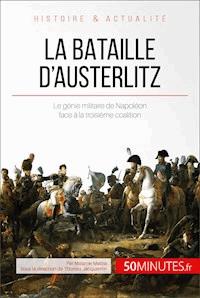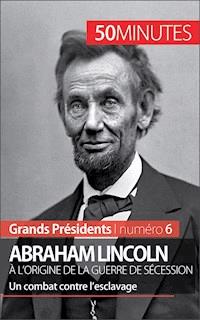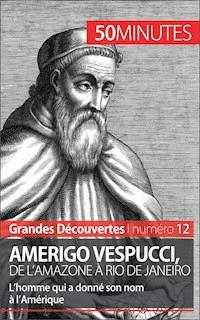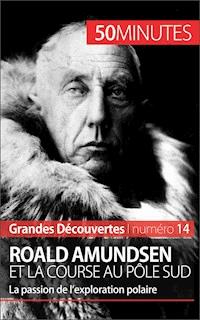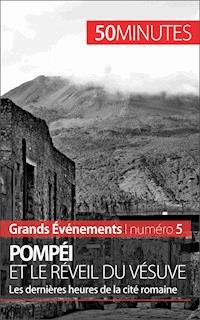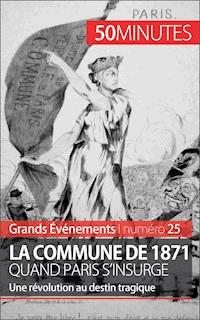
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 50Minutes.fr
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Grands Événements
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur la Commune de Paris en moins d’une heure !
Entre 1789 et 1871, la France connaît de nombreux soubresauts politiques. Entre révolutions, tentatives républicaines, restauration de la monarchie et prestige impérial, elle n’a pas eu un instant de répit. En 1870, sa cuisante défaite contre la Prusse attise à nouveau la colère du peuple. Du 18 mars au 28 mai 1871, un dernier soulèvement secoue Paris et aboutit à la constitution d’une Commune autonome. Rapidement, des premières mesures sont prises pour rétablir la liberté de la presse, instaurer la laïcité, rendre l’enseignement obligatoire... Mais la répression ne se fait pas attendre et la Commune finit par s’éteindre dans le feu et le sang.
Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur :
• Le contexte de l’époque
• Les acteurs principaux
• La Commune
• Ses répercussions
Le mot de l’éditeur :
« Dans ce numéro de la collection 50MINUTES | Grands Événements, Mélanie Mettra nous fait découvrir le dernier soulèvement parisien dans la lignée de ceux qui ont jalonné l’histoire révolutionnaire. Bien décidés à se battre pour leur liberté, les Parisiens se soulèvent contre le gouvernement de Versailles et s’érigent en Commune autonome. Si l’espoir est grand du côté des C-communards, l’événement connaît une issue tragique et meurtrière. » Stéphanie Dagrain
À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grands Événements
La série « Grands Événements » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante faits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent tout savoir sur un sujet précis, tout en allant à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos auteurs combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d’histoire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 49
Ähnliche
LA COMMUNE
Quand ? Du 18 mars au 28 mai 1871.
Où ? À Paris.
Contexte ? La guerre de 1870 contre la Prusse et la fin du Second Empire.
Protagonistes ?
Adolphe Thiers, homme politique, journaliste et historien français (1797-1877).
Louise Michel, révolutionnaire française (1830-1905).
Jules Vallès, écrivain et journaliste français (1832-1885).
Nathalie Lemel, révolutionnaire française (1827-1921).
Eugène Varlin, homme politique et syndicaliste français (1839-1971).
Répercussions ?
La naissance de la Troisième République.
L’apparition du mythe fondateur des révolutions prolétariennes.
La Commune, qui a lieu en 1871, est le dernier soulèvement parisien dans la lignée de ceux qui ont jalonné l’histoire révolutionnaire française jusque-là. Entre 1789 et 1871, la France a connu sept régimes successifs, passant de la monarchie absolue vacillante à la monarchie constitutionnelle éphémère, de la République au Consulat puis à l’Empire, et renouant ensuite avec la monarchie avant de renouveler l’expérience républicaine puis impériale. Chaque rupture s’est faite dans la violence de l’insurrection.
En 1789, la prise d’armes par les Parisiens débouche sur l’élection d’une Assemblée. En 1792, la Première République naît durant la journée du 10 août (prise des Tuileries et chute de la monarchie) ; au printemps 1795 la réaction thermidorienne s’élabore sur les émeutes de germinal et de prairial (avril-mai). La Restauration prend fin en juillet 1830, lors des Trois Glorieuses (les 27, 28 et 29 juillet), alors que la capitale française se couvre de barricades, contraignant Charles X (1757-1836) à abdiquer et à prendre la fuite. Le 24 février 1848, c’est au tour de la monarchie de Juillet de Louis-Philippe Ier (1773-1850) de céder sous les coups de la révolution. Alors que Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), futur Napoléon III, profite du suffrage universel pour accéder à la fonction présidentielle puis impériale, c’est cette fois la combinaison d’une guerre et d’une ultime insurrection qui met définitivement fin aux soubresauts politiques d’un XIXe siècle particulièrement mouvementé. En effet, depuis 1870, la France est en guerre contre la Prusse, qui la défait en quelques semaines. L’empereur étant prisonnier et l’impératrice Eugénie (1826-1920) en fuite, un nouveau gouvernement républicain est élu. Mais la population parisienne, assiégée par les Prussiens, refuse de renoncer à sa liberté. Elle s’érige alors en Commune autonome en mars 1871. Elle a tout juste le temps d’ouvrir quelques horizons idéalistes avant de s’éteindre dans le feu et le sang.
CONTEXTE
DE LA RÉPUBLIQUE À L’EMPIRE
La présidence de Louis Napoléon Bonaparte
En février 1848, la monarchie de Juillet est renversée par une nouvelle révolution. Le gouvernement provisoire formé suite à l’abdication de Louis-Philippe Ier proclame la Deuxième République. Marquée par l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort, cette nouvelle ère politique voit surtout l’instauration du suffrage universel masculin (le 4 mars 1848), qui jouera un rôle inattendu dans la pérennité du régime. La Constitution de la Deuxième République prévoit en effet l’élection du président de la République, chef de l’exécutif, au suffrage universel. Le 10 décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte, neveu de l’empereur Napoléon Ier (1769-1821), remporte les élections présidentielles avec près de 5,5 millions de voix, contre moins de deux millions pour son adversaire, le républicain Eugène Cavaignac (1802-1857).
Exilé un temps à Londres et de retour depuis peu, il n’a jamais caché son souhait de restaurer l’empire, tel que le concevait son aïeul, c’est-à-dire comme un moyen de promotion des conceptions progressistes de la Révolution. Seuls les républicains radicaux pourraient véritablement lui faire obstacle, mais il parvient à les faire écarter de l’Assemblée. Son gouvernement renoue avec l’Église, en particulier dans le domaine de l’enseignement, dont il lui ouvre grand les portes, s’opposant ainsi à la laïcité républicaine. Dans le même temps, Louis Napoléon Bonaparte se prononce contre la loi qui assujettit le droit de vote à une obligation de résidence, qui écartait une nombreuse population ouvrière souvent mobile. Il parvient ainsi à naviguer entre une certaine forme de conservatisme et un progressisme social dont il s’est fait le promoteur dans son ouvrage De l’extinction du paupérisme, écrit en 1844. Lorsque, en 1852, se pose la question de sa réélection, qui est interdite par la Constitution, le prince-président se lance dans une campagne de révision de cette dernière. Suite au refus de l’Assemblée, Louis Napoléon Bonaparte la fait dissoudre le 2 décembre 1851. Ses opposants sont arrêtés et l’armée surveille Paris, mais aucune réaction ne se produit. Seul le Midi, très à gauche sur l’échiquier politique, connaît d’importants soulèvements qui sont durement réprimés (arrestations, condamnations à mort et déportations en Algérie). À nouveau plébiscité par le peuple les 21 et 22 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte entreprend une réforme de la Constitution et se proclame empereur en octobre 1852.
Le Second Empire et l’épanouissement d’un nouveau modèle économique
Le Second Empire voit officiellement le jour le 2 décembre 1852. Il est à la fois l’héritier de la Révolution et de l’Empire, mêlant parfois confusément le respect de certains idéaux républicains (égalité juridique, droit à la propriété, développement de l’instruction des filles) et l’autoritarisme (système des candidatures officielles, contrôle strict des ministres et des préfets, restriction des libertés de la presse et d’association). L’empereur a l’initiative des lois, préparées par le Conseil d’État et soumises ensuite à la discussion et au vote au Corps législatif.
En matière économique, on rattache souvent l’essor du capitalisme au Second Empire. En 1860, la France signe avec l’Angleterre un traité de libre-échange, mais cette période est surtout marquée par la réalisation de grands travaux qui modernisent le pays en profondeur. Ils concernent d’abord le réseau ferroviaire, qui connaît une extension nationale favorisant les échanges et stimulant la production sidérurgique. Les grandes compagnies comme le PLM (Paris-Lyon-Marseille)