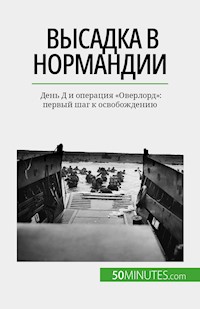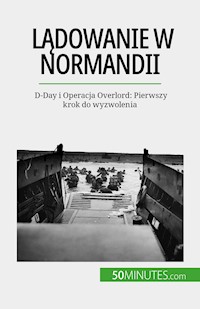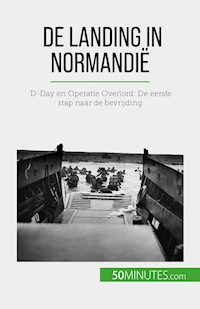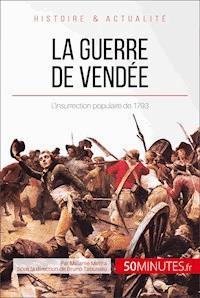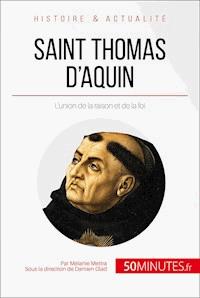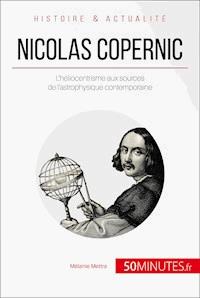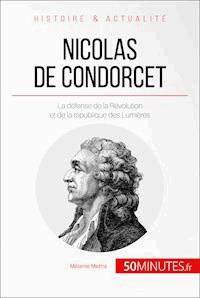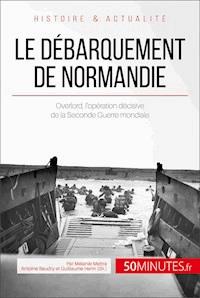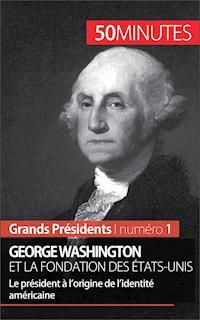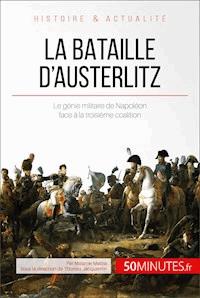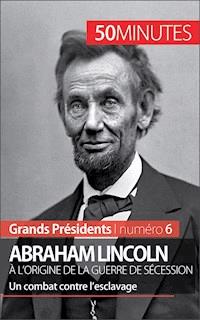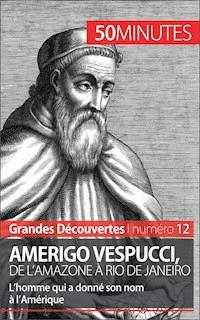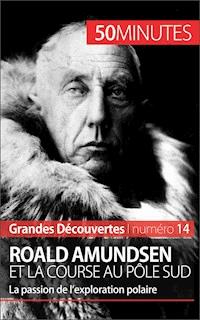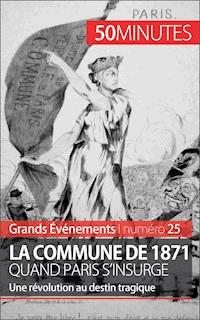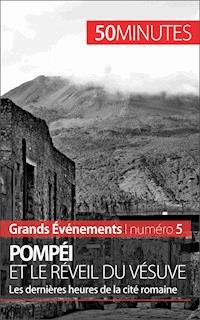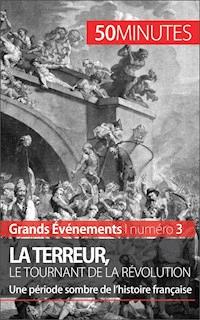
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 50Minutes.fr
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Grands Événements
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur la Terreur en moins d’une heure !
1792. Trois ans après la prise de la Bastille, la France est à un tournant critique de son histoire. Alors que la Première République vient d’être proclamée, des dissensions se font jour entre l’Assemblée législative et la Commune. C’est la seconde qui l’emporte, entraînant Paris, puis l’ensemble de la France, dans une spirale de violence qui voit Girondins et Montagnards se livrer à une lutte fratricide aux conséquences dramatiques : la Terreur vient à peine de débuter.
Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur :
• Le contexte politique et social de l’époque
• Les acteurs majeurs qui ont pris part à l’événement
• Le déroulement de la Terreur
• Les répercussions de l’événement
Le mot de l’éditeur :
« Dans ce numéro de la collection « 50MINUTES | Grands Événements », Mélanie Mettra nous plonge au cœur de l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire française. Les victimes de la Terreur se comptent par dizaine de milliers et la moitié d’entre elles ont dû affronter la terrible invention du docteur Guillotin. Si cette partie-là de l’histoire est bien connue, saviez-vous que cette période voit également la mise en place de valeurs qui participeront à la fondation de la République démocratique française ? »
Stéphanie Dagrain
À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grands Événements
La série « Grands Événements » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante faits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent tout savoir sur un sujet précis, tout en allant à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos auteurs combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d’histoire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 40
Ähnliche
LA TERREUR
Quand ? De 1792 à 1794
Où ? En France
Contexte ? La Révolution française (1789)
Protagonistes principaux?
Georges Couthon (1755-1794)
Maximilien Robespierre (1758-1794)
Louis Antoine Saint-Just (1767-1794)
Répercussions ?
La Terreur blanche (mai-juin 1795)
Le Directoire (26 octobre 1795-9 novembre 1799)
S’il est d’usage de fixer le début de la Révolution française en 1789, il est bien difficile d’en donner le terme. Elle est en effet marquée par une succession de régimes très divers, de la monarchie à une forme de monarchie constitutionnelle, de la république au consulat, jusqu’à l’Empire. Il est tout aussi malaisé de dessiner les contours des représentations qu’elle véhicule et de l’imaginaire qui l’entoure.
Elle est tout à la fois symbole de liberté, de réalisation des idéaux des Lumières, tout en étant frappée du sceau de la violence et du sang. C’est tout particulièrement le cas de deux années de gouvernement dont la dénomination donne toute la mesure : la Terreur. Entre 1792 – ou 1793, délimiter les sursauts de l’histoire est, là encore, une tâche ardue – et 1794, alors que naît la Première République de l’histoire de France, les hommes qui ont pensé la Révolution tentent de la fonder et de la protéger par les moyens qu’ils dénonçaient et qu’ils continueront de dénoncer. Époque de paradoxes, à l’image de l’instauration d’une démocratie par l’oligarchie, de confrontation de conceptions du progrès politique et humain profondément divergentes, elle fait également entrer dans la postérité des personnages aussi fascinants qu’effrayants.
CONTEXTE
LA FIN DE LA MONARCHIE
En 1789, au terme de lourdes dissensions avec le Parlement de Paris, les parlements provinciaux et le clergé au sujet de la création d’un nouvel impôt destiné à renflouer les caisses de l’État, et après des manifestations populaires de plus en plus violentes, Louis XVI (1754-1793) ordonne la réunion des états généraux. Représentant la noblesse, le clergé et le tiers état, ils sont pour ce dernier l’occasion d’exprimer une volonté de renouveau imprégnée par la philosophie des Lumières et la Révolution américaine (1776-1783).
LES REVENDICATIONS DU PEUPLE ET DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Face à la crise économique et parlementaire, les revendications du peuple sont recueillies dans les cahiers de doléances, dont la rédaction précède l’ouverture des états généraux afin de servir les débats qui vont s’y dérouler.
Personne n’est hostile à la monarchie, mais chacun souhaite que l’avis de tous soit entendu. La population urbaine et rurale désire obtenir une baisse des impôts et des taxes, une politique plus efficace contre la misère et la famine, et moins d’inégalité. Le tiers état, quant à lui, réclame avant tout une constitution octroyant davantage de libertés individuelles et l’égalité de tous devant la loi, un pouvoir législatif conjoint avec le peuple et le roi ainsi qu’un pouvoir exécutif aux seules mains du monarque conjoint.
Les états généraux se réunissent pour la première fois au mois de mai 1789 à Versailles. La crainte d’un vote par ordre (une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, une pour le tiers état) se confirme pour les députés du tiers, qui seraient dès lors en minorité. Il se proclame alors Assemblée nationale, représentative de la majorité de la population française. Interdit de siéger avec les deux autres ordres, le tiers se réunit le 20 juin 1789 dans la salle du Jeu de paume, où il fait serment de ne se séparer qu’une fois une constitution rédigée. Ralliés par les députés du clergé, les trois ordres finissent par être réunis.
Mais l’épreuve de force qui les a opposés au roi, la présence des troupes royales autour du siège des états généraux, la publication de pamphlets et de libelles ainsi que la crainte de la famine ont attisé la colère des Parisiens, qui s’emparent des dépôts de munitions des Invalides puis de la Bastille le 14 juillet 1789. Les événements se précipitent alors. Dans la nuit du 4 août, les privilèges liés au système féodal sont abolis. Le 26 août, la Déclaration des droits de l’homme est adoptée. Mais Louis XVI persiste à rejeter les textes promulgués par l’Assemblée constituante, même lorsque celle-ci prévoit un droit de veto pour les représentants de la noblesse et du clergé.
Au mois d’octobre, alors que la crainte de famine frappe à nouveau la population parisienne, celle-ci se rend en masse à Versailles et contraint le roi à quitter la ville pour gagner Paris. Dans son palais des Tuileries, devenu résidence surveillée, Louis XVI assiste à la radicalisation de l’Assemblée. Il est arrêté dans la nuit du 20 au 21 avril 1791 à Varennes, alors qu’il tente de fuir l’étau parisien avec sa famille. Ramené dans la capitale, l’Assemblée le confirme dans ses prérogatives de monarque constitutionnel, mais le peuple éprouve désormais du ressentiment à son égard pour ce qu’il considère comme une trahison.