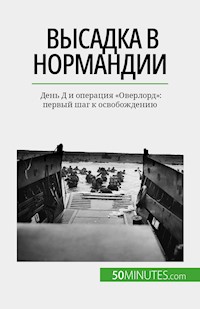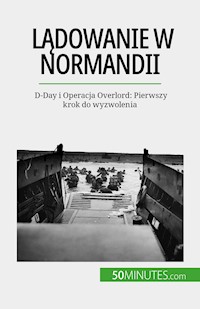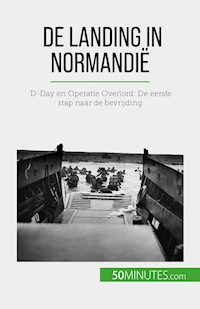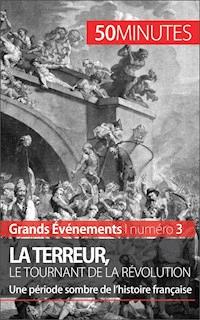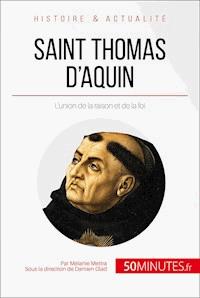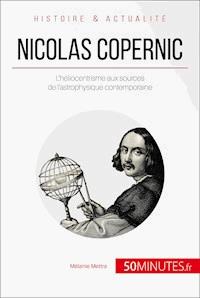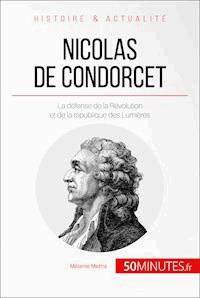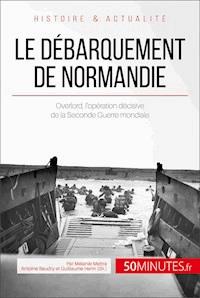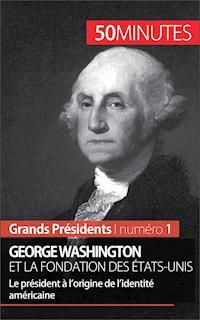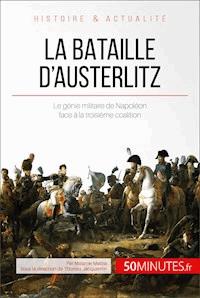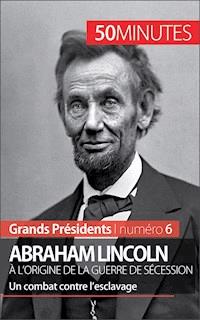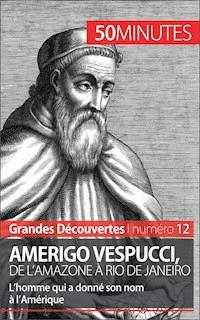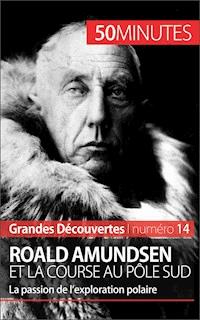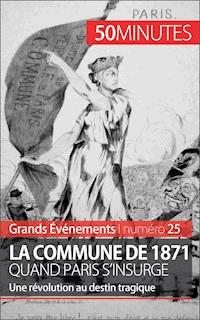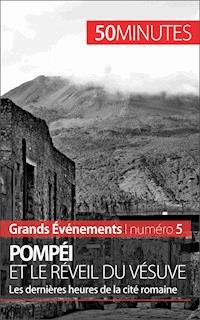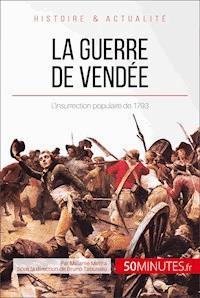
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 50Minutes.fr
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Grandes Batailles
- Sprache: Französisch
Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur la guerre de Vendée en moins d’une heure !
Le 23 février 1793, au plus fort de la Terreur, la Convention décrète une levée en masse : 300 000 hommes devront rejoindre l’armée révolutionnaire française, de gré ou de force. En Vendée, c’est une population appauvrie qui contemple les dérives d’une Révolution pourtant survenue au nom de la liberté. Refusant de servir une cause à laquelle il ne croit plus, le peuple se soulève, dans une insurrection qui se mue rapidement en mouvement contre-révolutionnaire. La réaction des républicains sera décisive : l’avenir de la France en dépend.
Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur :
• Le contexte politique et social de l’époque
• Les acteurs majeurs du conflit
• Le déroulement de la guerre de Vendée et sa chronologie (carte à l’appui)
• Les raisons de la victoire des républicains
• Les répercussions de la guerre
Le mot de l’éditeur :
« Dans ce numéro de la collection « 50MINUTES | Grandes Batailles », Mélanie Mettra nous plonge au cœur du soulèvement vendéen qui imprègne l’imaginaire depuis plus de deux siècles au travers d’une riche iconographie. Et pour cause, il s’agit de la guerre civile la plus violente que la France ait connue. Pourtant, elle n’y est que très peu étudiée. La France voudrait-elle faire oublier une page sombre de son histoire ? »
Stéphanie Dagrain
À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grandes Batailles
La série « Grandes Batailles » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante conflits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent tout savoir sur une bataille, tout en allant à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos auteurs combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d’histoire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 44
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
La guerre de Vendée
Introduction
La guerre de Vendée imprègne l’imaginaire depuis plus de deux siècles au travers d’une riche iconographie héroïque et réaliste. Les portraits des chefs vendéens et les scènes de bataille font le récit d’une période de trois ans s’étendant de 1793 à 1796, au cœur de la Révolution française. Le soulèvement des habitants des départements de l’Ouest de la France, surnommés à cette occasion la « Vendée militaire », contre les troupes républicaines symbolise toutes les contre-révolutions qui ont émaillé la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe.
Dans ces régions à forte tendance rurale, d’abord favorables aux premiers principes de la Révolution, l’importance de la religion catholique et le rejet de l’enrôlement forcé des hommes pour servir les guerres révolutionnaires font naître un sentiment communautaire très fort, à l’origine du conflit. Les populations de Vendée, mais aussi des départements traversés par la Loire, de Bretagne et de Mayenne se réunissent en armées pour affronter les troupes républicaines dans une guerre civile opposant les « Blancs » et les « Bleus » dans des batailles courtes, violentes, marquées par une répression féroce exercée par les représentants de la Convention nationale. Les massacres, les épidémies et la lassitude ont toutefois raison des insurgés qui s’inclinent en 1796 face aux forces républicaines. De nouveaux soulèvements ébranlent encore l’Ouest en 1799, puis en 1815, mais en 1832, les tentatives de la duchesse de Berry (1798-1870) ne réussiront pas à réveiller une Vendée pour un temps pacifiée.
Données-clés
Quand ? De 1793 à 1796 Où ? Dans les départements de l’Ouest de la France (Vendée, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Loire inférieure – aujourd’hui Loire-Atlantique)Contexte ? La Révolution française (1789-1799)Belligérants ? Les insurgés vendéens, surnommés les « Blancs », contre les armées nationales républicaines, appelées les « Bleus »Acteurs principaux ?Jean Nicolas Stofflet, général vendéen (1753-1796)Jacques Cathelineau, généralissime vendéen (1759-1793)François Athanase de Charette de la Contrie, généralissime vendéen (1763-1796)Henri du Vergier, comte de La Rochejaquelein, généralissime vendéen (1772-1794)Jean-Baptiste Kléber, général républicain (1753-1800)Louis Marie Turreau, général républicain (1756-1816)Lazare Hoche, général républicain (1768-1797)Issue ? Victoire républicaineVictimes ?Camp des insurgés : entre 100 000 et 150 000 mortsCamp de l’armée républicaine : entre 50 000 et 150 000 mortsContexte politique et social
La marche vers la République
Après l’effervescence des débuts de la Révolution, la France connaît rapidement des tensions religieuses, sociales et politiques extrêmes. L’espoir qu’a fait naître le mouvement révolutionnaire s’évanouit rapidement. Les changements tant promis ne se produisent pas et la population se montre très vite mécontente de la situation.
La constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790 par l’Assemblée constituante, accroît davantage la colère du peuple. Ce texte, qui exige que les membres du clergé prêtent serment de fidélité à la Nation, à la loi et au roi, divise à la fois le clergé et la population. Les prêtres qui refusent de s’y plier – très nombreux dans l’Ouest de la France (environ 60 %) – sont désormais qualifiés de « réfractaires », mais ne subissent pas encore de sanctions. Certains considèrent d’ailleurs que cette nouvelle loi émane des protestants, ce qui ravive le conflit entre catholiques et protestants dans les régions où le maillage des églises constitue le cœur de la sociabilité.
Dans le même temps, le pays connaît des soulèvements populaires dus à des crises de subsistance. Le manque et la cherté des denrées attisent la colère de la population contre les aristocrates, les commerçants et les propriétaires accusés d’accaparer les vivres et de spéculer sur leurs ventes. Les biens ecclésiastiques, qui pouvaient parfois profiter aux populations rurales pauvres, ont été confisqués en 1789 et sont devenus des biens nationaux que les élites urbaines s’accaparent.
La politique est elle aussi agitée par des dissensions au sein de l’Assemblée constituante. Nombreuses, en particulier au sujet du statut du roi, ces tensions sont d’ailleurs à l’origine des notions politiques de droite, de gauche et de centre. Au printemps 1791, un décret empêche Louis XVI (1754-1793) de s’éloigner de Paris. La famille royale passe outre et, dans la nuit du 20 au 21 juin, s’enfuit en direction de Montmédy, espérant soit y lever des troupes pour marcher sur Paris soit passer la frontière. Cette fuite provoque la radicalisation du mouvement révolutionnaire et exacerbe le nouveau sentiment républicain, sentiment que l’Assemblée constituante ne partage pas. Pris à Varennes, ramené à Paris et rétabli dans ses pouvoirs par l’Assemblée, Louis XVI accepte la Constitution le 13 septembre 1791 : la France devient dès lors une monarchie constitutionnelle. Mais les rapports entre le roi et les députés restent tendus. La situation est aggravée par la guerre contre les Prussiens et les Autrichiens qui reçoivent le soutien du roi et dont les troupes s’approchent dangereusement de la capitale.
Au printemps 1792, l’Assemblée législative promulgue des décrets au sujet :
des prêtres réfractaires qui sont désormais pourchassés ;de la liquidation de la garde royale ;de la convocation d’une nouvelle fédération.