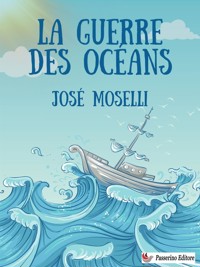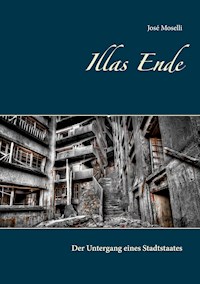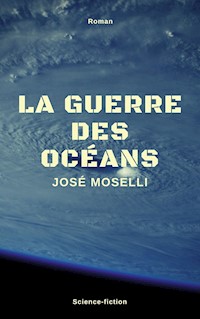
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Arsenal de Singapour. Les catastrophes se suivent : sous-marins coulés, dock défoncé.
Das E-Book La Guerre des océans wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, AVENTURES, Science-Fiction, Récits maritimes
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
Mentions légales
I
Il faut le dire, ni l’amirauté anglaise, ni l’amirauté américaine ne se doutèrent de rien lorsqu’elles apprirent les terribles sinistres. Elles crurent d’abord à la fatalité : la fatalité a bon dos pour expliquer ce qu’on ne peut élucider !
Puis elles incriminèrent les communistes, les bolcheviks, les I.W.W. « International Workers of the World », association à qui les Américains reprochent des tendances anarchistes.
Ce fut le Maya, un croiseur léger britannique qui inaugura la série des catastrophes. Le Maya était en réserve dans l’arsenal de Singapore. Par une nuit pluvieuse, une explosion sourde fut entendue. Les hommes de garde sur les quais et à bord des navires voisins virent le Maya s’incliner sur le flanc et s’enfoncer dans l’eau noire.
Les journaux ont publié les détails du désastre. Le Maya fut difficilement renfloué. Plus de cent hommes avaient péri noyés, enfermés dans ses flancs.
Depuis, l’on ne parle plus du Maya. A-t-il été démoli ? A-t-il été réparé ? L’amirauté anglaise est discrète.
Le sinistre fut attribué – par les journaux – à une explosion de soute. Il n’en était rien. Bien des marins anglais le savent : le « Maya » avait débarqué toutes ses munitions plusieurs jours auparavant !
Cinq jours – très exactement ! – après le coulage du Maya, le grand dock flottant, long de trois cents mètres et capable de recevoir les plus gros cuirassés du monde, qui se trouvait dans l’arsenal de Singapore, sombra. (Il n’est pas encore réparé !)
Cette fois, l’amirauté britannique s’émut. Singapore fut mis en état de siège, ou peu s’en faut.
Mais les coupables – s’il y en avait ! – ne furent pas découverts. L’« accident » du dock flottant fut attribué à une vanne mal fermée qui avait – soi-disant – laissé pénétrer l’eau dans les caissons. Une drôle de vanne, en effet, car le dock flottant avait une déchirure de plusieurs mètres dans ses tôles !…
Mais cela, seuls les gens de l’arsenal le surent. Un journal de Singapore, le Straits Herald, qui voulut publier la vérité, fut bel et bien saisi et supprimé.
Et l’on parla d’autre chose.
Mais la série des catastrophes était loin d’être close !
Dans le même mois, trois sous-marins britanniques disparurent : le A-7, le C-115 et le C-119.
Le A-7 partit pour exécuter des exercices au large des îles Bermudes. Il ne revint jamais.
Le C-115, qui appartenait au Pacific-Squadron, quitta Vancouver pour se rendre à Victoria – une petite traversée de quelques dizaines de milles – et n’arriva pas.
Le C-119 avait quitté Sydney pour se rendre à Brisbane. On l’y attend encore. On l’y attendra toujours.
Ces disparitions, qui ne purent être tenues cachées, émurent fortement l’opinion publique, tant en Angleterre qu’ailleurs.
On les attribua à des abordages, à des fausses manœuvres, à des défauts de construction. Les journaux anglais, soutenus par l’opinion publique, réclamèrent énergiquement des enquêtes sérieuses. Des commissions furent nommées. On attend encore leurs conclusions.
D’ailleurs, l’Angleterre n’allait pas être seule frappée !
Quelques jours après la disparition « officielle » du C-119, l’on apprit qu’une poudrière importante de l’arsenal de San Diego (Californie), avait sauté, ensevelissant 57 hommes et 11 officiers sous ses décombres.
Cette catastrophe fut suivie, cinq jours plus tard, de l’échouage du navire porte-avions Tuskeegee, lequel, au dire de ses officiers, heurta, en plein Pacifique, un haut-fond rocheux qui déchira sa coque sur plusieurs mètres et faillit le faire sombrer.
Ce haut-fond n’était pas porté sur les cartes. L’on envoya un bâtiment hydrographe, le Fulton, le rechercher et en déterminer la position.
Le Fulton reconnut qu’à la place indiquée comme étant celle du gisement du haut-fond, l’océan était profond de 3 756 mètres. Exactement.
Des journaux chuchotèrent que ce haut-fond devait s’appeler épave, ou mine flottante…
Mais l’attention se détourna aussitôt du Tuskeegee, car une dépêche de Manille apprit aux Yankees que le transport Saratoga, qui amenait 1.600 hommes aux Philippines, avait coulé au large du cap Engano. En plein jour !
Le navire s’était empli avec une telle rapidité que quelques hommes à peine avaient pu être sauvés.
Les Américains qui avaient accablé les Anglais de leurs sarcasmes en apprenant les désastres survenus à leur marine, s’émurent à leur tour. Ils nommèrent des commissions d’enquête.
Des bruits coururent que les sinistres avaient été causés par des espions japonais. Les journaux s’en firent l’écho. Le gouvernement japonais protesta.
Les Anglais, eux, avaient incriminé la Russie. Les Russes protestèrent…
En Angleterre et en Amérique, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent mélangés aux équipages des navires de guerre ; d’autres « travaillèrent » dans les forts, dans les arsenaux. Ils ne devaient rien découvrir.
Mais, à Singapore, des scaphandriers qui avaient été envoyés pour aveugler la brèche du dock flottant remontèrent à la surface une petite ventouse de caoutchouc, à laquelle adhéraient des fils de cuivre. Des chimistes examinèrent la ventouse. Ils découvrirent que, sur une de ses faces – la face interne – des fragments de peinture adhéraient. Cette peinture était identique à celle qui enduisait la carène du dock flottant !
Des gens bien informés affirmèrent que la ventouse avait dû servir à fixer une bombe, une machine infernale quelconque, le long des flancs du dock. Oui, mais qui l’avait fixée ?
L’énigme restait entière.
… Les enquêtes continuaient, lorsqu’un soir, à sept heures, un grand nombre d’amateurs de T.S.F. anglais et continentaux, qui écoutaient les différentes émissions musicales, eurent la désagréable surprise d’entendre soudain des claquements et des aboiements qui brouillèrent tout.
Et, dans le silence qui suivit, ils purent distinguer nettement ces paroles, articulées en anglais, avec un soupçon d’accent étranger :
Qu’on écoute avec la plus grande attention ! Ce message, de la plus haute importance, est destiné aux légations de la République du Chili à Londres et dans les différentes capitales européennes.
Attention ! Je déclare que le sous-marin Arauco, actuellement en essais à Barrow-in-Furness, Angleterre, où il vient d’être construit pour le compte de la République chilienne, doit être laissé pour compte à ses constructeurs !
Ce sous-marin doit partir dans cinq jours pour Valparaiso. S’il part, il n’arrivera pas. Il subira le sort du A-7 et du C-1 15 et du C-119. Rien ne pourra l’en préserver !
Cet avis ne sera pas renouvelé. Il a été également radiodiffusé dans l’hémisphère austral, de façon à ce que le public et le gouvernement chiliens ne puissent arguer de leur ignorance.
Mon message est terminé.
Des sifflements, des « chuintements » suivirent… Et, de nouveau, les émissions en cours se firent entendre.
Tous les journaux du lendemain, et spécialement ceux du Royaume Uni, mentionnèrent la mystérieuse communication.
Beaucoup furent d’avis qu’il s’agissait d’une plaisanterie, d’une fumisterie. Quelques-uns opinèrent pourtant que « cela » pouvait être sérieux…
Des experts en radiophonie furent consultés. D’après les témoignages de plusieurs amateurs, le menaçant radiogramme paraissait avoir été envoyé par un poste émetteur situé à l’ouest de l’Europe, en plein océan.
Sur la longueur d’onde, les « amateurs » n’étaient pas d’accord. Les uns affirmaient qu’il s’agissait de petites ondes : c’étaient les amateurs dont le poste était réglé pour en recevoir de telles. D’autres – ceux qui étaient en train de recevoir des émissions à grandes ondes au moment de l’étrange message – assuraient, naturellement, qu’il s’agissait de grandes ondes. Et les experts, comme toujours, concluaient en sens opposés…
La légation chilienne, à Londres, fut interviewée par des nuées de journalistes.
Le ministre chilien, prudent, se refusa à toute déclaration. Il ne savait rien. Il n’avait pas d’ordres de son gouvernement. Pour lui, jusqu’à plus ample informé, l’affaire n’existait pas.
D’autres journalistes allèrent demander à M. Thomas Flanagan, directeur des chantiers Oceania, à Barrow-in-Furness, ce qu’il pensait de la mystérieuse communication.
— Je ne perds pas mon temps à réfléchir sur des plaisanteries aussi stupides que celles dont vous me parlez ! fut la réponse de M. Flanagan.
Le commodore Dario Esteban Osorio, officier de la marine chilienne, qui était venu à Barrow pour prendre livraison du sous-marin, fut catégorique :
— Cette communication radiotélégraphique me paraît une farce ! déclara-t-il. Dans tous les cas, les essais du Arauco sont terminés, et, à moins de contre-ordre formel de mes chefs, j’appareillerai à la date prévue ! Qu’on ne me parle plus de ce misérable incident !
Les journaux publièrent ces rudes paroles. Tout le monde les approuva.
Pendant les journées qui suivirent, les experts radiophoniques de toute l’Angleterre s’efforcèrent en vain de découvrir l’origine de la menaçante communication. Les éléments dont ils disposaient étaient tellement vagues qu’ils ne devaient aboutir à aucun résultat…
Entre temps, des télégrammes chiffrés – par câble – étaient échangés entre la légation du Chili à Londres et le gouvernement de Valparaiso. Un attaché diplomatique se rendait à Barrow-in-Furness et avait une longue entrevue avec le directeur des chantiers navals qui avaient construit l’Arauco.
Les chantiers, en effet, devaient effectuer la livraison du sous-marin à Valparaiso, à leurs risques et périls. L’équipage était composé de marins chiliens, mais des ingénieurs du chantier devaient accompagner le navire.
Or, à la suite de l’étrange menace radiotélégraphique, il apparaissait que les risques de la traversée étaient beaucoup augmentés, à tel point que les assureurs avaient aussitôt élevé de soixante pour cent le taux de la prime ! Et le chantier ne voulait pas supporter cette augmentation. Il avait aussitôt notifié cette décision à la légation chilienne…
Que se passa-t-il entre l’attaché diplomatique chilien et le directeur des chantiers ? Il n’en transpira rien. Mais bientôt, le bruit circula à Barrow que le départ de l’Arauco était retardé.
Les hommes du sous-marin, interrogés à leur sortie en ville, déclarèrent qu’ils ne savaient rien. Le lendemain, l’on apprit qu’ils étaient consignés à bord.
Or, le départ devait avoir lieu le jour suivant. Les nombreux journalistes accourus à Barrow, levés dès l’aube, tentèrent en vain de savoir quelque chose. Ils purent cependant constater que la journée se passait sans que le sous-marin appareillât.
Une semaine passa encore. L’énigmatique envoyeur de message restait inconnu. Il n’avait plus, d’ailleurs, donné signe de vie.
L’Arauco, cependant, était toujours amarré à quai, à quelques centaines de mètres de la cale d’où il avait été lancé.
De nombreux détectives, payés par le chantier Oceania, le surveillaient jour et nuit. L’équipage, consigné à bord, ne mettait plus les pieds à terre. L’on savait que le plein d’essence et d’huile avait été fait, que les vivres étaient au complet. Le sous-marin était prêt à appareiller. Il n’appareillait pas. Qu’attendait-il ?
Toutes sortes de bruits circulèrent, plus absurdes les uns que les autres. L’on connut enfin la vérité : l’Arauco allait être convoyé, et convoyé par un bâtiment de guerre de la marine chilienne : le destroyer San-Pedro, qui venait d’être achevé aux chantiers de La Spezzia (Italie).
Le San-Pedro, un beau navire de cent trente mètres de longueur, capable de donner trente cinq nœuds, soit plus de soixante kilomètres à l’heure, était armé, en plus de mitrailleuses et de pièces de petit calibre, de quatre canons de 138 millimètres, qui le rendaient redoutable. Ainsi escorté, l’Arauco ne risquait pas d’être attaqué par un pirate, quel qu’il fût !
La prime d’assurance demandée aux constructeurs fut ramenée à son prix antérieur.
Et, à l’improviste, le sous-marin, convoyé par le destroyer, quitta Barrow-in-Furness. Un matin, les journalistes venus aux nouvelles apprirent que les deux navires étaient partis…
En Angleterre, en Amérique, des paris furent engagés. Les menaces du sans-filiste inconnu allaient-elles se réaliser, ou bien les deux navires arriveraient-ils à bon port ?
L’opinion générale fut que la traversée de l’Arauco se terminerait heureusement. L’émotion causée par la série de sinistres s’était calmée. On oublie vite… En peu de jours, l’on ne parla plus de l’Arauco.
Des radios expédiés par le sous-marin apprirent au public qu’il avait successivement touché La Corogne, puis Las Palmas (îles Canaries), et Dakar.
D’autres radiogrammes permirent de savoir que l’Arauco et le San-Pedro poursuivaient heureusement leur traversée de l’Atlantique. Ils passèrent au large de l’îlot de Fernando Noronha, et, deux jours plus tard, entrèrent dans le port de Pernambuco.
À bord, tout s’était bien passé. Pas la moindre avarie. La discipline s’était maintenue stricte.
Les deux détectives anglais Charles Jackson et Alfred Smith, qui avaient été embarqués secrètement à bord du sous-marin où ils remplissaient les fonctions d’électriciens, allèrent déposer leur rapport au consulat du Chili. Un rapport optimiste et rassurant. Les commandants des deux navires se montrèrent également satisfaits.
Au cours d’un bal donné en l’honneur des officiers de l’Arauco et du San-Pedro par le gouverneur de l’état de Pernambuco, les capitaines du sous-marin et du destroyer, interrogés par des journalistes, répondirent qu’ils n’avaient jamais pris au sérieux la menace du radiotélégraphiste inconnu… et que si le sous-marin avait été convoyé, ç’avait simplement été pour rassurer les familles des hommes de son équipage.
L’Arauco et le San-Pedro, après trois jours passés à Pernambuco, reprirent leur voyage.
Ils firent successivement escale à Bahia, à Rio-de-Janeiro, à Montevideo, où ils restèrent une semaine, pendant laquelle ils furent les héros de multiples réjouissances…
Ils quittèrent Montevideo pour Bahia-Blanca, où ils arrivèrent heureusement.
De Bahia-Blanca, les deux navires gagnèrent Port-Stanley, dans les îles Falkland, où ils restèrent quarante-huit heures, le temps de renouveler leur provision de mazout et de procéder à quelques serrages dans les machines. Tout allait bien à bord…
Vingt-quatre heures après le départ du San-Pedro et de l’Arauco de Port-Stanley, la station de T.S.F. de cette ville capta un message envoyé par l’Arauco et signalant que tout allait bien à bord…
Ce fut la dernière manifestation de vie des deux bâtiments. On les attendit en vain à l’île des États à l’entrée du détroit de Magellan, où ils auraient dû s’arrêter.
On crut à quelque avarie… Des avisos chiliens et argentins furent envoyés à leur recherche… Ils durent revenir sans avoir trouvé trace du sous-marin et du destroyer. Rien ne subsistait plus d’eux.
Le radiotélégraphiste inconnu avait exécuté sa menace !
II
Un mois s’était écoulé depuis la mystérieuse disparition de l’Arauco et du San-Pedro. Les journaux anglais et américains – sans compter les journaux chiliens – après avoir publié les opinions de plusieurs experts navals – lesquels experts n’en avaient pas, d’opinion ! – avaient, peu à peu, parlé d’autre chose, des grèves, des menaces de guerre, des élections, des incendies…
Nul ne se souvenait plus des deux navires perdus – sauf les familles des marins de leurs équipages – lorsqu’un crime étrange vint de nouveau secouer l’opinion publique.
Les côtes de la Floride, situées sous un merveilleux climat, réchauffées l’hiver par le gulf-stream, rafraîchies l’été par les vents alizés, constituent, si l’on peut dire, la Côte d’azur américaine. Il n’est pas de milliardaire, voire de simple millionnaire américain qui ne possède en Floride une « résidence » plus ou moins luxueuse, depuis le simple bungalow jusqu’au château princier. Quant aux hôtels, aux palaces, ils sont formidables, et leurs prix le sont également.
Palm-Beach est la véritable capitale mondaine de la côte floridienne. C’est à Palm-Beach que se réunit ce que les Yankees, appellent la « Society », la société de ceux qui possèdent au moins plusieurs millions de dollars.
À Palm-Beach, l’on joue au polo, au tennis ; l’on dispute des régates à la voile, en canots automobiles ; on excursionne en hydroplanes, l’on pêche les gigantesques poissons du golfe du Mexique.
Cette pêche, qui s’effectue avec de grands canots automobiles munis d’engins perfectionnés, est la grande attraction des côtes floridiennes ; c’est à qui ramènera le poisson le plus étrange, le plus formidable : certains de ces poissons, les tarpons, des raies énormes qui pèsent parfois une tonne et plus, et les sea-bats, chauves-souris de mer, mettent souvent en péril leurs chasseurs. Mais ce n’en est que plus excitant, exciting, comme disent les Yankees.
Parmi les pêcheurs de tarpons en villégiature à Palm-Beach, se trouvait le jeune lord Montagu Thornsdale, un richissime Anglais à demi Américain par sa mère, laquelle était née Jane Watson, et était fille de l’ancien attorney-general, Elmer Watson.
Wilfrid Montagu Thornsdale, un aimable garçon de vingt-quatre ans, était très populaire à Palm-Beach. Sportsman accompli, de polo, il s’était octroyé plusieurs coupes et avait gagné d’innombrables matches grâce à son racer, le Daredevil (Téméraire), un long canot automobile de plus de six cents chevaux de force.
Wilfrid Thornsdale était parti de nuit sur son Daredevil, pour aller pourchasser le tarpon. Il était accompagné de trois « hommes de couleur » – façon polie de dire des nègres – : Jabez Montgomery, le patron du canot, Matthews White, matelot, et Jim Carruthers, mécanicien.
Lorsque lord Thornsdale partait ainsi à la pêche, il ne restait jamais plus de vingt-quatre heures absent.
Aussi ses amis commencèrent-ils à s’inquiéter lorsque, après quarante-huit heures d’absence, le Daredevil ne donna pas encore signe de vie.
Des télégrammes furent envoyés dans les principales villes de la côte, dans les îlots avoisinants où le canot automobile avait été susceptible de relâcher. Nul ne l’y avait vu. Or, le racer, on le savait, était muni d’un puissant appareil de T.S.F., et, de plus, le temps était resté beau dans toute la région depuis son départ.
De nombreux sportsmen partirent à la recherche du canot disparu.
Parmi eux se trouvait M. Johnson Petersen, un gros fabricant de conserves de Chicago, qui avait pris le jeune lord en amitié.
M. Johnson Petersen se trouvait à environ soixante milles au nord-est de Palm-Beach, à bord de son yacht auxiliaire Fortuna, lorsque le matelot perché dans les barres de flèches signala une embarcation immobile dans l’Est.
Le Fortuna se dirigea vers elle. Un quart d’heure ne s’était pas écoulé que M. Petersen abaissait ses jumelles qu’il n’avait plus cessé de tenir devant ses yeux, et s’écriait :
— Mais… c’est le Daredevil !
Le moteur du Fortuna fut lancé à toute puissance. Bientôt le yacht de M. Petersen ne fut plus qu’à quelques dizaines de mètres de l’embarcation. Il stoppa.
M. Petersen ne s’était pas trompé. C’était bien le Daredevil, immobile comme une épave sur l’océan calme.
— Hello ! Montagu !… Cheer up, my boy ! lança M. Petersen qui essayait d’être jovial.
Sur le pont étroit du racer, personne. Tout paraissait en ordre, à bord…
Un canot, dans lequel avaient pris place le premier officier du Fortuna, deux matelots et M. Petersen, se détacha du yacht et vogua vers le Daredevil.
Impossible d’imaginer un temps plus beau ! Le ciel était d’un bleu clair, sans tache. Pas un souffle de vent ne ridait l’océan dont la surface unie et luisante avait la couleur de l’opale.
Le Daredevil, tout blanc, ses cuivres bien vernis, son pont sans une souillure, semblait attendre des invités.
Le canot du Fortuna n’en était plus qu’à trois mètres à peine, lorsqu’un énorme vautour jaillit littéralement du racer. Il partit obliquement, comme une flèche, en agitant ses longues ailes avec vigueur. En quelques secondes, il se fut élevé dans le ciel clair.
M. Petersen, malgré lui, eut un petit frisson. Mais le canot, habilement manœuvré, accostait déjà le Daredevil.
M. Petersen, un gros homme de cinquante ans, au visage rond et rouge comme un fromage de Hollande, tint à grimper le premier à bord du racer.
Soufflant un peu, il se dirigea vers le cockpit de l’embarcation, placé à l’arrière et d’où s’était envolé le vautour.
Il poussa une exclamation rauque et recula avec une telle violence qu’il serait tombé si l’officier du Fortuna, qui l’avait suivi, ne l’eût retenu.
Dans le cockpit, un homme était assis, affalé, plutôt : lord Montagu Thornsdale. Il était vêtu de l’élégant costume de flanelle blanche qu’il portait en quittant Palm-Beach l’avant-veille, mais un des côtés du veston était teint en rouge brun, par le sang jailli d’une blessure à la place du cœur. Au centre de la tache rouge, le manche en cuivre d’un poignard brillait…
Le malheureux sportsman était mort, et, détail affreux, le vautour qu’avaient vu les gens du Fortuna lui avait rongé les orbites et les lèvres.
— Lord Thornsdale a été assassiné ! murmura l’officier du Fortuna. Ce doivent être ses nègres qui ont fait le coup ! Ces noirs, il faut s’en méfier ! On ne s’en méfiera jamais assez !
— Voyons le reste ! fit M. Petersen, qui s’était déjà ressaisi.
Il marcha vers la petite porte donnant dans le compartiment du moteur, lequel compartiment occupait les deux tiers de l’embarcation.
Elle était fermée. M. Petersen l’ouvrit. À l’intérieur, il y avait trois cadavres : un en travers du moteur, les deux autres placés à droite et à gauche de la double rangée des trente-deux cylindres.
— Ce ne sont pas les nègres ! fit M. Petersen.
L’officier du Fortuna ne répondit pas. Ce ne pouvaient être les nègres, puisqu’ils étaient là tous trois, et bien morts.
L’officier, passant devant M. Petersen, se pencha sur les cadavres et constata qu’ils ne portaient aucune blessure apparente, mais que leurs traits révulsés exprimaient une horreur, une épouvante, une souffrance sans nom. Tous trois avaient encore les yeux largement ouverts. Leurs prunelles éteintes semblaient contempler une vision d’enfer. Des filets d’une bave verdâtre avaient coulé des commissures de leurs lèvres. Les mains étaient crispées, recroquevillées par les spasmes.
Autour des malheureux, rien ne semblait avoir été touché. Le moteur paraissait intact, ses cuivres et ses nickels brillant comme des miroirs.
M. Petersen, cependant, y découvrit des taches, des taches de bave.
Les petits placards de tôle placés de chaque côté du moteur, entre les réservoirs d’essence, n’avaient pas été ouverts. Aucune trace de lutte ne se voyait. Mais l’officier du Fortuna constata que les réservoirs étaient absolument vides, que plus une goutte d’essence ne restait à bord.
— Il y a eu crime ! fit le fabricant de conserves. Nous allons remorquer le Daredevil à Palm-Beach !… Il n’y a qu’à laisser les noirs où ils sont… Quant à lord Montagu, vous allez le faire envelopper décemment dans un suaire et le faire transporter à bord, dans le fumoir… Poor boy !
He was a jolly good fellow, indeed ! (c’était vraiment un gentil garçon.)
Les deux hommes ressortirent du compartiment du moteur.
M. Johnson Petersen, qui avait repris tout son calme, alla revoir le malheureux lord.
Il retint une exclamation : autour du cou du mort, une chaînette de cuivre avait été passée, entre la chemise de soie molle et le veston de flanelle. À cette chaînette était accrochée une médaille ovale, en cuivre également, assez semblable, comme dimension, aux plaques d’identité dont étaient munis les combattants pendant la guerre.
M. Johnson Petersen, domptant sa répugnance, saisit la chaînette et approcha la plaque de ses yeux. Il y lut ces mots, gravés avec un burin grossier :
A-7, Saratoga, Arauco… et cæteraFeodor Ivanovitch Sarraskine1865. England and America : remember !
La stupéfaction, la stupeur de M. Johnson Petersen furent si immenses que, pendant plusieurs secondes, il resta immobile, penché sur le cadavre, tenant dans sa main la petite plaque de cuivre.
Il s’attendait à tout, mais pas à lire sur cette plaque une allusion au mystère de l’Arauco !
Il reposa doucement la plaque sur la poitrine du mort et se redressa. Derrière lui, l’officier du Fortuna, qui ignorait la découverte de son patron, attendait.
M. Petersen eut une petite hésitation. Il ouvrit la bouche pour parler, mais se tut. Et, se penchant de nouveau sur le corps inerte du jeune lord, il détacha la chaînette, la prit et la fourra dans sa poche.
— Prenez le Daredevil en remorque ! ordonna-t-il à l’officier. Et amenez-le le long du Fortuna, qu’on puisse embarquer le corps de lord Montagu !… Allons !
Titubant un peu, M. Johnson Petersen regagna le canot qui l’avait amené. Celui-ci, peu après, entraîna le racer vers le Fortuna…
Six heures plus tard, le yacht du fabricant de conserves, remorquant le Daredevil, accostait un des appontements de Palm-Beach.
La nuit tombait. La plage était déserte.
M. Johnson Petersen, laissant les corps à la garde de ses marins, débarqua seul et bondit vers le poste de police le plus proche.
Il y fit aussitôt le récit de sa rencontre et remit aux policiers la chaînette de cuivre et la plaque qu’il avait retirées du cou de lord Montagu Thornsdale.
L’affaire était d’importance ! Le chef du poste, sans perdre une seconde, prévint téléphoniquement M. Higginbotham, le directeur de la police de Palm-Beach.
Dix minutes ne s’étaient pas écoulées que le fonctionnaire rejoignait M. Petersen dans le poste.
Le fabricant de conserves dut répéter son récit.
— Étrange ! apprécia M. Higginbotham, après avoir longuement examiné chaîne et plaque. Je ne pense pas que lord Montagu ait jamais porté de son vivant un pareil bijou autour de son cou ! Non !…
D’autre part, l’inscription est bizarre : A-7, Saratoga, Arauco sont des noms qui paraissent se rapporter aux navires récemment disparus…
« Mais qui est ce Feodor Ivanovitch Sarraskine ? Un Russe qui en veut à l’Angleterre et aux États-Unis ? Cela peut se concevoir : tous les navires si mystérieusement détruits sont anglais ou américains !…
« Mais que signifie ce numéro 1865 ? Est-ce un millésime ?… Nous allons voir cela, et, pas un mot aux journalistes, monsieur Petersen !
— Les journalistes ? Des voyous et des rascals ! Je les hais ! déclara le fabricant de conserves. « Ils » ont publié que, dans mes fabriques, quand un ouvrier tombait par accident dans les malaxeuses de viandes pour pâtés, on n’arrêtait pas les machines !… Ce qui est faux, je n’ai pas besoin de vous le dire ! Si on n’arrêtait pas les machines, on trouverait des débris d’os et de boutons de culotte dans mes pâtés, et cela me ferait du tort !…
— Je comprends cela ! admit M. Higginbotham. Enfin, nous sommes d’accord !… Pour le reste, je vais donner des ordres pour qu’on vienne prendre les corps demain matin… En attendant, qu’on n’y touche pas ! Il faut que le médecin légiste les voie !… Peut-être y aura-t-il des empreintes à prendre ? Et recommandez à vos marins de tenir leurs langues !
— Je vais faire pour le mieux ! assura M. Johnson Petersen. Quant à ces gueux de journalistes, s’il s’en montre un, je le fais boxer par mes marins.
Il serra la main du directeur de la police et regagna le Fortuna.
Plusieurs marins du yacht malheureusement, étaient déjà descendus à terre. Ils avaient dû parler, car une foule épaisse se pressait sur l’appontement, devant le navire du fabricant de conserves.
À la clarté des lampadaires électriques, M. Petersen reconnut plusieurs de ses amis du Palm-Beach Impérial Yacht Club, lesquels, aussitôt, se précipitèrent à sa rencontre, pour avoir des détails.
M. Petersen tenta en vain de se dégager. Il réussit à remonter à bord de son yacht, mais suivi de plusieurs douzaines d’amis ou simples curieux.
Force lui fut de raconter comment il avait découvert au large le racer de lord Montagu Thornsdale. Mais il s’abstint de mentionner l’existence de la mystérieuse chaînette de cuivre et de la plaquette qui y était suspendue.
Il put enfin faire refouler les curieux et sauter dans son auto qui, entre temps, était arrivée sur l’appontement.
Le véhicule fila aussitôt dans la direction de la résidence du fabricant de conserves.
— Un gentleman vous attend, sir, et désirerait vous voir pour une affaire urgente ! lui déclara son valet de chambre, à peine eut-il franchi le seuil de sa villa :
— Un gentleman ? Qui ça ? Je ne reçois que des amis et dont je sais le nom !… Je n’attends personne ce soir ! Faites sortir cet homme ! D’abord a-t-il dit son nom ?
— Je n’ai pas cru devoir le faire, mister Petersen ! fit un gros homme jaune en surgissant du salon voisin. Je suis M. Douglas Sgorp… chef des informations de l’American Evening News, de New-York !… Je viens vous parler… hum… du… (Douglas Sgorp, de sa main épaisse et courte, fit le tour de son cou) et de la… (le doigt de Douglas Sgorp dessina les contours de la plaque ovale trouvée par M. Petersen sur le cadavre de lord Montagu Thornsdale).
III
M. Johnson Petersen, à l’ordinaire, ne s’émouvait que très difficilement. Il avait fait plusieurs fois faillite. Il avait tenu tête à des grévistes qui voulaient incendier ses usines. Il avait lui-même désarmé un spéculateur qui, ruiné par lui à la Bourse, l’avait assailli avec un pistolet automatique au poing.
Le cynisme, l’impudence de Douglas Sgorp le clouèrent au sol :
— Quoi ? Quoi ? aboya-t-il. Vous… journaliste ? Vous avez le front ?… Vous… Hors d’ici !… Décampez ou je vous fais jeter dehors ? Vous entendez ?
M. Douglas Sgorp n’avait pas bougé. Lui non plus ne se troublait pas facilement, encore moins facilement que le fabricant de conserves :
— Je suis prêt à me retirer, monsieur Petersen, dit-il tranquillement, mais, demain, l’American Evening News pourra commencer la publication du rapport du professeur Smithson sur le danger des conserves au salicylate !… C’est très intéressant !… N’est-ce pas ?
M. Petersen lança à son visiteur un regard haineux :
— Les véritables empoisonneurs, c’est vous, les journalistes ! gronda-t-il. Des bandits ! Des rascals… qui n’hésitez pas à ruiner d’honnêtes contribuables… à jeter par terre des industries nationales, qui contribuent à la prospérité du pays !… Vous êtes…
— Je vois que vous vous souvenez, mister Petersen, que vous avez été candidat au Sénat, hé ? interrompit Douglas Sgorp, en souriant. Tout à fait bien pour une réunion électorale, ce petit discours !… Ça m’étonne que vous n’avez pas été élu !… Mais il s’agit de votre trouvaille !… L’American Evening News sait tout !… Vous avez remis la chaînette de cuivre et le médaillon à M. Higginbotham… N’avez-vous rien gardé ?
— Quoi ? Que voulez-vous que j’aie gardé ? maugréa M. Petersen, complètement démonté.
— Je n’en sais rien… Un petit souvenir !… Vous devez être un collectionneur !… Un bijou… un document… Hein ?… Si vous avez gardé quelque chose, montrez-le-moi… La presse doit tout savoir !
— Et je n’ai rien gardé, sir !… Et je ne suis pas un voleur, moi, sir !… Je suis un honnête homme !… Un self-made-man ! Un law-abiding citizen !… (un homme qui s’est fait lui-même ! un homme respectueux des lois.) Et tout le monde ne peut en dire autant !…
— Well !… Vous n’avez rien gardé !… Je vous crois, mister Petersen !… Je vous demanderai donc simplement de me faire le récit de votre découverte, de vos impressions !… Je le câblerai aussitôt à New-York, de façon à ce qu’il puisse paraître dans notre numéro de demain matin !… Avec votre portrait !… Nous l’avons là-bas… comme celui de tous les hommes proéminents et celui de toutes les personnes qui nous semblent sujettes à être arrêtées quelque jour. Une fois que quelqu’un est arrêté, c’est le diable pour avoir son portrait : la famille ne veut pas le donner. Les amis disent qu’ils n’en ont pas !…
« Et cela vous fera de la publicité, nous ne manquerons pas de mentionner que vous êtes le président de la National Packing C°, Incorporated !…
— J’ai fait mon rapport à la police !… Je n’ai rien à y ajouter !… Allez voir M. Higginbotham qui vous le communiquera, s’il le juge bon !
— J’irai voir M. Higginbotham si je le juge utile, monsieur Petersen. Je ne vous demande pas si les os de vos jambons sont cariés !… Chacun son métier !
« Ce qu’il faut à l’American, ce sont vos impressions directes !… Vous allez me les communiquer ! Je vous écoute !…
M. Johnson Petersen paraissait avoir repris tout son sang-froid. À la vérité, il était hors de lui. Mais il connaissait l’American Evening News. Il savait que ce terrible journal pouvait – par une simple série d’articles – le ruiner en moins de trois mois.
Il avala sa salive, qui lui parut amère ; et, avec un petit rire forcé, il murmura :
— Ça vous fait plaisir ? Allons-y ! On voit que vous avez du temps à perdre !…
Et le fabricant de conserves, d’une voix posée, neutre, la voix qu’il prenait pour lire un rapport à ses actionnaires, fit le récit de la découverte du Daredevil et des cadavres qu’il contenait.
Douglas Sgorp le laissa parler, sans prendre la moindre note.
Quand il eut terminé, le chef des informations de l’American Evening News lui posa quelques questions serrées, d’un ton de juge d’instruction : Avait-il remarqué des ecchymoses sur les corps de lord Thornsdale et de ses hommes ?… Était-il certain que les marins du Fortuna, qui l’avaient accompagné à bord du racer, n’avaient pas fait disparaître quelques objets pouvant servir de pièces à conviction ? Qui, d’après lui, était mort le premier ? Lord Thornsdale ou ses hommes ?
— Mais je n’en sais rien ! Comment voulez-vous que je le sache ? Je ne suis pas médecin légiste ! Et j’étais tellement ému de ma découverte que je n’ai pas songé à observer mes marins ! D’abord, ce sont tous des honnêtes gens !
— Le mot honnête comporte toutes sortes de significations : cela dépend de celui qui le prononce ! remarqua froidement Sgorp. Au revoir, cher monsieur Petersen ! Charmé d’avoir fait votre connaissance !…
Et le gros homme, tranquillement, marcha vers la porte du vestibule, l’ouvrit et sortit.
M. Petersen, immobile, le regarda s’éloigner à travers une baie.
À moins de cent mètres de la porte du parc, un confortable cabriolet attendait. Douglas Sgorp s’y jeta :
— Chez le patron ! lança-t-il au chauffeur nègre qui, aussitôt, embraya.
L’auto fonça en avant à toute allure, pour s’arrêter, moins de cinq minutes plus tard, à l’extrémité nord de la plage de Palm-Beach, devant un monumental portail de fer forgé encastré dans une muraille de pierres taillées en pointes de diamant et surmonté d’un entrelacs de lettres dorées.
L’arrivée de l’auto avait dû être annoncée, car les vantaux du portail s’ouvrirent automatiquement devant elle. Le véhicule, à petite allure, traversa un grand parc planté de bambous, d’aréquiers, de cèdres et d’eucalyptus et s’arrêta devant un vaste perron de marbre sur lequel s’ouvraient plusieurs portes-fenêtres cintrées. À travers les vitrages, des lumières filtraient.
Douglas Sgorp traversa rapidement le perron et pénétra dans un grand hall soutenu par des colonnes de marbre blanc, et garni de statues antiques, ou prétendues telles.
Un valet de pied s’avança aussitôt vers lui et le conduisit dans un salon chinois, de forme octogonale, où attendait un homme maigre, de petite stature, au visage rasé, sillonné de rides. Les lèvres étaient minces ; le nez, long et mou, s’allongeait comme une trompe. Au-dessus du front, quelques rares mèches de cheveux d’un blond filasse étaient collées à la peau du crâne. Les yeux, en vrille, de couleur gris-vert, dardaient des regards aigus, pénétrants.
L’homme n’était rien moins que M. William-Arthur Feist, directeur de l’American Evening News et président de la Radio-Corporation, une agence qui fournissait des nouvelles à plus de cinq cents journaux américains et étrangers, une des premières puissances des États-Unis.
M. William-Arthur Feist cracha dans un plateau de porcelaine bleue la boule de chewing-gum qu’il malaxait entre ses dents aurifiées.
Les deux mains dans ses poches, il marcha vers Douglas Sgorp et demanda, d’une voix neutre :
— Eh bien ?
— Je viens de voir le charcutier, patron !… Je l’ai confessé !… Il a voulu « un peu » faire le malin, mais je lui en ai enlevé l’envie !… Il ne sait vraiment rien d’autre que ce qu’il a raconté à M. Higginbotham !…
— Nous publierons ses déclarations… Vous allez arranger ça, Sgorp ! Une chance, que je sois en villégiature à Palm-Beach ! Moi qui voulais repartir hier !… Il faut téléphoner tout de suite à Washington et à New-York… Cette affaire m’intéresse !…
— C’est peut-être simplement un beau crime, patron !… L’assassin aura voulu égarer la justice… Il aura laissé exprès cette médaille de cuivre sur laquelle il a gravé des mots qui ne signifient rien !… Et, pour mieux réussir, il aura mentionné les noms des navires si bizarrement disparus !
— Hum !… Il y a deux écoles : ou bien nous déclarons que l’affaire est un simple assassinat crapuleux, ou bien nous nous lançons sur la piste des bateaux perdus !
« … C’est la seconde alternative qui est la plus sensationnelle !… Quoi qu’il en soit, que la mort de lord Thornsdale se rapporte ou non aux disparitions de navires, peu nous importe !… Il faut que l’American Evening News élucide ce mystère ! – D’abord, savoir si la chaînette de cuivre et la plaque appartenaient au jeune lord ?…
— Je ne le pense pas, patron !
— Qui sait ? Ces Anglais ont des manies si stupides !… Il se peut que lord Thornsdale portait habituellement sur lui cette chaînette, comme porte-bonheur, comme amulette !… Il la cachait, et voilà tout !… Il faut enquêter là-dessus !…
— On pourrait faire enlever la chaînette et la plaque, patron, ce ne serait pas difficile !
— Non ! Cela ne nous servirait à rien !
« Il faudra faire des recherches… Savoir, si, en 1865, il y a eu un Sarraskine qui a laissé des traces !… Ce Sarraskine, si l’inscription de la plaque n’est pas l’œuvre d’un fumiste, en voudrait à l’Angleterre et aux États-Unis… En tout cas, il doit être mort depuis longtemps, si tant est qu’il avait mettons vingt-cinq ans, en 1865 !…
« Vous allez écrire votre papier article et prendrez ensuite le premier train pour New-York. Une fois là-bas, informez-vous de ce Sarraskine ! Comme toujours, carte blanche. Mais réussir !
— Je vais faire pour le mieux, patron !
Il s’inclina et se retira, sans que W. -A. Feist ait retiré les mains de ses poches.
Moins d’une heure plus tard, il roulait vers New-York.
C’était une personnalité, que Douglas Sgorp. Âgé de quarante-cinq ans, gros et trapu, il avait une tête en forme de poire : crâne pointu, garni de cheveux noirs, clairsemés ; larges yeux bordés de rouge, sous lesquels la peau formait des poches. Le nez était court et camard ; il surmontait deux lèvres lippues. Le menton, haut et rebondi, comme un talon de galoche, se continuait par deux épais bourrelets de chair jaune qui rejoignaient la poitrine.
Douglas Sgorp n’avait rien de sympathique ! Plusieurs fois, il avait failli être arrêté pour des affaires malpropres, chantage ou autres. Il avait réussi à s’en tirer. On le craignait. Il savait trop de choses. Avec cela hardi, audacieux, bluffeur, hâbleur ; l’on ne savait jamais, quand il menaçait, s’il était sincère ou s’il se flattait.
Depuis plusieurs années, il était le chef des informations de l’American Evening News et le bras droit, l’éminence grise de M. William Feist.
Les grands financiers, manieurs d’affaires, trusteurs, le craignaient comme le diable. Les hommes politiques le ménageaient.
Au Capitole, à Washington, au City-Hall, à New-York, il entrait en maître, sans quitter le petit chapeau d’étoffe grise, passé, délavé, déformé, qui lui servait d’habituel couvre-chef. Presque continuellement, il mâchonnait un cigare, qu’il rallumait et rallumait, sans parvenir à l’empêcher de s’éteindre.
Dans les discussions, il avait une façon de considérer ses interlocuteurs, un mélange de cynisme et de gouaille, qui démontait les plus hardis.
M. William-Arthur Feist, qui s’y connaissait en hommes, savait qu’il pouvait se fier à son chef des informations !
Arrivé à New-York à sept heures du matin, Douglas Sgorp, de la main, fit signe à des crieurs de journaux qui stationnaient devant la gare du Grand Central Railroad. Il acheta une demi-douzaine de feuilles encore humides d’encre, et s’engouffra dans un taxi.
— Oh ! Oh ! ronchonna-t-il.
En première page du journal il lisait ce titre, imprimé en caractères gras, sur deux colonnes :
Drame de la piraterie en Écosse
MISS ANNIE MONTAGU, SŒUR DE LORD THORNSDALE ENLEVÉE PAR DES PIRATES. LE MANOIR DE THORNSDALE INCENDIÉ
Dépêche particulière. – De notre correspondant d’Inverness.
Le manoir de Thornsdale, où vivait miss Annie Montagu, la jeune sœur de lord Montagu Thornsdale récemment assassiné au large de Palm-Beach, vient d’être à son tour victime de bandits inconnus. Cette nuit, les habitants de la bourgade d’Inverness, située à un demi-mille du manoir, ont vu passer une grande automobile, tous feux éteints… Presque aussitôt, ils ont aperçu des lueurs autour du manoir. C’était la forêt de sapins qui couvre les pentes ouest de la colline sur laquelle est bâtie la demeure historique des Thornsdale qui flambait.
L’alarme fut aussitôt donnée. Mais les villageois ne disposaient que d’une pompe tout à fait insuffisante. Quand ils arrivèrent sur les lieux du sinistre, le feu s’était communiqué au manoir. Les sauveteurs aperçurent un homme qui accourait vers eux. Il portait une profonde blessure à la poitrine et ses habits étaient lacérés et à demi brûlés. C’était M. Malcolm, l’intendant du château. M. Malcolm, qui perdait son sang en abondance, eut le temps, avant de s’évanouir, de raconter qu’il avait surpris les incendiaires, des hommes masqués de haute stature, et qu’il avait engagé une lutte désespérée avec eux. Ils l’avaient repoussé et s’étaient enfuis en emportant miss Montagu roulée dans une couverture…
Le malheureux régisseur avait pu entendre la jeune fille appeler au secours !… Il avait pu se relever et avait vu les bandits sauter dans une grande auto qui s’était éloignée à toute vitesse.
M. Malcolm a été transporté à l’hôpital d’Inverness où l’on désespère de le sauver. La police anglaise recherche les bandits. Le signalement de l’auto a été envoyé partout.
L’article s’arrêtait là.
Douglas Sgorp passa sa langue sur ses lèvres.
— Le frère poignardé, la sœur enlevée ! Voilà la famille Montagu de Thornsdale éteinte !… Que peut-il y avoir là-dessous ?… Si les bandits qui ont tué lord Montagu et enlevé sa sœur sont les mêmes que ceux qui ont provoqué les sinistres maritimes, nous sommes en face d’une association puissante et riche !… Il y a peut-être « quelque chose à faire ? »
Douglas Sgorp, rapidement, parcourut les autres journaux. Ils ne donnaient pas d’autres détails que la feuille qu’il venait de lire.
Sgorp les froissa, ralluma son cigare une fois de plus, et se plongea dans ses réflexions…
Quelques minutes plus tard, il arrivait dans le petit appartement qu’il occupait dans la 38e rue, non loin de Broadway, en plein centre des affaires.
— Il y a un gentleman qui désire vous voir, sir ! Il est déjà venu hier soir et est revenu ce matin ! lui déclara le nègre qui lui servait à la fois de valet de chambre et de cuisinier. Il est dans le salon !
Douglas Sgorp prit impatiemment la carte qui lui était tendue et pénétra dans son salon.
IV
Un jeune homme, paraissant environ vingt-huit à trente ans, mince, svelte, attendait, debout au milieu de la pièce. Son visage, soigneusement rasé, avait une expression à la fois calme, froide et digne, légèrement insolente. Ses cheveux, d’un blond filasse, étaient nettement partagés par une raie qui descendait jusqu’à la nuque. Un monocle s’enchâssait dans son œil gauche. Tout, en lui, attestait l’élégance la plus raffinée, depuis les fins souliers de chevreau glacé jusqu’à la pochette de crêpe de Chine pendant négligemment de la poche de son veston en drap bleu marine.
— Et alors ? Du nouveau ? demanda brutalement Sgorp, sans même tendre la main à son visiteur.
— Oui, du nouveau, mister Sgorp ! Quelque chose de très important !… De gros !… De sensat…
— Oui, oui… Au Secretary of State (ministère des Affaires étrangères américain) tout ce qui sort de la routine est qualifié sensationnel !… Je parie que vous allez m’apprendre que le shah de Perse s’est fait limer les cors de ses pieds ?
— Vous plaisantez toujours, mister Sgorp !… fit le jeune homme avec une exquise bonne grâce. Mais vous savez bien que je ne me permets de vous déranger que pour vous communiquer des – documents indiscutablement intéressants !
Et le visiteur appuya sur le mot « indiscutablement ».
Douglas Sgorp eut un haussement d’épaules qu’il n’essaya même pas de dissimuler :
— Il y en a, oui ! admit-il. Vous les faites, d’ailleurs, payer assez cher, Mittheim !… Qu’est-ce que c’est ? Je vous préviens qu’il me faut du sérieux, pas des broutilles ! Nous en avons assez d’acheter des ragots et des racontars !
— Je me permettrai de vous faire observer, monsieur Sgorp, que vous exagérez, du moins quant à moi ! Je ne pense pas vous avoir jamais communiqué des pièces sans…
— Au fait ! Qu’avez-vous à m’offrir, cette fois ? coupa le chef des informations de l’American Evening News.
— Je suis ici pour vous le dire, naturellement, monsieur Sgorp ! remarqua le jeune homme, toujours poli et courtois. Je vous apporte la copie d’une lettre qui est parvenue hier soir au Secretary of State !…
« D’après M. Mitchell, le secrétaire particulier du ministre, qui l’a ouverte et lue, elle est authentique. Elle porte toutes les traces de l’authenticité ! C’est une pièce qui va révolutionner l’Amérique et même l’Europe, je peux le dire !
— Vous pouvez dire ça et autre chose, Mittheim ! Mais cela ne prouvera rien, vous autres, diplomates et bureaucrates, vous êtes de fieffés blagueurs !… Voyons, qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Déboutonnez-vous : vous ne vous croyez pas, je pense, à la Conférence des Ambassadeurs ?
— C’est une lettre – une lettre que j’ai pu lire et que je viens vous communiquer – moyennant vingt-cinq mille dollars, monsieur Sgorp ! précisa tranquillement M. Mittheim.
Sgorp ne répondit pas.
Depuis longtemps, il « employait » M. Archibald Mittheim, un sous-chef de bureau au Secretary of State. M. Mittheim lui fournissait des renseignements qu’il grappillait un peu partout dans les bureaux du ministère et, même, au besoin, se procurait par des moyens à lui, que Sgorp ne tenait pas à approfondir.
Sgorp payait les documents qui lui étaient soumis, et ces documents paraissaient ensuite dans l’American Evening News, ou ne paraissaient pas, suivant les besoins de la cause.
M. Archibald Mittheim augmentait ainsi ses émoluments… Mais, jamais, il n’avait – de loin ! – émis des prétentions pareilles. Jamais il n’avait vendu aucune pièce plus de mille dollars.
Et voilà qu’il en réclamait vingt-cinq mille ! Il fallait, vraiment, qu’elle en valût la peine !
— C’est une lettre se rapportant à la disparition des sous-marins, du Tuskeegee et de l’Arauco ! expliqua M. Mittheim, voyant que Douglas Sgorp attendait la suite.
— Vous l’avez sur vous ? s’enquit simplement Sgorp.
— Non. Mais je la sais par cœur. Je n’ai pas voulu en conserver la copie… J’aurais pu la perdre, ou on aurait pu me l’enlever !…
Un silence suivit ces paroles. Douglas Sgorp, les yeux mi-clos, observait son visiteur.
— Oui… oui… murmura-t-il. Vous êtes homme de précaution, Mittheim, quoique je n’aie jamais eu l’idée de rien vous enlever !… Well ! Récitez-moi votre petite histoire, puisque vous la savez par cœur, et, si, réellement, elle vaut les vingt-cinq mille dollars, je vous signe immédiatement un chèque de cette somme !
— Il va être huit heures, monsieur Sgorp ! Je n’ai pas beaucoup de temps à moi !… J’ai pris un congé jusqu’à demain matin. Il faut que je reprenne le train pour Washington !… Nous discutons pour rien !… Donnez-moi le chèque de vingt-cinq mille dollars et je vous récite ma leçon, sinon, j’ai encore le temps d’aller la réciter à un autre journal !… Je le regretterais beaucoup, étant donné l’excellence et l’ancienneté de nos relations, cher monsieur Sgorp !
Ces quelques phrases avaient été prononcées du même ton doux et aimable, habituel à M. Mittheim.
Douglas Sgorp, entre ses lourdes paupières, lança au fonctionnaire un regard atone.
— Vous êtes un peu dur aujourd’hui, Mittheim ! dit-il. N’oubliez pas que nous pourrions – si nous le voulions – vous faire du tort !… Il y en a qui sont à Sing-Sing (prison de l’État de New-York) et qui en ont moins à se reprocher que vous !… Les preuves sont entre nos mains !
— Oh ! monsieur Sgorp !… Vous m’affligez !… Vous voulez peut-être m’intimider ?… C’est de bonne guerre, quand on discute, mais vous savez bien que je vous suis trop utile pour que vous vous laissiez jamais aller à des actes aussi regrettables !
« Par qui me remplaceriez-vous, d’autant plus que je sais les noms de tous les camarades qui… vous rendent les mêmes services que moi !… Il y a MM. Montgomery, Halsward, Gathway…
— Ça va !… Voilà le chèque ! coupa Douglas Sgorp, rudement.
Il avait compris que – pour le moment – Mittheim était le plus fort. Alors, inutile de discuter davantage.
Tirant de sa poche un carnet de chèques, il en libella un au porteur et le tendit au fonctionnaire du Secretary of State.
M. Mittheim l’examina, le plia soigneusement et le fourra dans le petit portefeuille de maroquin écrasé qu’il portait dans sa poche.
— Alors ? fit Sgorp.
— Écoutez-moi : je récite !
… À Monsieur le Secretary of State, à Washington.
Veuillez lire et méditer cette lettre avec attention. Une copie identique vous en sera envoyée dans un délai que je me réserve d’apprécier, mais qui sera assez bref.
C’est moi qui ai coulé le croiseur britannique Maya, le dock flottant de Singapore, les sous-marins A-7, C-115 et C-119. C’est moi qui ai fait sauter le Fort Sumter, à San Diego et avarié le Tuskeegee. C’est moi qui ai coulé le transport Saratoga, et, en dernier lieu, ai fait disparaître le destroyer chilien San-Pedro et le sous-marin Arauco, après avoir averti les autorités anglaises et chiliennes.
On ne m’a cru qu’à demi. Le résultat a démontré que je savais tenir mes promesses.
La flotte britannique et la flotte américaine iront par le fond, quand il me plaira. Mais je n’y tiens pas. Je ne suis pas un barbare. Je fais ce qu’il faut et rien de plus.
L’Angleterre et les États-Unis m’ont causé un tort considérable. Ces deux nations ont failli ruiner ma vie, et, en tout cas, ont été cause qu’une partie de mon existence a été irrémédiablement gâchée. Les exécutions de navires auxquelles j’ai dû procéder me suffisent, comme vengeance.
À présent, il ne me reste plus qu’a obtenir les dédommagements auxquels j’ai droit en stricte justice et équité. Moi seul sais ce que j’ai souffert. Moi seul peux le savoir. Moi seul peux évaluer le tort immense qui m’a été fait.
Ce tort, je l’ai évalué. Je l’évalue à cinquante millions de dollars, qui devront m’être versés en or. Ils seront embarqués sur un navire que je désignerai. Ce navire sera évacué, au large, en un point que je préciserai, par son équipage. L’or sera ensuite recueilli par mes soins et le navire qui l’aura transporté, coulé.
J’exige, de plus, une reconnaissance solennelle, de mon innocence par le gouvernement des États-Unis et la promesse, enregistrée par le Sénat, que je ne serai en rien inquiété.
Le Foreign Office1est également en possession d’une lettre de moi semblable à celle-ci. Je lui réclame une indemnité et la possession paisible de l’archipel des Bermudes. Plus, la reconnaissance de mon innocence et la promesse, enregistrée par la Chambre des Communes et de l’Assemblée des Lords, que je ne serai en rien inquiété.
Je n’ai point voulu faire connaître mes exigences à l’opinion publique mondiale, ce qui m’eût été facile au moyen de la T.S.F., mais j’ai estimé ce procédé inutile.
Pour la cession des Bermudes, je tiens à vous faire connaître que j’ai simplement demandé à ce qu’elle me soit faite en qualité de compagnie à charte, chartered, pour 99 ans.
Les autorités américaines verront certainement ce changement d’un bon œil, attendu que la base navale anglaise d’Hamilton devra disparaître.
L’amirauté britannique aura à s’entendre avec le Naval Secretary2américain pour que les 50 millions de dollars, ainsi que les 10 millions de livres sterling, que je réclame à l’Angleterre, soient chargés sur le même navire. Cela réduira les frais, simplifiera et accélérera les choses.
Ledit navire devra être rendu dans un délai de soixante jours à dater d’aujourd’hui dans l’océan Pacifique : latitude Sud : 10°, longitude Ouest : 120° 30’ 30”.
Un accusé de réception de la présente devra m’être fait au moyen d’une annonce dansl’American Evening News et le New-York Herald, de New-York. Annonce ainsi conçue :
« F.I.S. Accepté. Jonathan. »
Cette annonce devra être insérée dans un délai de deux semaines. Faute de quoi, je considérerai que vous n’avez pas jugé mes arguments dignes d’attention, et qu’il me faut vous en fournir d’autres, ce à quoi je ne manquerai pas.
Pour éclairer votre religion, veuillez, avant tout, consulter les Annales criminelles de Washington, volume XXI, juillet 1865. Affaire Feodor Ivanovitch Sarraskine.
Feodor Ivanovitch Sarraskine, c’est moi.
Je m’efforce, monsieur le Secretary of State, de vous saluer avec considération.
Feodor Ivanovitch Sarraskine.
M. Mittheim, qui avait récité tout d’une haleine la lettre du mystérieux Sarraskine, se tut.
Toujours souriant, il passa un fin mouchoir parfumé sur son front où des gouttes de sueur avaient perlé.
— C’est tout ? demanda Douglas Sgorp, qui avait écouté avec une scrupuleuse attention.
— C’est tout, mister Sgorp ! Il me semble, n’est-ce pas, que c’est suffisant ?
— Oui… c’est « assez » intéressant ! admit le chef des informations de l’American Evening News. Vous avez une excellente mémoire, monsieur Mittheim !
— On me l’a toujours dit, monsieur Sgorp !… Je m’en félicite aujourd’hui plus que jamais, puisqu’elle m’a permis de vous rendre service et, je pense, de vous être agréable !
— Vous êtes certain de n’avoir rien oublié, de n’avoir rien changé dans le texte en question ?
— Rien. Mémoire photographique, telle est la mienne !
— Oui… Et comment avez-vous réussi à connaître cette lettre ?
— Vous me permettrez, monsieur Sgorp, de garder pour moi les sources de mes informations. Mon devoir est de ne pas découvrir mes… amis !… J’ajoute que, sur les vingt-cinq mille dollars que vous m’avez si aimablement remis, une forte partie est destinée à rémunérer ces concours !
— Oui, le moins possible, hé ? ricana Sgorp. Et savez-vous ce que compte faire le secrétaire d’État ?… Quelles ont été ses réactions en lisant cette lettre ?
— Il est resté impassible, autant que je sache ! Mister Wilbur Royce est peu communicatif !… Je sais qu’il a ordonné de faire des recherches à Washington pour savoir qui est cet homme Sarraskine !
La lettre, d’ailleurs, n’est arrivée qu’hier ! Je suis immédiatement venu ici… Si vous n’aviez pas été absent, vous l’auriez depuis hier soir !
— Il fallait l’apporter à M. Hobbey, mon secrétaire !
— Oh !… Une pièce de cette importance ! Ce n’était pas possible, pas prudent, monsieur Sgorp !…
— Well !… Je suppose que la lettre n’est pas apocryphe, sinon, je me verrais obligé à vous inviter à me restituer les dollars !…
Pour le reste, tenez-moi au courant. Si je ne suis pas ici, vous ferez tenir les renseignements à mon secrétaire, à mots couverts. Code 7. Compris ?
— Entendu, monsieur Sgorp ! Comptez sur moi ! Et mes très sincères remerciements pour votre si aimable accueil !…
M. Mittheim s’inclina :
— Adieu, jeune crapule ! fit Douglas Sgorp, bonasse.
M. Mittheim ne broncha pas. Il n’avait pas entendu… ou il n’avait pas voulu entendre.
— Vais-je à Washington, ou n’y vais-je pas ? murmura Sgorp, une fois seul. Si je vais là-bas et que je demande à consulter les archives criminelles, on se doutera que je suis au courant. Il ne le faut pas.
Quelle affaire ! La plus formidable affaire du siècle !… Je vais demander une augmentation de cent pour cent au patron !…
— … Oh ! Mais, il y avait des journaux, en 1865 ! S’il est advenu une « affaire Sarraskine », ils ont dû en parler !… Quel malheur que l’American Evening News n’existait pas encore !
Douglas Sgorp, pendant quelques instants mâchonna son cigare refroidi.
Il se fit servir un « petit » déjeuner, omelette de trois œufs, quelques tranches de jambon, biscuits, et un pot de confiture, avala le tout et ressortit.
Un taxi le déposa devant l’immeuble de la New-York Society Library, une des plus vieilles bibliothèques de New-York, dont les portes venaient de s’ouvrir.