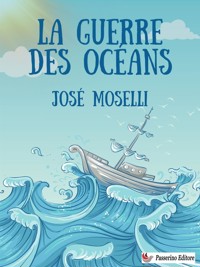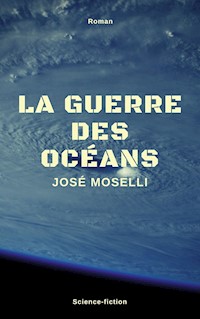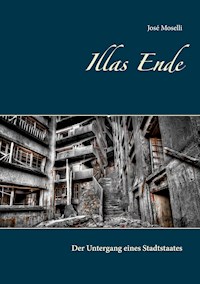3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Karl Kressler, ancien associé de Francis Drake, banquier richissime, cherche à s'emparer de la fortune de celui-ci. Individu sans scrupules et cruel, il ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Nous voguons dans le Pacifique, et jusqu'au détroit de Behring au milieu de multiples péripéties...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
La Prison de glace
La Prison de glaceI. QUELQUES ÉNIGMES.II. LES HASARDS DE L’OCÉAN.III. L’ANABIOSE.IV. PIERRE FERNAULT APPARAÎT ET DISPARAÎT.V. À LA RECHERCHE DU CÂBLE.VI. ALLO ! VANCOUVER ?VII. KRESSLER VEUT ABOUTIR.VIII. LE GENDARME DE L’OCÉAN.IX. LE CORAIL ET L’ALGUE.X. RISQUES ET FORTUNE DE MER…XI. LE CYCLONE.XII. APPARITIONS DANS LA NUIT.XIII. PIERRE FERNAULT AGIT.XIV. LE YOUYOU.XV. EN PLEIN OURAGAN.XVI. LA POURSUITE.XVII. LE SAUVETAGE.XVIII. LES EMBARRAS DE KRESSLER.XIX. LE SUPPLICE DE LA GLACE.XX. UN VIEIL AMI.XXI. LES PÉRIPÉTIES DE L’ÉVASION.XXII. L’IMPRÉVU.XXIII. LE NIHILISTE.XXIV. LA JUSTICE.XXV. LE BAGNE D’ANIOUTCHKINE.XXVI. LE REVENANT.XXVII. SUR LA PALISSADE.XXVIII. LA PRISON DES FEMMES.XXIX. À TRAVERS LA TAÏGA.XXX. LA KOUNGASS. – LES NAUFRAGÉS.XXXI. LE « LYNX ».XXXII. LA BATAILLE.XXXIII. LA « MERMAID ».Page de copyrightLa Prison de glace
José Moselli
I. QUELQUES ÉNIGMES.
Dans tous les pays du monde, la police, comme la médecine, n’ont jamais été très populaires : on leur reproche leurs insuccès, leurs hésitations, oubliant que ces deux honorables corps de métiers ont à réprimer et à guérir des maux qu’ils ignorent…
En temps d’épidémie, le sort des policiers et des médecins n’est pas gai : pour un peu, on les rendrait responsables des maux qu’ils s’évertuent à atténuer.
Car il y a aussi des épidémies de crimes ! Et c’est d’une de ces épidémies dont il sera question dans ce chapitre.
Une épidémie étrange. Plusieurs méfaits, qui eussent, après tout, passé inaperçus s’ils avaient été commis isolément. Mais, comme ils se succédèrent en moins d’une semaine, l’imagination du public en fut considérablement impressionnée, d’autant plus que l’arrestation des coupables parut tout de suite devoir se faire attendre.
Le chimiste Charles Elwell, qui habitait dans un des nombreux boarding-houses avoisinant la Barbary-Coast, à San Francisco, disparut. Comment ? Impossible de le savoir.
M. Charles Elwell était avare et riche. Son avarice était grande ; c’était elle qui l’avait incité à aller se loger dans la modeste pension de la veuve Clapham ; M. Elwell poussait si loin l’avarice qu’il ne payait sa logeuse que lorsque celle-ci se fâchait ; il voulait garder son argent en banque le plus longtemps possible, afin de ne pas perdre un cent d’intérêt.
Depuis trois jours, la veuve Clapham réclamait à son pensionnaire le montant de la semaine écoulée et elle avait obtenu enfin la promesse d’être réglée le lendemain matin. Seulement, le lendemain matin, Elwell, qui devait se rendre à la banque pour y retirer de l’argent, ne sortit pas de sa chambre. La veuve Clapham, après avoir attendu jusqu’à onze heures, commença à craindre que son pensionnaire fût malade. Elle frappa. Elle appela. Elle ne reçut aucune réponse. Son inquiétude augmentant, elle tenta d’ouvrir la porte à l’aide d’une double clé qu’elle possédait. Mais Elwell, prudent comme un avare qu’il était, avait fait poser un verrou à l’intérieur, et ce verrou était fermé. La veuve Clapham, de plus en plus inquiète, renouvela ses appels. Mais sans plus de succès. Elle se décida alors à prévenir la police. La porte fut enfoncée par un serrurier requis. Or, Charles Elwell n’était pas dans la chambre, bien que le lit défait attestât qu’il y avait couché ! La veuve Clapham se rappelait parfaitement l’avoir vu entrer la veille, vers neuf heures du soir. Il n’était pas ressorti.
Cela, la vieille logeuse en était sûre ! Pour sortir de l’appartement, situé au neuvième étage d’un vaste building de briques noirâtres, il fallait passer devant la chambre de la veuve, et celle-ci ne dormait jamais que d’un œil. Elle eût donc entendu sortir son locataire, d’autant plus que M. Elwell ne sortait jamais le soir…
Quoi qu’il en fût, le chimiste avait disparu. La chambre fut fouillée par les policiers. Ils n’y découvrirent rien de suspect, rien qui pût se rapporter à la bizarre volatilisation du chimiste.
Charles Elwell voyait très peu de monde. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre, à écrire ou à méditer ; il sortait rarement. En attendant l’enquête qui devait suivre, les scellés furent posés sur la porte de la chambre, au grand désespoir de la veuve Clapham qui, tout en raccompagnant les policiers, gémit :
– Non seulement, il me devait la semaine dernière et trois jours de celle-là, mais encore je ne vais pas pouvoir trouver un autre locataire, puisque vous avez cacheté la porte de la chambre ! Je vais être ruinée, sûrement…
Comme il est d’usage, les journaux de San Francisco s’emparèrent de l’affaire. De jeunes reporters affluèrent chez la veuve Clapham, laquelle, dans son désespoir, ne sut que répondre des imbécillités à leurs questions. Mais qu’importait ? Les reporters, sans en demander davantage, brodèrent sur le peu qui leur avait été dit. Ils firent allusion à la Mafia, à la Main Noire, à quelque extraordinaire vengeance dont aurait été victime le chimiste.
Mais les jours s’écoulèrent – trois jours – sans qu’aucun détail nouveau fût venu rallumer la curiosité du public. L’on commença à oublier l’affaire.
Seulement, le quatrième jour qui suivit la découverte de la disparition du chimiste, une nouvelle énigme vint s’ajouter à la première. Le consul d’Angleterre à San Francisco, l’honorable William Phelps, fut retrouvé mort dans son bureau par son valet de chambre.
M. Phelps était âgé de quarante ans ; il avait toutes les apparences d’une santé robuste. Dix minutes avant que son valet le découvrit affaissé sur son bureau, il avait, reçu un visiteur. Ce visiteur fut retrouvé : c’était le capitaine du croiseur britannique Antigone, arrivé le matin même à San Francisco.
Cet officier, interrogé, déclara que le consul lui avait paru être en parfaite santé lorsqu’il l’avait quitté.
La famille s’émut et demanda l’autopsie, laquelle n’apprit rien à la justice ; les organes de M. Phelps étaient intacts ! Pas de lésions, ni au cœur, ni au cerveau, ni aux poumons. Aucune trace de poison dans l’estomac ni dans les intestins. Le sang pur. Bref, l’infortuné consul possédait tout ce qu’il fallait pour faire un excellent vivant, – et il était mort.
Comme dans le cas du chimiste Elwell, une enquête fut ordonnée. Elle ne donna aucun résultat, ce que les journaux ne manquèrent pas de souligner. La disparition de Charles Elwell fut rappelée et nombreux furent ceux qui virent une corrélation entre ces deux mystères. L’hypothèse d’une vengeance exercée par une société secrète prit de la consistance, mais resta une hypothèse, aucune preuve ne venant l’étayer.
Et, le surlendemain de la mort de M. Phelps, le sanatorium de San Blas, situé de l’autre côté de la baie de San Francisco, à l’ombre des monts Tamalpais, le sanatorium de San Blas flamba comme une meule de foin. Plusieurs dizaines de malades – de riches malades – furent brûlés vifs.
Le sanatorium de San Blas, situé au centre d’un vaste parc planté de red trees, de ces arbres rouges géants qui sont l’orgueil de la Californie, constituait à lui seul un mystère. L’on y soignait les tuberculeux.
En Amérique, comme en Europe, nul ne désire faire connaître qu’il est atteint de la terrible maladie. Les hospitalisés de San Blas étaient de cet avis ; ils venaient là passer plusieurs mois dans l’espoir de ralentir les progrès de leur mal. Personne, sauf les médecins traitants, ne connaissait leurs noms ; ils étaient ainsi à l’abri des indiscrétions du personnel.
Aussi, lorsque, l’incendie éteint, l’on voulut compter les victimes, ce fut impossible : les trois médecins avaient péri dans le sinistre. Seuls, deux infirmiers sur vingt-huit avaient échappé. Ils déclarèrent que les malades devaient être au nombre de quarante au plus. Quant aux circonstances de l’incendie, impossible de mettre les deux hommes d’accord. L’un disait que le feu avait commencé dans l’infirmerie ; l’autre affirmait que les flammes étaient tout d’abord apparues dans le bâtiment renfermant les moteurs fournissant l’électricité au sanatorium. Or l’infirmerie et la chambre des moteurs se trouvaient aux deux extrémités de l’établissement.
L’opinion des enquêteurs, cependant, finit par se stabiliser ; ils devinèrent que les deux rescapés disaient la vérité : le feu avait dû prendre à la fois dans l’infirmerie et dans la chambre des moteurs. C’était ce qui expliquait que l’immense bâtiment eût été entièrement consumé. Évidemment, l’incendie était l’œuvre d’un criminel qui avait allumé plusieurs foyers.
Des recherches permirent de constater que les murailles avaient été arrosées d’essence et firent découvrir des résidus provenant évidemment de pastilles incendiaires à l’aluminite. Mais ce fut tout ce que la justice apprit. Les coupables, s’ils avaient laissé la trace de leur forfait, avaient parfaitement anéanti les leurs, de traces.
Naturellement, l’impuissance de la police fut raillée. Certains publicistes proposèrent, non sans humour, que la police fût licenciée, puisqu’elle ne servait à rien. Mais la masse du public prit la chose plus au sérieux et une sorte de terreur plana sur San Francisco. Pendant plusieurs jours, chacun ouvrit son journal avec l’appréhension d’apprendre quelque nouveau et mystérieux forfait.
Mais il est rare de voir advenir les malheurs que nous appréhendons. Ce sont d’autres, inattendus, qui nous accablent. La série des crimes mystérieux s’arrêta. Mais une nouvelle « calamité advint. Une calamité d’un autre genre. M. Gilson, un des plus gros agents de change de San Francisco, commença de faire vendre à la Bourse les actions de l’Amalgamated Dying Co. et des sociétés filiales :
L’Amalgamated Dying Co., la plus grande compagnie fabriquant des produits tinctoriaux en Amérique, avait un capital de plusieurs centaines de millions de dollars. Ses usines étaient éparpillées dans toute l’Union ; plusieurs, même, venaient d’être construites au Canada, au Brésil et en République Argentine pour éviter les droits de douane. Les bénéfices étaient énormes, plus de 30 pour 100 par an du capital ! Aussi les actions avaient-elles monté vertigineusement ; il n’était pas de clerk ou de dactylographe, si pauvre soit-il, qui n’eût dans son portefeuille un ou plusieurs titres de l’Amalgamated Dying Co. Car tout le monde prévoyait de nouvelles hausses.
Or, l’agent de change Gilson était connu notoirement pour être l’homme d’affaires de Francis Drake, le plus gros actionnaire et l’administrateur de l’Amalgamated Dying Co… Si, donc, Gilson vendait les titres de cette société, c’était qu’il en avait reçu l’ordre de Drake ou qu’il savait par Drake que l’affaire allait devenir mauvaise…
Les gens furent d’abord incrédules. Mais, lorsque Gilson vendit les titres de l’Amalgamated Dying Co. par paquets énormes, il y eut une baisse effroyable. En trois jours, les actions, qui valaient 160 dollars, tombèrent à trente ! Et Gilson vendait toujours !
Plusieurs de ses amis le questionnèrent : il leur répondit tranquillement qu’il avait l’ordre de Drake de vendre à tout prix. Ces propos furent répétés : la baisse s’accentua, une véritable débâcle… Et la dégringolade de l’Amalgamated Dying Co. entraîna celle des sociétés filiales. Ce fut un formidable krach. Plusieurs banquiers se suicidèrent ; des spéculateurs, incapables de régler leurs différences, s’enfuirent. Des centaines et des centaines de petits capitalistes, d’employés, furent ruinés.
Mais Francis Drake, où était-il ? En vain, voulut-on le savoir de Gilson. L’agent de change opposa le secret professionnel. Il avait ordre de son client de ne pas révéler sa résidence. Somme toute, M. Drake avait parfaitement le droit de faire vendre ses titres si cela lui plaisait ?
À cela, rien à répondre. Mais un jeune journaliste, plus fin que les autres, pensa que s’il ne pouvait découvrir la retraite de Drake, du moins il avait des chances de retrouver sa fille unique, miss Margaret, laquelle, comme tous les ans à cette époque, devait villégiaturer à Pasadena, la plage des millionnaires yankees, près de Los Angeles.
Miss Margaret Drake était bien à Pasadena, dans un des hôtels de la montagne. Elle ne savait rien encore des opérations de son père et passait son temps à jouer au golf et au cricket.
Le jeune reporter lui apprit le terrible krach provoqué par les ventes de Gilson et lui demanda où se trouvait Francis Drake :
– Mais, à Chicago, je pense, bien que je n’aie point eu de ses nouvelles depuis bientôt trois semaines…
– Et à quel hôtel, miss ? demanda le journaliste, tremblant de joie.
– Hôtel Belmont. C’est là qu’il descend chaque fois… Je vais, d’ailleurs, lui télégraphier : Je vous dirai ce qu’il en est !
Le reporter attendit. Hélas ! la réponse vint dans la soirée : Francis Drake avait quitté l’hôtel Belmont depuis vingt-deux jours et nul n’avait plus eu de ses nouvelles depuis…
Miss Margaret sursauta. C’était une vraie Américaine ; décidée et énergique.
– Je vais voir ce qui se passe ! déclara-t-elle au reporter déconfit.
Deux heures plus tard elle prenait le train pour San Francisco où, aussitôt arrivée, elle se faisait conduire chez l’agent de change Gilson. Le financier répondit sans hésitation à sa demande d’explications :
– Voici le télégramme de votre père, miss. Il vient d’Honolulu, aux îles Hawaï. Il est chiffré, à l’aide d’une combinaison que moi et lui connaissons seuls, et m’ordonne de vendre à n’importe quel prix tous ses titres de l’Amalgamated Dying Co. et de ses filiales. J’ai obéi. Depuis, je n’ai plus rien reçu !
Miss Margaret n’insista pas. Elle fit immédiatement câbler à Honolulu, se fiant sur la notoriété de son père pour que la dépêche lui parvînt.
Elle en fut pour ses frais ; ce fut le gouverneur de l’île qui lui répondit lui-même, et ce fut pour l’aviser que M. Drake ne se trouvait pas aux îles Sandwich et qu’il n’y avait jamais paru !
Margaret Drake n’hésita pas : le lendemain, elle s’embarqua sur le courrier de Sydney qui, en cinq jours, l’amena dans la capitale des îles Sandwich.
À peine débarquée, elle courut aux bureaux du câble afin de se faire donner des éclaircissements. Une surprise, la plus grande de toutes, l’attendait : l’employé, ayant consulté ses livres attentivement, lui déclara que jamais le câblogramme reçu par l’agent de change Gilson n’avait été envoyé !
II. LES HASARDS DE L’OCÉAN.
Miss Margaret Drake avait étudié à l’Université d’Harvard : elle avait fait plusieurs voyages en Europe, elle avait acquis de la prudence et de la réflexion ; aussi la réponse de l’employé de la Compagnie du câble ne la satisfit-elle pas. Elle commença par demander à voir le registre où étaient transcrits les télégrammes expédiés. Elle vit parfaitement ainsi que le fameux câblogramme signé de son père et adressé à l’agent de change Gilson n’y figurait pas. Mais ce n’était peut-être là qu’une coïncidence, qu’un oubli ! Ce câblogramme, Gilson le lui avait montré ; il était transcrit sur un papier à en-tête de la Compagnie du câble et portait les signes de la plus parfaite authenticité. Margaret Drake avait pu s’en assurer : la dépêche était bien arrivée à Frisco, donc elle était partie.
L’enquête faite par Gilson à San Francisco avait donné des résultats concluants : le fameux câblogramme avait été reçu par le manipulateur Howard, un employé de confiance au service de la Compagnie depuis vingt ans ; d’ailleurs, la bande originale de papier, imprimée en alphabet Morse, existait encore.
Oui, le câblogramme avait bien été envoyé, pas de doute possible.
C’est pourquoi la réponse de l’employé d’Honolulu et l’examen du registre des télégrammes expédiés ne satisfirent nullement Margaret Drake. Elle fit demander au directeur de l’agence du câble de bien vouloir lui accorder un entretien. Ce dernier la reçut aussitôt, écouta ses explications et commença par répondre qu’il était sûr que le fameux câblogramme n’avait pas été envoyé d’Honolulu… Pourtant, il ne refusa pas de s’assurer du fait. Les employés furent interrogés un à un, séparément, et devant Margaret Drake. Tous furent d’accord : jamais ils n’avaient expédié le mystérieux câblogramme ! Impossible de douter de leurs dires !
Mais le directeur de l’agence du câble alla plus loin. Il télégraphia à San Francisco pour se faire donner l’heure et le jour exacts, précis, de l’arrivée de l’énigmatique dépêche. La réponse arriva aussitôt. Elle révéla un fait troublant : à la minute précise où était arrivé le mystérieux message à San Francisco, la communication entre la capitale de la Californie et Honolulu avait été interrompue. Le fait avait été noté par l’employé de service. Nul n’y avait fait attention : les câbles sous-marins sont sujets à diverses causes d’interruption provenant des cyclones, tempêtes, ouragans et autres météores ; dans ce cas, les transmissions se font mal ou pas du tout, le courant électrique ne passant plus à travers le câble ou se perdant en route.
– Évidemment, expliqua le directeur de l’agence du câble à la jeune fille, le câblogramme en question a été forgé à San Francisco par un employé de la Compagnie qui avait connaissance de l’interruption des communications… Du moins, c’est la seule explication que je vois… Elle n’est pas très satisfaisante, puisque vous m’affirmez avoir vu la bande de papier imprimée en alphabet Morse qui porte le fameux message… Il est vrai qu’on peut fabriquer une de ces bandes…
– Je ne le crois pas, monsieur, contesta la jeune fille, car j’ai constaté moi-même que les extrémités de la bande en question coïncidaient parfaitement avec les extrémités du message précédent et du suivant, et sans erreur possible !
Le directeur s’inclina :
– En ce cas, miss, je ne vois pas d’explication possible, mais une chose est certaine, c’est que le câblogramme n’a pas été expédié d’ici !
– Je vous crois, monsieur ! conclut la jeune fille, sincèrement.
Margaret Drake, peu à peu, en arrivait à pressentir qu’une terrible machination avait dû être ourdie contre son père, pour le ruiner. De toute évidence, la dépêche n’avait pas été expédiée d’Honolulu. Tout concordait pour le prouver. Tout d’abord que Francis Drake n’était jamais allé aux îles Hawaï, et ensuite les témoignages des employés du câble.
Comment était arrivé le télégramme ? c’était ce qu’on saurait plus tard.
Margaret Drake ne s’attarda pas plus longtemps à élucider cette énigme. Ce qu’elle voulait, avant tout, c’était retrouver son père. Depuis bientôt six semaines qu’il était parti pour Chicago, en voyage d’affaires, elle n’avait plus eu de ses nouvelles. Était-il seulement encore vivant ? Les faussaires qui avaient expédié ou forgé la fameuse dépêche avaient dû, auparavant, s’assurer que le financier ne se mettrait pas en travers de leurs projets. Ils l’avaient sans doute réduit à l’impuissance, tué peut-être…
Margaret Drake, malgré son gracieux visage auréolé de cheveux blonds, ses yeux bleus et sa bouche souriante, était douée d’une énergie que lui auraient enviée beaucoup d’hommes. À la pensée que son père était peut-être mort, elle ne pleura pas : elle ne pensa qu’à le venger en démasquant ses ennemis.
Comprenant qu’elle n’avait plus rien à faire à Honolulu, elle retint aussitôt une place sur le premier navire appareillant pour San Francisco.
Trois jours plus tard, elle quittait la capitale des îles Hawaï à bord du paquebot américain Kalakaua.
À bord, Margaret parla peu. Elle réfléchissait. Et, plus elle réfléchissait, plus elle en arrivait à cette conclusion que son père avait dû être assassiné par les auteurs de la dépêche… Dans quel but, tout cela ? L’agent de change Gilson le lui dirait ! Malheureusement, Margaret Drake ne se doutait pas que bien des jours s’écouleraient avant qu’elle revît San Francisco !
Ce fut deux jours après le départ d’Honolulu que le fait se produisit. Il était onze heures du soir. Le Kalakaua, lancé à toute vitesse, filait sur les flots calmes du Pacifique. La plupart des passagers étaient restés sur le pont, à respirer le souffle vivifiant de l’alizé ; étendus dans leurs fauteuils ou accoudés aux lisses, ils parlaient peu, bercés par le ronflement rythmique des machines.
Margaret Drake, installée dans un fauteuil, regardait, sans la voir, la mer sombre que striaient de longues traînées phosphorescentes produites par le glissement des poissons. Tout était calme et silencieux. L’officier de quart, vêtu de blanc, se promenait nonchalamment d’un bout à l’autre de la passerelle, donnant à peine de distraits regards à l’horizon vide : la terre était loin ; quant aux navires, aucun ne s’apercevait. Ils sont rares dans cette partie du Pacifique.
Mais s’il n’y avait ni navires, ni terre, le danger n’en existait pas moins. Un danger impossible à deviner, impossible à éviter : le derelict.
Le derelict est une épave. Souvent des bâtiments, aux trois quarts détruits par l’incendie ou par la tempête, sont abandonnés par leurs équipages qui les croient perdus. Et il arrive que, par suite de la nature du chargement ou de la coque, les carcasses ainsi évacuées ne coulent pas. Ou, plutôt, elles ne descendent qu’à une faible profondeur, ce qui les rend invisibles, mais non inoffensives.
Semblables à des écueils flottants, beaucoup plus dangereux que des récifs, puisqu’on ne peut en déterminer l’emplacement, les terribles derelicts dérivent, entraînés par les courants. Et malheur au navire qui les heurte ! sa perte est presque certaine.
C’était un de ces derelicts au-devant duquel filait le Kalakaua… Un léger coup de barre à gauche ou à droite, un rien, et le paquebot eût passé à côté du danger sans que personne s’en doutât. Mais la fatalité veillait…
À l’improviste, une formidable secousse ébranla soudain le Kalakaua, si formidable que les fauteuils furent renversés. Et, à la seconde suivante, le grand navire s’inclina, en même temps que la lumière électrique s’éteignait, tandis qu’une colonne de vapeur bouillante jaillissait par les grillages situés au-dessus des chaudières : le Kalakaua avait été atteint en son centre et coulait rapidement !
Sur le pont incliné, dans les ténèbres, les marins se précipitèrent vers les embarcations. Parmi les cris d’angoisse des femmes et les blasphèmes des hommes, le sauvetage s’organisa. Deux canots purent être mis à la mer. Et ce fut tout : le grand paquebot, soudain, se dressa, l’étrave menaçant le ciel, et, d’un coup, disparut parmi un formidable remous. Le drame n’avait pas duré cinq minutes !
Margaret Drake était bonne nageuse. Renversée par la secousse, lors du premier choc, elle avait dédaigné de courir vers les embarcations. Voyant que le navire allait couler, elle s’était jetée à la mer pour ne pas être aspirée par le tourbillon causé par l’engloutissement du Kalakaua.
Elle fut presque aussitôt recueillie par un des deux canots.
Les survivants étaient peu nombreux, tant la catastrophe avait été soudaine. Ils étaient quarante, au plus. La majeure partie du personnel de la machine avait été tuée par l’explosion d’une des chaudières.
Tant bien que mal, les naufragés s’organisèrent. La mer était calme, heureusement. Margaret Drake, en compagnie des autres femmes, s’installa à l’arrière du canot, sous un prélart goudronné.
Le restant de la nuit s’écoula sans incident. Au jour, les naufragés, à leur grande surprise, et à leur encore plus grande satisfaction, aperçurent dans l’est un grand schooner qui filait dans leur direction ! Un mât fut dressé : des pavillons y furent hissés. Les hommes saisirent les avirons et lancèrent les deux canots à la rencontre du bâtiment inconnu.
Pendant une heure, les survivants du Kalakaua passèrent par de terribles alternatives d’angoisse et d’espérance, se croyant tour à tour sauvés ou abandonnés.
Ils furent sauvés.
Le schooner était un bâtiment américain, le Black-Seal[1], de Los Angeles, en route pour les îles Bonin, où il devait se ravitailler en eau douce, avant d’entreprendre sa campagne annuelle de pêche aux phoques dans les mers du Japon septentrional.
Son capitaine accueillit charitablement les naufragés et leur fit donner des vivres et des vêtements. Mais ce fut en vain que Margaret Drake et les autres passagers du Kalakaua lui proposèrent une forte somme pour changer la route de son navire et les emmener à San Francisco. Le marin ne voulut rien entendre :
– Je vous déposerai à Ima-Shima, aux îles Bonin, déclara-t-il péremptoirement. Vous y trouverez rapidement un navire qui vous transportera au Japon d’où il vous sera facile de regagner Frisco !
Il fut impossible de le sortir de là. Les survivants du Kalakaua durent faire contre mauvaise fortune bon cœur, heureux, après tout, de s’en tirer avec leur vie sauve.
Margaret, cependant, ne s’avoua pas battue. S’étant fait connaître au capitaine du Black-Seal, elle lui offrit vingt mille dollars pour faire route sur l’Amérique. Mais ses offres furent aussi vaines que celles de ses compagnons :
– Vous m’offririez un million de dollars, miss, fit l’entêté marin, que je refuserais : je suis parti pour une campagne de pêche aux phoques, et je pêcherai des phoques !
Margaret, la rage au cœur, dut se résigner comme les autres.
Pendant vingt-trois jours, elle vit l’eau glisser lentement le long des flancs rugueux du schooner… Que se passait-il pendant ce temps ? Que devenait son père ? Quelle nouvelle infamie préparaient les mystérieux envoyeurs du câblogramme ?
Il fallait s’armer de patience.
Le vingt-quatrième jour qui suivit l’arrivée des naufragés du Kalakaua à bord du schooner, le Black-Seal entra dans la baie d’Ima-Shima, une des îles Bonin. Margaret distingua une vaste plage de corail pulvérisé et de hautes collines recouvertes de broussailles.
Une douzaine de navires étaient ancrés dans la rade. Tous, sauf un, étaient des goélettes américaines et canadiennes venues, comme le Black-Seal, pour se ravitailler, avant de partir pour la pêche aux phoques dans la mer de Behring.
Parmi eux, se distinguait un petit yacht à vapeur tout blanc, à cheminée jaune, et à l’arrière duquel flottait le pavillon allemand. Il semblait désert ; du moins, personne ne se voyait sur son pont.
Margaret le regarda d’un œil distrait. Un yacht ! Que lui importait ? Ce qu’elle désirait, c’était un navire pouvant la ramener rapidement en Amérique.
En compagnie des autres naufragés du Kalakaua, elle s’embarqua dans un sampan qui, en quelques minutes, la conduisit à terre.
Les rescapés eurent vite gagné l’unique auberge du village, une grande paillotte recouverte de chaume et plutôt rudimentaire, en fait de confortable. Margaret, qui, heureusement, avait conservé quelques centaines de dollars en billets de banque sur elle, réussit à se faire donner une petite chambre qu’elle partagea avec une des passagères du Kalakaua qui était souffrante.
Elle passa le restant de la journée à s’enquérir d’un navire partant pour l’Amérique. Elle apprit ainsi que le yacht ancré en rade se nommait l’Adler et allait appareiller pour les îles Salomon, en croisière de plaisance. Inutile donc, de demander à son propriétaire de la prendre à bord !
Le gouverneur de l’île, un petit fonctionnaire japonais, déclara à la jeune fille qu’elle pouvait espérer, avant un mois, trouver une place sur le vapeur qui relie les îles Bonin au Japon…
Gaie perspective, vraiment ! Mais il n’y avait rien d’autre à faire.
Le soir, exténuée et désespérée, Margaret Drake regagna l’auberge et se coucha après un léger dîner. Malgré ses soucis, elle s’endormit rapidement…
Un râle sourd la fit sursauter. Elle eut le temps de distinguer le jet lumineux d’une lampe électrique de poche que tenait un géant. Elle vit deux hommes se précipiter sur elle, tandis qu’un troisième retirait le poignard qu’il venait de planter dans la poitrine de sa compagne de chambre !
La jeune fille voulut crier. Mais un des hommes lui appuya sa large main sur la bouche, tandis que l’autre, rapidement, l’enveloppait d’une grande couverture. En un clin d’œil, la malheureuse fut ligotée, bâillonnée et saucissonnée dans le tissu épais. À demi étouffée, tremblante d’angoisse, elle comprit qu’on l’emportait.
Une sensation de fraîcheur lui apprit qu’elle n’était plus dans l’hôtellerie. Pendant quelques minutes, elle sentit qu’on l’emportait à grands pas. Elle entendit quelques mots prononcés en allemand et fut déposée sur un plancher mouvant en qui elle devina le fond d’une embarcation. Elle entendit le grincement des avirons contre les tolets… Une voix nette et calme parvint à ses oreilles :
– Desserre un peu le bâillon et enlève-lui la couverture, Otto ! Il ne faut pas qu’elle étouffe ! Nous ne risquons plus rien, maintenant !
[1]Phoque noir.
III. L’ANABIOSE.
Margaret Drake tressaillit : il lui semblait reconnaître cette voix. Sûrement, elle l’avait déjà entendue. Mais où ? Quand ? En quelles circonstances ? Elle n’aurait pu le dire…
Elle n’eut, d’ailleurs, pas le temps de rappeler ses souvenirs, son attention étant attirée autre part. Brutalement, de grosses mains écartèrent la couverture dans laquelle elle était enroulée.
Au-dessus d’elle, la jeune fille distingua le ciel étoilé. Elle vit qu’elle se trouvait dans une grande baleinière, maniée par quatre gigantesques nègres vêtus de toile blanche. À l’arrière, un homme était assis, enveloppé dans un imperméable dont le capuchon était rabattu sur ses yeux.
Margaret regarda l’individu qui venait d’écarter la couverture : une gigantesque brute à cheveux roux, aux yeux verts qui luisaient dans l’ombre.
Ses grosses mains poilues desserrèrent un peu la bande de toile bâillonnant la prisonnière, puis il se releva et, en silence, alla s’asseoir auprès de l’homme à l’imperméable :
– Plus vite, chiens ! grommela en allemand ce dernier.
De nouveau, Margaret tressaillit. Oh ! elle en était sûre, maintenant, elle reconnaissait cette voix ! Mais impossible de dire à qui elle appartenait. En vain, la jeune fille écarquilla ses yeux. Elle ne put distinguer les traits du mystérieux personnage. Étendue comme elle était, sur le dos, au fond de l’embarcation, elle ne pouvait apercevoir que le ciel et les bordages du canot. Elle se résigna à attendre.
Où la menait-on ? À bord d’un des schooners ancrés en rade, sans doute. Sans que rien eût pu justifier cette hypothèse, Margaret était sûre, certaine, que ses ravisseurs étaient les mêmes que ceux qui avaient fait disparaître son père.
Que voulaient-ils d’elle ? Cela, elle se le demandait. S’ils désiraient sa mort, ils n’auraient eu qu’à la tuer, au lieu de courir les risques de cet enlèvement… quitte à jeter ensuite son cadavre à la mer : les requins ne manquent pas aux îles Bonin !
Margaret Drake en était là de ses réflexions, lorsque la voix de l’homme à l’imperméable résonna de nouveau :
– Tiens bon partout !
Les rameurs lâchèrent leurs avirons. Presque aussitôt, un léger choc ébranla le canot et Margaret distingua au-dessus d’elle les vergues d’un navire dont l’embarcation venait d’accoster l’échelle. Sur l’ordre de l’homme à l’imperméable, deux des matelots noirs soulevèrent la prisonnière et la montèrent sur le pont du bâtiment inconnu. Margaret reconnut immédiatement le navire : c’était l’Adler, le petit yacht en partance pour les îles Salomon. Pas d’erreur possible. La jeune fille put voir le tuyau jaune, les deux mâts, les rouffles d’acajou. C’était bien l’Adler.
Elle n’eut pas le temps d’en observer davantage, car les deux noirs qui la portaient s’engouffrèrent dans une écoutille, descendirent une douzaine de marches et pénétrèrent dans un petit salon prétentieusement meublé, dont les murailles disparaissaient sous des tentures de soies voyantes. L’homme à l’imperméable, qui précédait les deux nègres, se retourna et, du geste, leur indiqua un des divans sur lequel ils déposèrent la jeune fille.
Après quoi, ils se retirèrent sans bruit.
L’inconnu étendit la main vers un commutateur qu’il tourna. Un lustre de bronze doré fixé au plafond s’irradia. L’homme, d’un revers de main, rabattit le capuchon dissimulant ses traits. Sa face apparut en pleine lumière. Une face rasée, au menton en avant, au front large, aux lèvres minces. Les cheveux, partagés par une raie médiane, étaient d’un blond filasse ; les yeux, d’un gris bleu, avaient une expression dure, cruelle.
L’homme, d’un geste vif, arracha le bâillon de la jeune fille ; il allait ouvrir la bouche pour parler, mais Margaret Drake le devança. Elle le reconnaissait enfin !
– M. Kressler ! s’écria-t-elle. Vous !
Karl Kressler avait été pendant dix ans l’associé de son père. Pendant dix ans, il était venu chaque dimanche chez Francis Drake. Puis, il y avait plusieurs années de cela, Margaret ne l’avait plus vu !
– Kressler et moi, nous nous sommes séparés, avait expliqué Francis Drake à sa fille. Nous n’avons pas les mêmes idées… Un garçon intelligent, mais sans scrupules : il finira milliardaire ou convict !
Depuis, Drake n’avait plus jamais parlé de son ex-associé. Mais Margaret avait su, par des conversations entendues, par les journaux, que Karl Kressler était devenu un des plus téméraires spéculateurs de l’Union. Et c’était ainsi qu’elle le revoyait, un bandit !
Mais le ton indigné de Margaret Drake n’avait en rien ému Kressler. Il s’inclina, impassible :
– Je suis heureux que vous m’ayez reconnu, miss ! dit-il. Cela évitera des préliminaires longs et ennuyeux… Ah ! voilà le guindeau qui ronfle : dans dix minutes, nous serons en route…
Un bruit de moteur venait, en effet, de se faire entendre. Margaret, bouleversée, ne répondit pas, attendant la suite.
Kressler, après avoir écouté l’espace de deux ou trois secondes, poursuivit de sa même voix calme et dure :
– Je n’ai pas besoin de vous dire, miss, que vous êtes ici en mon pouvoir absolu. Inutile d’espérer quelque secours. Vous ne quitterez ce bâtiment que lorsqu’il me plaira. Libre à vous de penser ce que vous voudrez. Mais je veux, avant tout, vous faire plaisir : sachez donc que votre père, Francis Drake, est à bord !
– Mon père ! À bord ! s’exclama Margaret, sursautant.
– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire. Vous le verrez demain ou après-demain… Cela ne dépend pas de moi : vous vous doutez bien que je ne pensais pas vous voir aujourd’hui : c’est le hasard qui a tout fait… Moi, j’en ai profité. J’étais heureux de tenir votre père, mais mon bonheur est complet, maintenant que vous êtes à bord. La partie devient belle pour moi…
– Je ne comprends pas…
– Vous comprendrez ! C’est moi, je viens de vous le dire, qui ai enlevé votre père à Chicago. C’est moi qui suis l’auteur du câblogramme à l’agent de change Gilson. C’est moi qui ai fait racheter à vil prix les titres de l’Amalgamated Dying Co. C’est une spéculation, miss.
« Moi et votre père, nous avions chacun, juré d’avoir la peau de l’autre. Pour un peu, Francis Drake avait la mienne !
« C’est un homme, je n’en disconviens pas. Mais il a des scrupules, de la conscience, et autres fariboles. Moi, je vais droit au but. Bref, j’ai acquis à vil prix les actions de l’Amalgamated Dying Co. Drake est à demi ruiné.
« Mais j’ai autre chose à obtenir de lui. Il contrôle la Pennsylvania et Saint-Louis Railway le Grand Trunk and Mexico et plusieurs autres affaires. Je les veux. Et, si Drake ne veut pas mourir, il accédera à mes exigences, et je compte sur vous, miss, pour le conseiller d’accepter. D’ailleurs, j’ai encore une autre idée qui conciliera tout ! »
Karl Kressler s’interrompit. Galamment, il s’inclina et, un mince sourire fendant ses lèvres, prononça :
– Miss Margaret Drake, j’ai le très grand honneur de vous demander votre main !
– Jamais ! éclata la prisonnière, hors d’elle-même.
– Nous verrons cela ! fit Kressler, sans s’émouvoir… Voilà la machine en marche… Je vais vous débarrasser de vos liens : vous pourrez voir votre père, en attendant de pouvoir lui parler. Sa vue vous suggérera quelques salutaires réflexions !
Margaret ne répondit pas : elle était trop indignée, trop bouleversée pour cela. Et puis, la pensée de voir ce père qu’elle croyait mort l’empêchait de penser à autre chose.
Kressler, à l’aide d’un court poignard qu’il tira de son gousset, coupa les cordelettes ligotant la jeune fille. Puis, arrondissant le bras, il l’offrit à sa victime.
Margaret Drake, péniblement, se dressa :
– Je vous suis, monsieur ! dit-elle en regardant le bandit en face.
Kressler n’insista pas et marcha vers la porte du petit salon.
Le battant s’ouvrait sur une coursive, laquelle aboutissait à une porte de fer que Kressler ouvrit. Margaret vit devant elle un second couloir, aux parois de tôle, qui s’arrêtait devant une nouvelle porte.
Kressler, ayant tiré de sa poche une petite clé semblable à celle d’un coffre-fort, l’introduisit dans la serrure et attira le panneau à lui. À sa grande surprise, Margaret vit que le battant avait une épaisseur de près de 30 centimètres ; sa face intérieure était garnie de sciure de liège agglomérée. Par l’ouverture, une onde de froid se répandit dans le couloir, faisant frissonner la jeune fille :
– Venez, miss ! fit Kressler, de sa voix calme et dure.
Margaret, instinctivement, obéit. Elle vit Kressler tourner un commutateur avant de franchir le seuil. Deux lampes électriques brillèrent.
Derrière le bandit, Margaret Drake passa la porte. De l’autre côté, c’était une grande cabine sans autre ouverture que celle par où la jeune fille venait d’entrer. Plafond, plancher, cloisons étaient garnis de plaques de sciure de liège agglomérée. Tout autour du bizarre compartiment, des rangées de tuyaux de cuivre garnis d’ailettes étaient disposés.
Mais la jeune fille ne vit rien de tout cela, car, au centre de la pièce, trois hommes étaient étendus, rigides, blafards, sur un tapis de liège. Et Margaret Drake reconnaissait un de ces hommes semblables à des morts :
– Mon père ! s’écria-t-elle en frissonnant.
– Lui-même, miss ! Mais laissez-moi refermer la porte : il ne faut à aucun prix que la température s’élève !
Et, d’un bond, Kressler repoussa le panneau, qui s’encastra dans la paroi, avec un bruit sourd.
Margaret s’était laissée tomber à genoux au côté du corps de son père. Elle lui prit la main, mais eut un brusque recul en sentant sous ses doigts un contact glacé :
– Du calme, miss ! fit Kressler en saisissant la jeune fille par le bras. Votre père n’est pas mort : il est même, je le présume, en meilleure santé que jamais. Il est en état d’anabiose.
« Une merveilleuse invention, miss ! Veuillez m’écouter, je vous prie ! L’anabiose est un état léthargique spécial, obtenu par la congélation. Les fonctions de la vie sont suspendues ; le sang cesse de circuler dans les vaisseaux. La vie organique s’arrête. Mais la vie persiste…
« Regardez ce thermomètre : il marque 8. Or, la vie organique cesse à 6 et la vie elle-même à 10.
« Cette anabiose peut être prolongée plusieurs mois…
« Je vous avoue, miss, que je ne suis pas l’inventeur du procédé. Il a été trouvé par le professeur russe Bakhmétieff,… lequel ne l’a appliqué qu’à des souris. Ces Russes sont des imbéciles. Ce Bakhmétieff voulait se servir de son invention pour guérir les gens… Vous comprenez ?
« À 6 degrés au-dessous de zéro, l’organisme est pour ainsi dire stérilisé : tous les microbes qu’il renferme sont tués. Et le sujet, une fois décongelé, est débarrassé de ses maux…
« Moi, j’ai trouvé mieux. Le procédé m’a servi à des fins plus utiles… Je l’ai perfectionné. J’ai enlevé votre père à Chicago, je l’ai soumis à une basse température et l’ai ainsi amené sans risques, dans un wagon réfrigérant, jusqu’à Frisco où je l’ai embarqué à bord de mon yacht… Il en a été de même de ces deux gentlemen que vous voyez là !
« Dès ce matin, je vais faire le nécessaire pour ranimer votre père… Cela demandera plusieurs heures et des soins méticuleux. Mais Francis Drake n’a rien à craindre : le procédé est sûr. Demain, vous pourrez lui parler, et, j’espère, le convaincre. En devenant son gendre, j’arrangerai tous nos différends ! Je suis patient. Si vous refusez, j’attendrai. Vous finirez par accepter. J’en suis sûr ! »
Margaret Drake resta sans voix. Le froid intense qui régnait dans le compartiment, l’émotion, la rage, la haine, la paralysaient. Devant elle, son père gisait inanimé et glacé. Vivait-il, seulement ? N’était-ce pas simplement son cadavre qu’elle voyait ?
Elle regarda Kressler. Le bandit était impassible et contemplait les trois corps rigides d’un air satisfait :
– Moi ? Votre femme ? articula enfin la jeune fille. Jamais ! Plutôt vingt fois la mort !
– Je n’en crois rien ! fit simplement le bandit. Et maintenant, miss, il faut nous retirer. Je ne veux pas m’enrhumer, ni vous exposer à prendre mal. Demain, vous parlerez à votre père ! Venez ! Je vais vous conduire à votre cabine !
Margaret Drake eut un mouvement de rage ; mais, instantanément, l’inutilité de toute résistance apparut à son esprit. Il fallait attendre. Une fois son père revenu à la vie normale, elle agirait.
En silence, elle sortit, suivie de Kressler qui, ayant éteint les deux ampoules électriques, jeta un regard sur le thermomètre et referma la porte.
À sa suite, Margaret Drake gagna la cabine qui lui avait été réservée, une luxueuse pièce tendue de soie munichoise, mais dont la porte était garnie, à l’extérieur, de deux gros verrous, et dont les deux hublots étaient munis de grilles d’acier.
– L’on vous apportera à déjeuner à huit heures, fit le bandit. Il y a du linge dans les armoires ; je l’ai acheté hier à votre intention. Si vous avez besoin de quelque chose, sonnez !
Il s’inclina, sortit et referma la porte sur lui.
Margaret se laissa tomber sur le divan. Elle était épuisée, à bout de forces morales et physiques.
Machinalement, elle regarda vers les hublots. Elle faillit lâcher une exclamation d’épouvante autant que de surprise : deux mains venaient de se refermer sur les barres de fer défendant une des ouvertures. Entre les grillages, une face humaine apparut !
Margaret, indécise si elle ne rêvait pas, se dressa et, bravement, marcha vers le hublot :
– Qu’est-ce que… ? commença-t-elle.
Mais la bouche de la face inconnue s’ouvrit ; une adjuration en sortit :
– Chut ! Pour l’amour de Dieu, miss, écoutez-moi !