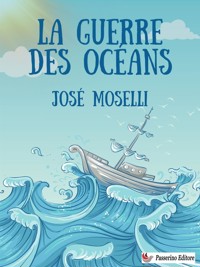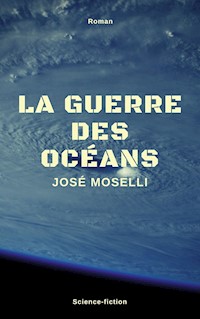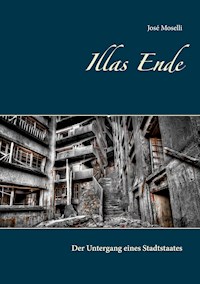Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Sur le Waré-Atua, un volcan éteint de l'île d'Espirito Santo aux Nouvelles-Hébrides, au centre du cratère, se trouve une dalle de matière noire, translucide, étrange...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Montagne des Dieux
La Montagne des DieuxPREMIÈRE PARTIE. LE GRAND CATALYSEURDEUXIÈME PARTIE. LE PIRATE MONDIALTROISIÈME PARTIE. L’ATOLL DES LÉPREUXPage de copyrightLa Montagne des Dieux
José Moselli
PREMIÈRE PARTIE. LE GRAND CATALYSEUR
I WARÉ-ATUA
La nuit. Une nuit étoilée des tropiques où rayonne la splendeur de la Croix du Sud.
Un immense cratère de forme circulaire, dominé par des falaises à pic, aux sommets déchiquetés, hautes de plusieurs centaines de mètres.
Le sol, de lave solidifiée, est d’un noir d’ébène et réfléchit les moindres étoiles.
Au centre de ce cratère, une cavité de trente à quarante mètres de diamètre, qui semble dallée avec une matière dure, translucide, assez semblable à du jade qui serait intérieurement éclairé.
Une clarté verdâtre, laiteuse, phosphorescente, s’en dégage. Elle se reflète sur une large et basse muraille de corail qui entoure le cercle.
De légers sifflements, qui, par instants, se taisent, troublent seuls l’effrayant silence.
Ils sont produits par des jets de vapeur souterraine qui jaillissent des failles zébrant les falaises.
Ce cratère, c’est Waré-Atua, la Montagne des Dieux…
Une silhouette humaine vient de se profiler au sommet d’une des falaises.
C’est un vieillard canaque, de taille gigantesque. Un pagne de phormium l’enveloppe. Il lève vers le ciel ses bras osseux et décharnés, reste ainsi pendant quelques instants, puis descend avec lenteur une étroite piste creusée dans le basalte à flanc de précipice et qui tourne sur elle-même en épousant les sinuosités de l’entonnoir volcanique.
Deux autres vieillards, vêtus semblablement de pagnes de phormium, apparaissent à leur tour ; ils sont suivis par des guerriers.
Ceux-ci sont nus, à l’exception d’une ceinture d’écorce tressée, à laquelle pendent des festons de dents de requins qui luisent comme des perles. Ils sont en grande tenue, mode canaque : chapelets de dents humaines tombant sur la poitrine, chevelures passées à la chaux, ce qui les fait ressembler à des perruques de laine rouge, pipes, soucoupes, roues de réveille-matin encastrées dans le lobe de l’oreille effroyablement distendu, colliers et jarretières de petits coquillages blancs que l’on dirait de porcelaine… Et puis, des armes : casse-têtes et massues aux extrémités renflées en forme de becs d’oiseau, javelines à pointes d’os humains, longues sarbacanes de bambou – et même quelques carabines.
Ces guerriers sont au nombre de plusieurs centaines. Ils avancent avec lenteur, avec gravité, en file indienne – sans prononcer un mot.
Chacun d’eux tient dans sa main gauche une torche résineuse dont la flamme rouge et fuligineuse monte droit dans l’atmosphère d’un calme absolu.
On n’entend que le sifflement intermittent des geysers que trahissent de légères bouffées de vapeurs blanches.
Un groupe de vieillards suit les guerriers. Ils ne sont pas vingt. Les hasards des combats, le poison empêchent qu’on vive trop longtemps dans la région de la Montagne des Dieux…
Après les vieillards, encore des guerriers. Ils sont tout jeunes, dix-huit à vingt ans, et n’ont pas d’armes.
Deux à deux, ils portent sur l’épaule de gros madriers de bambou auxquels sont suspendues, par les poignets et par les chevilles, comme des moutons fraîchement tués, des créatures humaines.
Cinq hommes et une femme. De race blanche. La femme est évanouie. Les hommes ne valent guère mieux.
Dix guerriers, en armes, farouches, terminent le défilé.
Et la longue file, serpentant lentement sur la piste qui conduit au fond du cratère, avance.
Le sol de lave brillante est enfin atteint. Guerriers et vieillards se rangent autour du cercle phosphorescent que la clarté des torches a fait pâlir.
Les prisonniers sont étendus sur le sol, côte à côte, à quelques mètres de distance du mur de corail blanc.
Ensemble, les guerriers ont élevé leurs torches au-dessus de leurs têtes, et, immobiles comme autant de statues, fixent la mystérieuse matière.
Le grand vieillard apparu le premier sur le bord du cratère prononce alors, d’une voix rauque, une longue incantation, puis se prosterne, à plat ventre, devant la muraille. L’assistance l’imite comme un seul homme. Les torches, foulées aux pieds, sont éteintes. L’on n’entend plus que le crépitement des brandons qui achèvent de se calciner…
Des nuages, qui se sont accumulés au-dessus du cratère, cachent soudain les étoiles. Dans les ténèbres revenues, seule se voit la dalle d’émeraude où semblent passer des ombres mouvantes.
Un des prisonniers, petit homme râblé, rasé, complètement chauve, et dont les dents d’or luisent, tourne la tête vers son compagnon de droite et murmure :
— Qu’est-ce que vous croyez que c’est, que cette « chose » verte, hein ?
— Ma foi, mister White, je n’en sais rien !… Un gisement de métal phosphoreux, sans doute… répond l’interpellé, un vieillard obèse, au visage rond et bienveillant terminé par une minuscule pointe de barbe grise.
Cet homme, c’est Honoré Sanard, le chimiste, le « père Sanard », membre de l’Institut et d’innombrables sociétés savantes de tous pays.
« Mister White », ce n’est rien moins que M. William-Walter White, le grand fabricant de savons de San Francisco, à la marque WWW, que l’on dit cent fois millionnaire, en dollars.
Le hasard bienveillant a voulu que Mrs White ait été placée à son côté. Elle est toujours évanouie.
Viennent ensuite les trois autres prisonniers : le planteur Louis Escoffier, grand gaillard aux formes herculéennes, le négociant en coprah Pierre Marrin, et enfin un Luxembourgeois qui voyage pour son plaisir : M. Leonardt Klagendorf, quadragénaire à l’œil bleu, cheveux blonds coupés courts et moustaches en brosse à dents.
Quelques heures auparavant, les captifs, profitant de ce que le petit vapeur Sarcelle, à bord duquel ils étaient passagers, avait mouillé ses ancres devant une crique de l’île d’Espirito-Santo, étaient descendus à terre pour y excursionner.
Le capitaine de la Sarcelle, homme prudent, leur avait recommandé de ne pas s’éloigner de la plantation dont il venait embarquer le coprah, et, en tout cas, de ne pas perdre de vue le rivage.
Tout d’abord, ils avaient suivi ce sage conseil.
Mais Mrs White, une grande femme rousse à l’allure désinvolte, avait bien vite décidé ses compagnons à pousser jusqu’au village indigène où étaient recrutés les travailleurs de la plantation, et qui était situé à quelques centaines de mètres de la mer. Elle espérait y trouver quelques « curios », pour ramener à Frisco et éblouir les bonnes amies. Galamment, les cinq hommes, qu’accompagnait le mousse de la Sarcelle, Robert Lanni, chargé de porter l’appareil photographique et l’ombrelle de Mrs White, l’avaient escortée jusqu’au village canaque.
Tandis que Mrs White marchandait quelques-unes de ces bizarres dents de cochons, particulières aux Nouvelles-Hébrides, des cris d’épouvante avaient soudain retenti. Le village était attaqué par les « Hommes de la Montagne », les farouches Canaques de l’intérieur de l’île…
En quelques instants, tout avait été fini. Les indigènes du village s’étaient enfuis, comme volatilisés. Et les Européens, avant d’avoir pu organiser une résistance quelconque, avaient été entourés, cernés, assommés à coups de manches de casse-tête, ligotés comme des bestiaux et emportés, suspendus à des perches de bambou, cependant que, derrière eux, les cases flambaient…
Le mousse de la Sarcelle avait disparu. Tué, sans doute. Dans les tristes conjonctures où ils se trouvaient, les prisonniers n’avaient plus pensé à lui.
Ceci se passait à trois heures de l’après-midi.
Pendant de longues heures, les captifs avaient été emportés à travers l’impénétrable forêt vierge, une forêt si épaisse que les rayons du soleil n’arrivaient pas jusqu’au sol.
Tout d’abord, ils avaient espéré que leurs ravisseurs allaient les enfermer dans quelque case de leur village, afin de tirer d’eux une rançon. Ce sont là des choses qui se voient encore, aux Nouvelles-Hébrides.
Ils s’étaient donc un peu rassurés – tant il est vrai que l’on croit toujours ce que l’on espère.
… À présent, ils comprenaient l’atroce vérité : ils allaient mourir, sacrifiés à l’extraordinaire et phosphorescente matière.
*** ***
Le vieillard qui s’était prosterné devant le mur de corail se releva lentement.
L’assistance l’imita.
Il poussa un cri guttural qui se répercuta longuement dans l’immense cratère, et qui fut immédiatement suivi par une formidable clameur hurlée par la foule entière des naturels.
Ranimée par ces vociférations, Mrs White ouvrit les yeux. Elle voulut se redresser. Ses liens l’en empêchèrent. Elle « réalisa » la situation, et une exclamation de terreur jaillit de ses lèvres sèches.
— Soyez calme, ma chère !… C’est une mascarade… une sorcellerie ! Nous ne risquons rien ! voulut la rassurer W.-W. White.
Elle ne répondit pas. Elle regarda longuement autour d’elle, vit les guerriers dont les yeux luisaient férocement dans les ténèbres ; elle vit le gigantesque Canaque au pagne de phormium qui brandissait une javeline terminée par une douzaine de pointes d’os acérées comme des aiguilles, et un soupir d’horrible détresse s’échappa de sa bouche.
— Tout est fini ! murmura Pierre Marrin. Les « Hommes de la Montagne » ne gardent pas leurs prisonniers !
Il achevait à peine de parler que deux des vieillards aux pagnes de phormium s’approchèrent de lui, le soulevèrent et le traînèrent jusqu’au mur de corail, contre lequel ils le firent s’agenouiller, la tête appuyée sur les blocs calcaires.
Le grand escogriffe, d’un geste précis, plongea sa javeline au défaut de l’épaule du captif.
Un violent jet de sang jaillit de l’artère crevée, cependant que le négociant, atteint à mort, s’affaissait, sans un cri.
Deux guerriers s’avancèrent aussitôt. Ils soulevèrent l’agonisant et l’étendirent sur la crête du mur de corail. Deux autres Canaques s’approchèrent. Ils portaient une grande jarre de terre rouge qu’ils déposèrent contre la muraille. Le grand vieillard qui venait d’égorger Pierre Marrin se pencha sur la jarre, et, à l’aide d’une demi-noix de coco emmanchée à un bâton de bambou, y puisa environ un demi-litre du liquide qu’elle contenait et en aspergea le dallage phosphorescent.
Un long sifflement retentit.
Le vieillard saisit aussitôt une torche, qu’un de ses acolytes venait de rallumer, à l’aide… tout simplement, d’une allumette, et la tint au-dessus du mur de corail.
Un large jet de flamme blanche, éblouissante, fusa, illuminant violemment l’immense cratère.
Les Canaques s’étaient prosternés.
Ils se relevèrent peu après, dans un silence de mort.
Pierre Marrin avait expiré. Son sang s’était vidé en dedans de la muraille de corail…
Et ce fut au tour de Louis Escoffier de mourir. Il se laissa emporter et égorger sans prononcer un mot. Et, immédiatement après le sacrifice, le vieillard aspergea le cercle phosphorescent, d’où jaillit un nouvel éclair…
Honoré Sanard, malgré ses liens, avait réussi à se redresser légèrement. Il regardait, avec des yeux écarquillés par une ardente curiosité.
— On dirait du magnésium ! murmura W.-W. White, avec un flegme véritablement yankee.
— C’est mieux que cela ! murmura le chimiste. C’est la plus grande découverte des temps modernes… de tous les temps !… Et ce sont ces sauvages qui l’ont faite !
— Comment ? fit le fabricant de savon, qui crut que la peur de la mort faisait déraisonner son compagnon.
— Ce Canaque a jeté de l’eau… de l’eau !…
— De l’eau ? Eh bien ?
— Eh bien, cette pierre… ce minéral… ce métal vert, un catalyseur… le catalyseur de l’eau… que l’on cherche en vain depuis…
Un cri affreux l’interrompit :
— William ! À moi !
Les deux vieillards avaient saisi Mrs White.
La malheureuse femme, folle d’épouvante, se tordait dans ses liens, essayait de mordre, impuissante.
— William ! À moi ! appela-t-elle encore d’une voix déchirante.
Déjà, on la faisait agenouiller contre le mur de corail.
— L’infortunée ! murmura Honoré Sanard, oubliant qu’il allait lui-même subir un sort semblable.
La lueur éblouissante jaillit encore du cercle vert…
— De l’oxygène et de l’hydrogène qui brûlent ! murmura Honoré Sanard.
— Oh ! vous avez raison !… L’odeur ! s’exclama W.-W. White. Celui qui posséderait ce… catalyseur… dominerait le monde !… Vous croyez…
— Je crois que ça va être votre tour, monsieur White ! fit sardoniquement Leonardt Klagendorf.
II L’OURAGAN
Tout semblait prouver que le Luxembourgeois était prophète à bon compte, car les deux vieillards qui assistaient l’égorgeur marchaient déjà vers William-Walter White.
— Good bye ! cria celui-ci. Dommage ! Une si belle affaire !…
Un formidable coup de tonnerre couvrit sa voix, cependant que les nuages qui, depuis le commencement de l’horrible cérémonie, s’étaient accumulés au-dessus du cratère, crevaient en pluie furieuse.
Les trois vieillards poussèrent un même cri d’épouvante et se précipitèrent vers la torche embrasée qui avait été posée sur le petit mur de corail, à côté du corps pantelant de Mrs White.
Trop tard : l’averse, en s’abattant sur la matière phosphorescente, se décomposait à mesure en hydrogène et en oxygène, avec de terribles sifflements. Les gaz ainsi libérés s’enflammèrent soudain. Une trombe de feu sembla envahir le cratère qui, pendant quelques instants, fut transformé en fournaise…
Des hurlements d’enfer retentirent, mêlés au bruissement de la pluie. Les Canaques, épouvantés, affolés, s’enfuyaient, se poussant, se renversant, s’écrasant pour atteindre plus vite l’unique piste permettant de gagner le sommet de l’entonnoir de basalte.
Il n’y avait pas place pour tout le monde à la fois ; alors, poignards, javelines et zagaies entrèrent en jeu. Dans les ténèbres éclairées par intermittences par la lueur des gaz enflammés, des combats sauvages s’engagèrent, accompagnés de clameurs démoniaques.
Les prisonniers, impuissants, regardaient, se demandant vraiment s’ils n’étaient pas les jouets de quelque horrible cauchemar…
Une colonne gazeuse flambait maintenant au-dessus du cercle phosphorescent. Les rafales de vent qui s’engouffraient dans le cirque de basalte la faisaient tourbillonner, la transformaient en une gigantesque spirale paraissant reposer sur sa pointe et dont l’extrémité se perdait dans les ténèbres d’en haut.
Ses reflets éclairaient fantastiquement les falaises déchiquetées dominant le cratère et y dessinaient des ombres étranges.
Les sifflements du vent se confondaient avec les clameurs et les cris des Canaques qui s’entretuaient avec une frénésie décuplée par la terreur.
Sur l’étroite piste conduisant au sommet du cratère, la file des naturels galopait, se pressant comme une tribu de fourmis chassées par l’orage.
En bas, cependant, les combats se terminaient déjà. Plusieurs dizaines de morts et de blessés jonchaient le sol, et les vainqueurs se pressaient pour passer sur la piste menant au salut.
Un formidable coup de tonnerre vint ranimer leur terreur : un éclair violet fit pâlir, pendant une fraction de seconde, la colonne de gaz enflammés jaillit du cercle vert : la foudre était tombée dans le cratère, à moins de dix mètres des prisonniers hagards.
La panique fut alors à son comble. Sur l’étroite piste, ce fut une suprême ruée, au cours de laquelle de nombreux Canaques furent projetés dans le vide et allèrent s’écraser sur la lave noire et brillante tapissant le fond du cratère.
Et rien ne bougea plus que quelque agonisant grattant le sol sous l’averse qui tombait avec une fureur accrue.
— Un cyclone qui est le bienvenu ! articula enfin W.-W. White.
— Pas un cyclone, un ouragan d’une rare violence, et c’est tout, rectifia Klagendorf. En tout cas, sans lui, nous serions chez Pluton !…
« Si nous pouvions en profiter pour fuir… car ces démons vont se rassurer et revenir !
Ces paroles ne reçurent pas de réponse.
W.-W. White et Honoré Sanard avaient parfaitement entendu, malgré les sifflements du vent et de la pluie et le fracas du tonnerre dont les grondements retentissaient à de brefs intervalles.
Les deux hommes, instinctivement, avaient tiré sur leurs liens, et avaient constaté qu’ils étaient solides ; la pluie, loin de les amollir, les avait encore resserrés…
— Si nous pouvions nous ronger mutuellement les cordes qui nous retiennent ! reprit Klagendorf. Moi, malheureusement, j’ai un dentier…
— Mes dents sont fausses aussi… des dents à pivot recouvertes d’or… bonnes à rien ! maugréa W.-W. White.
— Il m’en reste une demi-douzaine, de dents ! fit Honoré Sanard, et je doute qu’elles soient capables de broyer autre chose que des bouillies et des purées !… Mais il n’y a pas que ce moyen… Il faut chercher, trouver !…
« Il faut que nous nous sauvions pour faire connaître le merveilleux, l’extraordinaire catalyseur de l’eau, qui doit changer la face du monde !
« Moi, je ne suis bon à rien, messieurs, mais qu’importe ma personne !
« Vous deux, qui êtes vigoureux, vous allez tout tenter pour fuir, et au plus vite ! Pensez qu’en vous sauvant vous pouvez faire avancer la civilisation de plusieurs siècles peut-être !
Klagendorf et W.-W. White ne répondirent pas. Ils se souciaient peu de la civilisation, du moins pour l’instant.
Pendant une longue minute, aucune parole ne fut plus échangée entre les captifs.
Pluie et vent continuaient à faire rage, et la lueur précipitée des éclairs luttait avec la clarté tourbillonnante des gaz en ignition.
— Misère de nous ! grommela enfin le Luxembourgeois. Ces sauvages vont revenir et nous égorger ! Et ne pouvoir rien faire !
— Il faudrait rechercher quelque zagaie, quelque poignard abandonné par les Canaques ! fit Honoré Sanard, et essayer de nous en servir pour couper nos liens !
— Facile à dire, mais nous ne pouvons bouger ! observa W.-W. White.
Il disait vrai. Les prisonniers étaient tellement bien ligotés que le moindre mouvement leur était pour ainsi dire interdit. Les Canaques avaient immobilisé leurs bras, depuis l’épaule jusqu’au poignet, contre leur torse. Leurs jambes, des chevilles aux genoux, étaient maintenues par un entortillement compliqué de cordes de phormium, minces et dures comme autant de fils de fer. Quant aux nœuds, ils étaient serrés de façon à rendre vaine toute tentative de les défaire.
Klagendorf et Honoré Sanard se rendirent compte de la justesse de l’observation de l’Américain. Ni l’un, ni l’autre n’insista.
Aussi bien, les trois hommes étaient épuisés, rompus de coups, perclus de fatigue, et les émotions qu’ils venaient de ressentir avaient achevé de les démoraliser.
Klagendorf, sans prononcer un mot, essaya de ramper vers le mur de corail que la trombe de gaz enflammés éclairait fantastiquement.
Il dut aussitôt y renoncer : malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à avancer sur la surface polie de la lave, que la pluie rendait glissante comme un marbre.
Une exclamation de rage s’échappa de ses lèvres :
— Rien à faire ! grommela-t-il en allemand.
Jusqu’alors, les trois hommes s’étaient exprimés en anglais, langue que M. Sanard parlait à peu près couramment, et que Leonardt Klagendorf connaissait à la perfection.
L’exclamation du Luxembourgeois fit tressaillir Honoré Sanard. Il avait reconnu un accent indubitablement allemand, prussien même. Il ne fit aucune observation. Qu’importait, d’ailleurs, la nationalité de ce compagnon de malheur ?
— Ma pauvre femme ! entendit-il.
C’était W.-W. White qui regrettait la mort de son épouse.
— Je vous croyais consolé, mister White ! ricana Klagendorf. Ça vous reprend ?
— Je ne voulais pas penser à ma douleur quand je croyais qu’il valait mieux penser à nous sauver ; mais, puisque nous ne pouvons rien, je songe à ma chère Kate !… Elle n’avait pas toujours bon caractère, mais elle…
— Sans sa ridicule obstination à se rendre dans le village canaque, nous ne serions pas ici, mister White ! remarqua le Luxembourgeois. Elle n’a eu que ce qu’elle méritait, et nous autres, innocents, que…
— Je vous défends de parler ainsi de Mrs White ! interrompit le fabricant de savons, furieux.
— Vous me défendez ? Ah, ah, ah ! Si nous n’étions pas ici, ligotés comme des veaux à l’abattoir, je vous boxerais comme un vil mercanti d’Amérique que vous êtes !
— Messieurs… messieurs… voulut interrompre Honoré Sanard, conscient du ridicule de cette dispute entre deux hommes qui allaient sans doute mourir d’un moment à l’autre.
— Vous ! Laissez-nous ! On ne vous demande rien ! gronda Klagendorf.
« Sans ces marchands de cochons et de confitures, nous vous aurions écrasés comme des chenilles !
— Vous nous auriez écrasés ? Je vous croyais Luxembourgeois, monsieur Klagendorf ? fit tranquillement le savant.
— Je suis Allemand, et je m’en vante !
— Il fallait vous en vanter à bord de la Sarcelle, au lieu de renier votre nation ! Cela nous aurait évité de vous emmener ! remarqua Honoré Sanard.
— Et vous auriez conservé votre précieuse peau ! acheva W.-W. White. Mais je vous préviens que, si nous nous tirons de là, je vous infligerai la correction que mérite votre…
— Vous vous mettrez à dix-huit contre un, comme pendant la guerre, l’homme aux dollars ? ricana Klagendorf. Escroquez les gens, mais ne vous mêlez pas de vous battre, ça ne vous va pas !
« Quant à votre idiote de femme, vous pouvez continuer à la pleurer… ou de nous dire que nous la pleurez pour que nous ne sachions pas que, ce que vous pleurez, c’est votre sale carcasse de mercanti !
Ces insultes étaient hurlées. Les deux hommes, pour mieux se faire entendre, en étaient arrivés à crier de toutes leurs forces. Les éclairs et la lueur des gaz enflammés illuminaient leurs faces tordues par la rage et la haine. Ils frissonnaient dans leurs liens, et, s’ils l’eussent pu, auraient essayé de se mordre avec leurs dents fausses.
Honoré Sanard, calme, les regardait avec un immense mépris mélangé de pitié. Ces fous furieux étaient de race blanche, comme lui, et voués au même terrible sort…
À chaque seconde, le savant s’attendait à voir apparaître les Canaques sur la crête aux arêtes aiguës dominant le cratère, et alors, ce serait la fin…
Il entendit un cri de rage : W.-W. White avait craché à la figure de Klagendorf :
— Si vous ne crevez pas, aboya l’Allemand, je vous…
— Je me moque de vos menaces, espèce de sauvage, plus sauvage que ces Canaques ! l’interrompit W.-W. White. Ils…
— Chut ! Il me semble qu’on appelle ! cria Honoré Sanard, d’une voix qui s’entendit à peine dans le vacarme de l’ouragan.
— Vous êtes fou ? maugréa Klagendorf.
Honoré Sanard dédaigna de répondre. Il avait parfaitement entendu un cri, et il avait même cru reconnaître son nom !
Dressé sur son séant, le seul mouvement qui lui fût permis, il explora du regard l’immense entonnoir de lave et distingua, à moins de cent mètres de lui, dans la direction du sentier conduisant à la crête, une silhouette humaine qui sautillait d’un pas mal assuré.
Les trombes d’eau qui tourbillonnaient de toutes parts l’empêchèrent d’en voir davantage et d’identifier l’inconnu, lequel était de petite taille.
Celui-ci, qui avait atteint le fond du cratère, avançait en zigzags, allant de gauche à droite, de droite à gauche, revenant sur ses pas, se penchant sur les corps des Canaques qui s’étaient entretués au moment de la panique. Tout montrait qu’il cherchait quelque chose ou quelqu’un.
Peu à peu, il se rapprochait du cercle d’où jaillissait la colonne de gaz enflammés, et, par conséquent, des prisonniers.
Klagendorf et W.-W. White, en même temps, l’aperçurent et cessèrent de s’insulter.
— Un Canaque qui vient détrousser ses congénères morts ! ricana l’Allemand, à mi-voix.
Ses compagnons ne l’entendirent pas. Toute leur attention était tournée vers l’inconnu.
— Oh ! Mais c’est le mousse ! s’écria soudain W.-W. White.
— Le mousse de la Sarcelle ! fit Honoré Sanard.
Les deux hommes ne se trompaient pas. C’était bien le jeune garçon descendu à terre avec eux pour porter les impedimenta de feu Mrs White. Il était revêtu d’un pantalon et d’une vareuse de toile bleue déchirés, souillés de sang et de boue, et avait la tête nue.
— Mousse ! Par ici ! cria W.-W. White, de toutes ses forces.
— Vous voulez nous faire massacrer ? grommela Klagendorf, mais d’un ton singulièrement radouci.
Le mousse avait entendu. Il s’élança vers le groupe des captifs qu’il eut rapidement rejoint.
— D’où viens-tu ? Tu es seul ? l’interpella Klagendorf.
— Coupe nos liens, mon petit, et fais vite ! demanda Honoré Sanard.
Le mousse, sans répondre, tira de sa poche un grossier couteau à manche de corne, avec lequel, en un tournemain, il eut tranché les cordelettes qui garrottaient M. Sanard.
— Dépêche ! À moi ! clamèrent ensemble Klagendorf et W.-W. White.
Toujours en silence, le mousse libéra l’Allemand, qui, lui arrachant le couteau des mains, se précipita sur W.-W. White et coupa les cordelettes qui le garrottaient.
L’Américain avait poussé un cri.
— Ne craignez rien, monsieur White : je ne suis pas un assassin ! fit Klagendorf, qui semblait tout à fait calmé.
Le mousse de la Sarcelle, après un moment de surprise, s’était précipité vers Honoré Sanard qui, debout, immobile, contemplait, comme fasciné, le tourbillon de flammes jailli du cercle phosphorescent :
— Faut filer d’ici, m’sieur Sanard, parce que les Canaques ils ne sont pas loin ! lui cria-t-il dans l’oreille.
III DANS LES TÉNÈBRES
L’archipel des Nouvelles-Hébrides est, on peut le dire, un des derniers repaires, sinon le dernier, de la sauvagerie et du cannibalisme.
Paresseux, cruels, féroces et brutaux, les Canaques qui l’habitent sont parmi les races humaines les plus attardées.
Il serait facile de les réduire à merci, et, sinon de les civiliser, du moins de les obliger à renoncer à leurs atroces pratiques, ainsi que les Anglais, par exemple, l’ont fait aux îles Fidji.
Seulement, aux Fidji, les Anglais étaient les maîtres. Aux Nouvelles-Hébrides, il n’y a pas de maîtres.
L’archipel est administré par un condominium anglo-français. Il serait trop long de résumer ici les événements qui ont donné lieu à cette situation unique dans l’histoire coloniale. Bornons-nous à dire que, à la suite de la convention signée à Londres le 20 octobre 1906 entre la France et l’Angleterre, et promulguée à Paris le 11 janvier de l’année suivante, les Nouvelles-Hébrides constituent actuellement une colonie indivise.
Elles sont administrées par deux commissaires qui résident à Port-Vila, dans l’île Vaté : le commissaire français dépend du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et le commissaire anglais relève du gouverneur général de l’Australie. (Et n’oublions pas de mentionner que, suivant le droit strict, les Nouvelles-Hébrides devraient être françaises ! Mais ceci nous entraînerait trop loin !)
Il n’existe pas de troupes aux Nouvelles-Hébrides. Le corps de police aux ordres du tribunal mixte est absolument insuffisant.
Alors, les Canaques sont libres, ou à peu près, de commettre toutes les atrocités possibles.
Ils se divisent en deux rameaux tout à fait différents : les man salt-water, hommes de la mer, dans le jargon des traitants, et les man bush, hommes de l’intérieur.
Les man salt-water sont de mœurs assez tranquilles. Cela vient surtout de ce que leurs villages se trouvent sur le rivage, sous le feu des canons des croiseurs anglais et français. C’est parmi les man salt-water que se recrutent les travailleurs employés dans les nombreuses plantations de l’archipel, lesquelles sont également situées non loin de la mer.
Les man-bush, eux, vivent dans l’intérieur, dans les impénétrables forêts qui recouvrent l’archipel, forêts si épaisses qu’une expédition d’infanterie de marine, débarquée en 1886 dans l’île de Mallicolo, ne réussit à progresser qu’à raison de quatre kilomètres par jour, et ce au prix des plus grands efforts.
Les man-bush vivent surtout de rapines. Presque tous, sinon tous, sont cannibales. Comme armes, ils emploient principalement les javelines et les flèches à pointes d’os humains, dûment empoisonnées.
Ils exécutent des « raids » sur les villages du rivage, enlèvent les femmes, s’emparent de tout ce qui peut s’emporter et disparaissent dans leurs forêts.
À l’occasion, ils ne dédaignent pas de tenter un coup de main sur les habitations des planteurs.
Ils opèrent généralement par traîtrise. Un serviteur indigène, gagné par les promesses ou les menaces, leur ouvre de nuit la palissade qui entoure chaque habitation, et c’est l’attaque, le massacre terminé par l’incendie de la maison et des hangars à coprah.
L’affaire est vite connue. Si le planteur tué est français, l’on envoie un bâtiment de guerre français qui, généralement, se borne à envoyer au hasard quelques obus dans la forêt où l’on suppose que gîtent les assassins… il en est de même si la victime est anglaise : en ce cas, c’est un vaisseau britannique qui bombarde la brousse…
L’on comprend qu’étant donnée cette situation, les Canaques ne se gênent pas !
Honoré Sanard et ses compagnons avaient été enlevés par des man-bush, et l’ouragan seul leur avait évité une mort atroce…
Mais ils étaient encore loin d’être sauvés !
Le savant, tout comme Klagendorf ou W.-W. White, ne l’ignorait pas.
Les mugissements du vent et les sifflements assourdissants des flammes qui tourbillonnaient au-dessus du cercle mystérieux l’empêchèrent de comprendre ce que disait le mousse de la Sarcelle. Mais il le devina.
Il tressaillit, s’arracha à sa contemplation, et, se penchant vers le jeune garçon, hurla, car il fallait hurler pour se faire entendre :
— Je te suis !
— Comment es-tu arrivé jusqu’ici ? intervint Klagendorf, qui s’était approché.
— Hé ! Il nous le dira plus tard ! Fuyons ! observa rudement W.-W. White, qui n’était pas fâché d’interrompre son ennemi.
L’Allemand ne se fâcha pas :
— Allons ! dit-il.
Robert Lanni, déjà, s’était élancé dans la direction de l’étroite piste menant au sommet du cratère.
Avant de le suivre, Honoré Sanard, Klagendorf et W.-W. White eurent une pareille hésitation : ils éprouvaient une sorte de regret de s’éloigner du phénomène étrange qui se manifestait sous leurs yeux.
Pour des motifs différents, ils auraient voulu emporter un fragment, une parcelle de l’extraordinaire matière qui décomposait l’eau et la transformait, pour ainsi dire, en flammes.
W.-W. White pensait à une affaire gigantesque… Klagendorf songeait aux possibilités de puissance renfermées dans ce catalyseur idéal. Honoré Sanard imaginait les progrès que permettrait l’utilisation de ce qu’il appelait déjà « le grand catalyseur ».
Mais il fallait fuir, d’abord. Primum vivere, disaient les anciens. Premièrement, vivre. Si les trois hommes périssaient, l’existence de la matière phosphorescente risquait fort de rester très longtemps un secret pour l’humanité…
Tous trois, oubliant leur état d’épuisement, galopèrent à la suite du mousse.
En quelques instants, ils eurent atteint le débouché de la piste sur laquelle ils s’engagèrent : W.-W. White le premier, Klagendorf le suivant, et Honoré Sanard fermant la marche.
La pluie tombait toujours avec la même violence. Une de ces pluies comme l’on n’en voit que sous les tropiques, et qui font penser au déluge : de véritables cataractes d’eau s’abattant par paquets d’un ciel de suie d’où jaillissait, à de courts intervalles, le zigzag éblouissant d’un éclair accompagné d’une formidable détonation…
Tout d’abord, tout alla bien. Quoique la piste, grossièrement taillée dans le roc, fût très glissante, elle était suffisamment large et sa déclivité était modérée. De plus, les flammes des gaz en ignition l’éclairaient avec netteté.
Mais bientôt elle se rétrécit, jusqu’à ne mesurer que quarante à cinquante centimètres à peine, et sa pente devint abrupte, inclinée à plus de quarante degrés.
Le mousse et ses compagnons, pour ne pas glisser et dégringoler dans le vide, durent s’agenouiller, et avancer ainsi, en rampant presque.
À mesure qu’ils s’éloignaient du fond du cratère, les ténèbres s’épaississaient autour d’eux.
La piste, qui serpentait le long de la roche à pic, suivait les moindres méandres des falaises de basalte.
Par endroits, elle s’enfonçait dans une anfractuosité de la pierre, décrivait des virages en « épingle à cheveux », se redressait, revenait sur elle-même, dessinant tour à tour toutes les figures de la géométrie, depuis la ligne droite jusqu’au demi-cercle, en passant par les angles obtus, aigus, droits, les sinuosités les plus compliquées, et toujours enserrée entre le roc vertical et le vide.
Avec cela, la pluie qui fouettait les fugitifs au visage, les aveuglait, rendait la roche glissante comme de la glace, et les éclairs qui les éblouissaient.
« Mais il fallait avancer ou périr. Chacun ne s’occupait que de lui. Nul ne tournait seulement la tête. Oui, il fallait avancer.
Le sommet du cratère, cependant, se rapprochait, avec une lenteur désespérante.
Honoré Sanard, poussif, ahanant et soufflant, le corps ruisselant de sueur, les poumons haletant comme un soufflet de forge, souffrait atrocement. Ses genoux étaient en sang. Sa tête lui semblait une bille de plomb, et des nuages rouges, par instants, passaient devant ses yeux, cependant que des cloches sonnaient à ses tempes. Pour ne pas rester en arrière, il devait faire de douloureux efforts. Chaque mouvement lui était une torture ; ses souffrances étaient telles qu’il devait chasser la pensée lancinante de se laisser choir dans le vide, d’en finir.
Mais le Grand Catalyseur… Laisser ce secret à cet Américain, à cet Allemand ? Ce n’était pas possible !
Et le chimiste suivait…
La crête fut enfin atteinte, sous les torrents d’eau qui continuaient à s’abattre du ciel noir.
Les fugitifs, à bout de souffle, transis, boueux, épuisés, mains et genoux écorchés ou contusionnés par le contact des arêtes du basalte, purent enfin se mettre debout.
Les épaisses ténèbres qui régnaient au sommet du cratère les rendaient invisibles.
Vers le sud-ouest, à moins de cinq cents mètres d’eux, ils distinguèrent, groupées sur un éperon rocheux qui, sur trois côtés, dominait la vallée, les cases du village canaque, de grossières huttes de forme cylindro-ogivale, assez semblables à d’énormes ruches d’abeilles.
Une palissade, faite de pieux hauts de trois à quatre mètres, de la grosseur de la cuisse, les entourait. Entre les cases, de faibles et tremblotantes clartés rougeâtres apparaissaient ; elles étaient évidemment produites par des torches que la pluie et le vent faisaient vaciller.
— Par quel côté es-tu venu, petit ? demanda Honoré Sanard au jeune mousse.
— Je ne sais pas trop, m’sieur Sanard !… Quand les Canaques, ils nous ont attaqués, j’ai réussi à mettre les voiles et je me suis caché dans un arbre…
« Toutes les cases flambaient… J’ai attendu que les Canaques se soient éloignés… avec vous… et puis, je suis redescendu…
« Je comptais revenir vers la mer, pour aller avertir à bord… Mais je me suis égaré dans la forêt… J’ai tourné, j’ai viré… enfin j’ai entendu du bruit !
« Vous savez ce que c’était. C’étaient les Canaques qui vous transportaient ! J’étais allé me jeter en plein dans leurs jambes !… Heureusement qu’ils ne m’ont pas flairé !…
« Comme je ne savais que faire, je les ai suivis au petit bonheur… dans l’idée que peut-être je pourrais vous délivrer…
« Ils ne marchaient pas très vite, heureusement. Ils s’arrêtaient à chaque minute ! Ils avaient l’air de se méfier de quelque chose, comme s’ils s’attendaient à être attaqués… Enfin, ils sont arrivés là-bas, devant la palissade !… J’ai entendu une espèce de trompe marine… Il y avait des guetteurs…
« Les Canaques ont passé la palissade, un à un. Moi, comme de juste, je suis resté dehors… J’aurais sûrement été repéré ! J’ai attendu… Je comptais passer quand même… Mais rien à faire ! Il y avait des factionnaires, et je ne sais pas comment ils ne m’ont pas vu…
« … Enfin, ils sont ressortis… une vraie mascarade… On se serait cru au mardi gras !…
« Mais il n’y avait pas de quoi rire, pas vrai !… Vous étiez pendus comme des bestiaux, à des bambous… J’ai suivi… et je suis arrivé dans le volcan… Ça n’a pas été facile de descendre, et voilà-t-y pas que, comme j’étais presque rendu en bas, la pluie s’est mise à tomber et le feu a pris au milieu du cratère, et les Canaques se sont mis à courir, à galoper comme des fous…
« J’ai eu que le temps de me jeter dans une espèce de trou, entre deux blocs de pierre. J’ai bien cru que ça y était !…
« Mais ils ne pensaient qu’à fuir !… Ils ne m’ont pas vu !
« Je suis descendu, je vous ai cherchés… et voilà !…
« Quant à dire par où que j’ai passé pour arriver ici, y a rien à faire ! J’y comprends rien !
— Enfin, tu es bien venu par le nord, par l’est, par l’ouest, ou par le sud ? grommela Klagendorf qui, au côté de W.-W. White, s’était approché et avait tout entendu.
— Sûr que je suis venu par une de ces directions, mais je ne sais pas laquelle ! fit le mousse, froissé par le ton du pseudo-Luxembourgeois.
— La Sarcelle avait mouillé sur la côte ouest de l’île, fit W.-W. White, non loin de Tasselle-Mana ! Nous avons été emmenés dans l’intérieur, c’est-à-dire approximativement vers l’est. Dirigeons-nous donc vers l’ouest, nous sommes sûrs d’atteindre la mer !
— Sans doute ! objecta Honoré Sanard. Mais l’île d’Espirito-Santo mesure environ cinquante kilomètres de largeur devant Tasselle Mana.
« Si nos Canaques nous ont fait franchir trente kilomètres vers l’est, nous sommes plus près de la côte est que de la côte ouest, et, au surplus, rien ne nous dit que la Sarcelle nous attend !
« Le capitaine Beaufort doit nous croire tués et se sera hâté de regagner Port-Vila, afin de prévenir la commission navale de notre sort !…
« … Je pense donc que le plus simple, c’est de gagner le fond de cette vallée où doit se trouver quelque cours d’eau que nous suivrons jusqu’à son embouchure, ce qui nous évitera le risque de nous égarer !
— Et vous n’avez pas tort, monsieur Sanard ! approuva Leonardt Klagendorf. Faisons donc ce que vous dites.
— Oui. Cela vaudra mieux que de discuter inutilement ! fit W.-W. White. Mais dépêchons ! Ces Canaques ont des chiens… eux-mêmes ont un flair de dogues ! Dès qu’ils auront découvert notre fuite, ils ne seront pas longs à nous poursuivre !
— Allons ! conclut Honoré Sanard.
En groupe, les trois hommes et le mousse, ayant tourné le dos à l’agglomération canaque, entreprirent de descendre dans la vaste vallée dont ils distinguaient le fond à plusieurs centaines de mètres sous eux.
Le versant extérieur du cratère était en pente assez douce, mais, de toutes parts, des ronces, de hautes herbes, dures et coupantes comme des rasoirs, hérissaient le sol.
Les fugitifs ne tardèrent pas à être égratignés et écorchés sur toutes les parties du corps.
Personne ne se plaignit : il s’agissait d’avancer !
Les trois hommes et le mousse, trébuchant sur le sol imbibé d’eau, tournaient instinctivement la tête, presque à chaque pas, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas poursuivis. Mais les buissons leur cachaient le village des naturels, ils ne pouvaient rien voir.
Derrière eux, la lueur des gaz qui continuaient à brûler au fond du cratère se réverbérait sur le ciel d’encre…
Un aboiement rauque, soudain, les fit sursauter.
IV CHACUN POUR SOI…
Immobiles, les trois hommes et le mousse regardèrent autour d’eux. L’obscurité était complète. À deux mètres, les buissons de plantes épineuses se distinguaient à peine.
Les aboiements, cependant, continuaient, tout proches. Et, soudain, une ombre surgit d’un fourré. Un grondement rauque retentit, suivi d’un bruit mou, à peine perceptible.
— Je l’ai eu ! cria Robert Lanni.
— Qu’est-ce que tu dis ? demanda Klagendorf, qui se trouvait tout près du mousse de la Sarcelle.
— Le chien ! Je lui ai envoyé une zagaie dans le ventre ! précisa le jeune garçon.
— Une zagaie ?
— Oui. Je l’avais ramassée dans le volcan… Venez voir.
Et Robert Lanni s’élança vers le fourré d’où avait jailli la bête.
Celle-ci se tordait sur le sol, dans les affres de l’agonie.
— Je te félicite ! fit Klagendorf.
Il se baissa, ramassa une grosse pierre contre laquelle son pied venait de trébucher et en écrasa la tête du chien, un dogue de forte taille.
Il arracha alors la zagaie du corps de l’animal et la garda :
— Tu n’en as pas besoin ! dit-il au mousse qui étendait la main pour reprendre son bien.
— Il a pourtant montré qu’il savait s’en servir ! objecta Honoré Sanard qui, au côté de W.-W. White, s’était approché.
— Je sais encore mieux m’en servir que lui ! déclara l’Allemand, péremptoirement, d’un ton de défi.
— Ça va ! conclut philosophiquement Robert Lanni. Je trouverai autre chose : je n’ai besoin de personne, moi, pour m’armer !
— Quoi ? Répète ? siffla Klagendorf, une menace dans la voix.
— Je ne suis pas votre domestique, monsieur, et je n’ai pas l’habitude de répéter ce que je dis ! déclara fièrement le mousse de la Sarcelle.
— Bien répondu ! appuya W.-W. White.
— Nous ferions mieux de continuer notre route au lieu de discourir ! intervint Honoré Sanard qui craignait une nouvelle altercation entre l’Américain et l’Allemand et le mousse. Il y a peut-être d’autres chiens ! Ne les attendons pas !
Ces paroles étaient le bon sens même. Tout le monde le comprit.
Les fugitifs reprirent leur marche vers le fond de la vallée. Ils franchirent encore environ un kilomètre à travers les taillis épineux, et atteignirent la lisière d’une épaisse forêt, dont les arbres, entremêlés de lianes, de végétaux de toutes sortes, semblaient se toucher et former une véritable muraille.
Impossible de passer.
Les trois hommes et le mousse, bon gré mal gré, durent longer la barrière végétale, dans l’espoir d’y trouver une brèche.
L’averse tombait toujours et l’obscurité était absolue. Une épaisse couche de végétaux pourris recouvrait le sol ; les pieds y glissaient, s’y enfonçaient comme dans de la vase.
Pas un mot n’était échangé. Les fugitifs, pour le moment, poursuivaient le même but : la liberté. Mais tous se détestaient ou se méprisaient mutuellement.
Robert Lanni, de sa propre initiative, avait pris les devants et cheminait en éclaireur.
Ses compagnons, soudain, l’entendirent pousser une exclamation de joie. Ils le rejoignirent :
— Ici ! fit le mousse de la Sarcelle. Il y a un sentier !
« C’est pas large, mais on peut passer ! Suivez-moi, m’sieur Sanard ! J’ai une liane ! Prenez-en le bout ; comme ça, vous ne risquerez pas de me perdre !
— Tu es un brave garçon, mon petit ! fit le savant, touché de cette attention.
Il sentit le jeune garçon lui pousser dans la main l’extrémité d’une liane mince et flexible, et s’en saisit.
Robert Lanni ne s’était pas trompé. Une piste, un sentier large de soixante centimètres à peine, trouait la muraille d’arbres et de racines.
À moins de deux mètres du sol, d’ailleurs, lianes et branches de toutes sortes se rejoignaient. Cette piste ressemblait à un souterrain…
Elle était assez bien entretenue. Le sol était à peu près débarrassé de tous obstacles, et, latéralement, branches et branchettes étaient coupées avec une suffisante régularité.
La voûte feuillue était si épaisse que les cataractes d’eau s’abattant sans trêve des cieux ne parvenaient pas jusqu’au sol. Les fugitifs ressentirent un certain soulagement de n’être plus arrosés.
La piste décrivait de nombreux méandres. Elle zigzaguait, dessinait des angles aigus que rien, en apparence, ne justifiait. La cause en était très simple : les Canaques qui l’avaient percée ne voulaient pas qu’elle pût servir à leurs ennemis éventuels. Ces zigzags, ces méandres étaient destinés, en cas d’alerte, à faciliter la défense et les embuscades…
Sous les arbres, un bruissement sourd régnait : murmure de l’averse, tout en haut, sur les feuilles et les branches, agitation des myriades d’êtres – larves, rongeurs, oiseaux, reptiles, fauves, animaux de toutes sortes – qu’abritait l’impénétrable forêt…
Un sifflement bref s’entendit, accompagné du craquement d’une branche.
Robert Lanni poussa une brève exclamation.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda Honoré Sanard qui le suivait à moins de deux mètres.
— Quelque chose !… Il m’a semblé qu’on me tirait une flèche ! expliqua le mousse. J’ai entendu siffler, juste au-dessus de ma tête !
— Tu as la berlue, mon garçon ! grommela Klagendorf, avec rudesse. Avance, et pas de bavardages !
— D’abord, je n’ai pas d’ordres à recevoir de vous ! protesta le jeune garçon.
« Et quant à avoir la berlue, peut-être bien que je l’ai eue pour vous avoir délivré ! Si je vous avais laissé dans le volcan, vous ne crâneriez pas comme vous le faites !
— Voilà qui est parlé ! approuva W.-W. White. Très bien, mon garçon !
— Avançons ! conclut Klagendorf, qui ne jugea pas à propos de continuer la discussion.
Robert Lanni, sans insister, se remit en marche. Ses compagnons l’imitèrent en silence.
Ils n’avaient pas parcouru dix mètres que Leonardt Klagendorf poussa un grognement de fureur et s’étala de tout son long sur la piste.
— Der Teufel ! grommela-t-il. J’ai trébuché contre une corde tendue en travers de la piste !… Oh ! Je la tiens !… Attendez !… Ah, ah !
— Quoi ? questionna W.-W. White qui, tout comme Honoré Sanard et Robert Lanni, s’était immobilisé.
— Un arc !… Un arc tendu perpendiculairement à la piste !… Un arc colossal ! maugréa Klagendorf. Heureusement qu’il n’y avait pas de flèche dedans !
— La flèche, c’est moi qui ai dû la faire partir ! observa le mousse de la Sarcelle.
— Ces gueux de Canaques ! grommela l’Allemand, sans répondre à la remarque du mousse.
— En avant ! En avant ! Nous n’allons pas rester ici ! fit W.-W. White.
Klagendorf ne répondit pas. La petite troupe se remit en marche.
Elle venait de passer devant un des pièges familiers aux man-bush des Nouvelles-Hébrides, qui sèment les pistes de toutes sortes d’embûches : arcs placés de façon à lancer une flèche empoisonnée si l’on touche du pied une liane tendue au ras du sol, en travers du sentier ; pointes de bambou dissimulées sous le feuillage recouvrant la terre, et dont le simple contact cause une blessure mortelle.
Ces pointes, tout comme les flèches employées par les Néo-Hébridais, sont plantées pendant plusieurs jours dans le cadavre d’un animal en putréfaction, où elles s’imbibent de poisons qui tuent…
La découverte de l’arc avait causé une profonde impression sur les fugitifs, déjà démoralisés par les épreuves et les fatigues de toutes sortes qu’ils avaient affrontées. Ils avancèrent sans plus échanger un seul mot.
Robert Lanni qui, courageusement, avait continué à tenir la tête du petit groupe, avait fortement ralenti sa marche. À l’aide d’un bâton de bambou qu’il avait ramassé, il tâtait avec soin le sol devant lui et promenait son gourdin dans le feuillage de chaque côté de la piste.
Trois kilomètres environ furent franchis, sans qu’aucun nouveau piège ait été rencontré.
La piste, maintenant, était en pente très prononcée ; le sol, assez dur jusqu’ici, s’amollissait de plus en plus. Les pandanus, les palmiers, les fougères arborescentes, les ébéniers, les araucarias, les myrtes géants, les cèdres à feuilles d’olivier peu à peu étaient remplacés par d’énormes bambous qui, bientôt, formèrent l’unique végétation, cependant que le terrain devenait franchement marécageux.
— Nous ne devons pas être loin d’une rivière ! murmura Honoré Sanard.
Nul ne lui répondit.
Le mousse, d’instinct, accéléra le pas, imité par ses compagnons.
La piste s’élargissait légèrement. Après un dernier détour, très prononcé, elle déboucha à quelques mètres de la berge d’un large cours d’eau gonflé par la pluie.
Les fugitifs, arrêtés entre deux hautes murailles de bambous géants qui se touchaient de la racine à la pointe, purent constater, malgré l’obscurité, que le cours d’eau, quel qu’il fût, coulait avec une formidable violence.
Il charriait d’énormes souches, des arbres entiers déracinés par l’ouragan et dont les branches feuillues crépitaient sous l’averse.
— N’y a qu’à se jeter à l’eau et à s’embarquer sur un de ces arbres ! opina le mousse de la Sarcelle.
« … Vous savez nager, m’sieur Sanard ?
— Malheureusement non, mon garçon ! avoua le savant. Je connais le calcul différentiel, mais je ne sais pas nager !
— Vous en faites pas : on vous aidera !
— Moi, je sais juste assez nager pour me tenir sur l’eau ! grommela Klagendorf.
— Et je me demande, moi, si je suis capable de m’y tenir ! murmura W.-W. White.
— Eh bien, m’sieur Sanard, je me débrouillerai ! s’écria Robert Lanni, indigné. Laissez-moi…
Il n’en dit pas plus : plusieurs flèches sifflèrent au-dessus des têtes des fugitifs et allèrent s’abattre dans l’eau clapoteuse.
— Les Canaques ! s’écria W.-W. White.
Des hurlements féroces couvrirent sa voix et se mêlèrent au vacarme de l’ouragan.
L’Américain, sans hésiter, fonça vers la rivière. Klagendorf l’avait déjà précédé.
Presque ensemble, les deux hommes se mirent à l’eau et tirèrent leur coupe vers un gros arbre que le courant entraînait et qui se trouvait à une vingtaine de mètres à peine de la berge. Quoi qu’ils en eussent dit, c’étaient tous deux de solides nageurs. Ils eurent rapidement atteint la souche sur laquelle ils se juchèrent.
— Et si je vous crevais le ventre, maintenant, espèce de mercanti yankee ? ricana aussitôt Klagendorf en brandissant sa javeline qu’il n’avait pas lâchée.
— Essayez ! fit W.-W. White en arrachant de sa ceinture une longue flèche à pointe d’os humain, la flèche qui avait failli tuer Robert Lanni.
Le fabricant de savons l’avait sentie tomber presque à ses pieds, et l’avait ramassée sans mot dire. À présent, elle lui servait d’argument.
Un éclair illumina la rivière. Klagendorf vit la longue flèche à multiples pointes d’os, acérées comme autant d’aiguilles :
— Je ne suis pas un barbare ! Je plaisantais ! déclara-t-il. Quels qu’aient pu être nos dissentiments, monsieur White, n’oublions pas que nous sommes de race blanche et que nous devons nous entr’aider en d’aussi affreuses conjonctures !… Oublions ce que nous avons pu nous dire, notre tragique situation a pu nous faire déraisonner, et, pour moi, j’ai la plus haute estime pour la noble Amérique !
— Comme vous voudrez ! fit W.-W. White, qui s’assit à l’intersection de deux maîtresses branches, d’où il pouvait observer l’Allemand.
Celui-ci s’installa à quelques mètres de lui et n’essaya pas – pour le moment – de renouer la conversation…
Tous deux pensaient à Honoré Sanard et à Robert Lanni qu’ils avaient lâchement abandonnés et songeaient que, maintenant, ils n’étaient plus que deux, sans doute, à connaître l’existence du merveilleux catalyseur.
Derrière eux, la rivière était déserte.
Ils n’avaient plus qu’à se laisser aller au courant. Ils étaient certains d’arriver au rivage de l’océan, chez des Canaques plus civilisés, d’où ils gagneraient facilement un des établissements de la côte.
Et chacun d’eux réfléchissait aussi que, si l’autre mourait, il serait seul possesseur du secret. Et chacun d’eux savait que l’autre pensait la même chose que lui…
Le tronc d’arbre servant de flotteur aux deux hommes dérivait de plus en plus rapidement.
Klagendorf et W.-W. White, sans cesser de s’observer, avaient changé de place, de façon à s’abriter tant bien que mal des rafales furieuses qui se succédaient et lançaient sur la souche de véritables paquets d’eau limoneuse, lesquels venaient frapper les fugitifs.
— Attention ! hurla brusquement Klagendorf. Malheur !
— Quoi ? grommela l’Américain, qui crut son compagnon devenu fou.
V À LA DÉRIVE
Robert Lanni, le mousse de la Sarcelle, avait à peine quatorze ans ; à l’âge où tant d’autres ne connaissent que l’école ou le lycée, il avait déjà couru maintes aventures.
Niçois de naissance, il avait, de bonne heure, perdu son père. Pour aider sa mère à élever sa demi-douzaine de frères et de sœurs, il avait exercé bien des métiers : cireur de chaussures, porteur de bagages, chasseur de restaurant, crieur de journaux.
Finalement, il s’était engagé comme mousse sur une tartane faisant le cabotage sur la côte provençale. Il était ainsi allé à Marseille, y avait débarqué et avait trouvé une place de mousse sur un paquebot des Messageries maritimes allant en Australie.
Grièvement brûlé à la jambe par l’éclatement d’un treuil, il avait été laissé à l’hôpital, à Sydney.
Une fois guéri, il avait fait connaissance, dans le modeste hôtel où il attendait son rapatriement, d’un matelot de la Sarcelle, lequel lui avait appris que le capitaine de ce navire cherchait un mousse.
La Sarcelle, un petit vapeur d’environ six cents tonneaux, naviguait entre Sydney, la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides. Il poussait parfois, lorsqu’il y avait du fret, jusqu’aux Fidji.
Robert Lanni s’était enthousiasmé à la pensée de voir des « sauvages », des vrais ! Il s’était présenté au capitaine de la Sarcelle qui, sur sa bonne mine, l’avait aussitôt embauché…
Robert Lanni avait dû renoncer à son rapatriement. Mais il n’était pas pressé de revenir en France. Les aventures l’attiraient. Il ne se doutait pas qu’il allait, comme l’on dit, être servi – et amplement.
Il était de taille, d’ailleurs, à tout affronter. Plutôt petit, mais râblé et musclé, l’œil noir, la mâchoire un peu forte, il donnait une impression de force et d’audace. À bord de la Sarcelle, il avait parfaitement rossé un matelot qui prétendait le brimer.
En voyant Klagendorf et W.-W. White fuir lâchement, le jeune Niçois ne s’était ni indigné, ni lamenté.
— Venez, m’sieur Sanard ! avait-il crié au savant. Je suis bon nageur : je vous soutiendrai !
Le chimiste avait voulu protester, refuser – mais les Canaques arrivaient. Javelines et casse-têtes au poing, ils venaient d’apparaître entre les bambous ; plusieurs avaient en bandoulière les grands arcs avec lesquels ils avaient envoyé leurs flèches.
Leur flair plutôt que leurs yeux leur avait fait découvrir les fugitifs. Ils poussaient des cris de triomphe, croyant bien que leurs proies ne pouvaient leur échapper.
— Baissez-vous, m’sieur Sanard ! cria le mousse en se jetant lui-même à plat ventre sur le sol détrempé.
Honoré Sanard l’imita de confiance, et apprécia aussitôt le conseil en entendant siffler au-dessus de lui une rafale de longues javelines à pointes d’os.
— Vite ! Venez ! fit le mousse en se redressant.
Il saisit la main du savant, et, rudement, le releva et l’entraîna vers la rivière.
Soufflant, titubant, trébuchant, Honoré Sanard réussit pourtant – comment ? il ne le sut jamais ! – à ne pas tomber. Il eut bientôt les pieds dans l’eau. Il avança encore, toujours traîné par le mousse. L’eau atteignit ses genoux, ses aisselles.
Il eut un haut-le-corps. Robert Lanni, qui ne l’avait pas lâché, lui fit, d’une secousse, perdre l’équilibre. Il se débattit, barbota, avala une ample rasade d’eau boueuse, et se crut perdu.
De fait, il s’enfonça. Mais il sentit qu’on le redressait. Il étendit en avant sa main libre et la referma sur le bras du mousse :
— Laissez-vous aller, m’sieur Sanard ! Vous ne risquez rien ! entendit-il.
Se laisser aller ? Transi, éperdu, le pauvre homme non seulement ne lâcha pas prise, mais resserra ses doigts sur le bras de Robert Lanni.
— Lâchez-moi ! Vous m’empêchez de nager !
Il ne lâcha pas et reçut sur le menton un vigoureux direct qui l’étourdit. Il ouvrit la bouche but, une nouvelle gorgée d’eau, et lâcha prise.
— Mettez la main sur mon épaule, et tenez bon, m’sieur Sanard ! fit le mousse qui l’avait immédiatement saisi par le col de son veston. Là ! Comme ça ! Et ne vous en faites pas !
Instinctivement, Honoré Sanard fit ce qui lui était commandé. Il n’était plus qu’une pauvre chose, un vieil homme sans force.
Le courant, cependant, entraînait le mousse et son protégé.
Robert Lanni, qui nageait comme un marsouin, eut bientôt gagné le milieu de la rivière.
L’obscurité, heureusement pour lui et le chimiste, était complète. Elle empêchait les Canaques massés sur la berge, entre les bambous, d’apercevoir leurs victimes. Ils lancèrent, au hasard, une nouvelle bordée de flèches et de zagaies à l’endroit où ils croyaient que se trouvaient les fugitifs – mais ceux-ci étaient déjà loin…
Honoré Sanard, s’il était poussif et maladroit, ne manquait pas de sang-froid. Il eut vite reconquis son calme et s’arrangea de façon à gêner le moins possible les mouvements du mousse.
Robert Lanni, ayant repéré, un des nombreux arbres déracinés par l’ouragan et que le courant emportait, tira sa coupe dans sa direction, et, non sans peine, parvint à s’accrocher à lui.
Sur son conseil, Honoré Sanard s’agrippa à une des grosses branches de la souche. Le mousse, libéré, grimpa sur l’arbre, se mit à cheval sur le tronc et aida le chimiste à le rejoindre, – ce qui ne fut ni aisé, ni rapide.
Après une longue demi-heure d’efforts surhumains, le chimiste fut enfin installé à califourchon sur une maîtresse branche, ses courtes jambes plongeant jusqu’aux mollets dans l’eau clapoteuse.
— Tu m’as sauvé la vie, petit ! Je ne l’oublierai pas ! déclara-t-il.
« Vois-tu, moi, je n’étais pas fait pour les voyages ! Pour une fois que ça m’arrive, ça ne me réussit pas !… Enfin, espérons que nous nous tirerons de là !
— Sûrement, qu’on s’en tirera, m’sieur Sanard ! affirma Robert Lanni, avec conviction.
— J’y compte, petit, parce que, vois-tu, il faut absolument que nous fassions connaître…
— … la façon dont ces deux dégoûtants nous ont abandonnés, hein, m’sieur Sanard !
— Non… oui… enfin, ce n’est pas de cela que je veux parler !… En tout cas, je me charge de toi, petit ! Tu iras à Paris avec moi, et je veillerai à ton avenir !
— Je vous remercie, m’sieur Sanard ; mais, vous savez, Paris… j’aime autant continuer à naviguer !
— Tu n’as pas tort ! Enfin, nous verrons ça ! Tu n’auras qu’à me laisser faire !
Honoré Sanard n’insista pas.
L’indignité de Klagendorf et de W.-W. White, il l’avait déjà oubliée. S’il pensait aux deux hommes, c’était au sujet du « grand catalyseur ». Il avait deviné les espérances secrètes des compères. Il comprenait qu’ils ne voyaient, dans cette sublime découverte, que l’occasion d’assouvir, l’un son appétit de gain, l’autre son ambition. Et, cela, il ne le fallait pas.
Comme il venait de le dire au mousse de la Sarcelle, c’était la première fois qu’il accomplissait un grand voyage.
Honoré Sanard, à soixante ans passés, n’avait guère quitté Paris. Si. Il était allé deux fois à Vincennes, pour participer à un Congrès de chimistes…
Mais Honoré Sanard avait un cousin. Ce cousin, Jacques Ledru, était banquier.
Un matin, Jacques Ledru avait pénétré dans le petit appartement du savant :
— Tu peux me rendre un immense service, Honoré ! avait-il déclaré. Et surtout, rendre un grand service à la science. (Jacques Ledru connaissait bien le chimiste ! Il savait qu’il mettait la science au-dessus de tout !) Écoute-moi avec attention !
« … L’agriculture manque de bras. Et il faut manger, pourtant !
« Alors, comme tu ne l’ignores pas, l’on supplée à la pénurie de main-d’œuvre en employant des machines agricoles et en augmentant le rendement de la terre par l’emploi des phosphates.
« Or, l’on vient de découvrir, non loin des îles des Amis, dans le Pacifique, tout un archipel qui est, pour ainsi dire, composé d’îles de phosphate presque pur.
« Cet archipel appartient à un Anglais avec qui je me suis associé. Mais il faut des fonds pour exploiter cette magnifique affaire !… Alors, j’ai mis l’affaire en société, et je lance prochainement les actions du Phosphate Austral, actions qui feront vite prime !
« Cependant, avant de commencer les travaux, d’acheter le matériel, de signer les contrats, je veux m’assurer que les phosphates en question sont tout à fait excellents.
« J’ai donc pensé à toi. Tu vas partir pour Suva, îles Fidji, où tu rencontreras M. Hutchinson, c’est le nom de mon Anglais, lequel te conduira aux gisements.
« Tu prendras des échantillons, des prélèvements, que tu examineras, que tu analyseras. Et tu reviendras ici pour me soumettre ton rapport, qui, j’y compte, sera concluant.
— Il me semble que tu devrais attendre ce rapport, avant de lancer ta société, Jacques ? avait fait observer Honoré Sanard.
— Time is money, mon cher Honoré. Il faut faire vite. Et, si l’on s’embarrassait de toutes ces formalités à la Bourse, on ne ferait rien !
« D’ailleurs, j’ai confiance en M. Hutchinson, et, si je te demande un rapport, c’est, pour ainsi dire, par acquit de conscience.
« … Et j’allais oublier de te dire que, naturellement, tous tes frais sont payés et qu’il te sera attribué cinquante parts de fondateur, lesquelles, j’en suis certain, atteindront vite de très hauts cours, nous y veillerons !
— Tu sais, ces questions d’argent me sont complètement indifférentes, Jacques ! Je préfère rester en France. Cherche un autre chimiste… Il n’en manque pas, et je t’en indiquerai, si tu le désires ! Je ne tiens pas du tout à aller voir les îles Fidji ! avait protesté le savant.
Mais Jacques Ledru était tenace et énergique. Et puis, ce qu’il ne disait pas, c’était que, dans le prospectus d’émission des actions du Phosphate Austral, il avait eu soin de mentionner que le grand chimiste Honoré Sanard, membre de l’institut, avait analysé les phosphates appartenant à la société et les avait trouvés parfaits. Ce qui devait encourager fortement les souscripteurs.
Après une longue discussion, le pauvre Honoré avait cédé.
Il était parti pour Marseille, avait pris le paquebot pour Sydney, où il s’était embarqué sur la Sarcelle à destination de Suva…
Pendant l’escale de la Sarcelle sur la côte de l’île d’Espirito-Santo, le savant avait eu la malencontreuse idée d’accompagner à terre le groupe de passagers comprenant notamment M. W.-W. White et sa femme, ainsi que M. Klagendorf.
Ce qui avait failli lui coûter la vie, et lui valait d’être, présentement, perché sur un arbre mort que le courant entraînait… Mais ce qui lui avait valu de découvrir le grand catalyseur !
« Ce brave Jacques, songeait-il, j’ai eu du flair d’accepter son offre ! Il ne se doute pas de ce qui m’arrive !
« Quel retentissement, lorsque je ferai ma communication à l’Académie des sciences !… La face du monde changée !… Le Catalyseur Sanard ! »
Dans son enthousiasme, le savant en oubliait presque sa critique situation, et les tourbillons de pluie qui lui fouettaient le visage, et l’eau boueuse dont les rafales, par moments, le couvraient.
— M’sieur Sanard ! La jambe ! Votre jambe droite ! Levez-la ! entendit-il.
Machinalement, il obéit – juste à temps pour éviter la gueule béante d’un énorme saurien, laquelle se referma comme un couvercle de malle.
— Mettez-vous là… ici ! fit le mousse en l’attirant vers la naissance des maîtresses branches de l’arbre. Vous serez tranquille et ne risquerez pas d’être boulotté !
Sans mot dire, le pauvre savant alla se nicher dans le creux que lui indiquait Robert Lanni, et se demanda mélancoliquement s’il vivrait assez pour faire sa sensationnelle communication.
Le courant augmentait d’intensité.
Par moments, de violents tourbillons faisaient pivoter, tournoyer la souche, qui menaçait de chavirer.
Robert Lanni, qui s’était placé non loin du savant, ne pouvait rien et le comprenait. Des yeux, il essayait de percer les ténèbres, dans l’espoir d’apercevoir enfin l’océan. Mais vainement…
Le vent, dont la force s’était encore accrue, soulevait l’eau de la rivière qui, mêlée à la pluie, formait un rideau opaque au sein duquel le tronc d’arbre oscillait, virevoltait, penchait, plongeait sans trêve.
Honoré Sanard et le mousse ne pouvaient même plus échanger un mot. Le fracas des éléments étouffait tout autre bruit.
Quelques minutes passèrent. La vitesse du courant était maintenant vertigineuse. Les fugitifs se sentaient entraînés en avant, aspirés par une force irrésistible. Ils comprenaient pourquoi les Canaques ne les avaient pas poursuivis sur l’eau : la rivière était coupée par une cataracte dans laquelle l’arbre qui leur servait de flotteur allait être broyé comme un fétu – et eux aussi.
Honoré Sanard songea au « grand catalyseur », dont l’existence allait rester inconnue, et ne serait peut-être jamais découverte.
Il eut soupir de regret, tourna la tête vers le jeune mousse que la pluie et les embruns l’empêchaient de voir et murmura – pour lui seul :
— Dommage ! Le pauvre petit !…
Un grondement, à peine perceptible, mais distinct de celui produit par l’ouragan, parvint à ses oreilles : il devina qu’il était produit par la cataracte. La fin était proche !
Et rien à faire, rien à tenter…
Le rugissement de la cataracte se rapprochait avec une rapidité toujours plus grande. Il s’intensifia bientôt au point de dominer le vacarme de la tempête. Le tronc d’arbre cessa de tournoyer : aspiré comme par une gigantesque pompe, il fila droit, sans une embardée, avec la rectitude d’une flèche.
Autour d’eux, Honoré Sanard et son jeune compagnon distinguèrent des ombres mouvantes – d’autres épaves accrochées, çà et là, à quelque pointe de roc ou échouées sur les hauts-fonds qui, de toutes parts, barraient la rivière.
Le bruit de la chute devint assourdissant. La souche, brusquement, pivota sur elle-même – et, à la même seconde, Robert Lanni et le savant sentirent qu’ils étaient précipités dans le vide…
VI LA LUTTE POUR LA VIE
Tombé de plus de trente mètres de hauteur, l’arbre sur lequel étaient accrochés Honoré Sanard et Robert Lanni alla s’abattre sur un des plateaux de roc contre lesquels s’écrasait la masse d’eau.
La chance des fugitifs voulut que la souche tombât sur les deux maîtresses branches où ils n’étaient pas, lesquelles maîtresses branches furent brisées net par l’effroyable secousse.
Robert Lanni et Honoré Sanard, à demi assommés par le choc, furent précipités dans l’eau bouillonnante.
Robert Lanni était un admirable nageur. Ainsi que beaucoup de gamins de son âge, à Nice, il avait souvent passé des journées entières dans l’eau. Son endurance était remarquable.
Après être resté étourdi pendant quelques secondes, et avoir bu abondamment, il revint à la surface, s’ébroua, cracha, renifla, souffla, se secoua – et pensa au vieux savant.
Autour de lui, ce n’étaient que chaos et ténèbres. Sous l’ondée que les rafales faisaient tourbillonner, la cataracte déversait sur les rocs d’énormes masses d’eau qui se transformaient instantanément en une écume blanche, phosphorescente. Et le grondement infernal de la chute empêchait de rien entendre.
Robert Lanni se sentit entraîner à une vitesse vertigineuse. Il comprit qu’il ne pouvait rien, qu’Honoré Sanard était perdu ; sa haine et son mépris pour Klagendorf et W.-W. White augmentèrent encore.
Un fort choc l’arrêta net. Il sentit une violente douleur à sa jambe gauche, celle qui avait été brûlée par le treuil quelques semaines auparavant. Devant lui, il distingua une masse noire : un rocher contre lequel le courant venait de le projeter.
L’instinct de la conservation lui fit étendre les mains en avant et refermer les doigts sur une saillie de la pierre. Il resta ainsi pendant une dizaine de secondes, à reprendre ses sens.
Le courant, excessivement violent, tendait à l’entraîner, à lui faire lâcher prise. Il tint bon, rassembla ses forces, et, après avoir failli être enlevé à plusieurs reprises, finit par atteindre le sommet du rocher, sur lequel il s’assit.
Il était complètement épuisé, et sa jambe le faisait beaucoup souffrir.
Il la tâta, sentit qu’elle saignait, mais qu’elle n’était pas brisée comme il l’avait craint. Son bras droit était également contusionné. Il le frotta – mais, presque aussitôt, se redressa : il lui avait semblé entendre un appel, tout proche de lui. Il écouta, frémissant. Rien que le grondement de la cataracte…
Pourtant, le mousse était certain d’avoir entendu appeler. Il se pencha dans la direction d’où il croyait qu’était parti l’appel – et ne vit rien que l’eau bouillonnante.
Il pensa que, décidément, il avait été victime d’une illusion, et se redressa.
À ce moment, l’appel retentit de nouveau… Cette fois, Robert Lanni fut certain d’avoir réellement entendu. Il regarda encore, courbé sous l’ondée, et ne vit rien. Il attendit, dans l’espoir d’entendre encore le cri.
Il ne fut pas déçu. Tout près de lui, il perçut un gémissement. Il crut reconnaître la voix d’Honoré Sanard !
Au risque de retomber dans la rivière bouillonnante, il se mit à plat ventre sur la roche, et se pencha en avant, jusqu’à ce que sa tête et son torse surplombassent le vide.
Parmi les tourbillons d’écume blanche, il lui sembla distinguer une tache noire. Il écarquilla les yeux et vit que la « tache » remuait.
Un nouveau cri parvint à ses oreilles. Pas de doute ! La « tache » noire, c’était, ce devait être, la tête de M. Sanard !
Le savant était sans doute cramponné à quelque rocher, à fleur d’eau ; n’ayant pas la force de chercher un refuge plus sûr, il clamait sa détresse.
Robert Lanni, de toute sa voix, cria :
— M’sieur Sanard ! C’est vous ?
Il ne reçut pas de réponse. La « tache » ne bougea pas. Si c’était le savant, il n’avait pas entendu – ce qui était tout naturel, la voix ayant tendance à monter et le vacarme des eaux couvrant à peu près tout autre bruit.
Le mousse le comprit. Il vit la « tache » s’agiter… Si c’était Honoré Sanard, peut-être faisait-il un suprême effort avant de lâcher prise et de périr…
Cette pensée décupla les forces du jeune garçon. Bravement, témérairement, il s’avança un peu plus au-dessus de l’onde écumante – et s’y laissa tomber, la tête en avant.
Il plongea à une très faible profondeur, – car un tourbillon, aussitôt, le saisit, – et revint presque immédiatement à la surface.
Il se rendit compte alors de son imprudence : impossible de remonter le courant. Un navire même ne l’eût pu.
En quelques instants, le mousse fut à plus de cent mètres du roc qui lui avait servi de refuge.
Il ne désespéra pas, pourtant, et imagina sur-le-champ un moyen de revenir en arrière : c’était d’atterrir, de suivre la rive dans le sens contraire au courant, et, une fois en amont du roc d’où il était parti, de se remettre à l’eau.
La violence du courant, les ténèbres, la pluie et la bourrasque rendaient ce projet presque irréalisable.
Le mousse n’y pensa pas. Semblable au Taciturne – dont il ignorait le nom et l’existence – il n’avait pas besoin d’espérer pour entreprendre…
Nageant avec la rage du désespoir, il parvint à avancer en suivant une ligne diagonale, et, en quelques minutes, eut pris pied sur un banc de sable parallèle à la berge.